Le Pays plat (Flatland) d’Edwin A. Abbott : aux habitants de l’espace, cette œuvre est dédiée, par Oscar Dassetto (07/03/2022)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Le Questionnaire d’Ernst von Salomon, ode à l’indépendance d’esprit, par Oscar Dassetto.
Le Questionnaire d’Ernst von Salomon, ode à l’indépendance d’esprit, par Oscar Dassetto.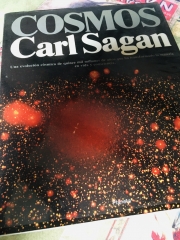 C'est au tout début des années 80 que je découvris, bien que fort indirectement, l'existence du Pays plat (Flatland) d’Edwin A. Abbott, mentionné dans l'ouvrage de Carl Sagan qui suivit la diffusion de sa remarquable série intitulée Cosmos, et que je dévorai alors dans sa traduction espagnole. Bien des années après cette découverte, je ne pouvais qu'ouvrir, pour la seconde fois, la Zone à Oscar Dassetto, et indiquer sa propre traduction à cette œuvre pour le moins étrange qu'est Flatland, toujours assez largement méconnue en France.
C'est au tout début des années 80 que je découvris, bien que fort indirectement, l'existence du Pays plat (Flatland) d’Edwin A. Abbott, mentionné dans l'ouvrage de Carl Sagan qui suivit la diffusion de sa remarquable série intitulée Cosmos, et que je dévorai alors dans sa traduction espagnole. Bien des années après cette découverte, je ne pouvais qu'ouvrir, pour la seconde fois, la Zone à Oscar Dassetto, et indiquer sa propre traduction à cette œuvre pour le moins étrange qu'est Flatland, toujours assez largement méconnue en France.Cette note s’appuie sur le texte original, en anglais, de la seconde édition du Pays plat («Flatland») et sur une traduction du roman en français réalisée par mes soins, accessible ici.
1. Présentation
 Edwin A. Abbott est né en 1838 à Londres. Il y meurt en 1926. Après de brillantes études – il excelle en lettres classiques, en mathématiques et en théologie à Cambridge – il prend la direction en 1865 de la City of London School, qui est alors une école indépendante pour garçons d’environ dix à dix-huit ans. Il quitte ce poste en 1889 et se consacre à la théologie et à l’écriture. Outre une biographie de Francis Bacon et une Grammaire de Shakespeare, il est l’auteur de romans religieux et de textes théologiques parus, pour la plupart, anonymement.
Edwin A. Abbott est né en 1838 à Londres. Il y meurt en 1926. Après de brillantes études – il excelle en lettres classiques, en mathématiques et en théologie à Cambridge – il prend la direction en 1865 de la City of London School, qui est alors une école indépendante pour garçons d’environ dix à dix-huit ans. Il quitte ce poste en 1889 et se consacre à la théologie et à l’écriture. Outre une biographie de Francis Bacon et une Grammaire de Shakespeare, il est l’auteur de romans religieux et de textes théologiques parus, pour la plupart, anonymement.C’est en 1884 qu’il publie sans doute son seul ouvrage à avoir connu le succès jusqu’à nous : Le Pays plat, sous le pseudonyme de «A. Square» [Un Carré].
Le texte original a fait l’objet de nombreuses éditions, pour certaines abondamment annotées et commentées, et de plusieurs traductions françaises professionnelles; ces dernières assez tardives, raison pour laquelle aucune n’est encore entrée dans le domaine public. Je propose pour ma part une traduction du Pays plat qui est, à ma connaissance, la plus récente accessible sur Internet sans restrictions : https://dassette.fr/livres/le-pays-plat/
Drôle d’ouvrage, bref mais non point famélique, le Pays plat est l’autobiographie fictive d’une figure géométrique, un Carré, originaire du bien nommé Pays plat en deux dimensions.
Le roman comporte deux parties. La première (Ce monde-ci) est une étude méthodique du Pays plat : climat, architecture, Histoire, condition des femmes (toutes des Lignes droites), classes sociales (prolétariat d’Isocèles, classe moyenne de Triangles équilatéraux, bourgeoisie de Carrés et de Pentagones, et noblesse de Polygones jusqu’au rang suprême de Cercle), régime politique ou encore embarras pratiques de la vision et du toucher dans un univers plan.
La seconde partie (D’autres mondes) relate pour l’essentiel les événements tragiques, antérieurs de quelques années à la publication du roman, au cours desquels les autres dimensions ont été révélées au narrateur Carré, et l’ont conduit à rédiger ses mémoires. L’irruption au Pays plat d’une Sphère provenant du Pays de l’espace (en trois dimensions) constitue, selon le Carré, «l’événement central de ce livre, [son] initiation aux mystères de l’espace» (chap. 11). De fait, cette seconde partie a une portée bien plus nettement philosophique et métaphysique. Elle tient même de l’expérience de pensée, avec comme une couleur, une nuance platonicienne du texte, alors que le Carré découvre successivement le Pays linéaire, le Pays de l’espace, le Pays point, envisage des mondes au-delà de trois dimensions, et se heurte au problème de dimensions supérieures à la sienne et inconnaissables : c’est-à-dire très exactement au problème de la transcendance. Le roman s’achève sur les réflexions découragées du Carré, présentées comme contemporaines de la publication du roman dans «notre» monde.
On manquera difficilement de voir une actualisation du mythe de la caverne dans ce témoignage d’un revenant, qui a visité des territoires aux autres défendus et n’en tire au milieu de ses semblables que du mépris et de la solitude.
La première partie est destinée à documenter, pour d’autres humanités dans d’autres dimensions (nous dans la nôtre, par exemple), l’existence d’un Pays plat auquel le Carré, malgré les vexations dont il fait l’expérience, demeure inextricablement attaché. La seconde a pour objet de susciter chez d’autres une épiphanie semblable à celle dont le narrateur fait l’expérience, épiphanie mélancolique où le sentencieux «Je sais que je ne sais rien», plutôt qu’un prélude à la connaissance, semble devenir son seul horizon.
1.1. Figures géométriques, quelles sont vos mœurs ?
 La première partie du Pays plat emprunte à l’histoire naturelle, à la géographie, à l’anthropologie, à l’Histoire pour brosser le paysage de cette contrée inconnue. L’époque contemporaine d’Edwin A. Abbott forme à de fréquents endroits le sous-texte évident du roman. Il est question de gentry et de gentlemen, les mœurs y sont étrangement anglicanes, le système éducatif rappelle curieusement celui mis en place par un certain Elementary Education Act en 1870, le narrateur (un Carré du Pays plat !) connaît fort bien Shakespeare, quand il ne cite pas carrément le magazine The Spectator… Abbott évoque la situation des masses Isocèles pratiquement dépourvues de droits, les structures sociales rigides qui, en restreignant l’accès du plus grand nombre et notamment des femmes à l’éducation, limitent le progrès, ou encore le conservatisme d’une élite de Cercles qui concentre pouvoirs temporel et spirituel pour régner sans partage sur le Pays plat. C’est une société de castes où Edwin A. Abbott condamne violemment, mais adroitement, la tentation coupable et intéressée du quiétisme pour les privilégiés. Cependant, le Pays plat n’a rien d’un fascicule sociologisant. Abbott fait preuve de bien plus d’habileté didactique : «Il y a environ trois cents ans, il fut décrété par le Cercle en chef que les femmes, puisqu’elles manquent de raison et regorgent d’émotion, ne devaient plus être considérées comme rationnelles, ni recevoir aucune éducation intellectuelle. […] Ma crainte est que cette politique, avec les meilleures intentions, ait été menée si loin qu’elle se retourne contre le sexe masculin» (chap. 12).
La première partie du Pays plat emprunte à l’histoire naturelle, à la géographie, à l’anthropologie, à l’Histoire pour brosser le paysage de cette contrée inconnue. L’époque contemporaine d’Edwin A. Abbott forme à de fréquents endroits le sous-texte évident du roman. Il est question de gentry et de gentlemen, les mœurs y sont étrangement anglicanes, le système éducatif rappelle curieusement celui mis en place par un certain Elementary Education Act en 1870, le narrateur (un Carré du Pays plat !) connaît fort bien Shakespeare, quand il ne cite pas carrément le magazine The Spectator… Abbott évoque la situation des masses Isocèles pratiquement dépourvues de droits, les structures sociales rigides qui, en restreignant l’accès du plus grand nombre et notamment des femmes à l’éducation, limitent le progrès, ou encore le conservatisme d’une élite de Cercles qui concentre pouvoirs temporel et spirituel pour régner sans partage sur le Pays plat. C’est une société de castes où Edwin A. Abbott condamne violemment, mais adroitement, la tentation coupable et intéressée du quiétisme pour les privilégiés. Cependant, le Pays plat n’a rien d’un fascicule sociologisant. Abbott fait preuve de bien plus d’habileté didactique : «Il y a environ trois cents ans, il fut décrété par le Cercle en chef que les femmes, puisqu’elles manquent de raison et regorgent d’émotion, ne devaient plus être considérées comme rationnelles, ni recevoir aucune éducation intellectuelle. […] Ma crainte est que cette politique, avec les meilleures intentions, ait été menée si loin qu’elle se retourne contre le sexe masculin» (chap. 12).Abbott «toilette» ainsi, non sans sarcasme, plusieurs idées progressistes pour les présenter sous un jour conservateur, bénéfique au maintien du statu quo. De même, il a parfois recours au raisonnement par l’absurde ou à un cynisme mordant pour évoquer le sort des masses laborieuses prises dans le rouleau-compresseur de son dix-neuvième siècle industrieux, à travers la condition des Isocèles, Triangles que leur base étroite range dans la catégorie des Figures irrégulières (par opposition aux Équilatéraux), et qui sont largement tenus pour idiots et violents. Le mépris qu’on leur porte est tel qu’on les emploie dans les écoles où, enchaînés, ils servent de «spécimens» aux enfants qui les manipulent pour s’exercer à mesurer des angles au toucher. Abbott écrit alors : «Dans certains États, les spécimens sont nourris à l’occasion et on tolère leur existence plusieurs années durant; mais dans les régions plus tempérées et mieux gouvernées, on s’aperçoit en fin de compte qu’il est plus conforme à l’intérêt éducatif des jeunes de faire l’économie de la nourriture et de renouveler les spécimens chaque mois — ce qui est à peu près l’espérance de vie à jeun dans la classe criminelle» (chap. 5).
On retrouve ailleurs cet humour grinçant et discret. Notre Carré juge ainsi que «la vie peut être assez monotone au Pays plat» mais doit reconnaître qu’il y a «naturellement des batailles, des complots, des troubles, des factions et puis tous ces phénomènes qui sont censés rendre l’Histoire intéressante», renversant ainsi avec ironie la causalité de la violence qui aurait l’attrait historique et le divertissement pour finalité.
 Ce sont donc aussi des questions parfois fort difficiles, et dont on sent bien qu’elles agitent ce siècle, qui sont soulevées; l'eugénisme au premier chef.
Ce sont donc aussi des questions parfois fort difficiles, et dont on sent bien qu’elles agitent ce siècle, qui sont soulevées; l'eugénisme au premier chef.Le lecteur sera surpris, à l’issue de cette première partie (qui compte douze chapitres mais guère plus d’une cinquantaine de pages) par l’amplitude que donne Abbott à son Pays plat avec une pareille économie. La variété des sujets évoqués, pourtant sans légèreté, et divers «effets d’abondance» (prétéritions, énumérations, litotes…) installent un univers d’une richesse inouïe et d’une complexité insoupçonnée. Comme l’annonce Abbott à demi-mot dès sa préface, tout n’y est pas transposition de son époque victorienne : de nombreux détails, de nombreuses anecdotes, relèvent d’une jubilation sincère de l’auteur devant la fiction et les possibilités purement intellectuelles offertes par l’expérience d’un monde en deux dimensions. Ainsi les problèmes géométriques, mathématiques ou physiques que rencontrent nos Figures pour se reconnaître, s’orienter ou éviter tout simplement de se blesser (chap. 5 et 6), ou la place accordée à l’art (chap. 8 à 10).
1.2. «Ô vaillants nouveaux mondes, qui portent en eux de tels peuples !»
C’est sur cette citation délibérément déformée (voir la troisième partie de cette note) de la Tempête, de Shakespeare, que s’ouvre la seconde partie. De même que la première partie n’a rien d’un austère catalogue, la seconde n’est pas un kyste à prétention philosophique enchâssé à grand-peine; non, fort heureusement, l’œuvre Edwin A. Abbott a sans doute quelques défauts mais pas ceux que l’on rencontre à l’occasion dans la littérature française du vingt-et-unième siècle. Il y a au contraire dans le Pays plat une intrication extrême et délicate des sujets et des procédés.
Dans la seconde partie, c’est l’irruption d’une Sphère tridimensionnelle dans un monde plat qui fournit le prétexte narratif aux expériences métaphysiques de notre Carré.
Avant cela, le Carré découvre en premier lieu, en rêve, le Pays linéaire. Un monde unidimensionnel dont les habitants se rangent le long d’une seule et même ligne droite. Le Carré se heurte alors à l’impossible tâche de rendre intelligible, pour le Monarque de ce royaume linéaire, l’existence d’un Pays plat en deux dimensions. Devant l’obstination du souverain à nier cette réalité, la frustration grandit et la discussion dégénère. Le Carré en est réduit aux insultes : «Sotte créature ! Vous croyez être la perfection incarnée, tandis qu’en réalité vous êtes le plus imparfait des imbéciles» (chap. 14) et se réveille en sursaut alors que toute l’armée du Pays linéaire le menace. Prélude cruel à l’événement qui se profile, bien réel lui : l’apparition d’un être en trois dimensions, une Sphère venue du Pays de l’espace – et à laquelle, malgré l’issue calamiteuse de sa propre épopée onirique au Pays linéaire, le narrateur Carré témoignera de la défiance et de l’hostilité : «“Monstre”, hurlai-je, “que tu sois saltimbanque, enchanteur, rêve ou diable, je n’endurerai pas davantage tes railleries. L’un de nous doit périr.” Et à ces mots, je me ruai sur lui» (chap. 16).
Il ne se laissera convaincre que lorsque la Sphère l’arrachera physiquement au Pays plat pour lui permettre de faire l’expérience du Pays de l’espace. Le Carré se laisse alors embarquer dans une épopée très dickensienne qui le mènera jusqu’au Pays point (le pays à nulle dimension).
Au terme de cette épopée, le Carré se voit assigner la mission d’évangéliser ses pairs et de leur faire accepter l’existence de dimensions insoupçonnées. Une tâche ingrate, vouée à l’échec, et qui conduit notre narrateur en prison où il rédigera ses mémoires – ceux-là même que nous avons entre les mains – et finira ses jours.
Pour finir, deux éléments formels rendent compte avec limpidité de ce qui sous-tend chacune de ces deux parties.
C’est dans la première que l’on retrouve, dans une note de bas de page présentée par notre narrateur Carré comme une vague allusion à quelque chose dont il aurait eu connaissance lors de son séjour au Pays de l’espace, une référence à un article du magazine The Spectator daté de 1884, année de la parution du roman. Seule note, et même seul élément de tout Le Pays plat qui fasse explicitement référence à la réalité contemporaine de l’auteur, elle trahit (ou confirme) la satire sociale et la portée contemporaine du récit.
Le second élément, très évocateur, lui, de ce qu’est dans son essence la seconde partie du roman, nous est donné par les dialogues. Absents de la première partie, ils deviennent soudain omniprésents (pour ainsi dire la quasi-totalité des chapitres 13-14 et 16 à 19, soit 6 sur les 10 que compte la seconde partie) et sont pour certains mis en page comme du théâtre avec d’authentiques didascalies nominatives (chaque personnage identifié avant sa réplique) énonciatives («à lui-même», «après une pause») et mélodiques («avec humeur»). Une disposition qui peut rappeler les dialogues platoniciens, et la filiation de ce texte avec la matrice philosophique occidentale.
On relèvera aussi, dès le sommaire, les intitulés des chapitres : ceux de la première partie sont essentiellement descriptifs («Concernant…», «De…») et traduisent sa vocation documentaire ou analytique; alors que pratiquement tous les intitulés de la seconde partie portent sur une action («Comment j’essayai…», «Comment je vins…») et traduisent, précisément, sa dimension expérimentale, ce dont il est bel et bien question, quand bien même s’agirait-il d’une expérience de pensée.
2. Un conte métaphysique et didactique
La seconde partie du roman renferme sa matière peut-être la plus universelle : une authentique aventure métaphysique. Dans cette trame serrée, le Carré explore des dimensions dont il niait l’existence jusqu’à la folie, malgré l’évidence mathématique qu’il avait sous les yeux; il découvre que l’édifice du savoir tient à peu de choses; il constate que l’univers est vastement superstitieux sitôt que l’on rencontre un être pourvu des attributs que l’on donnait à Dieu; il est témoin de l’ignorance béate et fait l’expérience d’un abattement profond où le plongent ses propres découvertes.
2.1. Ce que savoir doit à croire
Le narrateur Carré fait d’abord l’expérience, en songe, d’une dimension «linéaire» (le bien nommé Pays linéaire) ne comportant qu’une dimension de longueur. Par la suite, il reçoit la visite, bien réelle cette fois-ci, d’une Sphère tout droit venue du Pays de l’espace qui comporte, lui, trois dimensions : de longueur, de largeur et de hauteur. À l’issue d’un périple dans ce monde où tout est volume, le Carré retrouve son plan natal. Il y rencontre une dernière fois la Sphère qui lui rend visite en songe. Elle l’entraîne alors au Pays point, le pays à nulle dimension, et lui confirme avoir découvert entre-temps l’existence d’autres pays aux dimensions plus nombreuses encore que trois.
Ce qui se joue d’abord ici, lorsque le narrateur (chapitres 13 et 14) cherche à expliquer en vain la nature d’un pays en deux dimensions au roi du Pays linéaire, c’est l’incommunicabilité de cette réalité donnée à voir contre l’ordre des choses, par un effet du sort. Cette incommunicabilité se traduit très simplement en termes géométriques : sitôt que le narrateur Carré pénètre au Pays linéaire, il n’existe qu’en tant que ligne. Tout ce qui est extérieur à cette ligne, qui seule occupe une portion d’espace linéaire, est invisible et pour tout dire inexistant aux yeux des habitants linéaires, qui sont contraints, comme tout un chacun, par les lois physiques de leur univers. De ce fait, le Carré ne peut pas apparaître autrement que comme une ligne, il ne peut en aucun cas faire valoir dans le monde sensible son altérité : «Ce royaume linéaire n’avait pas assez de dimensions pour me représenter en entier» (chapitre 16).
Or le discours montre lui-aussi très vite ses limites. Le motif se répète : confronté à un visiteur venu d’une dimension supérieure, qui se prétend Sphère mais ne peut se montrer autrement que comme un Cercle dans un monde en deux dimensions, confronté à ce visiteur donc, le Carré fait à son tour l’expérience d’une «dissonance cognitive majeure», pour le dire en termes contemporains, qui se traduit par un rejet violent et un puissant désir d'annihilation de l’intrus porteur d’une vérité aussi cruellement inaudible; intrus qu’il était lui-même, aux yeux des habitants du Pays linéaire quelques heures plus tôt.
Et une fois encore, lorsqu’il est emmené dans la troisième dimension et que, brutalement enivré par cette découverte, il se laisse aller dans un moment de grande fébrilité à imaginer d’exotiques pays à quatre, cinq, six dimensions et davantage, son guide dans la troisième dimension, la Sphère, s’indigne à son tour et rejette en bloc l’idée de dimensions supérieures à la sienne, répétant l’erreur du roi du Pays linéaire à l’annonce de la deuxième dimension, puis du Carré à l’annonce de la troisième. Même événement répété et même arrogance, même dédain renouvelé d’une dimension à l’autre.
Cet échec n’est même pas celui de la logique, ni même une faillite intrinsèque du langage. Le chapitre 15, où la Sphère se présente au Carré, s’ouvre sur une anecdote : le narrateur raconte comment son jeune petit-fils, un hexagone, a soudain l’intuition confuse et naïve d’une dimension supérieure au cours d’une leçon de géométrie. Constatant qu’un carré n’est rien d’autre, en termes mathématiques, que le carré d’une ligne, il se demande quelle est l’apparence géométrique d’une ligne à la puissance 3. «La géométrie n’a que deux dimensions» (chap. 15), lui rétorque le Carré, éteignant d’un coup l’espoir que la connaissance mathématique, peu importe sa sophistication, soit le moyen de faire la lumière sur une réalité à ce point «autre» et contre-intuitive que celle d’une nouvelle dimension. Le Pays plat dispose de tous les outils intellectuels nécessaires pour concevoir l’existence d’une troisième dimension, du cube en l’occurrence, mais rejette leurs résultats tout à la fois.
Faillite des moyens ? Non : à un plus haut degré, impossibilité des fins. La réception mise en échec par l’Homme tel qu’il est fait, question platonicienne par excellence, est un spectre qui hante le roman dès sa préface, où Abbott soulève à demi-mots la question : «Il [l’auteur] espère que son œuvre, prise dans son ensemble, se révélera à la fois stimulante et divertissante pour ces habitants du Pays de l’espace au caractère raisonnable et humble, qui – à propos de ce qui est de la plus haute importance mais qui échappe aux sens – refusent d’affirmer d’une part “Ceci ne peut pas exister” et d’autre part “Il doit en être exactement ainsi, et nous savons tout ce qu’il faut savoir.”« Deux mises en garde, l’une contre une vision étriquée, amputée de toute aspiration, et l’autre contre une «demi-habileté» bigote, qui n’en forment au fond qu’une seule contre la fatuité.
S’il est certes question de s’arracher à l’horizon immédiat des sens, c’est précisément l’expérience d’une dimension supérieure qui parvient à convaincre le Carré; non pas la parole ni les instruments mathématiques, non pas la science, mais bien les sens. C’est ici que la portée métaphorique du Pays plat joue à plein, car cette expérimentation prend un tour bien singulier : elle se fait en songe ou avec l’aide d’une entité supérieure, seule capable d’ouvrir les portes d’une dimension inconnue. Abbott explore une troisième voie, voie médiane entre les «sens» et la «connaissance», exploration surnaturelle, initiatique, à la croisée de la foi et du culte des Mystères. Constat que le Carré formule ainsi : «Même moi – moi qui me suis rendu au Pays de l’espace et qui ai eu pendant vingt-quatre heures le privilège de comprendre la signification de “hauteur” – même moi, je ne peux la concevoir aujourd’hui, ni la saisir par le sens de la vue ou par un quelconque raisonnement; je ne peux l’appréhender que par la foi» (Préface).
Constat désenchanté d’un narrateur qui en est réduit à la foi et à une mystique du désespoir, Le Pays plat porte en lui l’inquiétude profonde de l’Homme abandonné des dieux, celle du pasteur chargé de lourdes vérités mais bien seul au moment de prêcher. Et dans cette nuit obscure, l’Homme rendu à son humilité doit se résoudre, ou bien au nihilisme, ou bien à la foi.
Cette foi ne lui vient pas de ses découvertes scientifiques, ce n’est pas le raffinement de ses outils mathématiques qui l’a conduit à acquérir la foi, mais plutôt cette dernière qui lui a révélé à quel point leur enseignement était d’ampleur. Croire et savoir apparaissent alors indissociables. Au fond, dit Abbott, y a-t-il encore une possibilité de connaissance sans croyance ? Le savoir peut-il se construire à force de tâtonnement dans l’obscurité relativiste plutôt qu’en suivant la voie, pas toujours fructueuse mais résolue, d’une conviction intérieure ?
2.2. Des dieux de droit humain
De dieux, il est bien question dans Le Pays plat. Ainsi le Carré, arraché à son plan natal et l'apercevant maintenant depuis les hauteurs de la troisième dimension, ne sait plus lequel vénérer : «Ébahi à la vue des mystères de la Terre, ainsi révélés à mon œil indigne, je dis à mon compagnon, “Regardez, je suis devenu comme un dieu. Car les sages dans notre pays disent que de voir toute chose, l’omnividence selon leur propre terme, est l’attribut de Dieu seul.” Il y avait une pointe de dédain dans la voix de mon professeur quand il formula sa réponse : “Est-ce bien le cas ? Eh bien vos hommes sages doivent vénérer jusqu’aux pickpockets et aux assassins de mon pays à l’égal des dieux : car il n’est pas un seul d’entre eux qui ne voie tout ce que vous voyez maintenant. Non, croyez-moi, vos sages se trompent”» (chapitre 18).
Le Carré se voit subitement rappelé à l’ordre : dans la troisième dimension, le dernier des idiots a accès à un ordre de la réalité bien supérieur à celui des savants parmi les savants de la deuxième dimension.
Deux chapitres plus loin, le Carré, après avoir visité le Pays linéaire et après avoir montré les plus violentes réticences à l’annonce d’une troisième dimension, fait l’ultime expérience, guidé par la Sphère, d’un Pays point qui ne comporte aucune dimension. C’est littéralement un point. Sans longueur, sans largeur, sans profondeur, sans aucune dimension de l’espace. C’est un point peuplé de lui-même, un être total et béat, d’une finitude parfaite. Le narrateur Carré constate sa suprême félicité, son état d’extase éternelle, il est tout plein de lui-même, parle de lui-même à la troisième personne car il n’y pas de frontière entre son intériorité et son extériorité, il ne peut rien concevoir en dehors de lui-même : «“Il remplit tout l’espace”, poursuivit la petite créature tout à son soliloque, “et ce qu’Il remplit, Il est. Ce qu’Il pense, c’est ce qu’Il énonce; et ce qu’Il énonce, c’est ce qu’Il entend; et Il est Lui-même Penseur, Orateur, Auditoire, Pensée, Verbe, Audition : Il est l’Unique, et aussi le Tout dans le Tout. Ah, quel bonheur, ah, quel bonheur que d’être !”» (chapitre 20).
La Sphère s’adresse alors au Carré : «“Abandonnons ce dieu du Pays point à la fructuosité ignorante de son omniprésence et de son omniscience : rien de ce que toi ou moi pouvons faire ne peut le sauver de son autosatisfaction.”»
Ce dieu-point, qui occupe le niveau le plus bas dans la hiérarchie des dimensions, incarne à merveille «l’animal immortel et bienheureux» contre lequel met en garde Épicure dans sa Lettre à Ménécée, car le sort des Hommes ne peut lui être qu’indifférent.
Mais que sont, au juste, ces dieux sitôt nommés qu’ils sont réduits à l’impuissance, dépassés par de simples humains ? Un dieu n’est-il rien d’autre que ce qui, appartenant à un monde supérieur, échappe au monde inférieur ? S’il existe une infinité de mondes, emboîtés comme des poupées russes, les dieux sont-ils à leur tour infiniment nombreux et divers ? Les dieux ont-ils leurs propres dieux ?
Tout se joue dans le contraste entre le Pays point, à la fois être total et pays à nulle dimension, et la condition du narrateur Carré dans la fin du roman; contraste qui constitue, selon moi, l’un des joyaux du Pays plat.
Car à l’inverse de notre dieu-point, le Carré, foudroyé par la connaissance des mondes qui échappaient à sa conscience, mais incapable de la transmettre à ses contemporains, sombre dans la mélancolie. Il finit ses jours en prison au Pays plat, où son «évangile des trois dimensions» n’est pas reçu autrement que comme les divagations vaguement menaçantes d’un fou. Une très petite élite, initiée, ou plus exactement mise en garde, soupçonne bien l’ampleur de cette réalité qui lui échappe. Mais jalouse de sa suprématie politique et spirituelle, et redoutant qu’une telle révélation ne pousse le Pays plat dans le chaos, elle réprime durement toute marque d’intérêt à son égard.
Dans Le Pays plat, le sacré et le divin se dissipent à mesure que l’on s'élève dans la hiérarchie des dimensions. Le seul Dieu véritable, le seul être omnipotent et omniscient, mais dans les limites étriquées de son univers, c’est le Dieu du Pays point, un Dieu si dérisoire qu’on peut le contempler sous une loupe et en tirer du mépris; ailleurs, tout est relativiste. Dire cela, c’est mettre le doigt sur la tension à l’œuvre dans le roman entre l’espoir d’une transcendance et le constat désolé d’un monde qui, dans toutes les directions de l’expérience sensible, n’a que contingence à offrir.
Œuvre anti-nihiliste mais aussi profondément inquiète, Le Pays plat est un conte moral d’une précision métaphorique et didactique extraordinaire, et d’une ampleur spirituelle et philosophique saisissante, qui se double d’une virtuosité littéraire certaine.
3. Un enfant bien constitué de la littérature
3.1. Art didactique
Si Le Pays plat a bien parmi ses objets l’épistémologie et la transmission du savoir, avec un humour parfois grinçant – quand il est par exemple question des «spécimens» de Triangles sacrifiés dans les écoles pour permettre aux jeunes enfants du Pays plat d’apprendre à reconnaître les angles – le roman fait preuve en lui-même d’un intense effort pédagogique. C’est une nécessité compte tenu du degré d’abstraction du sujet que s’est choisi Abbott, dont l’inclination académique fait en ce domaine des merveilles.
Dans cet effort argumentatif de tous les instants, Le Pays plat regorge d’artifices pédagogiques, d’une telle variété et avec une telle exhaustivité qu’il pourrait quasiment faire office de Bible en la matière. On y retrouve pêle-mêle exemples («Un exemple vaudra mieux qu’un long discours pour éclairer mon propos», chapitre 6), métaphores, analogies, expériences («Posez un penny sur l’une de vos tables dans l’espace, au centre; penchez-vous ensuite au-dessus et regardez-le d’en haut.», chapitre 1), schémas («comme dans l’illustration présentée», chapitre 2), répétitions, comparaisons, questions rhétoriques («Dès lors, comment distinguer une chose d’une autre quand toutes apparaissent identiques ? La réponse tient en trois points.», chapitre 5), problèmes énoncés comme dans n’importe quel manuel de mathématiques, introduction progressive d’un lexique savant («une forme à cinq côtés, ou pentagonale», chapitre 2)…
Abbott s’est montré soigneux, quasiment pointilleux, en ne faisant l’économie d’aucune explication; obsession qui s’est traduit naturellement par une abondance de prépositions, de connecteurs logiques, et un sens de la nuance qui s’épanouit à merveille dans l’usage des adverbes.
Certains verront dans ce style qui aspire à la clarté un peu docte d’un instituteur une certaine austérité. Quoi de plus normal pour un Carré érudit, qui aspire avec tout l’aplomb de sa caste à faire découvrir la subtilité d’un pays plat à des êtres qui en ignorent tout ?
Ce serait méconnaître le talent investi dans ce roman qui emprunte tantôt à l’histoire naturelle, tantôt à la philosophie, pour aboutir à une œuvre originale, à la fois roman d’aventures, précis scientifique, essai métaphysique et, à mon sens, chef d’œuvre de la littérature.
3.2. L’estompement, horizon littéraire
J’appellerai ici «estompement», ou «effet d’estompement», l’effet produit par l’atténuation des seuils successivement rencontrés par le lecteur entre son référentiel et celui de la fiction. Il ne s’agit pas, comme le désigne et le théorise Roland Barthes sous le nom «d’effet de réel», d’établir l’illusion d’une fiction qui serait, dans sa quête de vraisemblable, un décalque parfait de la réalité. Dans le cas du Pays plat – dont Abbott réitère au contraire la nature fictive avec tant d’insistance que son projet tout entier pourrait s’apparenter à une prétérition – ce qui importe n’est pas tant d’asseoir la vraisemblance de l’œuvre que de conduire le lecteur à réévaluer son référentiel.
Schématiquement, l’effet de réel consiste à asséner avec force : «Ceci est vraisemblable; ce que vous lisez, c’est ce qui est» tandis que l’effet d’estompement demande : «Qu’est-ce qui est vraisemblable ?» L’effet de réel est l’arme des naturalistes, l’estompement celle des mystiques et des conteurs. L’effet de réel cherche à donner l’illusion d’une conformité par rapport à un référentiel, l’estompement cherche à le subvertir. L’estompement, c’est un embranchement caché vers une autre réalité. Il amplifie la portée de cette «suspension consentie de l’incrédulité» qui fait droit à l’invraisemblance congénitale de toute fiction.
Cet estompement se manifeste avec clarté dans trois occurrences particulières : les citations, la préface et les diagrammes. Ces éléments ont ceci de commun qu’ils sont d’une certaine façon étrangers à la pure matière du texte littéraire. La préface l’introduit sans en faire tout à fait partie, les citations sont des emprunts, les schémas ne sont pas du discours mais de l’image.
Et de fait l’étrangeté, ou plus exactement (mais c’est un peu néologique) «l’étrangèreté» cultivée par Abbott concourt singulièrement à cet estompement. Les citations auxquelles il a recours ne sont jamais attribuées, ni situées, et sont même délibérément quoique subtilement altérées.
Dans la préface, une citation de la tragédie de Shakespeare Troilus et Cressida, («Un trait de la nature apparente le monde entier») devient ainsi : «Un trait de la nature apparente tous les mondes», et en ouverture de la partie II, c’est une citation de la tragédie La Tempête («Ô vaillant nouveau monde / Qui porte en lui un tel peuple !» dans le texte original) qui devient sous la plume d’Abbott : «Ô vaillants nouveaux mondes / Qui portent en eux de tels peuples !».
Les pluriels ainsi introduits par Abbott – qui sont légitimes d’un point de vue narratif puisqu’il est vraisemblable que le narrateur Carré n’ait de nos auteurs qu’une connaissance imparfaite, et qui illustrent à merveille les enjeux multidimensionnels du Pays plat – brouillent imperceptiblement le cadre de référence du lecteur. Une subtile altération du réel suffit ainsi à donner l’illusion d’un pont entre l’œuvre de fiction et le réel. Le lecteur, lisant ces quelques vers célèbres de Shakespeare sans en avoir le souvenir exact, mais sentant bien qu’il a sous les yeux quelque chose de familier (ce d’autant que le public d’Abbott au moment de rédiger son roman est lettré), tisse naïvement un fil entre les chefs d’œuvre du poète et le propos du Pays plat, et développe ainsi de lui-même, par le jeu propre de sa pensée, un réseau apparemment cohérent mais profondément subversif.
On peut dresser un parallèle entre ce mécanisme et celui employé par Stendhal en tête de chacun des chapitres de la Chartreuse de Parme, où figurent des citations parfois complètement fantaisistes. Celles-ci s’apparentent à du paratexte, qui ne s'inscriraient pas tout à fait dans le roman mais auraient le rôle d’amarres veillant à ce que la fiction ne s’éloigne pas trop du quai. Or ces éléments, qui semblent constituer un lien, sont en réalité mensongers (tant chez Abbott que chez Stendhal) puisqu’ils ne font que donner l’illusion d’une passerelle vers la réalité qui conduit en fait tout droit à l’illusion romanesque. C’est bien une amarre, mais il n’y a point de quai au bout; et ce qui semble être un quai, c’est encore le vaisseau de la fiction.
La préface constitue elle aussi une amarre de ce genre. Elle fait son apparition dans la seconde édition du texte. Introduite comme «De l’éditeur», elle a pour objet de répondre à certaines critiques formulées à l’encontre de la première édition de l’ouvrage. Or, l’éditeur en question se présente comme un ami du Carré-narrateur, publiant à sa demande ses mémoires dans notre dimension. On comprend donc que cette préface est fictionnelle (quoiqu’elle permette à l’auteur de répondre à des critiques bien réelles) et qu’elle se rattache de plein droit au roman. Mais ici encore, Abbott simule une connivence avec un référentiel réel, étranger à la fiction, en l’occurrence l’éditeur bien tangible du roman, et semble lancer une amarre qui se rattache en fait à la fiction elle-même. Cette préface joue un rôle important dans l’estompement en ce qu’elle subvertit le cadre de référence du lecteur et concourt à lui rendre vraisemblable l’idée qu’une Figure géométrique en deux dimensions puisse avoir composé et publié des mémoires. Mais cette illusion repose sur un équilibre subtil, et si l’estompement est opérant, c’est parce que le narrateur fictionnel de cette préface traite de la fiction elle-même; c’est parce que ce qui a toutes les apparences du paratexte est en fait métafictionnel.
Enfin, dernier ressort de cet estompement dont il sera question ici : les diagrammes qui illustrent Le Pays plat. Ils occupent une place qui les distingue des illustrations que l’on trouve couramment dans les œuvres de fiction (tout registre confondu, de Dickens à Balzac jusqu’aux romans pour «jeunesse» contemporains, en particulier fantastiques, où la présence d’une carte imaginaire est un exercice convenu) parce qu’ils singent les diagrammes des ouvrages scientifiques. Ici, les diagrammes ne se contentent pas d’illustrer le récit. Ils ne s’inscrivent pas dans une juxtaposition, somme toute arbitraire, de texte et d’images : parce que le narrateur s’y reporte explicitement, ils font partie intégrante du récit. Pour prendre conscience de l’intrication des images et du récit, on peut songer à ceci : il est tout à fait possible d’éditer Balzac, ou Dickens, ou l’immense majorité des romans illustrés sans leurs illustrations d’origine, d’autant plus que ces illustrations peuvent être un fait du prince de l’éditeur, et sont rarement de la main de l’auteur. Le livre qui en résulterait perdrait peut-être de sa richesse, mais le récit, le roman, la matière littéraire en elle-même ne se verrait pas amputée d’un iota. Au contraire, tout lecteur du Pays plat qui aurait entre les mains une édition non-illustrée serait déboussolé par ce narrateur l’invitant à se reporter dans le texte à quelque chose qui ne s’y trouve pas; comme si une publication scientifique renvoyait à une figure x ou y dont on aurait fait l’économie pour ne garder que le seul texte. Abbott illustre Le Pays plat exactement comme un naturaliste illustrerait le récit de ses découvertes. Et ces illustrations contribuent à l’estompement en ce qu’elles subvertissent la présomption de loyauté qui entoure les diagrammes scientifiques, de même que les citations manipulées ou la préface fictive. Le narrateur du Pays plat est, d’une certaine façon, profondément déloyal car il ne cesse de toucher aux frontières de son récit afin d’en brouiller les contours.
Cet estompement, dont on pourrait se contenter d’apprécier toute la virtuosité même s’il n’avait aucun objet, est le vaisseau parfait des interrogations métaphysiques du Pays plat. Car la question de la vraisemblance vous hante, une fois le roman refermé. De quel côté se trouve-t-elle, à quai ou à bord ? Dans l’existence de seulement trois dimensions dont, par une sorte de miracle, nous saisirions merveilleusement la nature, ou dans l’existence de dimensions inaccessibles, partiellement ou entièrement inconcevables ?
C’est le grand accomplissement du Pays plat, par des moyens proprement littéraires, que de s’insinuer dans l’interstice où spiritualité et science, cette dernière plus encore avec les avancées de la physique au XXe siècle, se retrouvent dos à dos : trois dimensions ne suffisent pas à rendre compte du monde.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, oscar dassetto, flatland, le plat pays, edwin a. abbott, science-fiction |  |
|  Imprimer
Imprimer
