L’Amérique en guerre (28) : Bart le magnifique (Requiem) de Shelby Foote (02/05/2022)

Crédits photographiques : Foote-Nan Goldin.
 L'Amérique en guerre, par Gregory Mion.
L'Amérique en guerre, par Gregory Mion.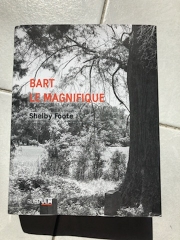 «C’était un magnifique spécimen d’Américain.»
«C’était un magnifique spécimen d’Américain.»Henry James, L’Américain.
«C’était plus que le sommeil d’un volcan, c’était sa complète extinction.»
Jules Verne, L’île mystérieuse.
Perpétuité du Sud et fatigue d’un sudiste nébuleux
Les aventures – et finalement les mésaventures – de Bart le magnifique (1) tiennent lieu d’une longue messe prononcée à la mémoire de Hugh Bart comme le suggère le sous-titre de ce livre en version française : Requiem. Le maître de cette cérémonie a presque tout connu de l’homme dont il va être question. Il a connu ses gloires aussi bien que ses humiliations et il a décidé de raconter au petit-fils du défunt – Asa Bart-Bateman – ce qu’il en fut de son grand-père dans cette région spéciale du Mississippi où la radioactivité des valeurs sudistes a toujours sévi. Enclavée dans ce que l’on appelle plus largement le Delta, cette portion du Mississippi constitue le principal maillon d’une chaîne axiologique enveloppant le Nord-Ouest de l’État du Magnolia ainsi que des sections de l’Arkansas et de la Louisiane. L’ensemble de ce territoire est regardé aux États-Unis à l’instar du Sud véridique, du Sud tutélaire, inamovible et increvable civilisation du redoutable Delta, point de repère de toute l’œuvre de Shelby Foote qui a tenté d’en restituer l’âme, l’histoire et la mythologie. L’influence de Faulkner a bien sûr été déterminante pour explorer d’un bout à l’autre ce Delta reformulé en imagination, et ici, plus particulièrement, ce segment du Mississippi que Shelby Foote a réinventé par le biais du simple nom de Jordan County, pure cartographie littéraire sans véritables détails géographiques à inspecter, pure construction romanesque dont les limites flexibles ont permis à l’auteur d’amplifier la charge de l’invisible sur ses personnages et sur ses lecteurs. Ainsi, là où Faulkner avait nettement dessiné la carte de son célèbre Yoknapatawpha County, agrégeant l’espace à une dimension précise pour mieux descendre éventuellement dans les abysses du temps, Foote, lui, travaille davantage les indications chronologiques afin peut-être de repousser les dimensions spatiales des terres du midi américain, et donc, peut-être, afin de faire sentir avec une plus vive conscience la drastique nature d’un Sud éperdument irrédent. Et ce faisant, Shelby Foote, dès ce roman initial (2), découvre la source ductile de son inspiration et amorce la compréhension exhaustive de «ce pan de territoire appelé Jordan County» (p. 17) tel qu’il l’écrit dans une importante préface datée de 1986, préparant alors la réédition de ce roman des débuts, environ quatre décennies après sa publication originale en 1949. Autant dire tout de suite que ces délais s’expliquent en partie par l’embarras de Shelby Foote devant un livre qui se cherche encore une langue, un livre encore sous perfusion des prédécesseurs admirés pour leur écriture, un livre, enfin, qui n’a pas manqué de s’adosser à ses ancêtres directs, vétérans d’une ceinture méridionale dont le jeune écrivain ne peut d’abord s’emparer qu’en circulant parmi les souvenirs de famille. Mais quoi qu’il en soit de ces dignes aveux, la lecture de ce livre est capitale pour tous ceux qui désireraient savoir depuis quels gisements l’œuvre de Foote s’exprime, et elle est même d’autant plus fondamentale que ce roman d’apprentissage paraît soutenir une déroutante idée, ou, à tout le moins, une idée dont nous assumerons l’interprétation : un sudiste sans la guerre (que la guerre soit civile ou mondiale) n’est pas vraiment un sudiste.
Celui qui rapporte les hauts et les bas de Hugh Bart est surnommé Billy Boy. Il a été le fidèle serviteur de ce maître ambigu de 1887 à 1914. Sa restitution des faits et gestes de Hugh Bart n’est pas dépourvue de cette passion inhérente aux majordomes qui ont éprouvé la transsubstantiation de la banale servitude en singulière observance. Selon ses dires, il ne fut par exemple jamais démenti que Bart avait de l’allure, qu’il avait même du charisme, et en nulle occasion ce diamant de l’humanité n’abandonna sa «dignité altière» (p. 24). Cette idéalisation résultant d’un domestique plus ou moins hypnotisé se justifie par la description de Hugh Bart en «fier et grand personnage [projetant] son ombre, immense, chevaleresque et biblique, dans la clarté irréelle et profuse du culte des héros» (p. 26). Il y a ici une vision personnalisée de Hugh Bart qui rappelle possiblement ce que Thomas Carlyle attendait du héros : une volonté de se sacrifier à la production de l’Histoire et de rebattre toutes les cartes qui auraient pu stupéfier le monde à l’intérieur d’un modèle hédoniste et démocratique. Médiateur radical entre un univers visible à la recherche d’une démarche galvanisante et un univers invisible porteur de transcendance, le héros valorisé par Carlyle transporte dans ses bagages les moyens d’une rénovation grandiose qui réveillera les multitudes et les délivrera non seulement des grégarismes institués, mais les détournera aussi des héros de jadis dont les heures de gloire sont révolues. D’une certaine manière, ce héros surgissant des secrets lointains d’une indéfinissable puissance va engendrer à son tour une stupéfaction, un ébahissement d’une exceptionnelle intensité, mais, à la différence d’un système de gouvernement ou d’un État massificateur, à la différence également d’une religion narcotique, il suscitera aussitôt chez les foules sidérées la capacité d’incarner une bonne variante de la force qui va hugolienne (3), une force édificatrice à la fois liée aux abîmes et aux firmaments, aux racines transcendées et aux cimes transcendantes, un mouvement libérateur qui saura compromettre tous les aspects vicieux de la paralysie mentale et matérielle. Le problème, cependant, c’est que cette silhouette astrale du héros, si elle peut revêtir la forme du prophète, du guerrier politique ou du penseur, n’en est pas moins une rareté, un quasi hapax au sein de la grammaire historique souvent menacée de léthargie et ralentie par des peuples aisément domesticables. À ce titre, les dénominations de Billy Boy pour qualifier Hugh Bart nous apparaissent sinon exagérées, du moins symptomatiques d’une cécité commune, d’un aveuglement ordinaire trahissant la facilité d’être abusé par les faux héros, les charlatans, les imposteurs et tout ce que l’on voudra parmi la procession des catastrophiques arrivistes. Il est d’ailleurs intéressant de mentionner que l’assortiment des hyperboles issu du cerveau médusé de Billy Boy sera ultimement remis en question par Asa Bart-Bateman lui-même, plus lucide, plus objectif sur la carrière existentielle de son aïeul, et, surtout, plus clairvoyant sur l’immédiate descendance de cet homme au fond assez médiocre (cf. pp. 367-372).
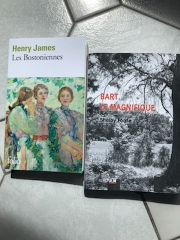 Une parenthèse peut du reste s’ouvrir pour souligner la douteuse magnificence accordée à Hugh Bart. Nous pouvons en effet mettre en balance cette espèce de falsification du héros de Carlyle avec un personnage de la littérature que la narration omnisciente présente comme un amoureux de l’auteur de Sartor Resartus et qui en réalise quelque peu les attentes messianiques à une échelle locale. Ce personnage se nomme Basil Ransom et il s’abat sur une société caricaturalement progressiste telle une météorite dotée de propriétés salvatrices. Il est le perturbateur – et le sauveur transitoire – du roman d’Henry James intitulé Les Bostoniennes. Lui-même originaire du Mississippi, reflet masculin de Hugh Bart dans le complexe miroir anthropologique du Sud, le troublant Basil Ransom a vu ses parents subir la déchéance après avoir «vidé jusqu’à la lie la coupe de la défaite» (4) confédérée en 1865. À l’image de tous les sudistes des États-Unis, Basil Ransom doit négocier avec cette odieuse faillite, mais, à l’inverse de Hugh Bart qui n’était alors qu’un enfant, il a foulé le champ de bataille de la guerre civile et il en a recueilli des vigueurs, des honneurs et des convictions. Ce sont ces multiples épaisseurs acquises sous le Stainless Banner qui permettent à Ransom de résister à la pression idéologique de Boston et aux crédos féministes de sa cousine éloignée Olive Chancellor. Les préjugés de cette dernière concernant le Sud provoquent au demeurant les préjugés de Ransom à propos du Nord. Il n’apprécie pas le fanatisme réformiste de tous ces bourgeois guindés qui ne se battent qu’à l’arrière, qui ne luttent qu’en proférant des phrases, et qui de surcroît le font avec une impudeur d’officiants de la morale. D’où son choix de «garder le silence au sujet du Sud», de se taire lorsque le Nord palabre jusqu’au bout de la nuit, de préserver la glorieuse patrie sécessionniste «des mains impies» qui se croient immaculées (5). Quand tous ceux-là érigent le Nord en directeur de conscience, Basil Ransom préfère que le Sud continue stoïquement à vivre, «à panser ses blessures et à rêver en paix», ce qui revient à miser «sur la lente action du temps» et «ses effets bienfaisants» (6). Aux affairements de sa distante cousine, Ransom rétorque donc par un patient et discret travail de fond, et, de jour en jour, il reprend un avantage sur le clan Chancellor malgré «la tragédie mêlée de farce» (7) qui a mortifié les gens du Sud. Cette remarquable constance le rapproche de ces sudistes «pauvres comme Job et intraitables» (8), de ces vaincus devenus des ruines fumantes d’orgueil, et c’est ainsi qu’il va débaucher la toute jeune Verena Tarrant du giron asphyxiant d’Olive Chancellor, celle-ci ayant fait de celle-là une aguichante oratrice chargée de plaider au quotidien la cause des femmes. Or la progressive déportation de Verena se révèle insupportable pour Olive car elle y devine les preuves accablantes d’un survivant et arrogant patriarcat, mais aussi, pour mieux dire, les stigmates d’un Sud remis de ses éclipses et de nouveau prêt à rayonner, à réaffirmer son lot de traditions décidément opiniâtres. Conformément à cet élan de réfection et autant par amour que par fierté, Basil Ransom parvient à extraire Verena Tarrant d’un piège mandarinal et psychique, à cette nuance près que cette exfiltration pourrait s’avérer tout aussi piégeuse. Mais quelles que soient les justes réserves exprimables à l’égard de Basil Ransom, ce qui le distingue des fragilités de Hugh Bart, c’est son unité de caractère, sa loyauté envers les meilleurs principes sudistes, et, plus intimement, son incorruptibilité devant les obstinations d’une modernité qui aimerait déconstruire les évidences naturelles en insufflant dans les âmes l’anarchie du divertissement et le poison de la rancune.
Une parenthèse peut du reste s’ouvrir pour souligner la douteuse magnificence accordée à Hugh Bart. Nous pouvons en effet mettre en balance cette espèce de falsification du héros de Carlyle avec un personnage de la littérature que la narration omnisciente présente comme un amoureux de l’auteur de Sartor Resartus et qui en réalise quelque peu les attentes messianiques à une échelle locale. Ce personnage se nomme Basil Ransom et il s’abat sur une société caricaturalement progressiste telle une météorite dotée de propriétés salvatrices. Il est le perturbateur – et le sauveur transitoire – du roman d’Henry James intitulé Les Bostoniennes. Lui-même originaire du Mississippi, reflet masculin de Hugh Bart dans le complexe miroir anthropologique du Sud, le troublant Basil Ransom a vu ses parents subir la déchéance après avoir «vidé jusqu’à la lie la coupe de la défaite» (4) confédérée en 1865. À l’image de tous les sudistes des États-Unis, Basil Ransom doit négocier avec cette odieuse faillite, mais, à l’inverse de Hugh Bart qui n’était alors qu’un enfant, il a foulé le champ de bataille de la guerre civile et il en a recueilli des vigueurs, des honneurs et des convictions. Ce sont ces multiples épaisseurs acquises sous le Stainless Banner qui permettent à Ransom de résister à la pression idéologique de Boston et aux crédos féministes de sa cousine éloignée Olive Chancellor. Les préjugés de cette dernière concernant le Sud provoquent au demeurant les préjugés de Ransom à propos du Nord. Il n’apprécie pas le fanatisme réformiste de tous ces bourgeois guindés qui ne se battent qu’à l’arrière, qui ne luttent qu’en proférant des phrases, et qui de surcroît le font avec une impudeur d’officiants de la morale. D’où son choix de «garder le silence au sujet du Sud», de se taire lorsque le Nord palabre jusqu’au bout de la nuit, de préserver la glorieuse patrie sécessionniste «des mains impies» qui se croient immaculées (5). Quand tous ceux-là érigent le Nord en directeur de conscience, Basil Ransom préfère que le Sud continue stoïquement à vivre, «à panser ses blessures et à rêver en paix», ce qui revient à miser «sur la lente action du temps» et «ses effets bienfaisants» (6). Aux affairements de sa distante cousine, Ransom rétorque donc par un patient et discret travail de fond, et, de jour en jour, il reprend un avantage sur le clan Chancellor malgré «la tragédie mêlée de farce» (7) qui a mortifié les gens du Sud. Cette remarquable constance le rapproche de ces sudistes «pauvres comme Job et intraitables» (8), de ces vaincus devenus des ruines fumantes d’orgueil, et c’est ainsi qu’il va débaucher la toute jeune Verena Tarrant du giron asphyxiant d’Olive Chancellor, celle-ci ayant fait de celle-là une aguichante oratrice chargée de plaider au quotidien la cause des femmes. Or la progressive déportation de Verena se révèle insupportable pour Olive car elle y devine les preuves accablantes d’un survivant et arrogant patriarcat, mais aussi, pour mieux dire, les stigmates d’un Sud remis de ses éclipses et de nouveau prêt à rayonner, à réaffirmer son lot de traditions décidément opiniâtres. Conformément à cet élan de réfection et autant par amour que par fierté, Basil Ransom parvient à extraire Verena Tarrant d’un piège mandarinal et psychique, à cette nuance près que cette exfiltration pourrait s’avérer tout aussi piégeuse. Mais quelles que soient les justes réserves exprimables à l’égard de Basil Ransom, ce qui le distingue des fragilités de Hugh Bart, c’est son unité de caractère, sa loyauté envers les meilleurs principes sudistes, et, plus intimement, son incorruptibilité devant les obstinations d’une modernité qui aimerait déconstruire les évidences naturelles en insufflant dans les âmes l’anarchie du divertissement et le poison de la rancune. De ce contraste entre deux personnages nous déduisons la conservation de la force de l’un et l’épuisement de la force de l’autre, le premier étant affûté par la guerre, par le sens même de l’Histoire et par son métier d’avocat, le second n’étant qu’un misérable nostalgique d’un combat que son âge ne pouvait l’amener à vivre, un souffrant exponentiel, en outre, qui mourra à la veille de la Grande Guerre comme si tous les événements d’envergure le laissaient à la marge, au rebord des vastes recompositions du monde humain. En cela Basil Ransom fut un relatif étalon de mesure de son temps, un certain magnétisme, un certain pôle gravitationnel qui modifia des trajectoires en profondeur, tandis que Hugh Bart ne fut qu’une demi-mesure, un laissé-pour-compte des archives essentielles qui a été inexorablement rattrapé par l’inessentiel. D’abord résolu à être un exemple de tempérament jupitérien aussi altier que l’impitoyable Old Man River, bien décidé à se cabrer tel un archétype de l’homme entier que rien ne saurait dépraver, Hugh Bart, peu à peu, s’est fragmenté dans le probable souci de n’avoir été qu’un contemporain minimal de la guerre de Sécession. Aux yeux de son tribunal intérieur, supposons-le, il a symbolisé un témoin presque gênant de ce drame fondateur qui endeuilla l’Amérique de 1861 à 1865. Il a été – contre son gré – le pâle repère juvénile d’un moment décisif pendant lequel se sont forgés les folklores des physionomies et des mentalités sudistes, ce moment où des hommes de la trempe du major Henry Dubose (9) se sont affirmés (cf. pp. 169-171), des hommes, en l’occurrence, capables de disserter à l’infini sur les batailles d’Appomattox, de Shiloh et de Five Forks, des hommes dont la noblesse et le courage leur ont donné le droit de transformer des Waterloo en Austerlitz. Or il semble que tout le malheur de Hugh Bart ait consisté à se prendre fréquemment pour un vainqueur d’Austerlitz tout en ayant à louvoyer avec un défaitisme croissant. À vrai dire, plus Hugh Bart s’est avancé dans le temps, moins il a été taillé aux proportions de l’irrédentisme du Deep South. Il s’est insensiblement évanoui comme présence spirituelle et comme présence temporelle, subordonné aux déclins d’une âme antihéroïque, contraint de s’arranger avec une vie rongée par l’absence de la guerre, une vie, en somme, qui a dû très souvent parodier des victoires en se dissimulant des rapports de plus en plus contrariés avec les éléments du tableau périodique sudiste.
Du Magnifique au Sinistre, de la guerre fantasmée à l’insoluble polémique intérieure
Au tout début de son parcours en trompe-l’œil, pourtant, Hugh Bart a copieusement arrosé le rhizome du Sud en traversant l’État du Mississippi et en devenant par la suite fermier, shérif et planteur, alternant des succès qui retarderont l’obscure épiphanie de l’échec, l’ombre dérangeante d’un itinéraire qui se reprochera à bas bruit de ne pas avoir été – ne serait-ce qu’un instant – un soldat de la Sécession. Dans cette perspective, le débutant Hugh Bart s’est démarqué des opportunistes de la Reconstruction et il a su faire amende honorable auprès des «flambées de colère d’une population noire hallucinée» (p. 26). Du reste, à cette époque-là, en amont de tous ses accomplissements et au plus vif de ses pérégrinations, Hugh Bart n’a même pas encore touché aux prémices de la majorité, si bien qu’à le voir marcher virilement d’un coin à l’autre du Mississippi pour tenter de s’établir, on pourrait avoir l’impression d’aviser les contours d’un fils prodigue inversé qui reviendrait sur ses terres pour les ensemencer de sa prometteuse lumière. Ce sont là des motifs d’émerveillement qui s’entretissent aux liturgies boursouflées de Billy Boy et qui inscrivent Hugh Bart sur les brisées de l’authentique personnalité littéraire. On ne peut d’ailleurs qu’apprécier la façon dont cet intrus de la guerre s’est hissé jusqu’aux derniers étages de la respectabilité méridionale, participant activement à «l’incubation de [sa] légende» (p. 32), gagnant des galons à d’autres endroits que sur les typiques champs d’honneur. Il s’est rendu miscible aux récits mélancoliques faisant la part belle aux anciens combattants qui ont servi «sous les ordres de Barksdale, Forrest, Jameson ou Van Dorn» (p. 43). Au milieu des prolifiques et singuliers phénomènes sudistes, il a su redéfinir sa vérité, remiser au placard son enfance et son adolescence décolorées, comprenant de la sorte que la vérité s’apparente moins à une idole éternelle et objective qu’à un énoncé subjectif qui nous aide à avancer. Par conséquent Hugh Bart s’est montré pragmatique au sens de ce qu’a pu théoriser William James : la vérité ne repose pas sur une fidélité absolue à la réalité, mais elle relève plutôt d’une qualité pratique, de quelque chose qui nous est utile à titre individuel, à savoir que l’idée vraie est une idée qui nous permet de poursuivre efficacement une finalité ou plusieurs finalités, à commencer par le projet de persévérer dans la vie (10). C’est pourquoi Hugh Bart s’est efforcé d’accumuler des vérités qui ont déblayé d’un point de vue pratique le chemin de son ascension tout en contournant la vérité ontologique de son encombrante inexpérience de la guerre. Son premier mérite, il faut l’admettre, aura été de se battre contre l’être de sa méconnaissance du terrain des hommes véridiques en multipliant les initiatives dans l’étant d’un Sud en voie de rétablissement. Ce qu’il n’a pu offrir dans le fond, il l’a offert dans la forme, puis, les années passant, il s’est lentement désorbité de cette volonté formelle en étant démasqué par les spectres sudistes, en étant puni par des grandeurs réelles qui lui ont remémoré la précarité de ses grandeurs artificielles, un peu comme si un Basil Ransom fantomal avait surgi des abîmes pour lui jeter un sort et pour lui rappeler qu’il est strictement interdit de tricher avec les hauts commandements du Sud.
S’il avait été prévoyant vis-à-vis de ces problèmes, il ne se fût point hasardé à récupérer la plantation baptisée Solitaire, ancien fief du général Clive Jameson, domaine croulant depuis 1882, date à laquelle le maître des lieux a passé l’arme à gauche. Cette propriété fut tantôt majestueuse, tantôt triviale, évoluant néanmoins vers la négative au fur et à mesure que le général dépérissait en raison des lendemains défavorables de la guerre civile (cf. p. 45). Héros du plus diviseur de tous les conflits de l’Amérique, le marmoréen Clive Jameson n’est pas tout à fait quinquagénaire lorsqu’il décède, emporté par les ruses de l’Histoire et par l’accablement d’avoir été déclassé, d’avoir connu, dans cet ordre chronologique invivable, l’héroïsme et la platitude. Il préfigure à bien des égards le délabrement qui s’emparera de son successeur, le subtil et imparable renversement de Hugh Bart. Si en effet le généralissime Jameson n’a pas pu affronter les funestes répercussions de la défaite de 1865, on ne voit pas comment Hugh Bart, avec ses compétences beaucoup plus modestes, pourra triompher des difficultés qui ont démoralisé un demi-dieu du panthéon confédéré. Il n’empêche que Hugh Bart, en 1886, se lance dans la réhabilitation de Solitaire, profitant d’une opinion publique indulgente qui perçoit en lui un hercule susceptible de redresser cette maison Usher de sa maléfique déroute. Il y a là une double illusion hypothétique : d’une part l’illusion des autochtones qui veulent imaginer que le vieux domaine de Jameson va revivre et renouveler un cycle de prospérité locale, et, d’autre part, l’illusion de l’acheteur qui ne se rend pas compte qu’il fait l’acquisition de ces décombres uniquement pour s’adosser à la mémoire d’un héros de la guerre, pour se confondre à lui et semer dans les esprits environnants l’impression qu’il appartient aux mêmes annales de la consécration militaire. Autrement dit, la situation patente nous dévoile un jeune homme du Sud qui se rend digne de sa région, mais la situation latente, elle, nous décèle un blanc-bec qui se méprend sur ses intentions et qui prospecte une reconnaissance amputée de son segment le plus important – la guerre civile vécue, entretenue et métabolisée dans toutes les fibres des guerriers d’autrefois.
Nul n’ignore en outre le catalyseur que peuvent représenter les illusions que les hommes ont d’eux-mêmes, et, à ce propos, Hugh Bart démarre sur les chapeaux de roues en relançant prestement la culture du coton, ressuscitant dans ces parages offensés une atmosphère d’antan. Il se nourrit des vieilles ambitions des patriarches qui ont donné aux plantations de coton leurs lettres de noblesse (cf. p. 56). Il restaure un paradigme que l’on croyait à jamais enseveli et il réussit à rapatrier un vernis d’espérance parmi les humiliés de la Reconstruction (cf. p. 60). En parallèle de ses rapides victoires, Hugh Bart épouse en 1890 Florence Jameson, la fille du défunt général, ajoutant à sa vaniteuse biographie le «romanesque» et le «chevaleresque» accolés au patronyme de Jameson (p. 70). De plus, en ramenant Florence à Solitaire, non seulement il agglomère sa femme au rang d’une «châtelaine» (p. 61), mais il console aussi en elle la petite fille qu’elle était pendant que son père entamait son irréversible effondrement au cœur d’une maison vouée à la décrépitude. Sans doute que Hugh Bart n’est pas non plus aveugle quant à l’apparence «disgracieuse» de cette femme (p. 65), et, en la faisant revenir pompeusement à Solitaire, il est possible qu’il veuille corriger cette infortune physique pour corriger d’un même mouvement vénérable l’infortune métaphysique de l’ancêtre déchu. Quoi qu’il en soit, du côté de Florence, ce retour aux sources se traduit comme «la reconquête d’une enfance idéale» (p. 80), comme la réinterprétation de l’âge tendre subitement interrompu par le dur machiavélisme du réel. Elle ne trouve donc pas que son rôle de vigie du foyer soit malséant car Solitaire, à l’instar des plantations avoisinantes, ressemble à ces large estates supervisés par de rigoureuses maîtresses de maison, autant de «véritables baronnies tenues par des femmes qui en [font] l’unique objet de leurs préoccupations» (p. 79). On aurait presque envie d’inférer que la plantation agit pour Florence à l’image d’une maison de poupée. Elle réorganise ici et maintenant ce qu’elle ne pouvait contrôler naguère, elle rejoue son enfance suspendue, tout comme elle s’aperçoit qu’il faudra bientôt augmenter les effectifs du domaine à la faveur d’une abondante maternité. Elle se sent prête à assumer ces œuvres de la vie, à surmonter le perturbant décor des «pierres tombales anonymes» (p. 80) qui oppressent chaque plantation et qui convoquent le souvenir des morts prématurées, la remembrance de ces nombreux enfants qui n’ont pas survécu et auxquels on avait réservé la tâche de perpétuer le sang du Sud, la tâche de prolonger l’aristocratie du coton et l’application assimilée de l’esclavage. Consciente de sa chance de ne pas reposer dans l’une de ces tombes délaissées qui eussent tant ému l’auteur de Middlemarch, Florence Jameson, devenue Mrs. Bart, s’apprête à prendre le relais de ces ventres sudistes (11), à continuer les rêves de transmission et de prolongation de ce midi particulier de l’Amérique, nonobstant les révolutions en cours dans la psychologie américaine et les fantasmes aristocratiques de son mari, les mirages alimentés par cet homme qui ne peut pas encore s’avouer ses hallucinations et son incomplétude native au regard des exigences du Sud.

La suite de cette étude est à lire dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, shelby foote, bart le magnifique, gregory mion, l'amérique en guerre |  |
|  Imprimer
Imprimer