Underground philosophy. Note sur la pensée anarchéologique de Jean Vioulac, par Baptiste Rappin (07/06/2022)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone.Note conçue et rédigée sur un air de Bob Dylan :
“How many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea ?
Yes, ’n’ how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free ?
Yes, ’n’ how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn’t see ?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind”
“How many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea ?
Yes, ’n’ how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free ?
Yes, ’n’ how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn’t see ?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind”
Introduction : un philosophe «hors les murs»
 Le philosophe Jean Vioulac publie, en ce printemps de l’an 2022, Anarchéologie, Fragments hérétiques sur la catastrophe historique aux Presses Universitaires de France, son septième ouvrage depuis la parution de L’époque de la technique. Marx, Heidegger et l’accomplissement de la métaphysique en 2009. Et il faut ajouter à ces livres une quinzaine d’articles publiés dans les revues spécialisées comme Philosophie, Les études philosophiques, Transversalités, la Revue de Métaphysique et de Morale, etc. Son travail est jugé touffu, dense, d’aucuns le diront aride et hermétique, d’autres lui reprocheront un manque d’empirisme, les derniers de distordre l’histoire de la philosophie, mais force est de constater que Vioulac place à chaque reprise son lecteur devant les grands noms de l’histoire de la philosophie : Marx et Heidegger au premier chef, mais également et fréquemment Kant, Husserl, Hegel et Nietzche, et encore de façon régulière, Platon, Descartes, Bachelard, Tocqueville, Anders, Benjamin, Sohn-Rethel, Derrida, Pascal et bien d’autres. D’ailleurs, afin de faciliter la lecture en ne multipliant pas les renvois, nous nous limiterons volontairement dans nos références à ces philosophes, et renverrons dans la mesure du possible aux textes de Vioulac lorsque nous serons amenés à les citer.
Le philosophe Jean Vioulac publie, en ce printemps de l’an 2022, Anarchéologie, Fragments hérétiques sur la catastrophe historique aux Presses Universitaires de France, son septième ouvrage depuis la parution de L’époque de la technique. Marx, Heidegger et l’accomplissement de la métaphysique en 2009. Et il faut ajouter à ces livres une quinzaine d’articles publiés dans les revues spécialisées comme Philosophie, Les études philosophiques, Transversalités, la Revue de Métaphysique et de Morale, etc. Son travail est jugé touffu, dense, d’aucuns le diront aride et hermétique, d’autres lui reprocheront un manque d’empirisme, les derniers de distordre l’histoire de la philosophie, mais force est de constater que Vioulac place à chaque reprise son lecteur devant les grands noms de l’histoire de la philosophie : Marx et Heidegger au premier chef, mais également et fréquemment Kant, Husserl, Hegel et Nietzche, et encore de façon régulière, Platon, Descartes, Bachelard, Tocqueville, Anders, Benjamin, Sohn-Rethel, Derrida, Pascal et bien d’autres. D’ailleurs, afin de faciliter la lecture en ne multipliant pas les renvois, nous nous limiterons volontairement dans nos références à ces philosophes, et renverrons dans la mesure du possible aux textes de Vioulac lorsque nous serons amenés à les citer.Bien trop haute, et imprudente, serait l’ambition qui prétendrait saisir la pensée de Vioulac dans un seul et unique article; c’est en effet un monument que le lecteur voit se dresser devant lui, un monument impressionnant et massif tant par l’ampleur des philosophies convoquées que par la sophistication des analyses livrées qui intègrent non seulement la philosophie, mais également une bonne part des sciences les plus récentes : physique quantique, cybernétique, paléoanthropologie. Et ils sont peu nombreux, à dire vrai, les penseurs contemporains en mesure d’écrire une œuvre d’un tel empan qui embrasse l’ensemble de la tradition occidentale pour relever le défi, non point d’une érudition qui ferait écho à la polymathie en son temps tournée en dérision par Héraclite, mais d’une confrontation essentielle avec l’époque contemporaine, sa logique propre et ses enjeux fondamentaux. Pierre Legendre, Pierre Caye, Michel Freitag, quelques autres très certainement, figures tout aussi discrètes que Vioulac.
Alors nous nous sommes résolus à prendre pour fil directeur celui qui mettrait le lecteur philosophe le plus mal à l’aise, celui qui aurait l’effet d’un rasoir d’Ockham et couperait de la philosophie contemporaine toutes ses parties grasses et superflues, celui qui serait assurément le plus volontiers intempestif : un fil directeur opiniâtrement à contre-courant de l’exercice actuel de la philosophie. C’est donc le fil à couper, le fil tranchant d’une philosophie hors les murs, à l’image de son auteur qui, délaissant les salles d’universités et les centres de recherche, fuyant les caméras et les médias, écrit depuis les classes de lycée et de khâgne. Quelle conception de la philosophie Vioulac se fait-il et comment la déploie-t-il dans son cheminement ? Ces questions, qui laissent entendre la décision subjective de défendre et de promouvoir une vision du monde, masquent en réalité le ressort essentiel de la pensée de Vioulac : à savoir que le philosophe ne décrète pas le destin de la philosophie, ni hier dans les allées antiques de l’Académie et les couloirs médiévaux de l’Université, ni aujourd’hui aux temps de la catastrophe.
1. De la philosophie à la misosophie
Notre problématique est par conséquent maladroitement formulée; selon Vioulac, comme pour Heidegger, la philosophie ne procède justement pas d’une conception (Die Zeit des Weltbildes), mais répond bien plutôt à une nécessité et même à un appel : la nécessité de et l’appel à penser la catastrophe, tâche à laquelle les philosophes de profession qui travaillent à l’Université ou au CNRS ne laissent pas de se dérober.
L’obsolescence de la philosophie
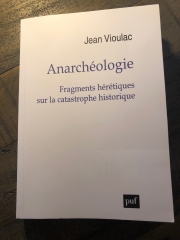 Que dire de la philosophie contemporaine ? On peut tout d’abord affirmer qu’elle se donne à voir dans l’espace public, quotidiennement, que ce soit sur les plateaux de télévision – pensons ici à Michel Onfray qui possède une chaîne à son propre nom : «MichelOnfrayTV», et se trouve régulièrement invité à s’exprimer sur les plateaux des chaînes d’information continue –, sur les réseaux sociaux – observons Raphaël Enthoven inonder l’oiseau bleu de ses messages de quelques deux cent quatre-vingt caractères – ou sur les étals de librairie, généralement au rayon «développement personnel» – c’est par exemple le cas Fabrice Midal et du syncrétisme Orient-Occident qu’il propose en guise de sagesse postmoderne. Ils aspirent, eux et leurs congénères médiagéniques, «non pas au trône de Pierre, mais, depuis un demi-siècle, au trône de Sartre» (Vioulac, 2018a, p. 67).
Que dire de la philosophie contemporaine ? On peut tout d’abord affirmer qu’elle se donne à voir dans l’espace public, quotidiennement, que ce soit sur les plateaux de télévision – pensons ici à Michel Onfray qui possède une chaîne à son propre nom : «MichelOnfrayTV», et se trouve régulièrement invité à s’exprimer sur les plateaux des chaînes d’information continue –, sur les réseaux sociaux – observons Raphaël Enthoven inonder l’oiseau bleu de ses messages de quelques deux cent quatre-vingt caractères – ou sur les étals de librairie, généralement au rayon «développement personnel» – c’est par exemple le cas Fabrice Midal et du syncrétisme Orient-Occident qu’il propose en guise de sagesse postmoderne. Ils aspirent, eux et leurs congénères médiagéniques, «non pas au trône de Pierre, mais, depuis un demi-siècle, au trône de Sartre» (Vioulac, 2018a, p. 67).La philosophie «sérieuse», quant à elle, s’exercerait dans l’enceinte de l’Université, dans la mesure où y officient des «enseignants-chercheurs» ayant été cooptés par leurs pairs au terme d’un ou de plusieurs processus de sélection éprouvants. D’ailleurs, les universitaires ne manquent jamais de souligner cette légitimité si difficilement acquise pour se différencier des «philosophes médiatiques» dont j’ai donné quelques exemples dans le paragraphe précédent. Légitimité du recrutement et donc du titre, mais également de «la prolifération monstrueuse des colloques, congrès, séminaires, journées d’étude ou conférences dans tous les pays du monde» (Vioulac, 2022, p. 15), tous événements auxquels le philosophe professionnel se doit de participer pour gravir les paliers des grades et des corps universitaires, mais qui témoignent plus profondément de son fonctionnariat, c’est-à-dire de son implication dans le fonctionnement de la Machenschaft, de la Machination.
Sans que l’on y prenne garde, l’Université s’avère assurément être l’une des organisations contemporaines au sein de laquelle la division du travail et la spécialisation des tâches furent poussées à leur extrême. Et ce que l’on nomme «recherche», et que Dominique Janicaud (1985) avait déjà identifié comme le dernier stade de la potentialisation de la puissance, n’est rien d’autre, au fond, que la pulvérisation du savoir en «d’innombrables spécialités aussi érudites que vaines» (Vioulac, 2022, p. 15).
Comme le note encore Vioulac (2018a, p. 60), «toute pensée, en tant qu’elle est d’abord affaire de mémoire et de communauté, a une assise institutionnelle»; la philosophie a ainsi requis la naissance de la Cité et la création des écoles philosophiques, puis l’émergence de l’université au XIIIe siècle, et le développement des sciences modernes n’avait de sens qu’en raison de leur reprise unitaire par la philosophie. Ce que confirme Michel Freitag (1995, p. 34) : «la vocation de l’université est inséparable de l’idée d’une certaine transcendance du monde de l’esprit, de la science et de la culture, et de l’exigence d’unité réfléchie qui lui est propre. C’est pourquoi l’université classique s’est développée sous l’égide d’une discipline maîtresse, la philosophie, dans laquelle cette synthèse devait être réalisée de manière toujours renouvelée».
Le projet de l’Université a pris fin avec la Seconde Guerre mondiale, moment de bascule à partir duquel elle se trouve intégrée au modèle de la triple hélice par lequel elle participe, avec ses équipes de recherche et ses laboratoires, aux côtés des entreprises et des gouvernements (et donc des armées), à la création de savoirs directement actionnables et opérationnels. Les temps sont à l’ingénierie, terme qui désigne aussi bien la méthode de conception des diplômes («l’ingénierie pédagogique») que le programme offert aux étudiants désormais mis en situation d’«apprendre à apprendre». Dans ces conditions, la cybernétique a bel et bien pris la place de la philosophie, ainsi que Heidegger (1995, p. 262) l’affirmait à un journaliste du Spiegel, car c’est bien «l’art de rendre l’action efficace», expression par laquelle Couffignal (1963, p. 23) définit la cybernétique, qui procède aujourd’hui à l’unification mobilisatrice des savoirs dans l’optique de l’utilité et de la performance, et non plus la philosophie dans le souci de la vérité. C’est la raison pour laquelle Vioulac (2018a, p. 42), dans les pas d’Anders, proclame ni plus ni moins que «l’obsolescence de la philosophie».
L’Université comme Musée
Cette obsolescence de la philosophie, qui condamne cette dernière non seulement à être en retard sur le réel, car le concept se lève quand le jour se couche, mais également et surtout à s’aveugler sur sa propre nature, ne peut être rendue pleinement intelligible sans une parenthèse historique et métaphysique dont le détour permet de mettre en évidence l’accomplissement du spectacle théorique (la theoria) dans le site moderne du Musée, dont l’Université n’est qu’une des déclinaisons, mais assurément pas des moindres.
Rappelons tout d’abord ces quelques éléments historiques en nous laissant guider par Vioulac : c’est lors de la Révolution française qu’apparaît réellement le musée, avec la création en 1793 du Louvre dont la mission première est la sauvegarde, la conservation et l’exposition des vestiges, entreprise évidemment indissociable de l’appropriation des œuvres par la force et la violence, ainsi qu’en témoigne la constitution du patrimoine du Louvre lors des guerres napoléoniennes. La colonisation et le pillage des patrimoines des peuples conquis ne firent que confirmer et amplifier cette tendance originelle.
Mais loin de se limiter au secteur «culturel», ou, peut-être, en tant que le «culturel» aurait désormais avalé et digéré le social, le Musée incarne «la situation époquale de l’humanité occidentale» (Vioulac, 2022, p. 53). C’est très certainement un raisonnement par défaut, ici énoncée sous forme de question rhétorique, qui permet à cette réalité de venir à la conscience : quel objet, quelle œuvre, quelle pratique, quelle époque, quelle partie du monde, quelle civilisation connaît encore le luxe d’échapper à sa muséification, à sa mise-en-musée ?
Ce vertige d’une muséification intégrale du monde conduit alors à interroger plus précisément ce qui s’y joue; et ce qui en la matière s’avère absolument décisif, c’est que les œuvres exposées acquièrent, par le pouvoir phénoménalisant du Musée, un nouveau type d’existence : sorties de leur site, décontextualisées, démondanéisées, elles se soumettent à une logique objectivante et respectent scrupuleusement la place qui leur est attribuée au sein d’un parcours artificiel créé ex nihilo. C’est en cela que le musée se trouve «dans une connexion étroite avec la Modernité philosophique, qui est en quête de ce qui reste quand tout a été détruit, de ce qui subsiste à la fin du monde» (Vioulac, 2022, p. 58). Il n’est qu’à songer à l’entreprise des Méditations métaphysiques, dans lesquelles Descartes détruit le monde et le sujet par la puissance de son doute, avant de se rattacher au dernier vestige de cette démolition : le cogito. De la même manière, le Musée arrache l’œuvre de son site qu’elle met entre parenthèses, en procédant de la sorte à une époché, et il accroche à ses murs et installe sur un support le résidu de cette réduction : la valeur esthétique.
Il en va de même à l’Université, il en va de même pour la philosophie : «La philosophie est ainsi elle-même muséifiée : le dispositif de recherche est ici inventaire, archivage et catalogage, conservation et restauration, c’est-à-dire, comme dirait Nietzsche, empaillage et momification» (Vioulac, 2018a, p. 66). Qu’observe-t-on lorsque l’on travaille à l’Université ? Une immense collection de savoirs, une gigantesque accumulation de connaissances, innombrables pièces dont les chercheurs assurent le tri, le classement et l’enregistrement. À cet égard, l’activité de l’universitaire contemporain ressemble à s’y méprendre aux fonctionnalités d’un système d’information.
Tout comme les œuvres dans l’enceinte des Musées, les savoirs évoluent et s’échangent dans un «champ d’équivalence» (Vioulac, 2022, p. 47) créé par le geste de démondanéisation qui préside à la muséification. Tous les savoirs sont aujourd’hui disponibles, prêts à être exploités, présentés puis sauvegardés, toutes les enquêtes et tous les intérêts personnels sont également légitimes, l’essentiel étant, pour le fonctionnaire de la Machination, de participer au grand procès de la récapitulation générale.
L’exigence première : penser la catastrophe
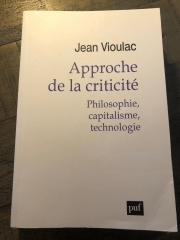 Il est obvie que ce champ d’équivalence neutralise la charge ontologique des concepts, des théories et des savoirs; tous placés sur le même plan, tous présentifiés sous les modalités organisationnelles des laboratoires, des équipes de recherches, des projets de recherche, des colloques et des revues académiques, ils se reproduisent, inoffensifs, désarmés, dans un même espace autoréférentiel et se dressent en «obstacles épistémologiques» : alors même qu’ils se prétendent «réflexifs» et s’affichent «critiques», ils sont en réalité les fidèles gardiens de l’impensé de la catastrophe. Donc de l’homéostasie cyber-totalitaire.
Il est obvie que ce champ d’équivalence neutralise la charge ontologique des concepts, des théories et des savoirs; tous placés sur le même plan, tous présentifiés sous les modalités organisationnelles des laboratoires, des équipes de recherches, des projets de recherche, des colloques et des revues académiques, ils se reproduisent, inoffensifs, désarmés, dans un même espace autoréférentiel et se dressent en «obstacles épistémologiques» : alors même qu’ils se prétendent «réflexifs» et s’affichent «critiques», ils sont en réalité les fidèles gardiens de l’impensé de la catastrophe. Donc de l’homéostasie cyber-totalitaire.Au contraire, Vioulac (2022, p. 48) présente la pensée comme prenant sa source dans l’état même du monde, et non pas dans une impulsion de la subjectivité : «L’importance reconnue à une pensée ne saurait reposer sur la fantaisie personnelle, mais uniquement sur la chose même, en l’occurrence l’état de détresse en lequel se trouve l’humanité contemporaine, la crise totale issue de l’évènement et de l’hégémonie d’un dispositif parvenue à l’hégémonie cybernétique mondiale». Et d’insister : «l’exigence de probité impose au philosophe de ne défendre aucune thèse ni aucune cause prédonnée, ni sensibilité politique, ni croyance religieuse, ni intérêt idéologique, ni valeur culturelle, ni même la philosophie» (Vioulac, 2022, pp. 299-300). Tout penchant personnel, tout engagement personnel, de quelque nature qu’ils fussent, fournissent une énergie recyclée au sein du système muséal. S’il est donc un élan de la philosophie, il provient du monde, mais non plus sous sa forme aurorale de l’étonnement, mais sous celle, finale, de l’effroi devant la catastrophe et la dévastation culminant dans le pilotage algorithmique du monde et des vies. C’est la raison pour laquelle il convient de reconfigurer la philosophie «conformément aux exigences de notre époque» : sa tâche se définit alors comme l’élucidation de «la logique immanente au dispositif technique» (Vioulac, 2022, p. 346); c’est aussi pourquoi les philosophes (Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger, etc.), dont Vioulac commente et interprète les pensées, ne sont pas convoqués au nom d’une préférence ou d’une dilection particulière, mais en raison de leur éclairage fondamental sur l’époque industrielle.
À l’évidence, ce projet d’élucidation ne saurait être mené dans l’enceinte du Musée; il requiert en fait un double détachement, tout d’abord institutionnel, ensuite philosophique. D’une part, le philosophe, qui fait sienne cette nécessité impérieuse de penser la catastrophe, n’a en réalité d’autre alternative que «se désolidariser de sa propre espèce» et de «devenir ainsi le Grand Hérétique que fut Nietzsche» (Vioulac, 2022, p. 300), schisme assumé qui le conduit à quitter, au moins par l’esprit mais très certainement aussi par le corps, les lieux officiels de la recherche dont Olivier Beaud (2002) a récemment montré la menace qu’ils font planer sur la liberté académique, si tant qu’un tel idéal put un jour prendre chair. Pour le dire d’un trait, «il n’y a pas de philosophie sans ce pas de retrait» (Vioulac, 2022, p. 173), il n’y a pas de pensée authentique qui puisse se déployer au sein de l’orthodoxie et de ses institutions. Mais cet éloignement ne suffit guère : il faut encore prendre congé de la philosophie elle-même, dans la mesure où l’amour de la sagesse qu’elle donna comme horizon à l’Occident puis au Globe ne conduisit à rien d’autre qu’à ladite catastrophe, c’est-à-dire à l’installation de la domination sans partage d’un marché cybernétique planétaire. De telle sorte que le rapport à la Totalité ne procède plus de l’amour, mais bien de la répulsion et du dégoût : la philosophie doit dès lors laisser la place à la «misosophie», «la pensée aujourd’hui doit ainsi se faire misosophie» (Vioulac, 2022, p. 21).
2. Une philosophie de la science
Paradoxalement, c’est sous l’angle de son rapport à la science, et tout spécialement à la science contemporaine, que la pensée de Vioulac se laisse peut-être le plus aisément saisir. En tout cas d’un prime abord. Mais disons immédiatement que par «philosophie de la science», le titre de cette partie, il ne convient pas du tout d’entendre cette spécialisation universitaire qui étudie les fondements de la science et la genèse de la connaissance vraie. Il faudrait plutôt prendre les deux termes dans leur connexion intime et originelle, dans la mesure où, pour Vioulac (2015, p. 63), «la philosophie a toujours été rigoureusement indissociable de la science», de telle sorte qu’il n’est de philosophie qui ne prenne son essor à partir de la science.
Philosophie et science premières
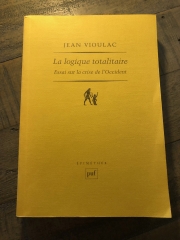 Rappelons ceci : le terme de «métaphysique» est absent des traités d’Aristote, et l’on doit probablement son invention à Andronicos de Rhodes, philosophe péripatéticien du 1er siècle avant J.-C. et éditeur des œuvres du Stagirite. Perplexe devant un ensemble de textes sans titre, il décida de les classer après la Physique et par conséquent de les appeler meta ta physika biblia dont la contraction donne précisément «métaphysique». Aristote parle plus précisément, dans le chapitre 1 du livre Γ d’une «science de l’Être en tant qu’Être» dont la vocation est de découvrir les «principes premiers de l’Être en tant qu’Être» (Aristote, 1991, p. 123). Cette remontée à la primauté du principe s’appuie sur la compréhension de l’être en tant que physis, en tant que nature, dont le philosophe précise les différents sens dans le chapitre IV du livre Δ : tout d’abord, «la production de tout ce qui naît et se développe naturellement»; ensuite «le mouvement initial qui se retrouve dans les êtres naturels et qui réside dans chacun d’eux»; puis «la matière primordiale qui fait que tous les êtres de la nature sont ou deviennent ce qu’ils sont»; enfin, «la matière première des choses» (Aristote, 1991, p. 168-169). La philosophie première, qui recherche l’Être en tant qu’Être, s’appuie sur la compréhension de l’être en tant que nature, c’est-à-dire sur les connaissances de la science de la physis alors élevée au rang de science première.
Rappelons ceci : le terme de «métaphysique» est absent des traités d’Aristote, et l’on doit probablement son invention à Andronicos de Rhodes, philosophe péripatéticien du 1er siècle avant J.-C. et éditeur des œuvres du Stagirite. Perplexe devant un ensemble de textes sans titre, il décida de les classer après la Physique et par conséquent de les appeler meta ta physika biblia dont la contraction donne précisément «métaphysique». Aristote parle plus précisément, dans le chapitre 1 du livre Γ d’une «science de l’Être en tant qu’Être» dont la vocation est de découvrir les «principes premiers de l’Être en tant qu’Être» (Aristote, 1991, p. 123). Cette remontée à la primauté du principe s’appuie sur la compréhension de l’être en tant que physis, en tant que nature, dont le philosophe précise les différents sens dans le chapitre IV du livre Δ : tout d’abord, «la production de tout ce qui naît et se développe naturellement»; ensuite «le mouvement initial qui se retrouve dans les êtres naturels et qui réside dans chacun d’eux»; puis «la matière primordiale qui fait que tous les êtres de la nature sont ou deviennent ce qu’ils sont»; enfin, «la matière première des choses» (Aristote, 1991, p. 168-169). La philosophie première, qui recherche l’Être en tant qu’Être, s’appuie sur la compréhension de l’être en tant que nature, c’est-à-dire sur les connaissances de la science de la physis alors élevée au rang de science première. La métaphysique est aujourd’hui devenue ontologiquement impossible, ou alors elle survit en tant qu’organe vestigial dans le formol des départements universitaires de philosophie et de théologie. Pourquoi ? Comment justifier ce jugement pour le moins péremptoire ? Voici la réponse de Vioulac, certes longue mais si limpide : «[…] toute la philosophie depuis son origine grecque […] a toujours privilégié une science constituant le domaine premier et paradigmatique pour l’interprétation de la réalité du réel, en l’occurrence la physique – et c’est précisément parce que la physique était science première que la philosophie première s’est élaborée comme métaphysique. Marx ne sort pas plus de la philosophie en se consacrant à l’économie qu’Aristote et Descartes en élaborant une physique ou Kant en la critiquant : la nouveauté de sa pensée tient à cette substitution de l’économie à la physique comme science première. Ce déplacement est imposé par notre époque, qui substitue un monde artificiel à l’ancien monde naturel : les choses telles qu’elles apparaissent dans notre environnement ne sont plus des données de la nature, mais des produits de l’industrie, et c’est pourquoi il faut substituer à une ontologie de la croissance naturelle et de ce qui croît par soi-même une ontologie de la production et de ce qui a été produit par l’homme» (Vioulac, 2015, pp. 56-7).
La Révolution industrielle a changé la donne : il a suffi de quelques décennies pour que les sociétés humaines soient transformées de fond en comble, reconfigurées de bout en bout. Un tournant, radical et violent, comme l’on n’en avait plus connu depuis la Révolution néolithique et la progressive sédentarisation des peuplades de chasseurs-cueilleur. Alimentation, habitat et habitudes, paysage, langage, travail, etc., tous les pans de l’existence se trouvèrent chamboulés et soumis à la logique catastrophique de la modernisation. Or, l’entrée dans la société industrielle est synonyme d’une artificialisation intégrale du monde, dont témoigne l’urbanisation galopante, à telle enseigne que notre milieu n’est plus constitué que par des objets produits selon les principes du management scientifique. C’est pourquoi l’économie, la gestion et l’ingénierie, toutes sciences de la production, sont les nouvelles sciences premières à partir desquelles peut s’édifier une misosophie première soucieuse d’élucider l’être en tant qu’être à l’époque de la planétarisation. C’est également pourquoi les œuvres de Marx (1), de Heidegger et des philosophes qui s’emploient à dévoiler la logique ontologique de l’industrialisation (ou du Capital, cela revient strictement au même) ne relèvent guère d’un attrait personnel ou d’un combat idéologique, mais bien d’un passage obligé.
Avec la cybernétique comme science première
S’il est bien aujourd’hui une science première, qui forme le moule des autres, c’est bien la cybernétique. Née aux États-Unis dans le giron des conférences Macy qui se tinrent de 1946 à 1953, la cybernétique se définit, par celui qui la baptisa, Norbert Wiener, comme la science du contrôle et de la communication; on peut également dire qu’elle est la science de l’information, des flux d’information et de leur gestion optimisée, que ces flux concernent les machines (les ordinateurs, les systèmes d’information), les animaux ou les êtres humains. Ce continuum informationnel permet d’insérer l’homme, et le vivant de façon plus générale, dans la société artificielle, c’est-à-dire dans le réseau des machines. Alors, comme l’affirme Vioulac (2009, p. 158), «la cybernétique est la science du contrôle des vivants par la machine; le moment cybernétique est celui de la fin de la différence entre vivant et machine par quoi se parachève l’indifférenciation de toutes choses propres à l’appareillement». La cybernétique constitue par conséquent l’ultime étape du nivellement ontologique, elle exprime et rend effective la thèse, propre à la société industrielle mais plongeant ses racines dans l’insurrection ontothéologique scotiste, de l’univocité de l’étant à la Machine (2).
Vioulac (2018a, p. 191) le rappelle : le grec kybernésis signifie «commandement», si bien que la cybernétique, si elle une science de l’algorithme, c’est-à-dire de l’enchaînement déductif de l’information au sein de boucles de rétroaction, n’en possède pas moins, et immédiatement, une portée sociale. Ainsi, «tout l’enjeu est de définir la nouveauté des modalités contemporaines de mise en ordre des sociétés induite par les technologies de l’information» (Vioulac, 2018a, p. 201). L’opération capitale est le codage, que l’on pourrait encore appeler formalisation, qui extrait – et abstrait – l’information de tout support matériel et dote ainsi cette dernière d’une existence autonome, libre qu’elle est de circuler de réceptacle en réceptacle. C’est bien la généralisation de ce processus qui nourrit les aspirations de l’intelligence collective, qui repose sur l’interaction homme-machine, et du transhumanisme, qui considère le couple homme-machine comme un système intégré.
De ce point de vue, la cybernétique réaliserait la philosophie, elle accomplirait son destin, dans la mesure où elle confère une effectivité technique à l’idéalisme platonicien. Par elle, la logique devient enfin logistique, c’est-à-dire gestion intégrale de l’être et de la vie. Forme ultime du logos, le management cybernétique enferme le monde dans une cage de silicium : celle de la tautologie du Même qui ne cesse, quand il se reproduit automatiquement à travers les algorithmes du Big Data, de se déduire de lui-même. C’est ici que «la question du totalitarisme apparaît dans sa détermination la plus radicale» (Vioulac, 2013, p. 463) car «c’est le machinisme qui constitue l’essence du totalitarisme» (Vioulac, 2013, p. 464). L’autonomisation du système technicien, permise par l’autonomisation de l’information dans l’opération de codage, transforme la recherche grecque de l’Un, du Même et du Commun en une réalité digitale carcérale dans laquelle les corps et les esprits sont constamment mis à disposition de la connexion à la Machine.
De la phénoménalisation à l’époque industrielle
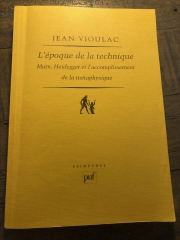 Le tournant industriel des sociétés occidentales n’a pas pour seul corollaire l’émergence de nouvelles sciences premières sur lesquels la philosophie première doit s’appuyer pour penser l’être en tant qu’artifice de la modernité. En effet, puisque la technique constitue désormais notre «milieu naturel», alors elle devient, de fait comme de droit, l’instance privilégiée, si ce n’est exclusive, de la phénoménalisation du réel. Cela signifie, en d’autres termes, que le monde n’apparaît et ne vient à l’existence qu’à travers l’outil; Bachelard (cité dans Vioulac, 2018a, p. 134) donne un exemple simple et instructif : c’est bien le microscope qui, parce qu’il donne accès à une réalité imperceptible à l’œil nu, crée la microbiologie. C’est bien pourquoi la phénoménotechnique doit prendre la place de la phénoménologie, exactement de la même manière que les sciences de la production – économie, management, ingénierie – ont remplacé la physique en tant que sciences de l’élaboration conceptuelle du monde.
Le tournant industriel des sociétés occidentales n’a pas pour seul corollaire l’émergence de nouvelles sciences premières sur lesquels la philosophie première doit s’appuyer pour penser l’être en tant qu’artifice de la modernité. En effet, puisque la technique constitue désormais notre «milieu naturel», alors elle devient, de fait comme de droit, l’instance privilégiée, si ce n’est exclusive, de la phénoménalisation du réel. Cela signifie, en d’autres termes, que le monde n’apparaît et ne vient à l’existence qu’à travers l’outil; Bachelard (cité dans Vioulac, 2018a, p. 134) donne un exemple simple et instructif : c’est bien le microscope qui, parce qu’il donne accès à une réalité imperceptible à l’œil nu, crée la microbiologie. C’est bien pourquoi la phénoménotechnique doit prendre la place de la phénoménologie, exactement de la même manière que les sciences de la production – économie, management, ingénierie – ont remplacé la physique en tant que sciences de l’élaboration conceptuelle du monde.Comme l’explique Vioulac (2018a, p. 152), qui ici encore suit le raisonnement de Bachelard, «le terme "phénoménotechnique" est dirigé contre "la gloire facile des phénoménologies de l’intuition", qui croient pouvoir accéder à un donné immédiat : à ce naïveté précritique, Bachelard oppose la thèse selon laquelle "rien n’est donné, tout est construit", qui impose de reconnaître que tout phénomène est résultat d’une activité de construction, laquelle met en œuvre des procédures déterminées et implique donc des médiations». Ce sont donc les constructions, d’une part intellectuelles que l’on nomme «méthodes» (et l’on connaît l’importance décisive de la méthodologie dans la science contemporaine), et d’autre part techniques, les instruments, qui, interagissant avec le réel, dont advenir les phénomènes, c’est-à-dire la manifestation de ce réel.
Deux sciences s’avèrent à cet égard décisives : tout d’abord la physique quantique, ensuite l’archéologie. Concernant la première, «le phénomène physique est machinique de part en part : la physique quantique est le déploiement inconditionné de la phénoménalité machinique qui définit le régime de vérité propre à l’époque qui est la nôtre» (Vioulac, 2018a, p. 157). Le Dispositif, par exemple un accélérateur de particules, redéfinit la vérité : celle-ci ne peut plus être appréhendée de façon traditionnelle comme adéquation de l’entendement et de la chose ou corrélation du sujet et de l’objet; elle se loge désormais dans l’adéquation d’un édifice mathématique aux mesures issues de l’expérimentation. La physique quantique ne comprend plus ni objet (des particules) ni sujet (effacé derrière les équations) : c’est une science qui s’accomplit «sous la forme d’un pythagorisme et d’un platonisme hyperboliques» (Vioulac, 2018a, p. 147) qui préfigure et configure l’advenue du réel sous forme de data.
La deuxième science qui relève de la phénoménotechnique est l’archéologie; en effet, «la résurgence de la Préhistoire est un effet de l’avènement du dispositif planétaire en lequel notre existence a désormais lieu» (Vioulac, 2022, p. 101), l’appareillage archéologique comprenant aujourd’hui, outre la formalisation toute managériale des fouilles, la stratigraphie, la prospection aérienne et l’utilisation de logiciels de visualisation de la Terre (comme Google Earth), les méthodes de datation et les analyses ADN, etc. Il faut donc bien convenir que «la Révolution industrielle manifeste la Révolution néolithique», que ce sont là «les deux seules Révolutions véritables qu’ait jamais connues l’humanité» (Vioulac, 2022, p. 105), que l’essence de ces deux Révolutions s’appréhende dans la phénoménotechnique, physique quantique pour la première, archéologie pour la seconde.
3. L’exploration critique des bas-fonds
La Révolution industrielle a par conséquent abouti à une objectivation de la sphère transcendantale, ou encore à l’appropriation par la Technique des conditions a priori de la phénoménalisation. On peut alors à juste titre parler d’une aliénation du transcendantal qui s’accompagne d’un fétichisme similaire à celui de la marchandise décrit et analysé par Marx : le pouvoir de phénoménalisation de la mégamachine, qui s’institue comme puissance étrangère, masque l’origine réelle du système technicien, à savoir la communauté de travail dont l’horizon messianique est alors la réappropriation de la sphère transcendantale. Justement, «c’est cette réappropriation qui définit la Révolution» (Vioulac, 2013, p. 431).
Le geste philosophique de la réduction
On peut encore le formuler de la manière suivante : à la crise anthropologique que fut et que continue d’être la Révolution industrielle fait écho l’entrée en régime critique de la philosophie dont le statut royal – la reine des sciences – se retourne ironiquement en une condition servile – la philosophie ancillaire des sciences modernes. Nous dégageons deux corollaires de la précédente affirmation. Tout d’abord, et comme nous le relevâmes déjà plus haut, les seules philosophies qui vaillent, par ces temps de catastrophe, sont celles qui se sont justement confrontés à cette époqualité critique : «Marx, Nietzsche, Husserl et Heidegger sont les auteurs essentiels de notre temps parce qu’ils sont les penseurs de la crise» (Vioulac, 2013, p. 25). Mais, en outre, l’inédite position de servitude de la philosophie «la conduit à une autocritique radicale qui lui impose de réévaluer, et de dévaluer, tout ce qu’elle fut jusqu’alors» (Vioulac, 2018a, p. 44). Et c’est ici Kant qui, de façon décisive, pava la voie aux penseurs critiques précédemment cités, dans la mesure où il fut le premier à destituer la théologie de son rang, à tel point, d’ailleurs, que Vioulac n’hésite pas à faire du philosophe de Königsberg, en raison des circonstances historiques, un «Robespierre philosophique qui a décapité la métaphysique avec la guillotine critique» (Vioulac, 2018a, p. 45).
Être un penseur critique ne consiste pas à se montrer critique vis-à-vis de l’époque, posture qui demeure somme toute superficielle et dont la portée révolutionnaire demeure bien faible. Surtout quand la société du spectacle a transformé ce type de négativité en un élément interne de son propre fonctionnement et de sa propre reproduction. Non, être critique, c’est s’attacher à regagner la sphère du transcendantal, c’est-à-dire à rétrocéder de l’effectivité – ce qui est en acte dans la société, là, posé devant nos yeux – à la possibilité – les conditions qui permettent à cette effectivité d’advenir, geste qui suppose de ne pas tomber dans le piège de la mystification et du fétichisme tendant à doter des hypostases abstraites de pouvoirs créateurs. À cet égard, on peut dire que la philosophie critique, qui n’est autre que la misosophie, poursuit l’entreprise première de démystification de la philosophie grecque qui substitua la raison aux mythes; mais contrairement à cette dernière, elle échappe à la tentation de poser un nouveau fondement abstrait pour isoler l’acte fondateur lui-même.
Par voie de conséquence, la misosophie est essentiellement une réduction ou, mieux dit, un ensemble d’opérations répétées de réduction qui consiste à se déprendre de l’attitude naturelle, caractérisée par la croyance en l’autonomie de la transcendance objective – en l’occurrence, celle du monde artificialisé de la société industrielle – et donc à laisser opérer la magie du fétichisme, pour étudier la manifestation, les modalités et les conditions d’apparition des phénomènes. Puisqu’elle consiste à opérer ce pas en arrière en direction de la fondamentation, la réduction peut être qualifiée d’«archéologique» (critique du fondement), en opposition avec la hiérarchie (sacralisation du fondement), caractéristique de la métaphysique qui pose l’éminence du principe premier et la présence de l’étant comme pierres angulaires de son édifice. Elle est le matériel de fouille (pelleteuse, pelle, pioche, truelle, etc.) dont se sert le penseur archéologue pour creuser et s’enfoncer dans le sol des fondements institués et découvrir, dans le sous-sol de l’être, les activités de constitution du monde. La misosophie est la pensée souterraine de l’Untergrund, elle est une philosophie underground, une «an-archie archéo-logique», c’est-à-dire une «une anarchéologie» (Vioulac, 2022, p. 86).
De la subjectivité transcendantale au corps vivant et du corps vivant à l’intersubjectivité
Dans Science et révolution (2015), Vioulac présente les trois réductions successives (qui seront reprises, de façon synthétique, dans Approche de la criticité en 2018 et dans Anarchéologie en 2022) qui le conduisent, dans les pas de Husserl, à installer la sociologie transcendantale comme nouvelle forme de philosophie première – ce sera donc une ontologie sociale. Suivons-le dans cette remontée vers la communauté originaire.
La première réduction, chez Husserl, consiste à radicaliser le tournant critique kantien, c’est-à-dire à élucider la structure noético-noématique des vécus, expression par laquelle il faut entendre la visée intentionnelle par le pôle subjectif noétique, au sein de la sphère réduite par l’époché, du pôle objectif noématique. «En dévoilant l’intentionnalité des vécus immanents, la réduction découvre ainsi l’essence même du transcendantal» affirme alors Vioulac (2015, p. 89) : la corrélation du sujet et de l’objet n’est plus la conformité d’une intériorité à une extériorité, mais se produit, tout au contraire, dans l’immanence de la sphère transcendantale.
Toutefois, cette première réduction produit un dédoublement du sujet, un «clivage du Moi» selon l’expression de Husserl, dans la mesure où la réflexivité inhérente à la réduction met en scène un sujet connaissant se prenant lui-même comme objet de connaissance, de telle sorte que ce premier mouvement aboutit à la constitution d’un «nouveau Je, pur observateur impartial et désintéressé de lui-même, […] artificiel et abstrait» (Vioulac, 2015, p. 96) à l’origine de «l’impasse idéaliste de la phénoménologie» (Vioulac, 2015, p. 113).
C’est à ce moment précis qu’intervient la deuxième réduction, qui mène de l’ego, pris au piège du solipsisme, au corps et à l’enracinement dans le monde. En effet, afin de sortir de la prison égologique, Husserl en vient à reconnaitre la nécessité d’un prédonné transcendantal, qui ne se confond pas avec la transcendance objective et supporte le sol idéaliste qui apparaît dès lors non plus comme fondateur mais comme fondé : ce prédonné n’est autre que le monde défini en tant que couche et flux matériels. Mais le lien entre ce prédonné hylétique et la conscience est le corps, le corps vivant (der Leib), de telle sorte que ce dernier devient la condition de possibilité de la subjectivité transcendantale. Vioulac peut alors conclure que «la deuxième réduction est incorporation de la subjectivité transcendantale qui la redéfinit par sa corporéité vivante» (Vioulac, 2015, p. 122).
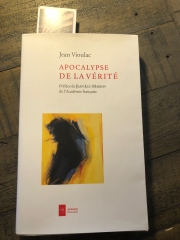 Deux strates sont à présent dégagées : celle de l’ego transcendantal et celle du corps vivant. Mais si la seconde fonde la première, il faut reconnaître, en sens inverse, que la première éclipse la seconde : cela signifie, pour être plus clair, qu’une couche idéaliste, qui définit le projet métaphysique en tant que tel, recouvre la concrétude du monde primordial. La deuxième réduction permet de renouer avec la vie du corps vivant, avec son activité première, c’est-à-dire avec la praxis. C’est précisément ici que s’enracine la troisième réduction : vivre, cela ne peut être que vivre-avec. Si la deuxième réduction quitte le solipsisme idéaliste pour retrouver le corps vivant, la troisième retrouve, sous le solipsisme de la vie, la primordialité de l’intersubjectivité. Ainsi, «l’être avec autrui est la condition de possibilité de la transcendance du monde, il est le fondement même de la constitution de la nature, du monde et de l’objectivité» (Vioulac, 2015, p. 165).
Deux strates sont à présent dégagées : celle de l’ego transcendantal et celle du corps vivant. Mais si la seconde fonde la première, il faut reconnaître, en sens inverse, que la première éclipse la seconde : cela signifie, pour être plus clair, qu’une couche idéaliste, qui définit le projet métaphysique en tant que tel, recouvre la concrétude du monde primordial. La deuxième réduction permet de renouer avec la vie du corps vivant, avec son activité première, c’est-à-dire avec la praxis. C’est précisément ici que s’enracine la troisième réduction : vivre, cela ne peut être que vivre-avec. Si la deuxième réduction quitte le solipsisme idéaliste pour retrouver le corps vivant, la troisième retrouve, sous le solipsisme de la vie, la primordialité de l’intersubjectivité. Ainsi, «l’être avec autrui est la condition de possibilité de la transcendance du monde, il est le fondement même de la constitution de la nature, du monde et de l’objectivité» (Vioulac, 2015, p. 165).La communauté de travail
Si l’intersubjectivité est le fond du fond du fond, l’Urgrund, qui apparaît suite aux opérations successives de la réduction, et puisqu’il ne peut y avoir d’intersubjectivité sans la préexistence d’une communauté et sans un processus constant de mise en commun, de communisation, alors le communisme peut être défini comme philosophie première : non plus comme une option politique parmi d’autres, mais comme le fond originel à partir desquels ces dernières peuvent jaillir. Il est la science de la communauté transcendantale en tant que fondement ontologique, qui considère chaque ego comme toujours déjà en relation avec la société comme totalité.
Avançons alors encore d’un pas : si le corps vivant est praxis et qu’il est corps-avec, inscrit dans la société, alors la communauté est communauté de praxis. De ce point de vue, le monde n’est jamais que l’humanisation du monde, c’est-à-dire son aménagement par la technique, les outils et les savoir-faire, si bien qu’il n’apparaît pas à travers nos sens mais se constitue par le façonnement de la matière par les communautés. La réduction conduit ainsi à mettre en évidence les impasses de la phénoménologie, limitée par sa perspective «esthétique», et reconduit, en contrepartie, à la primordialité de la phénoménotechnique : le travail, en tant qu’activité collective de production, est bien le lieu du jaillissement originaire du monde.
C’est bien pour cela que le capitalisme, qui n’est que l’autre nom de la Révolution industrielle, est le système de la suprême aliénation : non seulement parce qu’il parcellise le travail, qu’il coupe l’ouvrier de la conception et de la maîtrise de son travail, qu’il fait de la force de travail une marchandise, mais surtout parce qu’il demeure indifférent à tout travail concret en raison du primat accordé au travail abstrait : il ôte ainsi à la communauté de travail la conscience de son caractère transcendantal en vampirisant les fruits de son activité. En même temps que la valeur d’usage – qui n’est autre que cet arrangement du monde par l’homme – s’éclipse derrière la valeur d’échange – qui ramène toute chose au temps de travail social nécessaire –, le caractère producteur du travail se trouve happé par la Machine; cette captation du maniement – et donc de la phénoménotechnique ainsi que nous le vîmes dans la deuxième partie – par le Dispositif se définit très exactement comme Émancipation (ex manu capere) : «l’autonomisation des techniques procède de leur émancipation, c’est-à-dire de leur arrachement des mains de l’homme et leur fonctionnement automatique délié de tout enracinement dans l’activité humaine» (Vioulac, 2009, p. 302). L’émancipation transforme le maniement en management.
Conclusion : poétiques de la Révolution et du Spectacle
La communauté ne se vit jamais sous le seul mode du présent : nous sommes avec les vivants, bien sûr, mais également avec les morts, dont la présence se manifeste dans les sédiments de l’histoire qui forment le cadre de la praxis. Plus précisément, «toute communauté fait fond sur un humus de significations léguées par la tradition à laquelle elle appartient, et par son activité de formation de sens lègue aux générations futures une couche supplémentaire de significations» (Vioulac, 2022, p. 40). Pensée et langage s’avèrent indissociables, et c’est précisément ce nœud qui définit l’homme comme «affabulateur», comme «créateur prodigue de formes et d’images» (Vioulac, 2022, p. 248). De ce point de vue, et comme ne cessa de le répéter Jean-François Mattéi (voir à ce sujet : Rappin, 2016), le mythe constitue l’horizon de la raison, le logos ne peut se déployer sans l’appel du mythos; par conséquent, comme l’écrivent aussi bien Mattéi que Vioulac, la philosophie est en son essence une «mytho-logique». Le philosophe suit le poète et, dans l’oubli de cette dépendance originaire, le chasse de la cité.
Tirons alors le corollaire immédiat de la condition langagière et fictionnelle de l’animal humain : «le réenracinement de la phénoménalité dans le monde de la vie et le dépassement de ma détresse par un gai savoir [exigent] le renoncement à la science rigoureuse et l’élaboration d’un nouveau Mythe» (Vioulac, 2022, p. 250). Si donc jaillissement il peut y avoir, ce sera par les mots et les images : «refonder la vérité, c’est refonder la langue» (Vioulac, 2014, p. 147). Seuls les poètes endurent le mystère de l’origine tout en se maintenant dans l’étant et en faisant don du Poème à la communauté qui, si elle l’accepte, entre dans l’histoire sous sa garde. Le Poème est langue, et la langue cimente la communauté transcendantale qui fut identifiée plus haut comme le lieu originaire de constitution du monde.
Ce qui se joue donc dans la société du Spectacle, cette concentration du Capital dans les images, c’est l’accaparation par la Machine du statut de nouveau Mythe : «Mythe technologique qui définit le régime de phénoménalité contemporain et enfume l’humanité de sa production délirante» (Vioulac, 2022, p. 253). Le pouvoir des mots et des images n’y est plus mis au service de l’intersubjectivité et de la praxis communautaire, mais entretient l’asservissement à la religion de la performance. «D’où la tragédie du poète essentiel à notre temps de détresse, celui qui voulait "être absolument moderne", mais n’a pu que constater son impuissance face à la "barbarie moderne" et son "horreur économique" – impuissance à élaborer un nouveau Mythe face à la puissance monopolistique du Capital» (Vioulac, 2022, p. 253-254). Tout comme le Musée, le Spectacle neutralise la puissance politique des œuvres.
Notes
(1) Auquel Vioulac (2018b) consacre une très belle synthèse.
(2) Que le lecteur nous permette de le renvoyer à notre étude intitulée Heidegger et la question du Management (Rappin, 2015).
Bibliographie
La ville d’édition est toujours Paris, sauf exception alors indiquée.
Aristote, La Métaphysique, trad. Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (Pocket, coll. Agora, 1991).
Beaud Olivier, Le savoir en danger. Menaces sur la liberté académique (PUF, 2022).
Couffignal Louis, La cybernétique, (PUF, coll. Que sais-je ?, 1963).
Freitag Michel, Le naufrage de l’Université et autres essais d’épistémologie politique (La Découverte / MAUSS, 1995).
Heidegger Martin, Écrits politiques 1933-1966 (traduction de l’allemand par François Fédier, Gallimard, coll. Bibliothèque de philosophie, 1995).
Janicaud Dominique, La puissance du rationnel (Gallimard, coll. Bibliothèque des idées, 1985).
Rappin Baptiste, Heidegger et la question du Management. Cybernétique, information et organisation à l’époque de la planétarisation (Nice, Ovadia, coll. Chemins de pensée, 2015).
Rappin Baptiste, La rame à l’épaule. Essai sur la pensée cosmique de Jean-François Mattéi (Nice, Ovadia, coll. Au-delà des apparences, 2016).
Vioulac Jean, L’époque de la technique. Marx, Heidegger et l’accomplissement de la métaphysique (PUF, coll. Épiméthée, 2009).
Vioulac Jean, La logique totalitaire. Essai sur la crise de l’Occident (PUF, coll. Épiméthée, 2013).
Vioulac Jean, Apocalypse de la vérité (Éditions Ad Solem, 2014).
Vioulac Jean, Science et révolution. Recherches sur Marx, Husserl et la phénoménologie (PUF, coll. Épiméthée, 2015).
Vioulac Jean, Approche de la criticité. Philosophie, capitalisme, technologie (PUF, 2018a).
Vioulac Jean, Marx. Une démystification de la philosophie (Ellipses, coll. Aimer les philosophes, 2018b).
Vioulac Jean, Anarchéologie. Fragments hérétiques sur la catastrophe historique (PUF, 2022).
Lien permanent | Tags : philosophie, jean vioulac, baptiste rappin |  |
|  Imprimer
Imprimer
