Au-delà de l'effondrement, 69 : Le Troupeau aveugle de John Brunner (07/01/2024)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 L'effondrement de la Zone.
L'effondrement de la Zone. Il se pourrait bien que Le Troupeau aveugle (The Sheep Look Up) que John Brunner fit paraître en 1972 et qui fut traduit, comme toujours excellemment, par Guy Abadia en 1975 pour la mythique collection de Gérard Klein, Ailleurs & demain (1), décrive la société nord-américaine au moment précis de sombrer définitivement, constituant de la sorte une espèce de préambule involontaire à l'univers froid, minéral, sur le point de s'éteindre, que décrit Cormac McCarthy dans La Route; de fait, John Brunner est bel et bien «l'anthropologue horrifié de mondes qui existent presque» comme l'écrit Patrick Moran, à condition de préciser, immédiatement, qu'ils sont sur le point de disparaître.
Il se pourrait bien que Le Troupeau aveugle (The Sheep Look Up) que John Brunner fit paraître en 1972 et qui fut traduit, comme toujours excellemment, par Guy Abadia en 1975 pour la mythique collection de Gérard Klein, Ailleurs & demain (1), décrive la société nord-américaine au moment précis de sombrer définitivement, constituant de la sorte une espèce de préambule involontaire à l'univers froid, minéral, sur le point de s'éteindre, que décrit Cormac McCarthy dans La Route; de fait, John Brunner est bel et bien «l'anthropologue horrifié de mondes qui existent presque» comme l'écrit Patrick Moran, à condition de préciser, immédiatement, qu'ils sont sur le point de disparaître.Nul besoin d'accumuler, entre les deux romans, des détails qui sont autant de similitudes (ainsi de «la grisaille éternelle du ciel», p. 359 ou bien de la disparition des végétaux : «tout le monde savait qu'il n'y avait plus de fleur», p. 382, à propos d'une maladie de peau appelée muguet !, etc.), car nous savons déjà que nous avons perdu le monde, pourtant fort mal en point, que John Brunner évoque méthodiquement en braquant notre regard sur de nombreux aspects, tant écologiques que politiques, sociaux ou énergétiques, et nous le savons par ces textes placés en début de chaque chapitre portant des noms de mois, où sont ramassés, tout autant que des condensés d'une histoire mythologique décrivant la progression exponentielle de l'homme transformant l'univers qui l'entoure (cf. Profitons du bon temps ouvrant les événements du mois de mai, p. 189), des sortes de trouées narratives vers une réalité qui, dans le roman de Brunner, ne peut être que regrettée, ou alors considérée, retrouvée, rédimée, dans un inaccessible futur, de toute façon bouché, barré par un mur de flammes tellement géantes que leur éclat et la fumée qu'elles dégagent peuvent être perçus d'un continent à un autre : «Il faudrait prévenir les pompiers !» s'exclame ainsi un personnage, auquel il est répondu que «les pompiers auraient du chemin à faire», car «ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. Le vent souffle fort, aujourd'hui» (p. 414).
C'est la toute dernière ligne, ou presque, de notre roman puisque son ultime chapitre, intitulé L'Année prochaine, ne compte qu'une poignée de vers, extraits du Lycidas de Milton datant de 1638, quelques mots donnant son titre au roman de John Brunner :
«The hungry sheep look up, and are not fed, / But swol'n with wind, and the rank mist they draw, /Rot inwardly, and foul contagion spread».
Le monde que décrit John Brunner, à vrai dire, n'est plus visible dans son intégrité ontologique, pas même comme une parcelle, préservée, du Jardin d’Éden, puisque «cet organisme vivant que nous appelons notre mère la terre ne pourra plus supporter longtemps un tel traitement» (p. 405), ravagé qu'il est par les conflits, les maladies, dont certaines avaient pourtant disparues depuis des siècles mais qui réapparaissent opportunément, sans oublier la pollution non pas galopante mais victorieuse, l'eau contaminée, les ignobles maladies de peau, les malformations congénitales, les parasites qui deviennent indestructibles, les feux immenses nous l'avons vu, une violence endémique, provoquée par une nourriture contaminée ou par la simple envie d'en finir, une fois pour toutes.
C'est à cette aune non pas crépusculaire mais noire ou, chez McCarthy, grise, sépulcrale, qu'il faut se demander, en effet : «Quel avenir nous reste-t-il, Zéna ? Quelques milliers d'entre nous vivant dans des cavernes à air conditionné, nourris de cultures hydroponiques comme celles de Bamberley ? Pendant que nos autres descendants chercheront leur nourriture à la surface d'une terre empoisonnée, et que leurs gosses se traîneront, infirmes et malades, pires que des sauvages dégénérés, après des siècles de civilisation orgueilleuse ?» (p. 201).
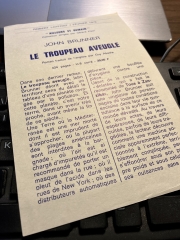 Il est impossible, dans ce roman qui semble être la terrifiante illustration de tel vers célèbre de William Butler Yeats, «Things fall apart, the centre cannot hold et que le prière d'insérer décrit comme «l'avertissement le plus saisissant lancé à la dernière génération qui puisse encore tenter quelque chose avant le cataclysme», réclame qui, pour une fois, n'est pas complètement fausse ni même exagérée, il est donc parfaitement impossible de revenir en arrière, y compris par l'action violente qu'incarnent les affidés d'Austin Train : le monde est vraiment en train de s'effondrer (2) pour, dans La Route, apparaître dans son horreur minérale, comme si Cormac McCarthy n'avait fait que suivre les intuitions de John Brunner, en effacer la multitude de trames, la complexité géopolitique et, lui-même, nous alerter non pas sur ce qu'il risque de se passer mais sur ce qu'il se passe, sur ce qu'il s'est passé à une époque difficile à préciser, pendant laquelle la Machine a pris le contrôle, a mis en coupe réglementaire, techniciste, nihiliste, une nature moins salie que corrompue, ne courant plus qu'à sa ruine comme un troupeau de moutons ou de ces porcs évangéliques infestés par la pourriture, vecteurs du Mal à l’œuvre qui, avant de se jeter du haut de la falaise, compte bien entraîner dans son irrésistible cavalcade le plus de monde possible, et même tout le monde, si cela lui est accordé.
Il est impossible, dans ce roman qui semble être la terrifiante illustration de tel vers célèbre de William Butler Yeats, «Things fall apart, the centre cannot hold et que le prière d'insérer décrit comme «l'avertissement le plus saisissant lancé à la dernière génération qui puisse encore tenter quelque chose avant le cataclysme», réclame qui, pour une fois, n'est pas complètement fausse ni même exagérée, il est donc parfaitement impossible de revenir en arrière, y compris par l'action violente qu'incarnent les affidés d'Austin Train : le monde est vraiment en train de s'effondrer (2) pour, dans La Route, apparaître dans son horreur minérale, comme si Cormac McCarthy n'avait fait que suivre les intuitions de John Brunner, en effacer la multitude de trames, la complexité géopolitique et, lui-même, nous alerter non pas sur ce qu'il risque de se passer mais sur ce qu'il se passe, sur ce qu'il s'est passé à une époque difficile à préciser, pendant laquelle la Machine a pris le contrôle, a mis en coupe réglementaire, techniciste, nihiliste, une nature moins salie que corrompue, ne courant plus qu'à sa ruine comme un troupeau de moutons ou de ces porcs évangéliques infestés par la pourriture, vecteurs du Mal à l’œuvre qui, avant de se jeter du haut de la falaise, compte bien entraîner dans son irrésistible cavalcade le plus de monde possible, et même tout le monde, si cela lui est accordé.Alors, demeure la lamentation et le rêve creux, plus d'une fois illustrés dans notre roman aussi implacable et mécaniquement lancé sur son élan destructeur que, certes fort rarement, donnant sa maigre place à l'ombre d'un regret ou, plus minuscule encore, quelque éphémère espoir vite emporté dans l'atmosphère pestilentielle, comme s'il avait été corrodé par une pluie acide qui détruit tout : «Il aurait pu lui dire : Je te montrerai des lacs qui ne sont pas souillés par les déchets des hommes. Des récoltes qui ont poussé sur du vrai fumier organique, avec de l'eau de pluie non souillée. Je te ferai manger des pommes cueillies sur des arbres qui n'ont jamais été traités à l'arsenic. Je te couperai du pain dans une miche qui te réchauffera les mains de la chaleur du four. Je te donnerai des enfants qui n'auront rien à craindre de pire que la bouteille lâchée par un ivrogne, qui marcheront droit, le sourire aux lèvres et la parole claire. Et cette parole serait emplie des échos d'une langue qui était celle de la civilisation il y a un millier d'années» (p. 244), mais, avec le monde qui se disloque, c'est aussi le langage capable de le chanter qui se désunit irrémédiablement, comme Cormac McCarthy l'a remarquablement montré dans La Route.
Vivant dans un univers de plus en plus dangereux, qui se fragmente ou s'effondre sous son propre poids, on peut, en effet, «presque croire que le monde en dehors de ce que l'on pouvait voir était en train de se dissoudre» et que, en conséquence, «ce que montrait la télé et que les journaux racontaient était une supercherie» (p. 296), mais ce discret tropisme du côté de Philip K. Dick, que Patrick Moran a raison d'opposer à John Brunner (cf. p. 12 de sa préface), n'est pas davantage exploré, et n'a même pas besoin de l'être, tant les personnages mis en scène, comme ceux de T. S. Eliot, ne paraissent être rien de plus que des hommes creux, la cervelle remplie d'un peu de bourre.
 L'action terroriste, même animée de beaux idéaux écologiques, ne peut ainsi rien faire, sinon ajouter le désordre au désordre car, ce qu'il faudrait, glisse l'un des personnages du roman de John Brunner, un certain Dr Untel, c'est une véritable purge, et pas simplement une fois par an et limitée aux États-Unis, comme a pu l'illustrer une récente série de plusieurs films simplistes : «si nous creusons trop profondément le sujet, nous risquons de découvrir que nous avons tellement dépassé les limites de ce que la planète est capable de supporter que seule une catastrophe majeure qui réduirait de manière draconienne à la fois la population du globe et nos possibilités d'interférence dans le cycle biologique naturel pourrait nous offrir une chance de survivre», et cette catastrophe, ajoute-t-il, «ne peut pas être une guerre, car cela détruirait encore plus d'espace cultivable» (p. 305). Il semblerait que Brunner ait ainsi en tête la possibilité d'une mystérieuse pandémie réduisant drastiquement le nombre d'habitants de cette planète ravagée.
L'action terroriste, même animée de beaux idéaux écologiques, ne peut ainsi rien faire, sinon ajouter le désordre au désordre car, ce qu'il faudrait, glisse l'un des personnages du roman de John Brunner, un certain Dr Untel, c'est une véritable purge, et pas simplement une fois par an et limitée aux États-Unis, comme a pu l'illustrer une récente série de plusieurs films simplistes : «si nous creusons trop profondément le sujet, nous risquons de découvrir que nous avons tellement dépassé les limites de ce que la planète est capable de supporter que seule une catastrophe majeure qui réduirait de manière draconienne à la fois la population du globe et nos possibilités d'interférence dans le cycle biologique naturel pourrait nous offrir une chance de survivre», et cette catastrophe, ajoute-t-il, «ne peut pas être une guerre, car cela détruirait encore plus d'espace cultivable» (p. 305). Il semblerait que Brunner ait ainsi en tête la possibilité d'une mystérieuse pandémie réduisant drastiquement le nombre d'habitants de cette planète ravagée.Austin Train a beau se cacher, faire le digne office d'éboueur, «vider les poubelles», conduire un camion-benne pour charger «des successions sans fin de wagons qui allaient déverser leurs tonnes de matières plastiques imputrescibles au fond des puits de mines abandonnées, comprimant des déchets ménagers destinés à être vendus comme compost aux entreprises d'aménagement du
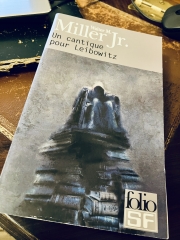 désert, piétinant dans des bottes énormes, étanches, inondées de sueur, des montagnes de verre brisé et de boîtes de conserves écrasées», puis revenir à l'action sous les feux de la rampe, il sait parfaitement que «dans mille ans, peut-être, toutes ces choses qu'il aidait à enterrer seraient exhibées dans des musées. S'il y avait encore des musées dans mille ans» (p. 306), cette interrogation apportant moins d'ironie que de pessimisme aux propos de Walter M. Miller dans son si fameux (et à juste titre) Cantique pour Leibowitz datant de 1959.
désert, piétinant dans des bottes énormes, étanches, inondées de sueur, des montagnes de verre brisé et de boîtes de conserves écrasées», puis revenir à l'action sous les feux de la rampe, il sait parfaitement que «dans mille ans, peut-être, toutes ces choses qu'il aidait à enterrer seraient exhibées dans des musées. S'il y avait encore des musées dans mille ans» (p. 306), cette interrogation apportant moins d'ironie que de pessimisme aux propos de Walter M. Miller dans son si fameux (et à juste titre) Cantique pour Leibowitz datant de 1959.Les scènes éclatées ne sont pas franchement une nouveauté en littérature, y compris chez John Brunner ayant expérimenté cette forme de narration kaléidoscopique dans Tous à Zanzibar mais, dans Le Troupeau aveugle, cette technique semble avoir été suffisamment maîtrisée pour ne pas interrompre inutilement la lecture, se demander quel est le personnage en action, ses liens avec les autres personnages et devoir s'interroger sur le sens de l'intrigue générale, innervée par une multitude de radicelles narratives; nous pouvons même tomber sur quelques lignes splendides, comme sorties d'une noire vision de Georg Trakl évoquant le long labeur du temps qui tout détruit, déchiquette et corrompt (cf. pp. 352-3), morceaux qui donnent raison à Patrick Moran qui affirme que John Brunner, «avant d'être un futurologue, est quelqu'un qui examine le réel sans détours et qui le restitue pour ses lecteurs avec une intensité hallucinatoire» (3).
C'est donc retrouver le sens premier du mot prophète qui n'est pas tant celui qui annonce le futur, dont on peut finalement longuement s'accommoder avant qu'il ne devienne une menace réellement dangereuse pour la sécurité du troupeau de moutons, que celui qui dénonce le temps présent, la maladie dévorant ces dernier de l'intérieur.
Notes
(1) J'ai relevé quelques fautes dans cette édition, qui ont toutes été corrigées dans le fort volume dédié à la tétralogie noire, à l'exception d'une : «car sinon sa voiture serait coincée là où Peg et Félice l'avaient trouvée», si l'on considère bien sûr que c'est la voiture et non son conducteur qui a été trouvée (p. 173 dans la première édition du roman).
(2) «Bon Dieu !» s'écria-t-il. Puis il répéta : «Bon Dieu ! C'est comme si le monde était...» «En train de s'effondrer ?, avança-t-elle, et voyant qu'il ne disait rien, elle hocha la tête» (p. 342).
(3) Voir l'excellente préface donnée par ce commentateur à son édition de La tétralogie noire chez Mnémos, 2018, p. 6. La toute première citation de notre préfacier se trouve à la page 11. Je signale une petite faute dans cette préface où manque un mot, «Dick contribue lui aussi par une nouvelle à l'anthologie», p. 12.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, science-fiction, au-delà de l'effondrement, john brunner, le troupeau aveugle, cormac mccarthy |  |
|  Imprimer
Imprimer
