« La littérature sous le soleil noir de la violence, 1 | Page d'accueil | La littérature sous le soleil noir de la violence, 2 »
16/06/2012
Relecture de La Route de Cormac McCarthy
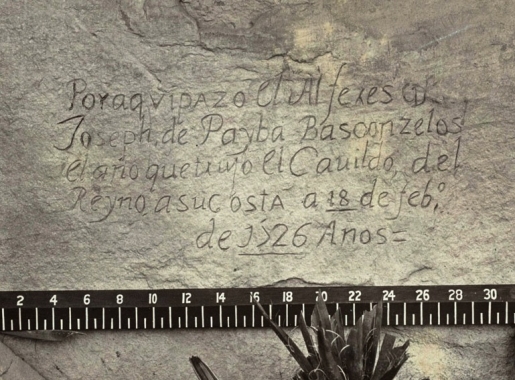
Au petit Enzo, dont je n'oublierai jamais le corps ravagé par la souffrance, cet après-midi où je le vis prostré sur une chaise, le regard plein d'une connaissance et d'une douleur au-delà de tout mot.
 Cormac McCarthy dans la Zone.
Cormac McCarthy dans la Zone.Ajout du 6 septembre 2015
Ma lecture de La Route a été citée par Manuel Broncano dans un ouvrage intitulé Religion in Cormac McCarthy’s Fiction: Apocryphal Borderlands, publié en 2014 par Routledge, ici.
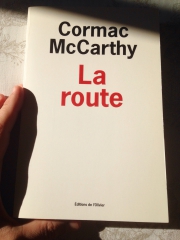 Acheter La Route sur Amazon.
Acheter La Route sur Amazon.Comme nul autre roman à ma connaissance, La Route nous plonge in medias res dans l'horreur. Cormac McCarthy ne s'intéresse pas aux causes (des feux immenses, capables de faire fondre des bâtiments entiers, dont on ne connaît pas la raison) qui ont provoqué la catastrophe et n'évoque que de quelques mots l'historique de la dégradation, dont nous ne savons si elle a été progressive ou fulgurante, des conditions de vie ou plutôt de survie, qui sont le lot quotidien d'un père accompagné de son fils, sur la route depuis plusieurs années, en direction du sud.
Nous savons quand même que, durant «les premières années» ayant suivi la catastrophe, «les routes étaient peuplées de fugitifs disparaissant sous leurs habits» (p. 30) et nous savons aussi que «les sectes sanguinaires» se sont «sans doute mutuellement consumées» (p. 20), même si, plus d'une fois, le père se trouve confronté avec le répugnant spectacle de rites anthropophages et démoniaques, qu'il ne peut comprendre. La barbarie, au sens étymologique du terme qui évoque un langage inarticulé, du moins incompréhensible par les hommes de raison, est bien réelle même si elle paraît devoir elle aussi disparaître avec toute forme de vie.
Une attention aussi peu romanesque (puisque le fait d'évoquer, a contrario, ces péripéties apocalyptiques constitue la matière première essentielle des autres romans évoquant les conséquences de la catastrophe) doit donc nous faire soupçonner un motif dans le tapis, que nous résumerons par la double trame ou questions suivantes, que Cormac McCarthy nous semble poser à chacune des pages de son roman : qu'est-ce qui peut être sauvé dans un monde en ruines ?, mais surtout, comment sauver ce qui mérite de l'être ?
Commençons tout d'abord par évacuer toute forme d'espérance dans une résurrection du monde tel qu'il a été. Dans La Route, l'univers désolé et surtout, de plus en plus désolé que traversent un père et son fils est radicalement privé de vie, livré tout entier à la consomption et à la disparition de la lumière, obstruée par une atmosphère de fine poussière qui s'est répandue partout.
Les premières lignes du roman sont saisissantes, qui se contentent de décrire une scène que l'on dirait biblique, puisque sans âge : «Les nuits obscures au-delà de l'obscur et les jours chaque jour plus gris que celui d'avant. Comme l'assaut d'on ne sait quel glaucome froid assombrissant le monde sous sa taie» (p. 9).
Le monde en ruines se dissout : «Les contours de toute chose s'estompant dans la pénombre» (p. 10) alors qu'une scène nous décrit le père «[c]herchant n'importe quoi qui eût une couleur» (ibid.) dans un paysage où la végétation n'est plus que tiges et arbres morts, «la campagne [étant] dévastée» (p. 11), les animaux tous morts, à l'exception d'un chien errant dans les ruines d'une ville que nous ne verrons même pas.
«Toute chose telle qu'elle avait été jadis mais décolorée et désagrégée» (p. 13), «la forme d'une ville apparaiss[ant] dans la grisaille comme une esquisse au charbon de bois tracée sur les terres dévastées» (pp. 13-4), cette image en creux, ce négatif, au sens photographique du terme, étant systématiquement repris par Cormac McCarthy tout au long de son roman, y compris lorsque le romancier décrit le monde d'avant l'effondrement, tel que l'a par exemple contemplé le père lorsqu'il était enfant et se promenait avec son oncle : «La rive était bordée de bouleaux, leurs troncs d'une pâleur d'os se détachant sur l'arrière-plan plus sombre des conifères» (p. 17).
Ailleurs, ce sont «les formes noircies des roches» qui émergent «des bancs de cendre» chichement éclairés par un «morne soleil invisible sur sa trajectoire de l'autre côté des ténèbres» (p. 18) ou bien une «indécise lumière», «frissonnante et sans origine, réfractée dans l'averse de suie à la dérive» (p. 19).
Un autre passage du texte semble condenser toutes les caractéristiques spectrales de ce monde vidé de sa substance et lui ajouter (ou plutôt, retirer) une dimension supplémentaire, puisque la terre dévastée que traverse la route est privée de toute forme de transcendance : «Il était couché et écoutait le bruit des gouttes dans les bois. De la roche nue, par ici. Le froid et le silence. Les cendres du monde défunt emportées çà et là dans le vide sur les vents froids et profanes. Emportées au loin et dispersées et emportées encore plus loin. Toute chose coupée de son fondement. Sans support dans l'air chargé de cendre. Soutenue par un souffle, tremblante et brève. Si seulement mon cœur était de pierre» (p. 16).
Mais il ne l'est pas, du moins pas encore et, à vrai dire, il ne le sera jamais, grâce à la présence de l'enfant.
Le monde d'au-delà de l'effondrement est obscur, silencieux, mort, froid et hermétiquement clos sur lui-même («froide obscurité autiste», p. 19). Il est absurde, comme l'indique le fait que le vent se contente désormais de faire circuler les cendres sans relâche, d'un pôle à l'autre. Ce monde ne possède plus de fondement, comme celui que le grand poème de William Butler Yeats intitulé The Second Coming évoque mais aussi, il est devenu ou redevenu profane, à tel point que l'univers en train de se dissoudre, en offrant l'«accablant contre-spectacle des choses en train de cesser d'être», peut toutefois permettre d'expliquer et de «voir comment il était fait» (p. 234), comme si le délire technologique ayant, probablement, conduit à la catastrophe, allait enfin permettre à l'homme de faire aboutir son rêve le plus ancien, connaître la création comme s'il en était le maître. Un maître de mort, qui l'a détruite.
Pourtant, ce monde, pour un temps encore, porte la vie : le survivant qui regrette d'être encore vivant et qui ne peut s'empêcher d'avoir cette pensée impie : ce sont peut-être les rêves qu'il fait (le roman s'ouvre par l'un d'entre eux) qui représentent la tentation la plus dangereuse de la mort (p. 24), laquelle lui rend le spectacle qui l'entoure insupportable.
La suite de cet article figure dans Le temps des livres est passé.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici.





























































 Imprimer
Imprimer