Apologia pro Vita Kurtzii : Suttree de Cormac McCarthy (18/12/2006)

Crédits photographiques : David Gray (Reuters).
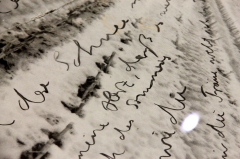 Apologia pro vita Kurtzii.
Apologia pro vita Kurtzii.«What I distinctly admit is the fault of having made Kurtz too symbolic or rather symbolic at all. But the story being mainly a vehicle for conveying a batch of personal impressions. I gave the rein to my mental laziness and took the line of the least resistance. This is then the whole Apologia pro Vita Kurtzii – or rather for the tardiness of his vitality.»
Lettre (3 décembre 1902) de Joseph Conrad à Mrs. E. Hueffer in Conrad, Heart of darkness édité par Robert Kimbrough (Norton Critical Editions, 1988), p. 211.
«J’ai lu Conrad comme un auteur prophétique qui avait prévu toutes les horreurs à venir.»
Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes (Le Serpent à plumes, 2002), p. 11.
«En juin, on ne lit pas : on fait du sport devant la télé.»
Pierre Assouline, réponse complexe à une question qui ne l'était pas moins, Le Magazine des livres n°1, novembre-décembre 2006, p. 7.
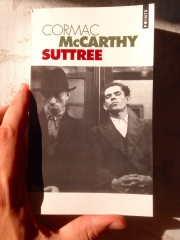 Acheter Suttree sur Amazon.
Acheter Suttree sur Amazon.Ces quelques lignes, spectrales et peut-être même difficiles à comprendre (quelle est donc leur visée sinon celle, purement architecturale, d'ajouter une nouvelle marche au long escalier plongeant dans le royaume souterrain ?), se veulent, comme en passant et sans qu'il en aille aucunement de leur nécessité profonde, l'anti-Assouline absolu, autant dire, un amer cordial contre la facilité journalistique consacrée en système publicitaire : non pas une écriture qui se prétend, à force de stupide transparence toutefois grumelée de fautes innombrables (de grammaire, de style, de pensée...) et d'approximations stakhanovistes, aussi aisée à lire que sa leçon, administrée devant un parterre d'idiots, est profondément inutile, ridicule encore dans sa prétention, en suçant l'actualité sale, à tenter (et à échouer) de donner à ses piètres lecteurs une idée évidemment fausse de ce qu'est la littérature mais bien, au contraire, une écriture difficile, parfois (souvent, voir la colonne de droite, catégorie Art poétique) assumant volontairement le risque de l'hermétisme. Se fera, devra se faire la communication indirecte, la redécouverte, par mon lecteur, s'il l'est réellement, s'il est donc opiniâtre et considère comme un péché contre l'esprit d'abandonner la lecture d'un livre (à la différence de cet imbécile insinuant qui m'écrivait tout récemment), la re-duplication, à ses propres fins elles-mêmes personnelles et donc incommunicables (hormis de cette façon dangereuse et rien de moins que facile) de ce que j'ai voulu dire.
La Zone est le silence, non point le mutisme qui est le bavardage de l'idiot, Pierre Assouline s'il l'on veut mais tout autant l'innombrable flatulence grasse des sites dits littéraires, tenus par les clones du journalier de nos lettres et par les pionnes sottes et surtout incultes (ici, chers lecteurs, les noms que je donne sont modifiables à souhait...) Adeline Bronner, Éli Flory ou Oriane Jeancourt, pesante trinité que je m'imagine toujours comme une espèce de trilobite paradoxal puisque le céphalon, par goût pervers de quelque démiurge n'aimant pas Darwin, a été remplacé par une longue bouche filtrant les plus insignifiants planctons de l'actualité : ce qu'ils, ce qu'elles n'ont pas honte de nommer littérature. La littérature pourtant est tout ce que l'on voudra sauf la facilité ou l'actualité, cette médiocrité bavante dont Pierre Assouline est sur la Toile l'un des plus fidèles apôtres, toujours désireux de rapporter la dernière bonne parole dégoulinant de l'énorme bouche cariée du On, qui, à force de prêcher, a transformé la terre en désert. Un désert où virevoltent comme une toupie devenue folle les paroles trompeuses et sordides, où surgissent les mirages égarant les mauvais yeux, leur faisant aisément confondre un écrivain et une baudruche. La littérature est tout ce qu'on voudra sauf ce que pense Assouline qu'elle est : un divertissement source de profits publicitaires et, parfois, une petite expérience inédite comme peut l'être, inespérée, la rencontre d'une belle femme au Lutetia, devant laquelle il va s'agir, pour escompter quelques mots minaudiers et peut-être même une nuit aussi luxueuse qu'horrible et vaine, de parader; elle est, cette littérature, tout ce qu'on voudra sauf la réconciliation d'une sottise que l'on dirait proprement surréelle entre deux poètes, disons Celan et Darwich, aussi mal lus l'un que l'autre par notre apprenti lecteur. Elle est même, cette littérature que je ne confonds pas avec l'immonde nullité journalistique qui s'abouche à elle comme une lamproie irrésistible, elle est même pour Bataille, l'expérience la plus cruciale du Mal. En somme, la littérature est le monde, sa prose luxuriante qu'il s'agit de savoir lire, comprendre, même déchiffrer si la difficulté est d'abord l'évidence d'une parole claire et pourtant hermétique, Assouline, qui ne sait rien de Primo Levi (et de Paul Celan, et de Mahmoud Darwich et de tous les écrivains qu'il commente misérablement), confondant obscurité (pourquoi pas celle de ses écrits pourtant transparents) et tradition hermétique.
Je délaisse, dégoûté, les livres faciles (par exemple : Être de droite, un tabou français d'Éric Brunet), purs produits consommables oubliés dans quelques jours sinon quelques heures, par retour d'un temps qui, lorsque les vrais livres sont ouverts, doit couler en heures d'un calme profond, incompressible, altier, doit s'engouffrer, pour y être miraculeusement distendu, dans le livre ouvert, infini. Ainsi ai-je pu lire, comme toujours en m'accablant de reproches pour ne pas m'être plus tôt soucié de pareil écrivain, les romans de Cormac McCarthy, mon alibi commode pour ne point lire, je l'ai déjà écrit, justement par manque d'un temps labile, Les Bienveillantes de Littell, gros roman hélas submergé sous les mots du On, les mots que mâchonne Pierre Assouline sans jamais se rendre compte qu'ils sont un peu plus sales, lorsqu'il les recrache, qu'au moment où sa vieille bouche sotte s'est ouverte pour les mastiquer. D'abord, sidéré à mesure que ma lecture progressait, Un Enfant de Dieu (le troisième roman) qui détaille le parcours d'un tueur en série, puis remontée à la source avec L'Obscurité du dehors (le deuxième) évoquant les aventures misérables d'une jeune mère à la recherche de son nourrisson, fruit des amours avec son propre frère qui n'a pas craint d'abandonner son enfant et enfin le premier, peut-être, en raison du prisme trompeur que m'a procuré cette lecture erratique, le roman qui m'a le moins plu, Le Gardien du verger. Revenant ensuite à une progression normale, linéaire (alors même que la littérature est ellipse fondamentale et s'accommode en fin de compte de pareils tours et détours) Suttree depuis quelques jours, superbe, immense, noir, long sanglot psalmodié de l'homme moderne réduit à rien, sorte de coruscante débandade d'un Bardamu qui serait resté en Amérique du Nord pour y crever d'ennui, d'alcool et de bagarres aux couteaux. Sertis dans ce miserere ténébreux, des éclats somptueux de beauté (comme les toutes premières pages du roman, comme le long épisode où Suttree aime la jeune fille d'un couple avec lequel il s'est associé pour pêcher des moules dont ils récupèrent les perles contrefaites), et puis, surtout, le génie unique consistant à faire de la destinée d'un seul le miroir où convergent les regards de la multitude des humiliés et des offensés. Je ne puis devenir Bardamu, dont l'errance exemplaire paraît encore trop grandiloquente, bien trop littéraire, trop française en un mot. Je pourrais m'imaginer, revenu de mes dernières illusions, triste Leopold Bloom ayant jeté au feu la littérature déchue, revêtant les guenilles de Suttree, ami fidèle d'arsouilles faméliques et avinés, protecteur providentiel de quelque éternel chapardeur Gene Harrogate. Suttree n'a point de haine, à la différence de Bardamu, sa guigne est celle d'un péan consommé, sans éclat ni fureur, elle paraît avoir été choisie sans regret, avec même quelque volonté de dépouillement : sans doute est-ce pour cela qu'il n'insulte pas la beauté et sait la voir sans désirer même la retenir. L'errance de Suttre ne me paraît point bileuse comme celle du double de Céline; je la rapprocherais plutôt de celle décrite par Gadenne dans L'Avenue, même si les signes d'une quête initiatique sont infiniment ténus dans le roman de l'Américain. McCarthy écrit ainsi : «Avançant à la rame délicatement sous la pluie parmi ces curiosa il se sentait à peine plus qu’un de ces objets sortis du filtre de la terre et emportés dans le courant, s’écoulant de la ville, cette forme froide et granuleuse au-delà de la pluie que nulle pluie jamais ne pourrait laver de ses souillures». Surtout, cet homme devenu, apparemment en toute conscience, épave n'est pourtant pas vide, Suttree n'est point un de ces hommes creux décrits par T. S. Eliot agitant aux vents leur caboche remplie d'un peu de bourre. En ses veines coule la sève du monde, dont la rivière puante qu'il ne cesse d'explorer (il exerce la noble profession de pêcheur) constitue le microcosme évident. Ce rapprochement entre Suttree et Bardamu ne vaut rien d'ailleurs, ce n'est là qu'une facilité, une paresse que je destine aux lecteurs du piètre journaliste Pierre Assouline, tout contents peut-être de retrouver sous leurs yeux chassieux, qui paraissent même ne jamais s'être ouverts sur un livre, quelque habituelle non-construction verbale de nature mollement invertébrée, si pauvrement illustrative des fadaises pressées de l'universel reportage, pas même pertinente puisque Bardamu s'enfonce volontairement dans la nuit alors que Suttree, selon le très beau mot que Faulkner adressa à sa nourrice noire lorsqu'elle mourut, endure, se tient droit :
«Ce n’est pas seulement dans les ténèbres de la mort que toutes les âmes ne sont qu’une seule et même âme.
De quoi te repentirais-tu ?
De rien.
De rien ?
D’une chose. J’ai parlé avec amertume de ma vie et j’ai dit que je prendrais ma propre défense contre l’infamie de l’oubli et contre sa monstrueuse absence de visage et que je dresserais une stèle dans le vide même sur laquelle tous liraient mon nom. Cette vanité je l’abjure tout entière.» Et puis demeure, bouleversante, une véritable fraternité des ébranlés, une communion des saints, donc des pécheurs, dans Suttree, qui aurait étonné, voire sûrement choqué l'altier Céline, peu préoccupé, du moins dans sa littérature, de faire étalage de bonté : «La nuit dans le lit en fer tout en haut de la vieille maison de Grand il restait éveillé et entendait les sirènes, clameur solitaire dans la ville, dans les rues vides. Il gisait dans sa chrysalide de ténèbres et ne faisait aucun bruit, partageant sa peine, parcelle après parcelle, avec ceux qui baignent dans leur sang au bord de la grande route ou sur le sol des tavernes jonché de verre ou dans une prison, menottés. Il se disait que même les damnés de l’enfer ont une communauté de souffrance et pensait que semblablement il saurait estimer un chagrin nominal chez les vivants comme sont pesés à la métairie désastre et ruine selon des lois d’une équité trop subtile pour être prédite.»
Il faut parler, à propos des romans les plus aboutis de McCarthy (dont, incontestablement, le très violent Méridien de sang est l'épure) d'un véritable élargissement, la prose magnifique du romancier américain devenant grosse d'un mystère qui la dépasse mais devant lequel elle ne désespère point. On dirait que Céline, de rage, détruit ce qu'il ne peut ou veut comprendre. McCarthy ne se couche pas ni ne cille devant le sombre spectacle de l'horreur : il se tient debout devant elle et consigne minutieusement chaque élément de la scène, cadavres en putréfaction, bagarres inouïes, cannibalisme, tueries abominables, lâchetés insignes, sabbats autour des feux sorciers. Contrairement à nos maigres bavards qui se gargarisent d'un paganisme approximatif coupé à l'eau plate d'un catéchisme de Procure et chiquent puis recrachent, à la demande des pions aisément choqués, un Christ verdâtre qui n'a plus qu'une fort lointaine parenté avec celui des Évangiles et ressemblerait plutôt à la pâte molle et versicolore de quelque sucrerie gluante sucée par un Lautréamont en culottes courtes, McCarthy ne s'embarrasse pas de méandreuses circonlocutions prétendant épuiser l'indicible ou son contraire, l'ineffable. McCarthy écrit. Un romancier dit et ne renonce jamais : un faux romancier, un romancier raté comme l'a été Maurice Blanchot, écrit pour dire qu'il ne peut pas écrire ou bavarde, comme Louis-René des Forêts, pour affirmer que l'essence du langage est de toute façon un impondérable qu'aucun discours ne pourra définir. McCarthy, lui, écrit et ne renonce pas : il est comme Goya griffonnant sans relâche ce qu'il voit et, plus encore, ce qu'il a vu, l'horreur à venir, l'horreur présente et passée (multipliant les masques comme le diable des Veilles de Bonaventura, l'horreur n'a pourtant qu'un seul visage que nul n'a vu) à quelques pas des charniers et des atrocités de la guerre. Notre romancier, soulignons-le, pérore toutefois moins que Goya affichant lourdement, dans l'une de ses plus célèbres gravures, son lumineux (et nigaud) credo révolutionnaire : El sueño de la razón produce monstruos, pieuse bêtise reprise par toutes les comptines maçonniques puisque nous savons que c'est au contraire le plein jour de la Raison qui enfante les monstres les plus innommables.
Osant écrire et ne réussissant jamais mieux dans sa tâche d'écrivain qu'en décrivant la rude matérialité des paysages (et certes leur magnifique beauté, ferment spirituel), il serait pourtant stupide d'affirmer que McCarthy manquerait de subtilité et qu'il renoncerait comme Zola, par bêtise d'esprit et lourdeur d'âme, à tenter d'évoquer les aériennes et inconstantes volutes, les très fins signes se dissipant dès que la plus petite inattention de celui qui observe a troué malheureusement la fragile harmonie entre les deux mondes. Car, dans les romans de McCarthy, l'élargissement que nous avons évoqué est aussi arche entre le monde visible et celui, invisible, dont les signes noirs et démoniaques ensemencent la terre dévastée, en constituent comme la doublure, la chair seconde existant depuis les premiers âges de l'univers : «Lumière de soufre. Y a-t-il des dragons dans les coulisses du monde ?». Pour McCarthy, évident lecteur de Shakespeare bien que nous ne sachions presque rien des goûts du personnage, le monde est infiniment plus riche que notre esprit ne saurait l'imaginer. Ainsi l'errance crépusculaire de la bande de sordides meurtriers décrite dans Méridien de sang est-elle, comme la course décrite par Lord Dunsany dans Carcassonne, comme les chevauchées, au plus profond de la nuit, de Metzengerstein et de Jambe-de-Laine, comme déjà, dans L'Obscurité du dehors, l'errance meurtrière du trio infernal, d'ordre mythique. Le mot ordre a son importance : l'arrière-monde qui détoure chacun des actes de ces personnages frustes (ou diaboliquement cultivés, comme l'est dans Méridien de sang la figure inquiétante du juge Holden, nous y reviendrons dans une note future) n'est pas moins important que le monde, faisant mentir Bonnefoy dont les orangeraies, il est vrai, n'ont jamais connu un débordement de sang capable, comme chez McCarthy, de déchirer la trame du visible pour pointer vers une dimension non pas supérieure à la nôtre mais inscrite au plus secret recès du paysage qui nous entoure, constituant sa doublure mauvaise : «Cette nuit-là il ne fit même pas de feu. Il se recroquevilla comme un singe dans le noir sous le rebord d’une falaise de schiste et contempla les éclairs. En bas, dans le bois, les troncs de bouleaux luisaient faiblement et les troupes d’une cavalerie fantôme s’entrechoquaient dans un ciel outragé, antiques revenants armés des outils rouillés de la guerre entrant en collision parallactiquement les uns contre les autres comme les silhouettes d’une fosse commune tondues et ceinturées et projetées avec une portée terrifiante à travers la nuit fracassante et au bas des pentes plus lointaines dans le noir et la noirceur encore à venir.»
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, romans, démonologie, cormac mccarthy |  |
|  Imprimer
Imprimer