Ce Dieu qui n'en finit pas de crever... (10/11/2015)
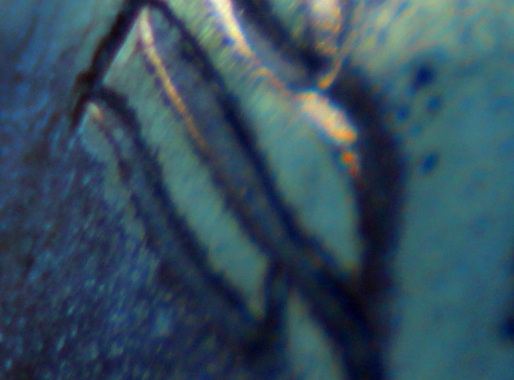
Photographie (détail) de Juan Asensio.
J’ai commencé la lecture de L’Imbécile, dont voici la troisième résurrection après une première naissance en 1991 et une deuxième en 2003 avant, sans doute une quatrième puis une cinquième renaissance, bien accordée à ce genre d’éphémère publication. Je dois avancer dans la lecture de ce numéro premier redivivus avant d’en parler, caractéristique qui suffira à m’isoler de la majeure partie du troupeau journalistique, qui parle (et parfois hélas, écrit) de ce qu’il n’a pas lu, jamais lu et a bien l’intention de ne jamais lire.
Conversation, il y a quelques jours, avec Laurent Schang, rencontré dans un café huppé du Trocadéro, où nous parlons en toute franchise de Cancer ! ainsi que de son expérience, éphémère elle aussi, de journaliste au Figaro Littéraire. Il ne m’apprend rien, d’ailleurs, sur les lamentables mœurs de cette congrégation d’impuissants habiles à la promotion que je ne sache déjà, sans avoir pourtant jamais fréquenté de bien près cette fuligineuse zone, pardon, fosse, où Babel creuse son puits d’insignifiance.
Relisant depuis quelques jours beaucoup de textes de Karl Kraus le grogneur (il s’agit là d’une épithète dite de nature), je note cette expression trouvée dans Cette grande époque, mystérieuse et bien accordée, comme toujours avec cet auteur fascinant, avec une sorte de déhiscence roublarde du Mal dont l’empire fumeux était dans son esprit favorisé par le bavardage de la Presse : «Le cadavre trouvé dans une valise représente l'indispensable sensation sans laquelle, en une époque aussi bruyante, on ne découvre plus rien».
Le cadavre, qu’il soit sec ou purulent : c’est le sujet même d’un texte que j’écris qui me coûte beaucoup de peine puisqu’il tente de rapprocher la mort de Dieu de celle de la parole et c’est aussi, étalé sur la table de dissection du Stalker, l’immonde bloc de chair putride que goûte délicatement, avec des baguettes de geisha experte, notre plus grand critique littéraire, que je n’ai pas besoin de nommer puisqu’il est un inrockuptible intellectuel.
C’est aussi, j’allais l’oublier, le sujet d’un des livres de Glucksmann dont j’avais rendu compte pour la revue (hélas trop méconnue hors de sa sphère d’influence directe, comme disent les géopolitologues dans leur pidgin) Liberté Politique.
Descend lower, descend only
Into the world of perpetual solitude,
World not world, but what which is not world,
Internal darkness, deprivation…
Into the world of perpetual solitude,
World not world, but what which is not world,
Internal darkness, deprivation…
André Glucksmann, La troisième mort de Dieu (Nil éditions, 2000). Les chiffres entre parenthèses renvoient à cette édition.
 Si la philosophie commence avec l'étonnement, l'interrogation qui ouvre l’essai de Glucksmann intitulé La troisième mort de Dieu devrait constituer l'évidente pierre d'achoppement, le scandale sur lesquels buttent le marcheur insouciant : «L'effacement du Très-Haut dans l'Europe contemporaine paraît d'autant plus étrange qu'il va de soi» (p. 19). En somme, le philosophe, dans cet ouvrage, s'étonne du fait que, justement, il n'y a pas – ou plus – d'étonnement. Et l'auteur d'insister précisément, de mettre à nu la plaie qui afflige l'immense corps européen, perclus d'ennui et de tristesse : non seulement Dieu est absent plutôt que caché – cette occultation ou éclipse selon Buber renvoyant au Deus absconditus d'Isaïe et de la tradition de l'apophatisme illustrée par Denys l'Aréopagite ou Maître Eckhart –, mais cette place est trouvée vacante, vide, hantée seulement par le fantôme pitoyable de l'antique présence, comme Michel De Certeau le soulignait naguère (1), comme l'auteur se plaît aussi à le rappeler : «Ce n'est point Dieu qu'il s'agit de remplacer, c'est sa place même qui ne se trouve plus» (p. 25). Dieu est donc mort, point n'est besoin de prêter au plus laid des hommes nietzschéens de criard haut-parleur pour faire écho à la nouvelle, comme on raconte que, sur les rivages de l'Antiquité, une voix, sépulcrale et terrible, annonça la mort du dieu Pan. Mais, à la différence de l'espèce d'insouciance enfantine qui illumine le grand midi du penseur de Sils-Maria, nadir de fausse félicité plutôt que zénith orientant la carrière du surhomme dédouané de ses fausses idoles, le penseur moderne doit constater, avec un regret à peine voilé – et sans doute une secrète nostalgie – que la faille ouverte dans l'Être, ce schisme dont parlait le grand Maistre en tentant de caractériser le Mal, loin d'avoir été comblée par quelque dieu grotesque de ferraille et de boulons devant lequel, au moins, se prosterner, a été au contraire creusée, excoriée, fouillée jusqu'à son tuf de noirceur primordiale. A la place d'un roc ou d'un os, de cet ungründ cher à Böehme, que trouve-t-on sinon le vide, la révulsante présence d'un il y a évoqué par Levinas ?
Si la philosophie commence avec l'étonnement, l'interrogation qui ouvre l’essai de Glucksmann intitulé La troisième mort de Dieu devrait constituer l'évidente pierre d'achoppement, le scandale sur lesquels buttent le marcheur insouciant : «L'effacement du Très-Haut dans l'Europe contemporaine paraît d'autant plus étrange qu'il va de soi» (p. 19). En somme, le philosophe, dans cet ouvrage, s'étonne du fait que, justement, il n'y a pas – ou plus – d'étonnement. Et l'auteur d'insister précisément, de mettre à nu la plaie qui afflige l'immense corps européen, perclus d'ennui et de tristesse : non seulement Dieu est absent plutôt que caché – cette occultation ou éclipse selon Buber renvoyant au Deus absconditus d'Isaïe et de la tradition de l'apophatisme illustrée par Denys l'Aréopagite ou Maître Eckhart –, mais cette place est trouvée vacante, vide, hantée seulement par le fantôme pitoyable de l'antique présence, comme Michel De Certeau le soulignait naguère (1), comme l'auteur se plaît aussi à le rappeler : «Ce n'est point Dieu qu'il s'agit de remplacer, c'est sa place même qui ne se trouve plus» (p. 25). Dieu est donc mort, point n'est besoin de prêter au plus laid des hommes nietzschéens de criard haut-parleur pour faire écho à la nouvelle, comme on raconte que, sur les rivages de l'Antiquité, une voix, sépulcrale et terrible, annonça la mort du dieu Pan. Mais, à la différence de l'espèce d'insouciance enfantine qui illumine le grand midi du penseur de Sils-Maria, nadir de fausse félicité plutôt que zénith orientant la carrière du surhomme dédouané de ses fausses idoles, le penseur moderne doit constater, avec un regret à peine voilé – et sans doute une secrète nostalgie – que la faille ouverte dans l'Être, ce schisme dont parlait le grand Maistre en tentant de caractériser le Mal, loin d'avoir été comblée par quelque dieu grotesque de ferraille et de boulons devant lequel, au moins, se prosterner, a été au contraire creusée, excoriée, fouillée jusqu'à son tuf de noirceur primordiale. A la place d'un roc ou d'un os, de cet ungründ cher à Böehme, que trouve-t-on sinon le vide, la révulsante présence d'un il y a évoqué par Levinas ?Non ! me dira-t-on, vous dites là une sottise, car l'homme, Dostoïevski a suffisamment insisté sur cet aspect avec sa parabole du Grand Inquisiteur, trouvera toujours un dieu, pitoyable et veule, fait à son image, auquel brader sa terrible liberté. La preuve ? Comment mieux caractériser le communisme et le nazisme qu'en affirmant que leur essence secrète n'est qu'une pure parodie d'un sacré, comme le disait Chesterton, devenu fou ? Bien évidemment, je ne l'ignore pas et, sans évoquer quelque savante étude sur ce sujet (2), je pourrais me contenter de rappeler qu'un des superbes romans d'Hermann Broch, Le Tentateur, a suffisamment caractérisé l'espèce de révélation négative, parodique et dévoyée, dans laquelle rougeoie la parole fausse du harangueur, de l'hypnotiseur de foule. En fin de compte, annoncé par le Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, dans lequel un aventurier, Kurtz, soumet une population d'indigènes par le seul pouvoir de son verbe – ou plutôt, de son contre-verbe –, relayé ensuite par les hommes creux de T. S. Eliot ou l'Hitler de carton-pâte campé par George Steiner dans son Transport de A.H., l'incarnation labile du dictateur n'est que la condensation fumeuse et temporaire d'un néant bavard, jamais avare de truismes, qui a parasité la Parole, le Verbe, brouillant la clarté du fiat originel par la jacasserie contre-factuelle du monotone ressassement. L'exemple du Monsieur Ouine de Bernanos nous désigne assez quelle qualité d'eau trouble et boueuse noie les destinées sordides de ces infatigables beaux-parleurs (3). Glucksmann l'écrit, caractérisant parfaitement cette plongée dans un Golgotha inversé, non plus ascendant mais descendant : «Méditer la disparition de Dieu, son actualité, ses limites revient à concevoir une antirévélation qui avance avec l'aura et la persuasion des anciennes révélations» (p. 34). Et notre penseur de poursuivre, avançant, je dois le dire, un étrange argument, censé parapher cette monstrueuse inversion d'un cachet d'infamie, je veux parler des massacres perpétrés au Rwanda : «La preuve par le Rwanda […] ne s'élève pas du terrestre au céleste, mais fait chuter le ciel sur la terre. Elle ne sublime pas le temporel dans l'éternel, mais s'acharne à dissoudre le second dans le premier. Les morts sans sépulture d'Afrique manifestent la contingence, non du monde, mais du ciel» (p. 43). Après tout, s'il est légitime, l'exemple des massacres inter-ethniques commis au Rwanda n'est pas plus véridique qu'un autre, ou plus éclairant : que dire du génocide auquel furent livrées des populations entières de Tziganes, exterminées par les Nazis, d'Arméniens (par les Turcs) ou de Cambodgiens (par les Khmers Rouges) ? De plus, je ne vois pas en quoi il fournirait l'argument ontologique d'une mort de Dieu, d'une contingence du ciel. Passons, Glucksmann a bien vu l'essentiel, cette déroute, ou plutôt cette étrange déhiscence d'une sacralité parodique, amère, violente et désabusée, qui constituera fameusement le jeu du Démon, entant son ancre dérisoire sur le fond sableux de l'inconstance (4) : «La terre et les cieux chantent encore un Être suprême tout-puissant et très savant, mais dorénavant il est radicalement pervers. Les sentiments s'inversent, sans cesser de puiser dans la boîte à outils théologique. Les anciennes traces et «preuves» de l'existence de Dieu balisent la piste du démon» (p. 190).
De la même façon, sans doute n'a-t-il pas tort d'évoquer une relative déroute du platonisme, dans sa volonté irénique de masquer le Mal en s'arrachant à la réalité rugueuse à étreindre dont parlait Rimbaud, retour de ses agapes de voyant ; ce point constitue d'ailleurs l'armature de l'essai de Glucksmann, son nœud gordien, ou plutôt, son double nœud : «[…] l'hypothèse n° 1, que cet essai entend explorer [est] la déchristianisation évidente, qui aujourd'hui submerge l'Europe et stupéfie le reste du monde, annon[çant] le retour d'un cruel principe de réalité plutôt qu'une existence «désenchantée», affranchie de tous les sentiments jadis qualifiés de religieux. Hypothèse n° 2 : ladite «déchristianisation» ne dissimule-t-elle pas une irrésistible déplatonisation des mœurs, des coutumes et de la civilisation ?» (pp. 70-1). La question reste posée, tant il est vrai que demeure troublante la concomitance, dans nos sociétés, entre deux phénomènes frères, mais frères ennemis : une extrême pruderie, un consensus par la banalité la plus fade, et une extrême impudeur, voire, une extrême violence.
Quoi qu'il en soit, l'évidence saute aux yeux : la foi de nos contemporains, minée par le doute – qui a fait suite au blasphème des temps altiers – et l'horreur, minée par le doute nourri quant à la réelle présence d'un Dieu incapable de sauver son propre peuple, pourtant élu, pourtant tombé comme Shadrak, dans la fournaise d'où nulle main secourable ne l'a tiré, cette foi vacillante ne saurait plus se nourrir de certitudes confondantes : «Rappelons que la foi d'aujourd'hui naît dans le dénuement et le déracinement, sur les rivages de l'effroi. Effroi théologique, vertigineusement orphelin, en éclipse de Dieu» (p. 109). Bien. Mais la foi, toujours, ne s'est-elle pas justement nourrie, avec une confondante prédilection, de racines amères, s'édifiant sur les plaies pulvérulentes du Christ en Croix de Grünewald plutôt que sur les tendres platitudes d'une foi réduite à une raison sociale, esthétisante à force d'être doucereusement mièvre ? Glucksmann le sait parfaitement, n'a-t-il pas lu Pascal et Kierkegaard, n'a-t-il pas, justement, lu et relu le grand Dostoïevski, ne s'amuse-t-il pas du platonisme de Pierre Boutang qui grondait George Steiner à propos de l'imbécillité philosophique représentée par l'idée d'un Dieu mort (5) ? Dois-je l'avouer ? Je me sens proche de George Steiner plutôt que de Boutang, et je ne peux m'empêcher de croire que, par ce doute, cette terreur, cette attente fourbue dans l'ennui du long samedi dont parle l'auteur de Réelles présences, par cette station angoissée dans la nuit du Golgotha, par ce regard qui ose à peine contempler, au loin, la première lueur, diffuse et vacillante, de l'aube nouvelle qui va pourtant courir formidablement sur les étendues parcourues inlassablement par les cœurs purs et tourmentés, non, je ne me tiens pas loin – mais affirmer cela, n'est-ce pas excéder formidablement les limites de la prétention et pécher contre l'espérance ? Oui… À moins que l'espérance réelle, comme Carlyle l'affirmait, ne puisse advenir qu'à l'unique condition de s'être plongée dans les ténèbres –, non je ne me tiens pas loin du pauvre Supplicié, et je me trouve près, aussi, de Bernanos, d'Unamuno, de Dostoïevski ou de Bergamín, plus près encore du Paul Gadenne de la splendide nouvelle intitulée Baleine, dans laquelle la carcasse échouée d'un immense cétacé est le gage puant d'une promesse et d'une gloire futures. Écoutons Glucksmann lorsqu'il écrit que le «moment de la Croix ne coupe plus le temps en deux, dès que celui qui la contemple sait mieux que celui qui s'y trouve cloué ce qui va se passer ensuite. Le fidèle chrétien croit que Dieu est plus grand que le supplice, il l'espère, il le souhaite, il prie pour cela, mais seule sa crainte, seul son tremblement, seules ses incertitudes distinguent sa foi des assurances profanes, savantes ou frivoles. Pour lui, l'annonce de la mort de Dieu, que son espérance seule dépasse, reste ici-bas religieusement indépassable» (p. 271).
Religieusement indépassable ! De pareilles phrases, scandaleuses aux yeux de certains, n'ont pas fini, je le crains, de hanter la caboche pleine de bourre des hommes creux qui, à leur tour, n'ont eux aussi pas fini, selon la prédiction du poète T. S. Eliot, de descendre dans les profondeurs où, peut-être, les attend le puits lumineux débouchant sur l'Azur, à moins que, toujours en suivant l'auteur de Quatre Quatuors, ces mêmes hommes soient condamnés à la reptation de la stérile redite :
This the one way, and the other
Is the same, not in movement ; while the world moves
In appetency, on its metalled ways
Of time past and time future.
Is the same, not in movement ; while the world moves
In appetency, on its metalled ways
Of time past and time future.
Notes
(1) Dans son grand ouvrage La Fable mystique, Michel de Certeau écrit : «L'Un n'est plus là [...]. A n'être plus le vivant, ce “mort” ne laisse pourtant pas de repos à la cité qui se constitue sans lui. Il hante nos lieux. Une théologie du fantôme serait sans doute capable d'analyser comment il resurgit sur une autre scène que celle d'où il a disparu. Elle serait la théorie de ce nouveau statut», La fable mystique 1, XVIe - XVIIe siècle (Gallimard, coll. Tel, 1995), p. 10.
(2) Par exemple, la remarquable étude de Victor Klemperer sur le langage nazi, LTI, la langue du IIIe Reich (Presses Pocket, coll. Agora, 1999, p. 153), dans lequel l'auteur écrit : «Pourtant, les mots qui restent gravés en souvenir de tout cela vont dans le sens de la transcendance chrétienne : mystique de Noël, martyre, résurrection, inauguration d'un ordre de chevaliers s'articulent (malgré leur paganisme) comme des représentations catholiques ou pour ainsi dire parsifaliennes, aux actes du Führer et de son parti.»
(3) J'ai tenté, dans le numéro 23 des Études Bernanosiennes (Minard-Lettres Modernes, à paraître), de traiter la sombre nouvelle de Conrad (en la comparant à Monsieur Ouine) sous l'éclairage crépusculaire d'une faillite du langage, grevé par le poids du mensonge et de la fausse parole admirablement décrite par Armand Robin. J'évoque ces questions difficiles par la symbolique, empruntée à l'astrophysique, du trou noir.
(4) L'inconstance, chère au juge Pierre de Lancre (cf. son Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, paru en 1613), est l'une des thématiques favorites utilisées par les démonologues afin de tenter de définir les versatiles manifestations du démon.
(5) Glucksmann (p. 270) fait référence au prodigieux dialogue entre George Steiner et Pierre Boutang (Dialogues Sur le mythe d'Antigone sur le sacrifice d'Abraham, J.C. Lattès, 1994).
(6) T. S. Eliot, Burnt Norton, Quatre Quatuors, Poésie, édition bilingue, traduction de Pierre Leyris (Seuil, coll. Le don des langues, 1992), p. 162.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, mort de dieu, andré glucksmann, nietzsche, michel de certeau, la troisième mort de dieu, nil éditions |  |
|  Imprimer
Imprimer