Au-delà de l'effondrement, 2 : L'Apocalypse russe de Jean-François Colosimo (07/04/2009)

Crédits photographiques : Tom Stromme (AP Photo/The Bismarck Tribune).
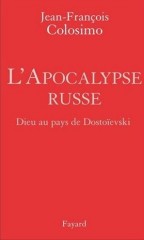 «Peut-on faire taire les voix jaillissant des décombres ?», se demande Jean-François Colosimo dans l'un de ses précédents ouvrages (1). C'est bien l'unique question à laquelle nous sommes forcés de devoir répondre car, comme l'écrivent Yannick Haenel et François Meyronnis dans le prologue de leur nouveau livre, Prélude à la délivrance (Gallimard, coll. L'Infini, 2009, p. 11, j'évoquerai ce livre d'ici peu), chacun «éprouve le pressentiment d'une catastrophe». Au risque de passer pour un exalté, je j'éprouve aussi ce sentiment, ne voyant pas trop de quelle façon la société française (occidentale tout entière ?) peut continuer à lentement s'effilocher, comme s'il s'agissait d'un tapis dont le motif, ordonnateur et offrant, du macrocosme, une image réduite, se serait presque complètement effacé.
«Peut-on faire taire les voix jaillissant des décombres ?», se demande Jean-François Colosimo dans l'un de ses précédents ouvrages (1). C'est bien l'unique question à laquelle nous sommes forcés de devoir répondre car, comme l'écrivent Yannick Haenel et François Meyronnis dans le prologue de leur nouveau livre, Prélude à la délivrance (Gallimard, coll. L'Infini, 2009, p. 11, j'évoquerai ce livre d'ici peu), chacun «éprouve le pressentiment d'une catastrophe». Au risque de passer pour un exalté, je j'éprouve aussi ce sentiment, ne voyant pas trop de quelle façon la société française (occidentale tout entière ?) peut continuer à lentement s'effilocher, comme s'il s'agissait d'un tapis dont le motif, ordonnateur et offrant, du macrocosme, une image réduite, se serait presque complètement effacé. Ces voix, allons-nous les recouvrir d'un drap blanc et ainsi les étouffer, revenir à nos vies insouciantes et nous boucher les oreilles ? La thématique de la voix, dans le livre de Colosimo, est d'une importance capitale. C'est Pierre Boutang qui durant un cours professé à la Sorbonne en 1980-1981 a révélé à l'auteur, comme il l'a révélé à un autre de ses disciples, Henri Du Buit, que la parole, «et partant la voix, est ekeïn, cette catégorie aristotélicienne plus et moins que l’habitus latin. C’est par elle que l’homme habite le monde, s’y projette. La parole, mais plus encore la voix, sont comme la parure, le vêtement, l’allure déterminant l’essence par les «alentours», de quoi je retire : à la fois gratuite et incessible» (2). Primauté incessible de la parole donc que Colosimo, au travers de Boutang lui-même grand commentateur de Vico, explique ainsi : «Babel fonde la métaphysique de la parole [...]. Cette première parole est un chant. C’est la diction intériorisée du monde. De ce lien originel procèdent, dans le passage de l’âge des dieux à celui des héros, les universaux de l’imaginaire, les métaphores essentielles qui fondent le mythe, la poésie, la loi – et donc la Cité, insiste Boutang. La décadence des universaux et, avec elle, celle du sacré, du chant, du droit, c’est l’âge des hommes dans le retrait du sens et la multiplication des non-sens» (3).
Le non-sens absolu, subsumant la multitude des non-sens et, en quelque sorte, les accomplissant dans une radiation définitive, serait celui que provoquerait une catastrophe majeure anéantissant, plus ou moins lentement, la faune et la flore puis finalement l'humanité elle-même, sans que nous ayons besoin de nous trouver sur Patmos pour savoir qu'alors se poserait la question ultime : que faire ? Comment survivre ? Écrire ? Quel besoin en aurait-on, puisque les livres seraient brûlés, les signes qui défigurent les villes modernes rapidement effacés, les institutions détruites, abolie la simple notion de transmission ? L'écriture n'a de sens et, sans doute, ne se peut concevoir que dans et pour une culture qui croit en l'espérance. Une culture du moins qui, quel que soit son degré d'abaissement, vénère les livres, comme le montre le très beau classique de Walter M. Miller Jr., Un cantique pour Leibowitz (publié en 1959, Gallimard, coll. Folio SF, 2001, p. 49) où nous pouvons lire : «Il n’y avait là qu’une poignée de documents pliés; c’était pourtant un trésor : ils avaient échappé aux flammes furieuses de la Simplification, quand les écrits saints eux-mêmes s’étaient recroquevillés, avaient noirci, étaient partis en fumée tandis qu’une populace ignorante hurlait et célébrait cela comme un triomphe».
Se débarrasser au contraire de l'écriture, source lointaine des maux par lesquels l'humanité aura péri et cultiver le don de la parole, dont l'essence même, hautement volatile, ne pourra jamais atteindre ce point, cette infinitésimale suspension temporelle pendant laquelle la réaction en chaîne va se déclencher inéluctablement ? C'est ce que suggère, une nouvelle fois et peut-être sur les brisées de Ray Bradbury, Miller Jr. qui écrit (Ibid., p. 396) : «Mais un monde étincelant de raison et de richesses commençait à se percevoir exigu comme le chas d’une aiguille, et victime de cet ulcère dévorant il finissait par ne plus vouloir croire ou ardemment désirer. Et voilà… Ils allaient de nouveau détruire le jardin terrestre, civilisé, savant; il allait être déchiré une fois de plus pour que l’homme pût à nouveau espérer au sein de la misère et de l’obscurité. Quant aux Memorabilia [autrement dit, les livres qui n'ont pas été détruits par les différentes catastrophes], elles partaient dans le vaisseau ! Était-ce une malédiction ?... Discede, Seductor informis ! Ce savoir n’était pas une malédiction, jusqu’à ce qu’à l’image du feu l’homme le dénature».
Finalement, le constat de Jean-François Colosimo rejoint celui de l'auteur de science-fiction : les personnages de ce magnifique roman ne peuvent se résoudre à abandonner à une destruction pure et simple les livres contenant un savoir qui a été pourtant responsable de la série de cataclysmes planétaires ayant ravagé le monde. «Alors que nous sommes sur l’île de la Révélation, écrit ainsi Jean-François Colosimo, nous savons, d’une science qui n’est pas de ce monde, que lorsque tout sera consommé, que l’univers ne sera plus, que Dieu sera tout en tous, quelque chose de nos hymnes continuera à s’élever dans la radiance de la gloire éternelle, car le Christ exalté est le Christ ressuscité en son humanité» (4).
Quelque chose de nos hymnes... Sera-ce le mystérieux Reste des vieilles prophéties juives ? Sera-ce la voix de l'homme que William Faulkner affirme être immortelle dans l'un de ses romans ? Sera-ce la petite poignée de survivants, peut-être muets, ayant échappé, par pur hasard ou miracle, à la destruction totale qui n'en finit pas de fasciner le cinéma et la littérature nord-américains (comme cette simple liste, mêlant bien sûr le pire et le meilleur, en témoigne), alors que la production artistique française, elle, se complaît, à de rares exceptions près, dans les petits marivaudages nous présentant des tranches de vie mille fois resservies, sans, cela va de soi, la moindre préoccupation métaphysique dont le pire des navets hollywoodiens ne semble décidément pas exempt ? Et cette communauté elle-même, qui aura toutes les peines du monde à ne point s'estimer, de fait, élue pour quelque mission, aura-t-elle dû sa survie au fait qu'elle aura su retenir l'aura des choses que Walter Benjamin rejetait en gémissant de tristesse derrière les plus hautes montagnes de notre monde désacralisé ?
La réponse de Jean-François Colosimo est à cet égard sans la moindre ambiguïté, qu'il la donne dans L'Apocalypse russe, le deuxième volet de son vaste traité «sur le Golgotha théologique et politique que connaît l’idée de Dieu depuis deux siècles» ou bien dans le premier volume de celui-ci, intitulé Dieu est américain (5), où il écrit : «La traduction des articles de foi en objets de sagesse commune, la simplification des rites liturgiques en occasions familières, la dégradation de l’espérance surnaturelle en progressisme séculier opèrent le passage à un Dieu anonyme – voire inconnu, absent» (6).
Dieu anonyme ou absent, réduit, aux État-Unis, à sa complexe et néanmoins festive caricature socialo-caritative teintée d'un millénarisme de bazar qui pourtant inquiète Colosimo écrivant, moins étrangement qu'il n'y paraît si l'on garde en mémoire que Dantec et le grand McCarthy avaient, dans tels de leurs plus récents romans, évoqué la forte probabilité d'une nouvelle guerre des religions (ou, en l'occurrence, des Églises réduites à des sectes sanguinaires) embrasant le crépuscule du monde, Colosimo écrivant donc : «Les guerres qu’elle [l’Amérique] mène au dehors seraient-elles censées n’exister que pour écarter le spectre d’une guerre civile, plus précisément une guerre de religion, au-dedans ? Fragile leçon mais que l’Europe devrait méditer plutôt que de célébrer en processions son désenchantement désarmé : le choc des civilisations n’exclut pas l’implosion des cultures» (7).
Dans L'Apocalypse russe, l'auteur revient sur cette question des origines du grand mouvement de sécularisation que connaît l'Europe (plutôt que le reste du monde), faisant du cas de la Russie, pays théophore (et théophage) s'il en est, le foyer d'incandescence où n'en finissent pas de brûler les petits apôtres du nihilisme contemporain : «demeure la question adressée à l’Europe, question pleinement politique parce que métaphysique : soit la philosophie est sans la Bible (Schelling), soit la Bible est sans la philosophie (Kierkegaard), et, dans les deux cas, triomphe une atomisation du sens» (8).
Cette atomisation du sens, étudiée par tant d'auteurs dont Léo Strauss, n'est jamais mieux disséquée, selon Colosimo, que par les romans de Dostoïevski, qu'il analyse durant plusieurs chapitres, à mes yeux les plus passionnants de son livre : «Car s’il est une conviction chez Dostoïevski, c’est bien l’irrémissible rupture, à partir des Lumières, que provoque l’autodéification de l’homme, fêlure ontologique qui excède le cours des révolutions et par laquelle l’homme, singeant l’Absent, se fuit, précipite sa perte et rencontre l’échec en affirmant une impossible liberté, d’abord tragi-comique, puis proprement infernale. Loin de réécrire les mythes anciens du vol solaire ou du feu dérobé, c’est à une descente dans les basses-fosses de la modernité, là où s’élabore la fiction du sujet autonome, qu’il s’emploie» (9). Et encore : «C’est à ses antihéros, passés par l’enfer, que Dostoïevski confie de dresser le diagnostic : la modernité entraîne le déchaînement de forces irrationnelles – rats, peste et choléra dont se vanteront les maîtres du soupçon. Elle cause la désintégration de la société et, partant, de l’humanité. Car, privée de la verticalité, la sacralisation de l’individu mène à l’immoralisme (Raskolnikov), au despotisme (Chigalev), à l’autodestruction (Kirillov)» (10).
En fait, selon Jean-François Colosimo, la puissance, réellement visionnaire, du génial romancier russe provient de ce que Dostoïevski, à l'inverse d'un clergé catholique de plus en plus prudent avec l'idée d'affirmer que le Mal est réel Adversaire, c'est-à-dire conscience angélique perpétuellement attachée à notre perte et pas vague défaut dans une magnifique et immense toile dont il faudrait s'éloigner quelque peu pour en saisir la splendeur et la perfection, croit, lui, en la puissance agissante du démon, dont il a même expérimenté, durant des années, la brûlure : «Négation, parodie, imposture, parasitage : il y a, pour Dostoïevski, une intelligence à l’œuvre tendant incessamment vers le néant, qui ne s’y dissout jamais mais qui se désintègre toujours plus, de manière indéfinie plutôt qu’infinie, suscitant, à rebours du désir d’immortalité, le goût de la mort et de l’oubli» (11).
Il y a, dans ce goût diabolique, cultivé pour lui-même, de la négation, autre chose que la reptation des monstres grouillant dans les romans du Russe, il y a la volonté de rendre divin l'homme et, pour ce faire, de le tuer, de l'annihiler, de le détruire industriellement dans un processus purement mécaniciste qui est une parodie du Calvaire, où la cruauté des soldats romains s'exerça du moins sur trois hommes uniquement, dont un seul toutefois était Dieu et non point des dizaines ni même des centaines (12) : «Parallèles, simultanées ou successives, inconciliables et pourtant convergentes à la théorie des nations théophores, telle qu’esquissée par Chatov, elles [les tragédies] ramèneront uniment l’homme-Dieu, les peuples divinisés, toujours plus exsangues, à l’infranchissable limite que constitue leur religion des araignées, ce culte ultime qui veut l’apocalypse pour l’apocalypse» (13).
Je laisse à mes lecteurs le soin de découvrir ce que Jean-François Colosimo entend par les termes religion des araignées. Il faut lire en tous les cas cette belle méditation qui n'a aucune prétention universitaire (l'ouvrage n'en est pas moins très solidement documenté) s'agissant de dresser l'inventaire des millions de meurtres que le régime soviétique a à son inhumain actif. Il faut la lire parce que je doute qu'elle ait reçu beaucoup d'échos dans la presse française, peu susceptible d'être slavophile et encore moins de s'être débarrassée de sa gangue idéologique encore puissamment prégnante. Il faut lire ce livre pour admettre avec Colosimo quelques sombres vérités, comme celle-ci : «À croire – ruse de l’Histoire ! – que le communisme, par sa destruction planifiée des paysages, des héritages et des classes, n’aura été qu’une parenthèse utile, efficace, féroce, ayant permis la dislocation accélérée de pans entiers d’archaïsme réfractaires à l’unification technique et marchande du monde» (14), et douter, en revanche, de cette autre : «Le Dieu de la Bible était peut-être absent d’Auschwitz. Le Christ de l’Évangile était assurément présent au Goulag» (15).
Notes
(1) Jean-François Colosimo, Le silence des anges (Desclée de Brouwer, 2001), pp. 47.
(2) Ibid., p. 109.
(3) Ibid., p. 108.
(4) Ibid., p. 145.
(5) Jean-François Colosimo, Dieu est américain. De la théodémocratie aux États-Unis (Fayard, 2006). La citation exacte est : «Le fait est que cet opuscule, cousu en coin d’un projet plus grand, un traité sur le Golgotha théologique et politique que connaît l’idée de Dieu depuis deux siècles, et dont les États-Unis ne sont qu’une station, risque fort de rendre également insatisfaits deux sortes de lecteurs : les américanolâtres et les américanophobes, voire de les faire communier dans un dédain partagé s’ils se targuent d’une quelconque science en matière d’américanisme», pp. 19-20.
(6) Ibid., p. 73.
(7) Ibid., pp. 176-7.
(8) Jean-François Colosimo, L’Apocalypse russe. Dieu au pays de Dostoïevski (Fayard, 2008), pp. 89-90.
(9) Ibid., p. 177, l'auteur souligne.
(10) Ibid., pp. 192-3.
(11) Ibid., p. 205.
(12) En sommes-nous si certains, comme je l'expliquais dans ma note consacrée à La visite du Tribun de David Jones ?
(13) L’Apocalypse russe., op. cit., p. 240.
(14) Ibid., p. 288.
(15) Ibid., p. 341.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, apocalypse, comunisme, jean-françois colosimo, l'apocalypse russe, walter m. miller jr., un cantique pour leibowitz |  |
|  Imprimer
Imprimer