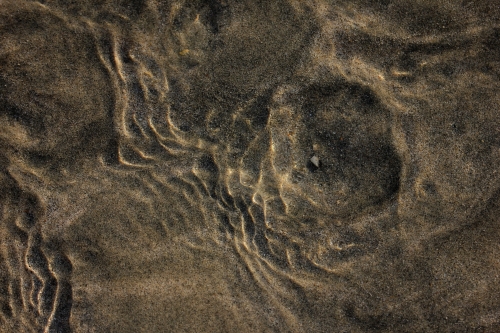Les mots ne sont pas de ce monde de Hugo von Hofmannsthal, puis Paysages de l'âme (20/11/2020)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
«De sorte que n’ayant rien et ne pouvant rien donner, ils s’abandonnent à des mots qui simulent la communication : puisque chacun ne saurait faire en sorte que son monde soit le monde des autres, ils imaginent des mots qui contiennent le monde absolu, et ils nourrissent de mots leur ennui, ils confectionnent un baume de mots contre la douleur».
Carlo Michelstaedter, La persuasion et la rhétorique (L’Éclat, 1998), p. 97.
«Au commencement était le Verbe. Avec ces paroles, les hommes se trouvent sur le seuil de la connaissance du monde et ils y restent, s’ils restent attachés à la parole. Quiconque veut faire un pas en avant, ne serait-ce qu’un minuscule pas, doit se libérer de la parole, doit se libérer de cette superstition, il doit essayer de libérer le monde de la tyrannie des mots».
Fritz Mauthner.
 Je reste stupéfié par la maturité dont témoigne le jeune Hugo von Hofmannsthal dans ses lettres à un officier de marine (du nom d’Edgar Karg) regroupées dans un volume intitulé Les mots ne sont pas de ce monde (Rivages poche, dans l’excellente collection Petite Bibliothèque), où j’ai cru reconnaître quelques-unes des plus belles intuitions d’un autre jeune génie, Carlo Michelstaedter. Qu'ils se soient mutuellement lus est du domaine de la pure spéculation mais, à la limite, il est plus fascinant qu'ils soient l'un et l'autre parvenus à des constats relativement similaires sur la nature du langage, le retrait de ce dernier, l'appel à la réelle présence, la pesanteur d'une langue qui n'est pas de ce monde et qui confine à l'expérience mystique pour Hofmannsthal, laquelle, cela va de soi, ne peut se dire par le truchement des mots imparfaits. Du reste, c'est à peu près à la même époque où pullulent les irresponsables que Broch (qui évoquera longuement la crise à laquelle Hofmannsthal a dû faire face dans Création littéraire et connaissance) peindra sans la moindre concession, période de remise en question voire d'effondrement des valeurs, et décidément critique envers la confiance placée dans la relation unissant les mots et les choses si l'on songe à l'exemple d'un Fritz Mauthner, que Franz Kafka (dans Description d'un combat), Kafka que lui non plus on ne saurait soupçonner d'avoir lu Michelstaedter et Hofmannsthal, émet des doutes sur la puissance du langage à saisir la réalité : «Et j'espère apprendre de vous ce qu'il en est au juste des choses pour qu'elles sombrent autour de moi comme une chute de neige, alors que pour les autres rien qu'un petit verre d'eau-de-vie sur une table est aussi solide qu'un monument».
Je reste stupéfié par la maturité dont témoigne le jeune Hugo von Hofmannsthal dans ses lettres à un officier de marine (du nom d’Edgar Karg) regroupées dans un volume intitulé Les mots ne sont pas de ce monde (Rivages poche, dans l’excellente collection Petite Bibliothèque), où j’ai cru reconnaître quelques-unes des plus belles intuitions d’un autre jeune génie, Carlo Michelstaedter. Qu'ils se soient mutuellement lus est du domaine de la pure spéculation mais, à la limite, il est plus fascinant qu'ils soient l'un et l'autre parvenus à des constats relativement similaires sur la nature du langage, le retrait de ce dernier, l'appel à la réelle présence, la pesanteur d'une langue qui n'est pas de ce monde et qui confine à l'expérience mystique pour Hofmannsthal, laquelle, cela va de soi, ne peut se dire par le truchement des mots imparfaits. Du reste, c'est à peu près à la même époque où pullulent les irresponsables que Broch (qui évoquera longuement la crise à laquelle Hofmannsthal a dû faire face dans Création littéraire et connaissance) peindra sans la moindre concession, période de remise en question voire d'effondrement des valeurs, et décidément critique envers la confiance placée dans la relation unissant les mots et les choses si l'on songe à l'exemple d'un Fritz Mauthner, que Franz Kafka (dans Description d'un combat), Kafka que lui non plus on ne saurait soupçonner d'avoir lu Michelstaedter et Hofmannsthal, émet des doutes sur la puissance du langage à saisir la réalité : «Et j'espère apprendre de vous ce qu'il en est au juste des choses pour qu'elles sombrent autour de moi comme une chute de neige, alors que pour les autres rien qu'un petit verre d'eau-de-vie sur une table est aussi solide qu'un monument».Dans une lettre postée depuis Göding, le 18 juillet 1895, voici ce qu’écrit l’auteur de la célèbre Lettre de Lord Chandos : «Les mots ne sont pas de ce monde, ils sont un monde pour soi, justement un monde complet et total comme le monde des sons. On peut dire tout ce qui existe, on peut mettre en musique tout ce qui existe. Mais jamais on ne peut dire totalement une chose comme elle est. C’est pourquoi les poèmes suscitent une nostalgie stérile, tout comme les sons». Et l’auteur de poursuivre à l’adresse d’un ami qui, si l’on en juge par les réponses qu’il lui donne, était d’une culture et d’une intelligence à l’évidence bien inférieures à celle du jeune Hofmannsthal qui, certes, a pu à bon droit être considéré comme un prodige : «Cela va un peu te perturber au début, car on a cette croyance chevillée au corps – une croyance enfantine – que, si nous trouvions toujours les mots justes, nous pourrions raconter la vie, de la même façon que l’on met une pièce de monnaie sur une autre pièce de monnaie de valeur identique. Or ce n’est pas vrai et les poètes font très exactement ce que font les compositeurs; ils expriment leur âme par le biais d’un médium qui est aussi dispersé dans l’existence entière, car l’existence contient bien sûr l’ensemble des sonorités possibles mais l’important, c’est la façon de les réunir; c’est ce que fait le peintre avec les couleurs et les formes qui ne sont qu’une partie des phénomènes mais qui, pour lui, sont tout et par les combinaisons desquelles il exprime à son tour toute son âme (ou ce qui revient au même : tout le jeu du monde)».
La coupure entre les mots et les choses est ainsi radicalement posée, en des termes toutefois que la Lettre à Lord Chandos ne se privera pas d’accentuer : «Les mots flottaient, isolés, autour de moi; ils se figeaient, devenaient des yeux qui me fixaient et que je devais fixer en retour : des tourbillons, voilà ce qu'ils sont, y plonger mes regards me donne le vertige, et ils tournoient sans fin, et à travers eux on atteint le vide». Car Hofmannsthal se garde bien d’affirmer, dans ces lettres, que le monde et le langage n’ont aucun point commun : l’œuvre écrite, l’œuvre d’art plus largement sont obligées de se contraindre, de choisir, d’extraire de la réalité le phénomène qu’il importe de relater. La phrase infinie, borgésienne ou plutôt faulknérienne, n’existe point car elle ne pourrait être pensée, prononcée et encore moins écrite par des êtres finis.
De la même façon, dans une lettre rédigée depuis le quartier de Klein-Tesswitz en Moravie, le 22 août 1895, Hofmannsthal infirme le pessimisme ontologique (il parle de «nostalgie stérile» renvoyant bien évidemment au mythe de la langue adamique) que saura développer jusqu’en ses plus extrêmes conséquences un Fritz Mauthner, un auteur très intéressant bien que très partiellement traduit en français. En effet, si les mots constituent un monde qui semble ne point correspondre totalement, par essence, avec la réalité qu’ils ne peuvent embrasser tout entière, et ériger ainsi une espèce de simulacre autonome dont Armand Robin affirmera qu’il est la déhiscence monotone du sous-langage, c’est moins la certitude de l’autarcie relative du mot qui inquiète l’auteur que celle, à vrai dire elle-même atténuée par Hofmannsthal donnant en exemple son propre cas, qui consiste à affirmer que les très mauvais livres et eux seuls se coupent, peut-être définitivement, du monde, pour la simple raison qu’ils n’ont eu le souci de s’adresser à l’esprit et au cœur des hommes : «La plupart, l’immense majorité des livres ne sont pas de vrais livres, écrit Hofmannsthal, ils ne sont rien d’autre que de mauvaises répétitions morcelées des rares vrais livres. Mais pour le lecteur, ça ne change pas grand-chose, il n’a pas besoin de se soucier de savoir si le premier ou le troisième messager raconte quelque chose, si le message est digne d’être entendu. Dit un peu grossièrement, les livres me semblent avoir cette fonction dans l’existence : nous aider à prendre conscience et de ce fait à profiter pleinement de notre propre existence. Qu’ils le fassent comme un tout ou de façon fragmentaire, ou plus ou moins, c’est une affaire personnelle. Il est possible que, pour moi, certains livres signifient en partie ce que je signifie pour toi : un compagnon qui se déclare.»
En fin de compte, prolongeant, non sans les gauchir assurément, les déclarations désespérées de Lord Chandos, les grands livres, ceux, fort rares, capables de bouleverser une vie entière, seraient, on peut le penser avec l’auteur du Chevalier à la rose, ceux-là mêmes qui auraient réussi à percer le mystère de cette langue qui n’est nulle langue : «J'ai su en cet instant, avec une précision qui n'allait pas sans une sensation de douleur, qu'au cours de toutes les années que j'ai à vivre [...], je n'écrirai aucun livre anglais ni latin : et ce, pour une unique raison, d'une bizarrerie si pénible pour moi que je laisse à l'esprit infiniment supérieur qu'est le vôtre le soin de la ranger à sa place dans ce domaine des phénomènes physiques et spirituels qui s'étale harmonieusement devant vous : parce que précisément la langue dans laquelle il me serait donné non seulement d'écrire mais encore de penser n'est ni la latine ni l'anglaise, non plus que l'italienne ou l'espagnole, mais une langue dont pas un seul mot ne m'est connu, une langue dans laquelle peut-être je me justifierai un jour dans ma tombe devant un juge inconnu».
Poser ainsi l’absolue relativité des influences, des dons et des semences que favorise l’art, c’est d’emblée affirmer que nul ne peut prétendre savoir où souffle l’Esprit, comme l’auteur, toujours dans cette même lettre extraordinaire du 22 août 1895, l’admet, posant la parenté absolue des êtres et des langages, écritures, sons, chants, reliés dans une chaîne infinie par le Verbe : «Il y a des étoiles qui, à cette heure précise, sont atteintes par les vibrations provoquées par la lance qu’un soldat romain a plantée dans le flanc de notre Sauveur. Pour cette étoile, c’est une chose qui est simplement du présent. Remplace maintenant ce médium simple qu’est l’éther par un autre chemin de propagation, allant de l’âme de celui qui vit quelque chose à l’oreille de celui à qui il le raconte. De la bouche de ce dernier à la suivante et ainsi de suite, avec au milieu toujours une halte dans le cerveau de ces gens, une halte qui ne va pas sans une modification de l’image réelle originale. Prends dans cette chaîne un poète, profond, et une foule de gens qui ne font que répéter. N’est-ce pas ce qui fait pleurer les enfants au bout de trois mille ans, une chose vraie et réelle et digne qu’on pleure à son sujet ? Coupe la chaîne à un autre endroit et à la place du conte tu obtiendras peut-être une prière fervente où l’âme, tenaillée par la peur, lance un cri vers Dieu, exactement comme le prince dans le conte, qui, épouvanté, se jette par la fenêtre d’une haute tour et disparaît dans l’eau noire. Coupe encore ailleurs et tu entendras une ineptie sans saveur. Certains maillons de cette chaîne sont justement des livres».
Tout est signe de tout : c'est le vieux précepte sacré, magique puis ésotérique que redécouvriront, cependant affadi depuis qu'il s'est appelé synesthésie ou correspondance, Maistre, mais aussi Baudelaire, Bloy, Hello, Huysmans, Massignon et bien d'autres écrivains patients, silencieux, inquiets de protéger les tigres au splendide pelage, afin que d'autres, inconnus pas même nés, puissent, à leur tour, scruter les signes de Dieu : heureux le poète qui peut incorporer à son écriture ces chiffres divins !
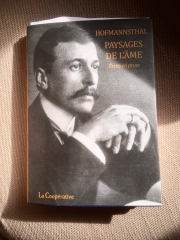 Acheter Paysages de l'âme sur Amazon.
Acheter Paysages de l'âme sur Amazon.Il faudrait pouvoir longuement évoquer le beau volume que les éditions La Coopérative ont publié d'Hofmannsthal, en ayant pris le soin de ne pas l'amputer de l'ample avant-propos consacré à ce livre d'abord paru en 1927 par Charles Du Bos, texte que le grand critique recueillera dans ses monumentales Approximations (juillet 1926-mars 1927, troisième série, Éditions des Syrtes, 2000, pp. 717-37). Comme toujours, Du Bos se montre d'une finesse et d'une sensibilité exemplaires, lorsqu'il écrit, reprenant une des métaphores d'Hofmannsthal qualifiant le poète de sismographe, que «le monde tressaille, le poète vibre; exactement il réagit; son mode d'action propre est la réaction» (p. 26), parlant à la fois de l'auteur de la très célèbre Lettre à Lord Chandos mais aussi de son propre cas puisqu'il assure qu'il n'est «héroïsme plus épuisant que celui de la réceptivité», et qu'en leur cas mutuel, «subir et répondre ne font qu'un» (p. 27). Hofmannsthal, tout comme son lecteur si attentif, n'auront eu de relâche que de développer les conséquences esthétiques et critiques d'une formidable disponibilité à l'Autre, jusqu'au risque que ce dernier envahisse l'enveloppe du poète, comme un cancer évide puis détruit l'organe qu'il colonise méticuleusement. S'ouvrant à ce qui n'est pas soi-même, le danger guette, bien au-delà du concept d'allomatique (soit l'éducation par l'autre), car Hofmannsthal ne va pas tarder à faire l'expérience d'une dépossession radicale, celle de ses propres mots réduits à de la peau sèche qui se détache d'un organisme sain. C'est ainsi, dirait-on, une commune capacité à accueillir (le monde, la beauté, la vie tout simplement) qui unit le grand lecteur à l'écrivain et dramaturge, l'un et l'autre captant admirablement le monde qui les entoure et qui n'est rien de moins que le reflet de leur âme, comme cette dernière ne cesse de s'ouvrir à la largesse de l'univers, l'un et l'autre, mot admirable, se trouvant dans le mouvement même, de passivité et de volonté tout à la fois, par lequel ils se donnent (cf. p. 29). Si les textes d'Hofmannsthal, nous assure Du Bos, témoignent d'une intensité tributaire «d'un prodigieux pouvoir d'ubiquité spirituelle» (p. 37), c'est parce que l'écrivain, véritable sismographe, en effet, du monde entier des choses, a su mieux qu'un autre s'accorder à l'harmonie de l'ensemble. Nous pourrions ici citer une très juste remarque de l'écrivain qui, évoquant un texte de Balzac, affirme que si, par impossible, il pouvait ouvrir le dernier livre d'un auteur qu'il chérit, après avoir lu tous ses textes, il ne serait de toute façon absolument plus le même lecteur que celui qui a lu les premiers. C'est dans un très beau texte intitulé Rois et grands seigneurs dans Shakespeare, qui est en fait un discours prononcé devant la Société Shakespeare à Weimar, en 1905, qu'Hugo von Hofmannsthal évoque ce qu'il appelle un ensemble, et qu'il définit ainsi : «Dans chacun de ces ensembles, les grandes choses ne se distinguent pas des petites, toutes dépendent les unes des autres, les grandes sont là pour l'amour des petites, les obscures pour l'amour des lumineuses, chacune cherche l'autre, en augmente ou diminue la valeur, lui prête ou lui enlève de la couleur, et en définitive,ce qui est sensible à l'âme, c'est le tout indivisible, insaisissable, impondérable» (p. 89). C'est ce sentiment de continuité entre les êtres animés et ceux qui ne le sont pas qui «fait une atmosphère au sein de laquelle les choses proches se lient aux lointaines, les grandes aux petites, où elles se mettent réciproquement en lumière, se renforcent, s'affaiblissent, se colorent ou se décolorent l'une l'autre; où la distinction s'efface entre l'important et l'insignifiant, le commun et l'extraordinaire, où tout concourt à créer l'ensemble dans lequel rien n'est disparate» (p. 90). Je ne sais si Léon Daudet, pantagruélique lecteur, s'est souvenu d'Hofmannsthal lorsqu'il a lui-même caractérisé la richesse d'une époque par son atmosphère. Dans un bel Entretien sur la poésie, Hofmannsthal écrira que le poète n'est rien de plus qu'un pigeonnier puisque ce n'est pas en nous qu'il faut descendre si nous voulons nous trouver : «c'est dehors que nous nous trouverons, dehors. Semblable à l'arc-en-ciel qui n'a pas de substance propre, notre âme est tendue sur l'irrésistible chute de l'existence. Nous ne possédons pas notre moi : c'est du dehors qu'il souffle vers nous, il nous fuit pour longtemps, puis nous revient dans un souffle» (p. 134).
 Qui peut dire, se demande Hofmannsthal, «d'un Rembrandt si l'atmosphère est faite pour les personnages ou les personnages pour l'atmosphère» (p. 93), cette lumineuse remarque valant à l'évidence pour Shakespeare tout comme, à des degrés certes moindres, pour les propres textes de l'auteur et même ceux de Charles Du Bos : entre les personnages, les textes et les lectures de ces trois auteurs, «l'espace n'est pas vide, mais vivant d'une vie mystique», et les trois, quelles que soient leurs évidentes différences profondément irréductibles, «émergent d'un élément commun, comme les figures humaines, les anges et les bêtes dans un tableau de Rembrandt» (p. 96).
Qui peut dire, se demande Hofmannsthal, «d'un Rembrandt si l'atmosphère est faite pour les personnages ou les personnages pour l'atmosphère» (p. 93), cette lumineuse remarque valant à l'évidence pour Shakespeare tout comme, à des degrés certes moindres, pour les propres textes de l'auteur et même ceux de Charles Du Bos : entre les personnages, les textes et les lectures de ces trois auteurs, «l'espace n'est pas vide, mais vivant d'une vie mystique», et les trois, quelles que soient leurs évidentes différences profondément irréductibles, «émergent d'un élément commun, comme les figures humaines, les anges et les bêtes dans un tableau de Rembrandt» (p. 96). Il y a pourtant un côté, un gouffre plutôt qu'une arrête ou un sommet, par lequel Hofmannsthal est beaucoup plus proche de Shakespeare que du si délicat Charles Du Bos, lui-même impeccable sismographe, percevant comme nul autre critique littéraire l'infinie richesse d'esprits, d'âmes et d'éléments, d'êtres vivants composant une atmosphère mais qui, sauf peut-être à une ou deux occasions (1), semble se détourner de la noirceur, non par crainte, entendons-nous bien, ou par quelque coupable excès de pruderie, mais parce que celle-ci ne saurait décemment occuper son esprit, constamment attiré par et vers la lumière. C'est ainsi que l'auteur conclut sa magnifique étude sur Shakespeare par ces phrases, que je considère être une espèce de sonde s'aventurant profondément dans une mer qui, jusqu'à présent, nous semblait particulièrement calme : «l'atmosphère de Shakespeare, le clair-obscur de Rembrandt, le mythe d'Homère, se seraient pour un instant fondues en une, et tenant en mains cette clef flamboyante, nous serions descendus jusqu'à la demeure des Mères. Là où ni l'espace ni le temps n'existent, nous aurions aperçu, dans leur union intime avec le rêve et l'effort des génies des temps lointains, le rêve et l'effort de notre temps : créer à sa vie une atmosphère, créer pour ses êtres la lumière et l'ombre de l'espace, créer de son souffle le mythe» (p. 97).
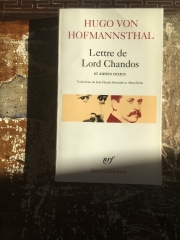 Je ne prétends bien sûr pas qu'Hofmannsthal se détourne de la souffrance, de la douleur, du Mal pour le nommer d'un mot, mais il est cependant clair qu'à trop vouloir prétendre lier les réalités les plus éloignées les unes des autres, à toujours tenter d'adopter une position surplombante, la tentation pourrait être assez vite vive de limer, lisser, gommer le sale, le vil, ce qui désunit, étymologiquement : le diabolique (diabalein), pour ne laisser éclater que la beauté de l'ensemble. Jean-Claude Schneider dans la belle préface qu'il donne à la Lettre de Lord Chandos et autres textes (Gallimard, coll. Poésie, 1992, p. 7) a parfaitement raison d'écrire qu'Hofmannsthal, contemporain presque jumeau de Rilke, «pressent le vide de l'époque, la dissolution générale des valeurs qui est en cours sous les fastes du siècle; pareillement le traversent angoisse et chaos, le menaçant jusque dans son expérience du langage», mais, ajoute Schneider, Hofmannsthal «craint de s'enfoncer trop avant dans cette théologie négative, dans cette perte de réalité dont il pressent tous les abîmes, et sa nature le pousse à fuir la déperdition, l'informe», alors que Rilke, lui, s'aventurera «d'instinct vers les extrêmes», comme en témoignent les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Voyons ainsi ces mots d'Hofmannsthal, à propos d'une étude sur Balzac (Des caractères dans le roman et le drame) : «Savoir lire les destinées où elles sont écrites, tout est là. Il faut avoir la force de contempler ces torches vivantes se consumant elles-mêmes, de les voir toutes à la fois, liées aux arbres de l'immense jardin éclairé par leur incendie, et de se tenir sur la plus haute terrasse, seul spectateur, en cherchant dans les cordes de la lyre les accords qui relient le ciel, la terre et ce spectacle...» (p. 69). Hofmannsthal ne détourne pas son regard du tragique : il prétend plutôt le subsumer dans un ordre qui en gomme l'aspérité, dans une harmonie supérieure qui en rédime la puissance désorganisatrice. Tout lier, c'est en fait tout rassembler, les phénomènes naturels, animaux évidemment, les choses inanimées peut-être, sont des «hiéroglyphes véritables, les signes vivants d'une écriture divine qui a inscrit dans le monde des choses inexprimables» (Entretien sur la poésie, p. 138).
Je ne prétends bien sûr pas qu'Hofmannsthal se détourne de la souffrance, de la douleur, du Mal pour le nommer d'un mot, mais il est cependant clair qu'à trop vouloir prétendre lier les réalités les plus éloignées les unes des autres, à toujours tenter d'adopter une position surplombante, la tentation pourrait être assez vite vive de limer, lisser, gommer le sale, le vil, ce qui désunit, étymologiquement : le diabolique (diabalein), pour ne laisser éclater que la beauté de l'ensemble. Jean-Claude Schneider dans la belle préface qu'il donne à la Lettre de Lord Chandos et autres textes (Gallimard, coll. Poésie, 1992, p. 7) a parfaitement raison d'écrire qu'Hofmannsthal, contemporain presque jumeau de Rilke, «pressent le vide de l'époque, la dissolution générale des valeurs qui est en cours sous les fastes du siècle; pareillement le traversent angoisse et chaos, le menaçant jusque dans son expérience du langage», mais, ajoute Schneider, Hofmannsthal «craint de s'enfoncer trop avant dans cette théologie négative, dans cette perte de réalité dont il pressent tous les abîmes, et sa nature le pousse à fuir la déperdition, l'informe», alors que Rilke, lui, s'aventurera «d'instinct vers les extrêmes», comme en témoignent les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Voyons ainsi ces mots d'Hofmannsthal, à propos d'une étude sur Balzac (Des caractères dans le roman et le drame) : «Savoir lire les destinées où elles sont écrites, tout est là. Il faut avoir la force de contempler ces torches vivantes se consumant elles-mêmes, de les voir toutes à la fois, liées aux arbres de l'immense jardin éclairé par leur incendie, et de se tenir sur la plus haute terrasse, seul spectateur, en cherchant dans les cordes de la lyre les accords qui relient le ciel, la terre et ce spectacle...» (p. 69). Hofmannsthal ne détourne pas son regard du tragique : il prétend plutôt le subsumer dans un ordre qui en gomme l'aspérité, dans une harmonie supérieure qui en rédime la puissance désorganisatrice. Tout lier, c'est en fait tout rassembler, les phénomènes naturels, animaux évidemment, les choses inanimées peut-être, sont des «hiéroglyphes véritables, les signes vivants d'une écriture divine qui a inscrit dans le monde des choses inexprimables» (Entretien sur la poésie, p. 138).Un autre texte, le plus connu de son auteur, je parle bien évidemment de La Lettre de Lord Chandos envoyée à Francis Bacon le 22 août 1603, confirme et à la fois nuance mon propos. Il le confirme car Lord Chandos, comme tous les narrateurs d'Hofmannsthal, vise une totalité, et que cette totalité lui est refusée par l'effritement du langage, sa décomposition soudaine, comme s'il s'agissait d'une véritable «rouille qui ronge autour d'elle»; il le nuance car plus d'une fois y perce une véritable inquiétude, d'abord face à ce que Lord Chandos qualifie de «maladie de [s]on esprit», ensuite en constatant que les mots d'ordinaire utilisés se décomposent dans sa bouche comme des «champignons moisis», enfin parce qu'il est parfaitement incapable d'exprimer le ravissement énigmatique, silencieux, sans limite, «sans paroles et sans bornes» et l'indicible sentiment de félicité qui le saisissent. Totalité tout d'abord, avec le projet exprimé de Lord Chandos d'écrire un livre encyclopédique qui se serait intitulé Nosce te ipsum puisqu'il s'agit de parcourir et de résumer, en un ouvrage qui les contiendrait tous, «toute l'étendue de la vie; partout j'étais au milieu de tout, jamais je ne trouvais rien qui ne fût qu'apparence. Ou bien je pressentais que tout était parabole et toute créature une clef des autres, et je m'éprouvais de force à les saisir l'une après l'autre pour me faire révéler par chacune toutes celles dont elle connaissait le secret» (pp. 44-5). Inquiétude ensuite et même, consternation voire franc désespoir devant la fuite des mots, elle-même signe d'une décomposition générale du langage, qui ne peut qu'accompagner la perception d'avoir perdu le centre, comme l'écrira bien plus tard Zissimos Lorentzatos, autour duquel l'univers poursuit sa folle giration, sans le môle duquel la force centrifuge le brise en milliards de milliards d'éclats. Lord Chandos évoque cette douloureuse dépossession qui confine à un état de sidération, voire de prostration et même de folie : «Les mots isolés nageaient autour de moi; ils se congelaient et devenaient des yeux qui se fixaient sur moi, et sur lesquels à mon tour j'étais forcé de fixer les miens, des tourbillons qui donnaient le vertige quand le regard s'y plongeait, qui tournoyaient sans arrêt et au-delà desquels il y avait le vide» (p. 47). Ce vide, cette progression inéluctable du néant, Hofmannsthal le caractérisera dans son aspect le plus négatif dans un autre texte que cette lettre de Lord Chandos, recueilli dans notre ouvrage, intitulé Les couleurs. Extraits des lettres du voyageur revenu (2), dans lequel il tentera de caractériser cette maladie du langage comme étant, pour commencer, d'origine éminemment européenne et capable de produire la surrection d'une «apparence spectrale de non-existence» (p. 117) ou encore la révélation horrifiante du «hideux gouffre du néant» (p. 120). Ce sentiment de retrait ou de reflux du langage, perçu comme étant parfaitement incapable de nommer les réalités les plus familières (3), sera immédiatement suivi d'une bouleversante révélation, dont on hésite à affirmer le caractère mystique puisqu'il concerne en tout premier lieu la réelle présence par laquelle un art supérieur à l'écriture, par exemple la peinture de Vincent Van Gogh, se donnera sans médiation, immédiatement, dans la verte primitivité que Kierkegaard appellera de ses souhaits hétéronymiques : «je sentais, je savais, je pénétrais tout, je jouissais des abîmes et des sommets, du dehors et du dedans, et tout cela dans la dix-millième partie du temps que je mets à te l'écrire. J'étais comme dédoublé», écrit ainsi le rédacteur de cette lettre imaginaire après qu'il a contemplé, stupéfait, la peinture du Néerlandais, «j'étais à la fois maître de ma vie, de mes forces, de mon intelligence, et je savais que le temps passait, qu'il me restait encore vingt minutes, puis dix, puis cinq» (p. 121). Impossible bien sûr de retenir par des mots cette vague que le narrateur voudrait saisir, mais qui fuit sous lui et l'abandonne irrémédiablement (cf. p. 124), impossible encore par le truchement si imparfait du langage malhabile et trompeur de retrouver ces moments où l'on vit au centuple, «quand ce qui toujours est muet et fermé, puissance inconnue, s'ouvre pour m'unir à soi comme dans une vague d'amour» (p. 125), la peinture d'un génie étant finalement plus proche de la nature de laquelle le langage nous éloigne, alors qu'elle n'est rien d'autre, comme nous le dit magnifiquement Hofmannsthal, que «vie vécu et vie qui veut revivre», alors qu'elle cherche, impatiente de notre froideur, à nous «attirer dans son sein» et à nous «faire découvrir dans ses profondeurs les grottes sacrées dans lesquelles» (p. 126) on peut se retrouver avec soi-même, quand au dehors nous ne sommes plus que des étrangers pour nous-mêmes. Hofmmansthal et Michelstaedter ne se sont très probablement jamais lus, mais quelle proximité dans la tentative qu'ils mènent, le second jusqu'au suicide, comme s'il refusait de toutes ses forces la synthèse rassurante que le premier, à trop se pencher sur les gouffres, à fini par saisir comme la toute dernière planche de salut ! La lettre de Lord Chandos elle aussi évoque, après ce reflux du langage incapable de saisir la pure présence des êtres et des choses, une «participation infinie», le «frisson de la présence de l'infini», ou encore «la source de l'extase énigmatique, sans paroles et sans bornes» je l'ai écrit plus haut (p. 51) dont les mots capables de le traduire «feraient se prosterner les chérubins» (p. 49). Que sont ces mots ? Qu'est ce langage qui, ne pouvant être atteint, contraint Lord Chandos à abandonner ses projets littéraires et même à se réfugier dans une espèce d'hermétisme qui nous fait songer à l'exemple d'un Monsieur Ouine qui ne se serait pas détourné de la création mais, faute de pouvoir la saluer dignement, aurait décidé de se contenter de la ressentir jusqu'à la pâmoison, jusqu'au ravissement que nous savons bien être au-delà de tous les mots, y compris ceux des plus grands poètes ? Cette langue est celle que parlent «les choses muettes» et dans laquelle, conclut Lord Chandos, il devra peut-être un jour, «du fond de la tombe, [se] justifier devant un juge inconnu» (p. 52). Nous sommes, avec cette déclaration, bien loin du personnage de Ouine qui ne doit se justifier devant nul juge, fût-il le plus haut, mais il n'en reste pas moins que le désespoir de Lord Chandos, devant la pâte qu'est le langage et qu'il est impossible de faire lever et gonfler, peut aboutir à dresser, devant le malheureux, la herse de l'hermétisme démoniaque génialement analysé par Kierkegaard, et que j'ai appliqué, ailleurs, à la lecture du dernier roman de Georges Bernanos. Les mots suivants ne peuvent que troubler tout lecteur du dernier roman de Georges Bernanos : «Il me semble alors que c'est moi tout entier qui suis en fermentation, qui jette des bulles, bouillonne et étincelle. Et le tout est une pensée enfiévrée, mais une pensée dont l'expression est plus immédiate, plus fluide, plus ardente que des mots. Ce sont des tourbillons; mais ils ne paraissent pas, comme les tourbillons de mots, mener dans l'insondable; ils me font pénétrer en moi-même, dans le sein le plus profond de la paix» (p. 52). En somme, en gardant ces lignes étonnantes à l'esprit, nous pourrions affirmer de l'ancien professeur de langues que lui aussi, comme Lord Chandos, a une fois senti la totale inutilité des mots, l'impuissance consubstantielle au langage de parvenir à saisir la réalité, ridiculement traduite en signifiants mais que, déçu par cette expérience, il aurait retourné les mots contre la Création plutôt que de se tenir muet, bien qu'heureux, face à elle. Comme Ouine, Lord Chandos semble être tombé en lui-même, au sein «le plus profond de la paix», l'état inexplicable qu'il vit depuis qu'il a perdu sa confiance dans le sens des mots restant d'ordinaire, comme il l'affirme à Francis Bacon, scelle, enclos en lui-même. Cependant, à la différence du vieux podagre corrupteur de Steeny et probable meurtrier d'un jeune valet, il faut remarquer que Lord Chandos, qui a commencé par perdre la confiance, aussi naïve qu'on le voudra, dans l'usage des mots, recevra l'intuition d'une pensée provenant du cœur, d'un langage pleinement ajointé à la pure présence mais aussi au pur présent, présence infinie selon ses propres termes, à tel point que c'est son propre corps qui paraît constitué uniquement de chiffres capables de lui donner la clé de toute chose. Ce langage est au-delà des mots, mais c'est encore la force du grand écrivain qu'est Hugo von Hofmannsthal que d'en saisir l'intuition et, surtout, de chercher coûte que coûte à en approcher la transparence iconique.
Notes
(1) Je fais référence au texte admirable intitulé De la souffrance physique, recueilli dans le volume des Approximations déjà cité (cf. pp. 1465-81). Nous pourrions également évoquer l'essai de Du Bos sur André Gide, dont la littérature a été, pour le grand critique littéraire, un sujet de questionnement mais aussi d'inquiétude.
(2) Il s'agit là d'une des cinq lettres fictives écrites en juin et juillet 1907, qui n'ont jamais été publiées ensemble par leur auteur, nous apprend l'apparat critique de notre ouvrage, qui note que la mention de Van Gogh est l'une des premières, parmi les textes littéraires de langue allemande, à saluer l'importance de son génie, qu'évoquera de nouveau, se souvenant peut-être d'Hofmannsthal, Heidegger dans ses Chemins qui ne mènent nulle part. C'est en 1900 qu'Hofmannsthal a découvert le peintre, par l'entremise de l'historien d'art Julius Meier-Graefe.
(3) C'est dans un texte de 1895 (intitulé Monographie Friedrich Mitterwuyzer et recueilli dans le volume Lettre de Lord Chandos et autres essais, Gallimard, 1980) qu'Hofmannsthal écrit ainsi : «Les mots se sont interposés devant les choses... D'ordinaire, les mots ne sont pas au pouvoir des hommes, mais les hommes au pouvoir des mots. Les mots ne se livrent pas, ils détissent le fil de toute vie... Quand nous ouvrons la bouche, dix mille morts parlent toujours avec nous», cité par Jean-Claude Schneider dans sa préface au recueil cité, p. 11.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, langage, les mots ne sont pas de ce monde, hugo von hofmannsthal, carlo michelstaedter, léon daudet, éditions la coopérative, charles du bos, georges bernanos, monsieur ouine |  |
|  Imprimer
Imprimer