D'un exorcisme pas très spirituel pratiqué sur Philippe Muray par Jacques de Guillebon (29/11/2011)

Crédits photographiques : Johannes Simon (Getty Images).
Jacques de Guillebon, Celle par qui le scandale arrive, La Nef n°225, avril 2011.
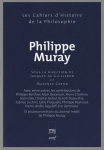 Le bernanosien approximatif (comme le laisse apparaître cet article), l'anarchriste, comme le surnomment ses compagnons d'estaminet plutôt que d'armes, le sympathisant lepéniste (voir extrait ci-dessus et site d'origine), l'anti-libéral caricatural Jacques de Guillebon, co-directeur, du moins sur le papier, d'un gros collectif (publié par le Cerf) consacré à Philippe Muray qui ne s'est jamais aussi bien porté que depuis qu'il est mort, a un seul talent, celui de faire croire qu'il sait écrire, et peut-être même celui de nous faire croire qu'il sait penser.
Le bernanosien approximatif (comme le laisse apparaître cet article), l'anarchriste, comme le surnomment ses compagnons d'estaminet plutôt que d'armes, le sympathisant lepéniste (voir extrait ci-dessus et site d'origine), l'anti-libéral caricatural Jacques de Guillebon, co-directeur, du moins sur le papier, d'un gros collectif (publié par le Cerf) consacré à Philippe Muray qui ne s'est jamais aussi bien porté que depuis qu'il est mort, a un seul talent, celui de faire croire qu'il sait écrire, et peut-être même celui de nous faire croire qu'il sait penser. Jacques de Guillebon a le talent de nous faire croire qu'il a du talent.
Ce n'est pas rien que ce talent-là, je vous prie de le noter. Si Guillebon avait eu la chance d'être un de ceux qui ont suivi, certes à bonne distance, à une distance plus que salutaire qui lui eût permis de n'être point démasqué, le Christ entouré des douze, il aurait, comme un amuseur vagabond en queue de troupe bidassière, exposé ses talents sur un petit tréteau de bois, avec des pois chiches colorés et un unique gobelet en guise de somme philosophique et théologique.
Si nous faisons le pari, évidemment pascalien, que Jacques de Guillebon pense, alors il nous faut admettre qu'il pense comme pense un chrétien résolument moderne, c'est-à-dire comme tout le monde ou presque, du moins c'est ce qui se murmure, la main craintivement posée sur la bouche impie d'oser semblables saillies peccamineuses, dans les arrières-boutiques des librairies Procure et dans le public, béat d'admiration, du petit raout insignifiant qu'il organise, le Cercle Cosaque qui, selon la réclame vaguement bloyenne, se tient debout alors que l'Europe s'écroule. La seule fois où j'y suis allé, à l'un de ces raouts, Jérôme Leroy nous affirmait, alors que dans le public résonnaient les beuglements d'une femme ivre, qu'on pouvait rester un communiste de pure souche dialectique tout en signant, presque chaque semaine, un papier dans Valeurs actuelles, y compris en y disant tout le bien que l'on pense de l'excellent (ce qui est le cas) dernier livre de son propre patron, Bruno de Cessole. Pas étonnant que Guillebon et Leroy soient amis, dans ces conditions : il est évident que tous deux savent, en plus de captiver les foules pendant moins de trois minutes, plier la réalité aux volutes de leur pensée, l'un en croyant qu'il sait écrire et que cela ne peut que se savoir, l'autre en s'imaginant qu'on peut être le dernier des communistes purs en se contentant de le fulminer derrière quelques chopes de bière.
Jacques de Guillebon, c'est bien simple, n'est à l'en croire ni plus ni moins que le dernier homme alors que la réalité quotidienne, autour de lui, se dissout de façon dramatique. Lui aussi nous racontera, depuis son piton rocheux, cheveux au vent et main en visière sur son regard aussi fulgurant que celui de Gorgone, la ruine universelle de l'univers.
Hélas ou heureusement, rien ne s'écroule sous les pieds de Jacques de Guillebon et notre dernier des Mohicans, la mine déconvenue, s'en va quêter un nouveau perchoir depuis lequel vaticiner et chanter l'Apocalypse qui vient, non, celle qui déjà ouvre son premier sceau sous nos yeux qui ne voient rien.
Ce talent de prestidigitation, je vous prie de me croire sur parole, ne lui est absolument pas disputable, car, fidèle au commandement biblique, Jacques l'arrose quotidiennement, comme un champignon de sacristie devenu monstrueux, des larmes les plus sincères : elles ont le don réellement intumescent de faire sortir de terre les larves les plus transparentes qui, choyées amoureusement, deviendront, de nouveau douchées de louches d'eau bénite, des livres, les livres de Jacques de Guillebon et tous ceux qu'il aura déparés de sa plume puisque, hélas, Guillebon aime contribuer à l'édification béatifique des foules en saponifiant sa prose blette dans des livres qui ne sont pas les siens.
Dans une vieille note publiée en 2005 sur ce blog, je m'étais amusé avec ce dernier enfant de personne (dure situation, point au-dessus toutefois des forces de notre apocalyptologue aguerri) qui semble heureusement s'être trouvé, depuis peu, une nouvelle maman en la personne de Chantal Delsol. Celle-ci, fort heureusement peu regardante et qui ne se doute pas de la haine récemment éclose entre ce même Guillebon et Maxence Caron (dont elle a postfacé le dernier ouvrage. Décidément, il faudra, pour suivre la mode, que je demande à Chantal une préface pour mon futur ouvrage...), a très gentiment préfacé la réédition de son livre à peu près insignifiant, Nous sommes les enfants de personne (évoqué ici), titre qui est évidemment faux en plus d'être sot mais qui donne, l'espace de quelques pages, un délicieux frisson de témérité à cet assis qui finira, entre deux directions calamiteuses d'ouvrages évoquant la position du clergé français sur le phénomène de la grenouille mutante de bénitier, quelques pollutions adolescentes et virtuelles (comme celles de ma page Wikipédia, sous le pseudonyme probable de Génie supérieur ?*), patron du Figaro Littéraire, où il encouragera de pâles béjaunes portant le cheich et la fleur de lys en pin's à répandre leur ardeur séborrhéique dans les colonnes qu'il dirigera vaguement, tout comme il a vaguement dirigé celles d'Immédiatement par exemple.
Intéressons-nous à ce qu'il est convenu, selon l'usage, d'appeler le travail de notre Jean de Patmos redivivus.
Et d'abord, pour ce qui concerne sa ronflante co-direction d'ouvrage, laissez-moi préciser que quarante contributeurs, Guillebon et Caron inclus, ont participé au livre édité par le Cerf. Jacques de Guillebon, en homme qui en impose et dirige comme un chef spartiate ses troupes, ne s’est personnellement occupé que de huit auteurs, dont six sont des amis plus ou moins proches. Huit auteurs sur quarante, dont six amis qu’il n’a pas à relancer, deux d'entre eux n'étant en outre que des transfuges d’un autre collectif sur Muray qui devait être publié l’année dernière mais a été annulé par Les Belles Lettres, on jugera le labeur de notre Sisyphe point insurmontable, encore moins titanesque. Inutile dès lors de préciser que l'avant-propos n'est pas le fait de Jacques de Guillebon, tout comme le plan de l'ouvrage et même la quatrième de couverture. On se demande même, dans un tremblement d'irrépressible frayeur, si l'article de Jacques de Guillebon est bien de lui mais je suis heureux de vous affirmer qu'il n'y a, sur ce point, pas le plus petit doute possible.
J'allais presque l'oublier, ce texte mirifique, où éclate, comme un diamant déjà ciselé enfoncé dans une gangue de rinçures, l'âpre génie contempteur d'une modernité qui n'a qu'à bien se tenir.
La contribution de Jacques de Guillebon qui se déclare, sans le moindre sourire et son regard de braise dardant même un ténébreux jet de fureur à qui oserait s'amuser de cette coquetterie, journaliste indépendant, est réduite à l'inessentiel : quelques pages journalistiques (pp. 425-32) où, tout marri de n'avoir pu faire de Philippe Muray le père de l'Église qu'il n'est bien évidemment pas, il le rejette dans les limbes où gémissent et claquent des dents celles et ceux qui ne sont pas comme Jacques de Guillebon, c'est-à-dire, fort heureusement pour nous, sept milliards de personnes à l'exclusion de Jacques de Guillebon qui se moque bien d'être le dernier homme sur Terre, pourvu qu'il ait l'occasion de demander quelques comptes au Créateur.
Amusons-nous du fait que notre aigle au regard capable de percer des montagnes de plomb, cet anarchiste chrétien, nous dit la réclame, qui a passé un certain nombre de ses vacances en compagnie même de Philippe Muray, ne s'est vraisemblablement jamais rendu compte, jusqu'à une date fort récente, que faire de Muray un catholique convaincu, c'est-à-dire guillebonien, était non seulement une pieuse sottise mais une consternante aberration intellectuelle, autrement dit : une erreur, pour le moins flagrante, d'analyse.
Puis-je donc, au passage, conseiller à notre si fin exégète une lecture dont il saura faire, espérons-le, profit, lecture qui n'est autre que le récent livre de Maxence Caron, avec lequel il est étrangement d'accord sur un point : Muray n'est pas catholique ?
Mais, non content de ne pas savoir lire, Jacques de Guillebon commet une erreur (un péché, Jacques ? Vite, à confesse !) beaucoup plus grave : il ment sur la vérité de Muray, qu'il transforme en séide de la mort puisqu'il n'a pas réussi à en faire un apôtre béat de la Vie et de la Lumière.
On croirait lire Charles Maurras évoquant Chateaubriand dans ses Trois idées politiques, affirmant de lui qu'il ne cherchait pas dans le passé «le fécond, le traditionnel, l'éternel» mais «le passé comme passé, et la mort comme mort, ses uniques plaisirs». Étonnante proximité de vues entre Guillebon et Maurras tout de même, la comparaison ne pouvant être portée beaucoup plus loin, le rédacteur de La Nef n'ayant quand même pas la stature intellectuelle du patron de L'Action française, et Muray n'étant pas Chateaubriand.
Il faut être en tout cas bien franchement assis pour ne pas tomber puis se rouler de rire par terre en lisant la toute première phrase de la notule guillebonesque : «Philippe Muray a aimé la mort, on dirait même qu'il n’a aimé que ça, et il est bien étonnant que ses contemporains, ou ceux qui le découvrent maintenant, l'aient lu comme cet écrivain qui les rend vivants; ou plutôt, ce pourrait être étonnant si l'on ne précisait de quelle manière il a aimé la mort : car il l'a aimée jusqu'à la vie» (p. 425).
Il n'y a, dans une accroche d'article aussi grotesque qui ne cherche, derrière un faux paradoxe, qu'à faire le malin, pas un argument digne de ce nom. Je n'ai certes pas connu Philippe Muray, je n'ai pas eu la chance de construire des châteaux de sable avec lui ni même, méduses aux pieds, d'aller taquiner le crabe mais enfin, la seule lecture de son œuvre, de toute son œuvre, m'a assez vite fait comprendre, je crois, que Muray débordait de vitalité, était même une vitalité coruscante par nature, comme le prouvent d'abondance ses textes et même, la moindre de ses lignes.
Fort bien, et alors ? Est-il donc si rare de rencontrer, sous la plume de tel imprécateur qui semble avoir, au petit matin, avalé une gorgée d'Etna pour se rincer les dents, un désespoir bien réel qui sourd implacablement à l'oreille attentive ? Un fin lecteur pourrait donc me faire remarquer qu'une telle vitalité est, par elle-même, suspecte et peut tout à fait n'être que l'écume jubilatoire superficielle d'un marécage de désespoir, où l'auteur, de temps en temps, ne craint pas de faire quelques longueurs et même un peu d'apnée.
Peut-être. Celle qui a connu le mieux Philippe Muray, sa veuve, pourrait sans doute nous renseigner sur la nature véritable de celui qui fut son compagnon mais ces confidences ne témoigneraient de rien de plus que de la complexion épisodique ou profonde d'un homme, et non point de ce qui suinte de son œuvre, alacrité, férocité, génie ou incontestable talent, ce qui est déjà beaucoup.
Le texte de Guillebon, intitulé, afin de bien nous donner une idée du travail éminemment journalistique qu'il a mené, Philippe Muray, jésuite libéral, est un condensé de formules hasardeuses, de rapprochements jamais sondés véritablement (avec Rabelais, Montaigne, Du Bellay, Ronsard, Henric, Sollers, cf. p. 428), de chemins qui ne mènent nulle part puisque nous apprenons qu'il y a chez Muray «de l'être postcalviniste», «c'est-à-dire du loyoliste, du jésuite» (p. 429), ce qui n'est guère éclairant, imprécisions, absences d'analyses véritables et impressionnisme voire sautillement intellectuels qui éclatent dans les toutes dernières lignes (sont-elles suffisantes pour sauver le reste de l'insignifiance ?) où notre inquisiteur au petit pied, enfin, peut établir sans ambages sa condamnation : «Et lui dont l'âme cachait sans doute quelque profond secret aura mendié par toute son œuvre la venue de cette Eucharistie dont le char [représenté par une toile de Rubens] le renverse» (p. 432).
Quelle était, au fait, l'idée principale avancée par Guillebon ? Oui, c'est cela : que Philippe Muray était un apôtre de la mort, qu'il a aimée, nous dit-on, jusqu'à la mort. Bien.
Qu'est-ce à dire ? Que Muray a tellement aimé la mort que, tel un fou de Dieu, il n'a pas hésité à se donner la mort pour la servir, honorer son implacable maîtresse, cette mort étant finalement, mais par antithèse, une vie triomphale, débarrassée de ses voiles ? Ou bien qu'il s'est contenté d'aimer cette marâtre jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne pourrait pas franchir la barrière entre la mort et la vie qui, chez Guillebon, ne peut être qu'une seule chose : le christianisme, la présence réelle d'un Verbe qu'il ne peut accepter que comme principe méthodologique, arme incandescente retournée contre la crétine époque festiviste, et non point comme certitude incarnée, douceur pourtant irrésistiblement conquérante d'une foi réelle, armée, ignacienne ? Ou bien encore, et c'est ce que semble suggérer l'extrait plus haut cité, qu'il n'a aimé la mort qu'à seule fin de faire comprendre à ses lecteurs que lui, lui-même, Philippe Muray, était incapable d'embrasser la vie mais que, eux, eux-mêmes, ses lecteurs, s'ils parvenaient à le lire attentivement, ils comprendraient quel avait été son chemin, qu'il ne pouvait faire un pas de plus mais qu'il les invitait à franchir le porche, à sauter par-dessus la barrière qu'il avait été incapable d'escalader ?
La réponse de Guillebon est pour le moins confuse : «La mort comme compagne quotidienne, c'est en effet ce qui ressort des œuvres de Muray quand on les relit doucement, posément, un peu après son passage» (p. 425), manière sans doute polie de nous faire comprendre que lui, Jacques de Guillebon, a bel et bien lu les textes de Muray, ce qui est une bonne chose, mais qu'il les a lus comme nul autre que lui n'a su les lire, ce qui en est une bien meilleure, du moins dans l'esprit de l'intéressé.
Guillebon, immédiatement après cette phrase, assoit sa révélante découverte sur deux textes de Muray, tout d'abord Minimum Respect puis l'incontournable XIXe siècle à travers les âges mais ces deux textes ne nous facilitent pas la tâche puisque le premier confond mort avec «ce qui achoppe [et] ce qui rate» et le second évoque «l'entrée de la mort dans sa pompe» au moment où «la translation des ossements du cimetière des Innocents vers les Catacombes» (p. 426) est décidée.
Cette piste, à peine annoncée, est abandonnée par Guillebon qui évoque Céline et admet que «la fabrique de la guerre» est l'arme utilisée par Muray «pour qu'apparaisse la figure d'autre chose» (ibid.) dont Céline, Muray et surtout Guillebon ne savent résolument rien, si ce n'est, nous dit notre exégète subtil, et nous avons une fois de plus complètement changé de sujet, si ce n'est qu'il y a, «au tréfonds [de l'être murayen] une tentation pour l'amour destructeur» (p. 427) que chacun de ses textes est censé, selon lui, conjurer, Muray détestant cette «pente femelle où il voyait les germes du pire» (ibid.).
Ici, nous avons droit à un petit détour historique (les années 70) grâce auquel revient le terme de «négatif» (p. 428) censé constituer, je le suppose, le polyptote subversif qui a pris les masques successifs de la mort et de l'amour de la destruction et nous ne sommes pas même surpris de voir apparaître les noms d'Henric mais, surtout, celui de Sollers qui, avec Muray, sont censés, selon Guillebon, avoir «cherché un accès différent au monde que ceux qui leur étaient proposé [sic], parce qu'ils savaient que la voie droite avait été perdue» (ibid.).
Cet accès qui rassemble nos trois auteurs, c'est une évidence selon Guillebon, est le «torrent baroque, celui où ils voyaient s'organiser finement les mouvements de la chair et de l'âme, pour accoucher de la liberté et de l'âme» (ibid.).
Nouveau tortillement intellectuel et baroque nous l'aurons compris qui nous fait à présent sauter, sans transition selon l'expression convenue, à la complexion censée être «postcalviniste», «loyoliste», «jésuite», de Philippe Muray (cf. p. 429) car il y a «chez Loyola comme chez Muray un héritage contré, mais un héritage quand même, de l'humanisme, celui d'Érasme plutôt que celui de Luther, qui les sépare définitivement de l'ordre médiéval» (ibid.).
Bon, nous sommes ravis de l'apprendre. Quelle était déjà, au juste, la thèse de Jacques de Guillebon sur Muray ? Qu'il aimait la mort jusqu'à la vie. Poursuivons.
C'est cette séparation du médiéval qui fait de Muray un «mauvais romancier», puisque «le bon, le grand, le très grand romancier toujours a quelque moment où il fait de l’œil de merlan frit à une réalité bécasse qui l'émeut» (ibid.), cet étrange tropisme, suivons Guillebon, étant le fait d'être «moyenâgeux à certain endroit», tropisme qui est donc propre aux grands romanciers.
Mais notre loyolesque Philippe Muray peut au moins se consoler puisque, comme son intransigeant ancêtre de plume et d'épée, il est lui aussi «totalement contre» (p. 430), cette «prise de position irrévocable» contre la modernité festiviste étant, nous retombons enfin sur nos pattes, «la vie en tant que porteuse de mort» (ibid.).
À ce point de sa non-démonstration, Jacques de Guillebon va-t-il donc nous révéler la raison pour laquelle Philippe Muray est à ses yeux un séide de la camarde ?
Non bien sûr car, nouveau développement, nouvelle bifurcation une fois de plus ô combien baroque, le «baroque», justement, de Philippe Muray est «une soif du mal» établissant clairement «l'évidence de son libéralisme» (ibid.) qui le place, mais attention tendez l'oreille, «de manière sourde», «à la confluence de Tocqueville et de Maistre, c'est-à-dire une manière de positiviste, quoi qu'il en ait» (pp. 430-1).
Joseph de Maistre positiviste ? Je laisse cette affirmation aux spécialistes de l'auteur des fameuses Soirées de Saint-Pétersbourg et reviens au développement pour le moins tortueux, tortu voire tordu de Jacques de Guillebon qui, une fois de plus, après ces quelques lignes, évoque le «jésuite Muray» qui veut absolument oublier l'ordre «gothique et roman» (p. 431) et refuse de considérer que la véritable mère et même, risquons le mot, la putain ayant engendré «tous les socioccultismes» n'est pas le XIXe siècle mais bel et bien la Renaissance.
Dès lors, dans une furie concaténative débridée, Jacques de Guillebon rattache tous ses wagonnets à sa locomotive devenue folle puisqu'il voit, dans cette volonté farouche de Muray de ne pas accuser l'époque du monde qui a été la véritable matrice de notre modernité purulente la preuve formelle du libéralisme de l'auteur, la doctrine libérale étant, selon notre conducteur de tortillard, celle qui proclame «qu'il ne faut pas changer le monde mais le décrire», le romancier étant alors placé, de fait, «en position de rieur des décombres» (ibid.), lui qui ne cherche pas un instant à «se débarrasser de l'homme qu'au contraire il aime à proportion du mal qui se manifeste en lui», qui «doute de toute communauté qui ne soit pas bâtie sur l'utilisation de ce mal, de ce «négatif», ce qui est précisément la définition du libéral, ce gardien de l'«Empire du moindre mal» contre l'Empire du Bien que toujours les utopistes rebâtissent» (pp. 431-2).
Si j'ai bien réussi à suivre le confus trajet de notre draisine baroqueuse, nous devons admettre que Jacques de Guillebon range Muray dans la classe des «grands pessimistes» (p. 432) qui sont aussi de parfaits libéraux s'opposant aux vues loufoques des utopistes, ainsi que des positivistes (Muray est décrit comme étant un «fils de Comte», un «vrai sociologue qui s'échine à fonder sa matière dans une théologie d'occasion», ibid.), dans ce sens particulier où ces derniers ne font que constater que l'homme est un être qui est tombé dans le péché et qu'il ne sert à rien de vouloir l'en extirper.
Mais alors, si Philippe Muray n'est qu'un rieur, je ne comprends pas bien pourquoi il a autant écrit, et en touchant à tous les genres hormis celui, sauf erreur de ma part, du théâtre ?
Si Muray n'est qu'un ricaneur qui, nous dit Guillebon, en ce point de grande importance, d'importance cruciale, d'accord avec la thèse de Maxence Caron, n'est pas véritablement catholique, pourquoi donc a-t-il, patiemment, sans relâche même, en dépit des coups portés par ses adversaires, du relatif silence qui a entouré son œuvre avant qu'un saltimbanque ne lui donne une fausse aura médiatique à laquelle bien des petits causeurs ont essayé de vite se raccrocher, pourquoi donc a-t-il essayé de bâtir une œuvre capable de résister à l'acide de l'hyper-festivisme ?
Est-ce parce que, en fait, Philippe Muray était un nihiliste accompli qui non seulement savait parfaitement ce qu'il adviendrait de ses textes mais qui se réjouissait, en secret, qu'ils se corrompent très vite puisque circulait en eux le même sang vicié que dans les veines de la modernité ?
Dès lors, n'est-ce donc pas dans ce sens qu'il faut comprendre la postulation guillebonesque selon laquelle Philippe Muray était un thuriféraire de la mort alors même qu'il a été enterré comme un catholique, loyolesque peut-être et même post-calviniste si l'on y tient absolument mais en tout cas comme n'importe quel autre catholique mis en bière, comme un homme accueilli par le Père ?
N'y a-t-il pas dès lors, entre ces deux auteurs que sont Maxence Caron et Jacques de Guillebon, en dépit du fait qu'ils semblent se détester cordialement (alors qu'ils se sont appréciés tout aussi cordialement), une secrète et magnifique accointance, l'un et l'autre reconnaissant en fin de compte, dans Philippe Muray, une part d'eux-mêmes qui est stérile, incapable de façonner une œuvre romanesque véritable ?
Maxence Caron, si je juge ce qu'il a écrit dans son étonnant ouvrage sur Philippe Muray, a pris conscience de ce qu'il lui reste à faire : une œuvre.
Je crains que Jacques de Guillebon, lui, n'ait toujours pas accepté sa stérilité littéraire et encore moins fait le deuil d'une vivacité intellectuelle qui n'a jamais été qu'un de ces faux signes que Dieu ou le Diable, allez savoir, jettent sous les yeux des hommes pour éprouver leurs forces.
Note
* Je pointe ci-après quelques troublantes coïncidences puisque, en cette période de publications évoquant Philippe Muray, il est assez drôle de constater qu'un certain nombre d'internautes, sous un petit nombre de pseudonymes relativement transparents (ici, Asinus asinum fricat est, selon toute logique, Jacques de Guillebon lui-même), se mènent une guerre virtuelle aux méthodes fort peu recommandables. La page Wikipédia regroupant les contributions d'un certain Génie supérieur est à cet égard édifiante, qui laisse apparaître des centres d'intérêt aussi transparents que la revue Immédiatement qui devient, sous la modification de GS, mythique puis, grâce à Falk van Gaver, ami proche de Jacques de Guillebon, véritablement catholique, les éditions de L'Œuvre, ou, bien évidemment, votre serviteur, qui apprend ainsi avec stupéfaction et amusement qu'il n'a pas participé à ladite revue Immédiatement ou bien que, devenu webcritique littéraire français plutôt que critique littéraire et polémiste, il a été le seul et unique abonné à sa propre revue, Les Brandes.
Notons encore que Génie supérieur ne se gêne jamais, du moins au sujet de personnes qu'il n'aime pas comme Pierre-Emmanuel Prouvost d’Agostino, de préciser leurs accointances supposées avec l'extrême-droite. Lorsqu'il s'agit de la page WP de Maxence Caron, véritable patron du collectif consacré à Philippe Muray, il faut surtout ne pas oublier que c'est... Jacques de Guillebon qui a salué, le premier on s'en doute, son travail.
Le plus drôle est pour la fin, avec, pour notre travailleur de l'ombre, l'évocation des nombreux textes de Jacques de Guillebon consacrés à Philippe Muray !
C'est sans doute Guillebon ou un de ses commis qui se cachent encore derrière ce contributeur sans nom ou un certain Elahustran, tout pressé de créditer le compte de Guillebon en directions d'ouvrages.
Nous constatons aussi que, de façon ô combien fortuite, la page WP de Maxence Caron a été proposée à la suppression par un certain Mihatsu qui a découvert l'existence de Caron le 16 novembre. Réponse du loup à la bergère, ou de la bergère au loup, au choix, amusons-nous de voir que la page WP de Jacques de Guillebon a été elle-même proposée à la suppression. Nul ne m'en voudra de constater (en décomptant les avis favorables à la suppression ou à la conservation) que la page de Maxence Caron, pour l'heure, a bien plus de chances que celle de Jacques de Guillebon d'être conservée sur Wikipédia.
Ne vous inquiétez donc pas pour ma propre page WP, qui, elle, a déjà subi les assauts de quelques farceurs comme il se doit anonymes même si, dernièrement, un mystérieux Alphabeta a pris le soin de préciser, sur ma page donc, que Jacques de Guillebon était un écrivain. Mais qui donc oserait douter de cette évidence ?
Je ne résiste pas au plaisir, enfin, de mettre ces enfantillages virtuels face aux déclarations que me tint l'intéressé dans un courriel chateaubrianesque et même patmologique pourrait-on dire, que j'ai reproduit ici et dont voici les toutes premières lignes : «Cher Juan Asensio, il faut bien constater à la fin – et je m’y risquerai sur votre blog, n’ayant pas l’habitude pour ma part de tirer dans le dos des hommes, dans le dos de mon prochain, dans le dos de mon très-prochain, vous abandonnant ainsi la responsabilité de publiciser ou non mes propos et d’assumer votre part de débat EN FACE, face à face, comme il se doit, et dans l’honneur [...]».
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, philippe muray, jacques de guillebon, maxence caron, éditions du cerf |  |
|  Imprimer
Imprimer