« Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa | Page d'accueil | Sukkwan Island de David Vann, par Lionel Miniato »
15/08/2011
Au-delà de l'effondrement, 33 : Le Dernier Homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville

Crédits photographiques : Sayyid Azim (Associated Press).
 Tous les effondrements.
Tous les effondrements.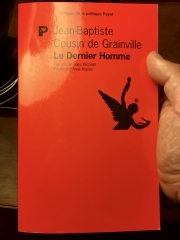 Je ne suis pas certain que la préface de Jules Michelet, verbeuse et grandiloquente, ni même la longue postface, finalement assez scolaire malgré sa bonne volonté d'établir des liens entre Le Dernier Homme et d'autres textes (comme ceux de Nietzsche), d'Anne Kupiec, servent réellement cette œuvre étrange, qui n'est réellement intéressante qu'au moment où le personnage principal, Omégare, se retrouve seul sur une terre vivant son dernier jour (soit le chant VIII) (1).
Je ne suis pas certain que la préface de Jules Michelet, verbeuse et grandiloquente, ni même la longue postface, finalement assez scolaire malgré sa bonne volonté d'établir des liens entre Le Dernier Homme et d'autres textes (comme ceux de Nietzsche), d'Anne Kupiec, servent réellement cette œuvre étrange, qui n'est réellement intéressante qu'au moment où le personnage principal, Omégare, se retrouve seul sur une terre vivant son dernier jour (soit le chant VIII) (1).Certaines pages sont, aussi, devenues tout simplement illisibles, ainsi chargées de métaphores totalement vieillies : «Dès que l'aurore ouvrait les portes de l'orient jusqu'au moment où la nuit, assise sur son char d'ébène, couvrait d'un crêpe les montagnes et les vallées [...]» (IV, p. 101) ou encore : «Tel qu'un lis flétri par les ardeurs dévorantes de l'été, si la nuit et ses vapeurs humides rafraîchissent les airs, il se relève sur sa tige désaltérée, et reprend son éclat argentin : ainsi les paroles du père des hommes [Adam] adoucissent les peines d'Omégare, les nuages de son front se dissipent, et son âme, plus paisible, peut entendre le langage de la raison et de la vertu» (VII, p. 144).
Il existe peut-être des spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle capables d'apprécier, par affectation ou habitude plutôt que par goût véritable je le crains, de telles images qui nous semblent aujourd'hui non seulement ridicules mais tout simplement fausses, dépeignant des états de l'esprit et de l'âme qui n'existent, ainsi traduits du moins, nulle part ailleurs que dans d'autres livres.
Et j'écris cette évidence avec une pointe de tristesse, puisque je me dis que c'est peut-être par de telles images, empruntées au sens où elles obéissent à un code des convenances et du bon goût littéraire parfaitement établi, que la littérature est ou était réellement un art, un langage ayant ses propres lois et constituant une réalité à part entière qui, avec celle du quotidien, cette vie misérable qui fut par exemple celle de Cousin de Grainville, n'entretient en fin de compte que des liens ténus.
De nos jours, il me semble que l'enfer du roman, pour reprendre l'expression de Richard Millet, déborde de toutes parts dans la réalité même, ce qui est un juste retour des choses puisque cette dernière a littéralement envahi le roman. C'est parce qu'il semble avoir oublié que le roman était, avant tout, affaire de convenances et d'accords tacites bref, de codes, entre l'auteur et son lecteur, que l'écrivain contemporain n'a plus, comme un Matzneff ou un Camus (Renaud bien sûr, car on aurait quelque peine à imaginer l'auteur de La Chute sombrer dans le ridicule consistant à sonder son nombril et d'autres tuyauteries moins nobles avec un microscope à balayage électronique, afin d'y traquer la plus petite micro-particule qui ne fût point 100% made in Gers), d'autre recours donc que de nous entretenir de sa pauvre vie aussi minuscule que lamentable, déveines de tuyauteries diverses comprises.
En somme, notre art littéraire (mais je pense qu'un Jean-Philippe Domecq ou un André Clair ne me contrediraient pas pour ce qui concerne les arts plastiques) s'est affaissé parce qu'il ne peut plus accepter la moindre contrainte et ne veut plus se référer à un langage commun, non point tant celui des masses accueillant les dernières productions de Nothomb, Musso, Gaudé ou Enard comme de vulgaires objets de consommation (ce qu'elles sont bien évidemment), que celui d'une élite dans les textes de laquelle l'honnête homme appuyait pour le renforcer et le tremper son idéal de beauté esthétique, sa confiance jamais trahie dans l'ordonnancement du monde et du texte qui en est le miroir tourmenté ou serein. Quoi qu'il en soit, cette confiance, naïve si on veut, a disparu et nous ne savons plus lire un texte tel que celui du Dernier homme autrement qu'en souriant, de temps à autre, d'un mauvais sourire.
Revenons à ce huitième chant du texte de Cousin de Grainville, le plus intéressant à mes yeux disais-je parce qu'il nous montre le dernier homme au nom suggestif d'Omégare errer, une fois qu'il a répudié sa compagne Sydérie, sur une terre dévastée où a eu lieu la résurrection des morts. Cousin de Grainville nous livre, à ce sujet, des précisions troublantes et dignes des plus grandes visions apocalyptiques : «Des anges placés aux pieds du trône de Dieu sonnent les trompettes du dernier jour, dont les éclats sont entendus jusqu'aux limites de l'univers. Aussitôt les corps qui recèlent des substances de l'homme se hâtent de les rendre. Au nord, la glace se rompt pour leur donner un passage. Sous les tropiques, l'océan bouillonne et les vomit sur ses rives. Ils sortent des tombeaux qui s'ouvrent, des arbres qui se fendent, des rochers qui se brisent, des édifices qui s'écroulent. La terre est un volcan immense d'où, par un nombre infini de bouches, s'élancent des ossements et des cendres» (VIII, p. 151).
Cette dernière phrase, que l'on pourrait imaginer reprise, à la virgule près, par le poète de La Fin de Satan, m'a fait immédiatement songer au paysage dévasté, recouvert par la poussière masquant l'éclat du soleil, qu'arpentent le père et son fils dans La Route de Cormac McCarthy. Cette image semble avoir durablement impressionné l'auteur lui-même puisque, au chant X, il écrira : «Du sommet de ces hautes montagnes, [le génie de la terre] voit sortir de tous les corps des flots de poussière qui grossissent à chaque instant, et forment un nuage épais dont la surface du globe est obscurcie» (p. 175; cf. aussi p. 152, où la poussière paraît vivante à Omégare). Cousin de Grainville est écrivain assurément, lui qui se laisse guider et surtout hanter par une image.
Autre dimension qui me semble essentielle de ce texte méconnu, sa leçon pour le moins pessimiste puisque nous assistons effectivement à la fin de l'histoire de l'homme et à la résurrection des morts. Ce pessimisme est lui-même source d'horreur (2) mais aussi de beauté (chant I, p. 56), selon le motif, fort connu, de la magnificence des ruines, célébrée par Constantin-François de Volney avec ses Ruines ou Méditation sur les révolutions des Empires publiées en 1789 : «Le soleil commençait à s'élever sur l'horizon, aucun nuage ne voilait l'azur du firmament, et cette journée était belle pour la décadence du monde.»
Je ne connais pas d'autre exemple littéraire, à l'exception peut-être des toutes dernières visions d'une planète éteinte portant les immondes rejetons de l'humanité future que nous livre le voyageur dans le temps de H. G. Wells, d'une leçon aussi pessimiste que celle du Dernier Homme.
Quelques-unes des pages les plus magnifiques du texte de Cousin de Grainville évoquent le sort du père des hommes, Adam, condamné à se tenir sur une île noire toute proche des Enfers, d'où lui parviennent, toutes les fois que les portes s'en ouvrent pour accueillir de nouveaux damnés, les hurlements des pécheurs, ses propres descendants qu'il a condamnés au labeur et à la peine. Au chant VII, Adam semble racheté par le sacrifice de son plus lointain et dernier descendant, Omégare, qui renonce à son amour pour Sydérie qui ne tardera pas à mourir et, ainsi, renoncera de fait à engendrer une engeance que les oracles prédisent maudite. Plus rien ne demeure, et nous ne savons rien du Jugement dernier dont la résurrection des morts annonce l'irruption imminente et prodigieuse.
Certes, le pessimisme de Cousin de Grainville est atténué par le fait que les événements du futur lointain sont révélés à un narrateur qui n'apparaît que dans le premier chant et aura pour seule mission de la transmettre aux hommes. Le présent de la narration est donc celui d'une époque indéfinie (celle, peut-être, de l'auteur ayant connu les soubresauts de la Révolution ?) où fait irruption le futur de la race humaine exténuée, et exténuée sans que nous sachions vraiment quelles sont les causes de cet épuisement. Cousin de Grainville veut-il signifier, par cet artifice de la mise en abyme, que le présent de la lecture est toujours celui du choix et de la décision qui pourra façonner l'avenir ? Pourtant, comme je l'ai dit, aucune explication ne nous est donnée sur la raison de l'épuisement de l'humanité si ce n'est le fait que celle-ci a littéralement harassé la planète qui la portait (chant I, p. 52) : «Après avoir lutté pendant des siècles contre les efforts du temps et des hommes qui l'avaient épuisée, [la terre] portait les tristes marques de sa caducité.»
En fait, alors même que l'auteur décrit plus d'une fois, tout au long de son texte, quelques merveilles de machinerie, il semble sous-entendre que c'est le progrès lui-même, du moins dans l'utilisation abusive de certaines de ses créations technologiques, qui est le responsable de la stérilité des hommes et de la fatigue de la Terre (cf. chant IV, p. 107). Et c'est finalement le sens réel des dernières lignes du texte de Cousin de Grainville que de nous mettre en garde contre l'impérieuse curiosité des hommes, toujours désireux de «pénétrer au-delà de l'éternité, s'il y restait quelque chose à connaître» (chant X, p. 187).
Mais il ne reste plus rien selon «l'esprit qui préside à l'avenir», plus rien de l'événement révolutionnaire formidable qui ébranla tant de grands esprits comme celui de William Blake auquel le texte de Cousin de Grainville fait parfois songer, plus rien même de Paris (3), plus rien, comme nous le montre une scène étonnante et bouleversante, qui décrit des inconnus ayant, l'un après l'autre, réparé une statue de Napoléon Ier (cf. p. 152), plus rien d'autre que «l'aurore de l'éternité» (Ibid.) et aussi la mission laissée au narrateur de raconter l'histoire dont il a été le spectateur puisque, décidément, seul semble garder quelque valeur ce qui a été écrit : «Les voilà donc, [...] ces ouvrages que l'homme appela si vainement immortels; demain peut-être ils n'existeront plus. Ah ! que cet univers périsse, je ne regrette point une demeure qui tombe en ruines de toutes parts; mais je pleure sur ces écrits que l'impression rajeunissait sans cesse, et qui sont aussi beaux que si leurs auteurs venaient de les publier» (chant VIII, p. 157).
Notes
(1) Les chiffres entre parenthèses (le numéro du chant et la page concernée) renvoient à l'ouvrage suivant, publié en 1805 par Bernardin de Saint-Pierre, l'année même du suicide de son auteur : Le Dernier Homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville (préface de Jules Michelet, postface d'Anne Kupiec, Éditions Payot, coll. Critique de la politique, 2010).
(2) Horreur lorsque le spectacle de la descendance du dernier homme lui est révélé : «Omégare attendri verse des pleures. Au même instant Dieu permet que le tableau de sa postérité se déploie à ses regards. Il découvre dans une plaine aride, sous un ciel ténébreux, ses enfants d’une forme hideuse, aussi cruels que difformes, se faisant une guerre atroce et perpétuelle; il les voit assis autour de tables ensanglantées, couvertes des membres de leurs frères dont ils se disputaient les lambeaux palpitants qu’ils dévoraient» (chant VII, p. 149).
(3) «Paris n'était plus : la Seine ne coulait point au milieu de ses murs; ses jardins, ses temples, son Louvre ont disparu. D'un si grand nombre d'édifices qui couvraient son sein, il n'y reste pas une chétive cabane, où puisse reposer un être vivant. Ce lieu n'est qu'un désert, un vaste champ de poussière, le séjour de la mort et du silence. Omégare jette les yeux sur cette triste étendue, et n'y voyant que des cendres entassées, il dit tout ému : «Sont-ce là les restes de cette ville superbe dont les moindres mouvements agitaient les deux Mondes ? Je n'y trouve pas une ruine, une seule pierre sur laquelle je puisse verser mes larmes; et moi je craindrais de voir périr la terre, ce tombeau de l'homme et de ses établissements !» (chant VIII, p. 153).






























































 Imprimer
Imprimer