Premières lueurs d’abîme : Benjamin Whitmer et Donald Ray Pollock, par Gregory Mion (18/12/2012)

Crédits photographiques : Desmond Boylan (Reuters).
Franz Kafka, L’Amérique (traduit de l’allemand par Alexandre Vialatte, Éditions Gallimard, 1946), p. 131.
«Le diable, dit M. Jung, a toujours existé, le diable a existé avant l’homme, le diable est le principe éternel qui a perverti l’homme pur ! Et ainsi il y aura toujours des méchants… L’inculpation du diable n’est pas à proprement parler une monstrueuse absurdité, mais plutôt une commodité providentielle. Car le diable a bon dos ! Le diable se charge de tout.»
Vladimir Jankélévitch, L’imprescriptible (Éditions du Seuil, 1986), p. 30.
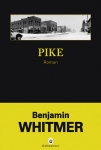 Benjamin Whitmer, Pike (traduit de l’américain par Jacques Mailhos, Éditions Gallmeister, 2012). Pour chacun des deux livres, les chiffres entre parenthèses renvoient aux éditions indiquées.
Benjamin Whitmer, Pike (traduit de l’américain par Jacques Mailhos, Éditions Gallmeister, 2012). Pour chacun des deux livres, les chiffres entre parenthèses renvoient aux éditions indiquées.Avant toute chose, il convient d’abord de saluer l’excellence de la traduction établie par Jacques Mailhos [traducteur du remarquable L'Homme qui marchait sur la lune d'Howard McCord, NdJA], lequel offre un nouveau titre exceptionnel pour les éditions Gallmeister qui sont en train de devenir l’une des plus belles maisons soucieuses d’importer en France une littérature américaine significative. Pike est le premier roman de B. Whitmer, un quadragénaire à la carrière multiple et natif du rugueux nord-est des États-Unis, lieu des tempêtes de neige et des étés caniculaires. Whitmer fut en outre tarabusté par les nécessités de s’éprouver, inquiet de creuser un sillon avant d’écrire, comme tant d’auteurs américains en ont d’ailleurs ressenti la patience sinon l’obligeance, un peu comme si l’écriture était une affaire d’atermoiement, une manière de retarder la mise en cohérence d’une série d’expériences fondatrices – vous aurez ainsi toutes les peines du monde à convaincre le lecteur américain quant à l’utilité des idées innées. C’est que le domaine littéraire, là-bas, n’y est qu’aléatoirement associé à l’Université et son système de quadrillage de la parole; on ne parviendra guère à recenser des écrivains qui ont pratiqué le temps long des académies, la meilleure exception étant peut-être Philip Roth et ses autoportraits engainés de ressentiment et d’escarres, ou plus minoritairement Laura Kasischke, professeur au supérieur dans le Michigan, qui vient de publier Les revenants, un «campus novel» qui décortique les désapprentissages estudiantins (1). À l’opposé des figures académiciennes qui ont souvent peuplé l’espace littéraire européen, l’auteur américain est instruit d’une condition a priori erratique, c’est-à-dire une condition de vagabondage qui s’explique par l’évidence d’une immense superficie. Contrairement à l’effet de centralisation des savoirs dont souffre quelque peu la France, les États-Unis sont parvenus à disséminer leurs puissances créatrices, Whitmer ayant vécu cent vies avant d’accoucher non pas d’une pâle autofiction, mais d’un roman à tous les points de vue authentique tant il redistribue dans ses personnages ce qui eût été insipide si on l’avait remisé dans l’obsession du «Je» autofictionnel (2). Autrement dit, le vécu de Whitmer, enrégimenté dans l’intelligence de la fiction, réussit à nous tromper sans nous mentir, à l’instar du toréador qui abuse le taureau tout en demeurant vulnérable au-delà de ses parades. C’est parce qu’il a joué avec le feu que Benjamin Whitmer est littéralement capable de jouer le jeu, en l’occurrence ici le jeu de la construction romanesque.
Chez Whitmer, par conséquent, on ne croisera aucun personnage exercé au passage des diplômes. On sera ainsi épargné de certaines condescendances qui décrédibilisent nombre de mauvais romans car, à un certain niveau d’enfoncement au cœur de la dépravation, une écriture conventionnelle voire frileuse serait trop étriquée pour conquérir les formes à la ramasse, le tassement des êtres ou la gueuserie de la violence. Là-dedans, les diplômes sonneraient hors sujet, le tarif des droits de scolarité effectuant de toute façon un premier écrémage des populations aux États-Unis. Mais qu’à cela ne tienne, celui qui donne son titre au roman, Douglas Pike, est un fervent lecteur en dépit de sa truanderie qui lui colle à la peau. D’ailleurs, on ne voit pas ce qui rendrait incompatible une existence criminelle bourlingueuse et une attirance pour la littérature, surtout que cela ne fait pas office d’argument ni de prétexte (3). Donc le voilà, Douglas Pike, ce vétéran des putasseries, ce condensé de matière brute qui fume quantité de Pall Mall, qui fait claquer le capuchon de son briquet et qui, dit-on, s’est assagi, du moins en surface. La vie de Pike a toujours plus ou moins gravité autour de Nanticote, sa ville natale enclavée dans les Appalaches, non loin de Cincinnati, un quasi-eldorado à côté de cette urbanité marginale où s’enveniment les calamités. Autant dire que Pike a presque tout le temps vivoté, balancé entre la criminalité et la contrainte de gagner sa croûte.
Hormis cette errance stationnaire, Pike a connu l’attraction de son vaste pays, tantôt videur à Kansas City, trafiquant d’héroïne à Denver (cf. pp. 128-129 pour découvrir certains aspects détaillés de ce curriculum vitae), ou alors réformateur de lui-même au Mexique, la fugue méridionale étant dans le roman noir le symbole d’une quête de soi, voire d’une enquête de voisinage parmi des pensées laissées en jachère, vaincues par une promiscuité psychologique où le meurtre est devenu l’usage (4). Rentré à l’intérieur de lui, Pike a frappé aux portes de ses malheurs; il est devenu le modèle de ces Américains de «l’intérieur» pour reprendre notre exergue kafkaïenne, il a laissé de côté les horizons superflus afin de mieux envisager son métier d’homme, fût-il une crapule qui s’est détachée de sa fille Sarah alors que la gamine n’avait que six ans. Cette évolution crapuleuse exhibe en outre les preuves que Pike est un homme définitivement taillé pour l’aventure humaine : on ne le verra pas se chercher des excuses, il se montrera assez équilibré malgré l’influence de ses agitations, et l’on verra même ses yeux s’embuer une fois. En contrepartie, on le verra aussi tuer. Néanmoins ces tueries sont l’apanage du chaos consubstantiel au genre du roman noir, elles sont représentatives des «tough guys» que le genre met en scène sous la plume d’un «tough guy writer», lequel emprunte à toute une fraternité d’écrivains formés au «soleil noir de la violence» (5), à ce soleil dont Meursault fut l’affligé dans L’Étranger, à ce soleil homicide qui aime éclairer ce que la majorité aimerait ne pas voir, la violence individuée étant insoluble dans les jugements de la masse. Or si le soleil de l’Algérie frappait de sa chaleur étouffante, poussant absurdement au meurtre, le soleil des Appalaches, en plein hiver, garantit une fraîcheur insupportable, et c’est ce même soleil qui va se déporter jusqu'à Cincinnati, l’agglomération où Pike se remet en selle, de nouveau fringué de brutalité, serpent venimeux qui s’arrache d’une peau écaillée, pleinement de retour dans la véhémence des choses. À ses basques, son complice, le jeune Rory, boxeur de quartier, physionomie musculeuse du prolétarien qui passe son temps à soulever des haltères, flanqué d’un passé assujettissant au possible (cf. pp. 32-33 pour comprendre quelques spécificités de ce curriculum vitae).
À Cincinnati, c’est le temps des émeutes, «Négroville» étant vindicative depuis qu’on a descendu un des siens et qu’il s’avère qu’un flic aussi affreux que psychotique a fait le coup. À vrai dire, le prologue de Pike donne le ton : Derrick Krieger achève un jeune homme à terre. Derrick, contrairement à Meursault, sait pourquoi il tire plusieurs fois sur sa cible : «Il tressaillait encore lorsque Derrick le rejoignit. Lèvres entrouvertes, bouche et nez écumant de sang. Il clignait des yeux, essayait de parler; le ciel pesait sur son visage comme une main invisible. Derrick lâcha une troisième balle, qui lui fit un trou fumant dans la tête» (p. 12).
Ce crime est la première souillure de Pike, quoique le caractère de Krieger représente à lui seul la raffinerie de toutes les souillures en attente. Si Krieger et Pike sont décrits comme des quidams relativement équivalents à propos des qualités physiques, rien ne les raccorde au chapitre des qualités humaines. En fin de compte, l’un des grands enjeux de ce roman, c’est de sauver la part viable de Douglas Pike, si excédentaire par rapport à l’indigence morale de Derrick Krieger, personnage de l’avilissement complet, véritable «bouillasse» de l’espèce humaine, perpétuel écho de cette «bouillasse» sur laquelle ne cesse de revenir Whitmer lorsqu’il décrit la neige poisseuse de déjections, comme si l’immaculé de la blancheur était sincèrement impossible lorsque celle-ci s’agrège aux trajets de Krieger. Du reste, Whitmer va jusqu’à concevoir deux natures de la neige : celle des quartiers infectés et celle des résidences pavillonnaires, la blanche et la moins blanche en définitive (6).
Soit. Cincinnati est le royaume de Krieger, il règne sur la ville en molestant les quartiers noirs, il a des parts dans l’industrie de la prostitution et de la came. C’est un flic embrigadé dans la corruption, cassé par le déterminisme : «Lorsqu’il avait pris son poste ici, il se représentait la ville comme un fleuve, comme le grand boueux Ohio qui séparait Cincinnati du Kentucky. Il se représentait chaque habitant comme un affluent venant alimenter un lac commun de droit et d’ordre. Il se représentait, lui et ses talents, comme une digue devant les y canaliser de force. Il était naïf. Cette ville avait toujours été travaillée par plus de courants différents qu’il ne le pensait. Des courants contenus dans les ghettos jusqu’au jour où ils brisent les vannes en un débordement électrique comme celui qui brûlait sous ses yeux» (pp. 28-29). Puis la naïveté est expulsée par les réalités d’une ambiance boueuse jusqu’à son ontologie : «Pour sa première affaire, il avait trouvé une fillette de six ans avec les intestins qui lui sortaient du trou du cul, et sa mère à côté qui refusait de faire une branlette à son copain» (p. 29). De telles visions évacuent tout détour psychologique. En pareil cas, il est inutile d’insister sur la dislocation mentale, sur la distorsion des normes, les protagonistes formant un appareil d’action où s’insinue chaque fois l’incubation des mal-salubrités évoquées çà et là dans le livre, lorsque l’auteur relate des segments d’histoire ancienne (cf. pp. 55-56 pour consulter un moment du passé appartenant à Douglas Pike). Le reste, sinon, est écrit au présent, temps de la véracité instantanée, la seule manière de ne pas gaspiller d’énergie en exubérance psychologisante. De plus, le roman est rythmé par de courts chapitres, chacun mettant en évidence une phrase ou un syntagme qu’on va lire au cours du chapitre en question, à l’exception du prologue et de l’épilogue (7).
Douglas Pike et Rory s’introduisent à Cincinnati dans le but de faire un peu de lumière sur la mort de Sarah, fille de Pike et junkie dont le cadavre a servi d’exutoire spermatique aux clochards des sous-quartiers. Ce qui encourage Pike à conquérir un semblant de vérité sur sa fille, c’est le surgissement de sa petite-fille Wendy, une fillette de douze ans qui ressemble à son grand-père en vertu de ses lectures (on la découvre lisant les Histoire extraordinaires de Poe, et nous apprendrons ultérieurement que Pike vient de lire Beowulf). La littérature constitue entre la petite-fille et le grand-père un point de suture providentiel qui n’est pas d’emblée perceptible. Mais il faudra savoir s’en contenter compte tenu de l’ampleur des plaies ouvertes, les écorchures et les estafilades ayant valeur d’habitude pour ces personnalités immondes – c’est-à-dire hors du monde commun, démesurément cernées par toute une variété de disgrâces.
Ainsi l’énigme qui valide l’estampille du roman noir au sujet de Pike est la suivante : quelles furent à peu près les circonstances de la mort de Sarah Pike ? Le tandem Pike/Rory va traverser Cincinnati parallèlement aux courses malveillantes de Derrick Krieger, empilant des rencontres aussi bien improbables que loufoques (Bogey, à ce titre, est un personnage tout droit ressuscité des chaudrons de la beat generation). Et fatalement, à force d’écumer de semblables arrondissements de la violence, les personnages finiront par entrer en collision, encore que, à certains égards, l’antagonisme qui réunit Krieger et Pike est immédiatement flagrant tel que nous l’avons jusqu’ici suggéré. D’autre part, la force de ce roman, c’est de miser sur une tentation de l’insurmontable. Éclairer l’abîme, c’est le mot d’ordre de Benjamin Whitmer, en quoi il serait possible de distinguer au milieu de la «bouillasse» des germinations moralistes. Ce qui compte, c’est de rapatrier à la surface policée quelques réalités contenues dans l’abîme, c’est d’essayer de restituer l’envers des phénomènes quand ceux-ci sont accaparés par l’impureté. En d’autres termes, ce qui compte, c’est de faire se lever le soleil noir qui déshabille entièrement les êtres, celui qui «[…] dénude entièrement, [qui] fait se ratatiner dans son fauteuil» (cf. l’exergue du chapitre 51, p. 181).

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, benjamin whitmer, pike, éditions gallmeister, jacques mailhos, donald ray pollock, le diable tout le temps, éditions albin michel, christophe mercier, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer