La Belle France de Georges Darien (06/01/2017)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Mâles lectures.
Mâles lectures. Langages viciés.
Langages viciés.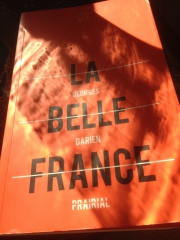 Acheter La Belle France sur le site de l'éditeur, Prairial.
Acheter La Belle France sur le site de l'éditeur, Prairial.Il faut commencer par saluer les toutes jeunes éditions Prairial qui, plutôt que de nous donner à lire puis jeter, à jeter avant même que de lire, tel ouvrage d'inculte écrivant présenté comme une révélation ou un chef-d’œuvre, révélation et chef-d’œuvre qui seront engloutis, d'ici quelques heures ou même minutes, par une autre révélation et un autre chef-d’œuvre, a cru utile, et a eu évidemment raison de le croire, de rendre de nouveau disponible un texte tout bonnement extraordinaire. Liberté extraordinaire, effrayante même à l'ère de la servitude volontaire qui caractérise notre époque et, en germe, celle de l'écrivain : Georges Darien ne plie l'échine devant aucun maître, et cette seule raison suffit à expliquer son oubli; violence extraordinaire, mais violence réelle, non surjouée, découlant logiquement de la liberté totale dont j'ai parlé et qui, si la première raison donnée n'était que quantité négligeable, expliquerait à elle seule l'oubli dans lequel ce contempteur implacable de ce qu'il a appelé, dans un autre livre, les pharisiens, est tombé; écriture extraordinaire, qui pourtant sert une thèse mais qui, par sa violence même, s'échappe du piège facile de la violence dirigée contre une cible trop aisément identifiable. Georges Darien n'a aucune cible, puisqu'il tire sur toutes (sauf peut-être sur les femmes), son écriture étant de toute façon une arme dont le canon est toujours chaud. Par cette plénitude, cet orgasme perpétuel de l'ire, il accède à une contrée mystérieuse, que seuls arpentent un tout petit nombre de marcheurs intrépides, qui n'ont strictement plus rien à perdre et, parce que totalement libres, ne peuvent plus faire rien d'autre que ce que le destin leur commande de faire : tuer, écrire, c'est selon, mais c'est au fond la même chose. Nous tenons un écrivain de sacré ramage et de lignage inconnu, et il n'est pas très étonnant qu'il soit tombé dans l'oubli disais-je, au vu de la complexion monstrueuse que j'ai mentionnée, bien assez forte, aujourd'hui, pour faire de vous un paria plus durablement embastillé qu'un démon dans l'Enfer de Dante. Ce qui frappe avant tout, c'est que Georges Darien, à la différence de tant d'exécrateurs pressés de se ranger des bagnoles et, en quelque sorte, de clamer leur amour à la Presse ou à la Coterie, ne peut être récupéré : imaginez un seul instant Georges Darien finir sur le giron d'une Élisabeth Lévy, comme Philippe Muray, le furibard réduit à quelque slogan mono-neuronal pour réactionnaire élevé au lait de caïman bio !
 C'est en 1901 que paraît, chez Stock après avoir été refusé partout ailleurs, ce texte qu'il serait tout bonnement inimaginable de pouvoir publier aujourd'hui, ou alors très largement caviardé comme le fit Jean-François Revel dans son édition du livre, et cela pour deux bonnes raisons qui n'en sont peut-être qu'une seule : La Belle France (1) est un texte aussi remarquablement écrit qu'il est d'une violence inouïe. Je m'amuse à imaginer quelle tête feraient les eunuques oints de moraline de La Croix s'ils devaient rendre compte d'un tel ouvrage, qu'ils s'empresseraient de châtrer en affirmant que la violence, fût-elle verbale, ne résout rien et que, même pour servir les pauvres, le Pauvre de tous les pauvres, pour introduire sa cause en somme auprès de sa Très Magnanime Éminence et le Toujours Prudent Si Saint Public qu'il s'agit de ne jamais froisser, mieux vaut se ranger aux habituelles laïcardes vertus républicaines d'un honnête et tempéré concordat du propos et du style ! Bref, renoncer. Bref, lâcher Darien, qui fut lâché de toutes parts parce que sa colère ne pouvait être assoupie par les lénifiantes hosties de la presse catholique ou même républicaine.
C'est en 1901 que paraît, chez Stock après avoir été refusé partout ailleurs, ce texte qu'il serait tout bonnement inimaginable de pouvoir publier aujourd'hui, ou alors très largement caviardé comme le fit Jean-François Revel dans son édition du livre, et cela pour deux bonnes raisons qui n'en sont peut-être qu'une seule : La Belle France (1) est un texte aussi remarquablement écrit qu'il est d'une violence inouïe. Je m'amuse à imaginer quelle tête feraient les eunuques oints de moraline de La Croix s'ils devaient rendre compte d'un tel ouvrage, qu'ils s'empresseraient de châtrer en affirmant que la violence, fût-elle verbale, ne résout rien et que, même pour servir les pauvres, le Pauvre de tous les pauvres, pour introduire sa cause en somme auprès de sa Très Magnanime Éminence et le Toujours Prudent Si Saint Public qu'il s'agit de ne jamais froisser, mieux vaut se ranger aux habituelles laïcardes vertus républicaines d'un honnête et tempéré concordat du propos et du style ! Bref, renoncer. Bref, lâcher Darien, qui fut lâché de toutes parts parce que sa colère ne pouvait être assoupie par les lénifiantes hosties de la presse catholique ou même républicaine.Il est une autre raison qui eût empêché Georges Darien de trouver de nos jours un éditeur et, si par chance il eût pu en dénicher un point trop châtré, de voir son livre passer sous les fourches caudines de la réclame journalistique : dans La Belle France, il n'a aucun ami, pas même les pauvres, coupables selon lui de s'habituer non seulement à leur pauvreté, mais de finir par l'aimer. Je cite in extenso un passage remarquable, et d'abord parce que l'auteur évoque son propre cas, ce qui est somme toute assez rare dans ce texte qui n'est qu'un immense projectile dirigé sur une multitude de cibles (les nationalistes, les socialistes, les curés, leurs parasites séculiers, les dirigeants politiques, et même nombre d'écrivains comme Molière !) qui n'en font finalement qu'une seule, le mensonge : «J'ai voulu écrire un livre sur la misère française, un livre dans lequel j'aurais fait voir quelle somme d'énergie immonde il faut, pour vivre, aux êtres qui se sont résolus à se conduire en lâches. J'ai commencé ce livre il y a longtemps; je l'ai abandonné; je l'ai repris dix fois, cent fois; et je ne le ferai sans doute jamais, tellement l'horreur me glace en l'écrivant, tellement je suis envahi par le dégoût ! Dernièrement, encore, j'ai essayé. Il me semblait entendre un grand cri venir de France, terrible comme un hurlement de supplicié, déchirant comme un sanglot d'enfant. Mais, vite, j'ai reconnu que ce n'était point un cri; c'était un ricanement – un ricanement qui se terminait en prière. J'ai jeté la plume... Je n'aime pas les pauvres. Leur existence, qu'ils acceptent, qu'ils chérissent, me déplaît; leur résignation me dégoûte», continue Darien, qui poursuit en affirmant que cette résignation le dégoûte à tel point que c'est, croit-il, «l'antipathie, la répugnance, qu'ils [lui] inspirent, qui [l]'a fait révolutionnaire. Je voudrais voir l'abolition, continue-t-il, de la souffrance humaine afin de n'être plus obligé de contempler le repoussant spectacle qu'elle présente. Je ferais beaucoup pour cela. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à sacrifier ma peau; mais je sacrifierais sans hésitation celle d'un grand nombre de mes contemporains. Qu'on ne se récrie pas. La férocité est beaucoup plus rare que le dévouement» (p. 125).
Ces lignes d'une méchanceté et d'une drôlerie irrésistibles sont bien évidemment loin d’être un cas isolé, puisque d’innombrables férocités surgissent en rang serré sous la plume de l'auteur de Biribi, notamment celles qu'il prête à Léon Bloy (2). Même si je songe aussi à Georges Bernanos, je ne puis que constater que Darien récuse par avance dirait-on toute opposition entre misère et pauvreté, sur laquelle Bernanos brodera plus d'une fois, comme nous le savons : «On remarquera que je n'établis aucune différence entre la pauvreté et la misère. Les deux termes sont synonymes, exactement. La distinction qu'on a voulu créer entre eux, bien qu'elle soit commode pour les souteneurs du présent état de choses, n'existe pas. Dès qu'on manque du nécessaire, on est pauvre; et dès qu'on est pauvre, on est misérable. Je ne crois pas que vivoter soit vivre; c'est agoniser. Je ne reconnais pas de degrés dans le dénuement. Je pense que tout être qui raisonne autrement que moi à ce sujet est un infâme menteur qui mérite la mort» (p. 122). Gageons que Bernanos, s'il a lu ces lignes, a dû par avance sourire de s'exposer aux imprécations d'un mort aussi intraitable que Darien (lequel quitta cette terre en 1921, cinq années avant que l'écrivain ne publie son premier roman, Sous le soleil de Satan), lorsqu'il écrivit sa Grande Peur des bien-pensants, qui veille à séparer la pauvreté de la misère qui est, affirme le grand romancier, une pauvreté devenue folle.
Comme tous les grands textes, La Belle France est essentiellement prophétique. Non pas qu'il annonce l'avenir, ce qu'il fait aussi cependant, mais parce qu'il commence, d'abord, par montrer quelle est la nature réelle du sol qui se trouve sous nos pieds : il n'y a là qu'une apparence de stabilité, car tout est friable, tout particulièrement la terre de France, qui d'ailleurs n'a pas de sol, puisqu'une baudruche (un mauvais rêve, dira Bernanos) ne saurait avoir quelque consistance que ce soit, sinon celle que veulent à tout prix lui donner les gonfleurs de baudruches. La France est un pays de vaincus c'est entendu. Mieux : elle est essentiellement le pays où les vaincus passent pour des victorieux : «Si vous voulez avoir droit au respect de tous, en France, commencez par vous faire battre» (p. 16). C'est ainsi que le «glorieux vaincu, voyez-vous, le seul, le vrai», est celui qui est «fier d'être vaincu», car «on lui dit qu'il a raison d'être fier», puisque «vaincu il est, vaincu il veut être, et vaincu il restera» (p. 17).
Le régime de l'imposture, nous le savons au moins depuis la lecture du deuxième grand roman de Georges Bernanos, est d'autant plus strict que les apparences extérieures sont impeccablement conservées. Un prêtre peut perdre la foi sans que le plus petit frémissement ne trahisse son tourment intérieur, scellé aux yeux de tous. Un peuple de vaincus comme l'est celui de la France doit donc veiller avec un soin jaloux à montrer qu'il ne l'est pas, et même à témoigner, aux yeux du reste du monde, qu'il est un peuple victorieux, plus victorieux qu'une armée de myrmidons gonflés aux hormones patriotiques : «Des monuments commémoratifs ! La France en est couverte; le sol gémit sous le poids de ces édifices d'ostentation et de mensonge. Jamais un peuple n'avait demandé à la pierre ou au bronze de lui fournir tant de preuves palpables de sa dégradation, tant de témoignages de son abaissement» (pp. 19-20), écrit ainsi Darien, qui complète sa sentence par ces mots et une date, fameuse, clouant le paon français sur la glace déformante de sa ridicule prétention : «Il est triste de voir une nation chercher à se mentir à elle-même; à duper, par l'exposé de convictions factices, ses sentiments réels; à se repaître d'illusions et d'impostures. Pas une fois, depuis 1870, la France n'a agi en nation sûre d'elle-même, consciente de sa valeur et de sa force. La noble blessée dont parlait Thiers est devenue une infirme sans noblesse. Et ce qu'il y a de plus entier chez l'infirme, c'est l'orgueil creux, la vanité» (p. 22). S'il semble donc clair pour l'écrivain que «la défaite trempe le caractère d'une nation; ou le brise» (p. 28), nous ne pouvons douter que la France soit un pays de pleutres gouvernés par des imbéciles, ribambelle d'enfants humiliés interchangeables contre lesquels Darien ne semble jamais avoir de mots assez durs, lui qui pourtant en regorge, d'une violence contrôlée infiniment plus convaincante et surtout puissante que les logorrhées du Céline pamphlétaire : «Le sens moral, qui est le sens de l'action, leur manque. Ils ne savent plus ce que c'est qu'un acte; ils en sont aux agissements. Et l'on dirait que la seule chose entière qui reste en eux, c'est cette rage interne, cachée dans les plus noirs replis de l'amour-propre, qui soulève en secret l'être ignorant, pusillanime et pervers contre tout ce qui vaut mieux que lui» (ibid.).
Finis Galliae, expression qu'emploie Darien (cf. p. 39), ou encore la France brisée, pourrait assez bien convenir comme sous-titre de son ouvrage, dont l'objet, nous apprend-il, est de montrer que les causes qui selon Helvétius produisaient en 1771 la décadence de la France sont «encore en existence» (p. 38). Je ne suis pas certain que Darien reprenne à son compte les raisons avancées par Helvétius, tout bonnement parce que le premier ne manque pas d'explications (le patriotisme, défini comme «l'hystérique désir d'une revanche impossible», p. 44, la Réaction englobant l'Armée et l’Église, «la pieuvre militaire et le vampire catholique», p. 64, etc.) venant au secours de son terrible constat, dont il a pris l'exacte mesure et qu'il a décidé de peindre dans une fresque immense, qui ne pourra que dessiller les yeux des badauds et qui, bien sûr, comptons sur les journalistes, sera précipitamment recouverte d'un voile pudique. Qu'importe la lâcheté des lâches puisque, quoi qu'il en soit, le mot d'ordre reste le même : il ne faut point fuir devant l'imposture, mais la crever.
Et, pour la crever, il faut être un écrivain, car lui seul, s'il n'est évidemment point un bonimenteur, saura dégonfler l'enflure des mots, et leur redonner le sens qu'ils n'ont perdu qu'à cause d'une manipulation de prestidigitateur. Pamphlet au carré voire au cube, pamphlet des pamphlets pour le coup, La Belle France est une critique radicale contre ce que j'ai appelé les langages viciés, et que Darien résume par une image remarquable, parlant de ces êtres «dont l'âme est un larynx» (p. 62) : «Mais, s'ils ne donnent pas l'exemple du patriotisme, ils le prêchent. De quelque parti qu'ils se réclament, leurs sermons et leurs homélies ne varient guère. C'est toujours le même couplet sur le merveilleux relèvement de la France, et le même refrain sur la revanche nécessaire que l'avenir tient en réserve; toujours les mêmes déclamations farcies de sous-entendus d'allure menaçante et de lieux communs hors d'usage; toujours les mêmes invitations à l'union, à la concorde, à l'oubli des querelles et des dissensions» (p. 48).
Il faudrait citer intégralement des dizaines de passages de ce livre prodigieux, qui annonce bien des colères, et peut-être même des haines littéraires futures, bien que l'objet n'en soit pas forcément le même, mais il n'en reste pas moins que La Belle France vaut d'abord pour le constat imparable et magistral posé sur un pays spectral : «Les yeux fixés sur un mirage qui sans cesse se recule, disparaît, et ne reparaît que pour s'évanouir encore, [la France] semble vivre dans une atmosphère étouffante et viciée qui enlève jusqu'à la possibilité même des compréhensions nettes et jusqu'au désir de l'énergie. On dirait que sur cette nation, la pénétrant par tous ses pores, plane l'odeur suffocante et putride de la défaite, pareille à un cadavre mal enfoui que la terre rejette, boursouflé et pourri, et dont les miasmes pestilentiels viennent empoisonner les vivants» (p. 52).
Toujours, la France se caractérise selon Georges Darien par son rêve de grandeur, que la réalité, sordide, dément à chaque seconde. Il suffit pourtant d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, mais comment se fait-il que Darien hurle dans le désert ? C'est que personne ne veut voir la réalité, bien sûr, si confortable pour tous les Assis qui font leur beurre et reluquent en prime les fesses grasses de la fermière, que Darien traite plaisamment de «pourfendeurs ataxiques», composant une «cohue de janissaires gâteux» (p. 61) ! : «Il aurait fallu faire un effort; il aurait fallu ne pas avoir peur. Et au lieu de se laisser confronter par la réalité de sa Défaite, elle a préféré rester face à face avec les fantômes vermoulus de ses Victoires mortes et le spectre imposteur de sa Victoire future» (pp. 57-8). La place de la France est donc inexistante, son passé étant faux, de même que son avenir, une nation ne pouvant vivre dans le seul présent de l'immanence radicale, privée de racines et de canopée.
Que faudrait-il donc, pour se débarrasser de cette «coalition d'assassins et de matassins, de faux-bonshommes et de fausses-couches» (p. 65), que faudrait-il faire pour envoyer dans son trou le «fougueux Jules Lemaître» qui, «dès qu'on allume les becs de gaz, baisse sa visière de combat sur ses paupières qui battent la chamade», ou pour évacuer le «bouillant Coppée» qui, «lorsque sa sœur a versé dans la camomille matutinale trois gouttes de la liqueur des braves, met des éperons à ses pantoufles» (p. 67) ? Il faudrait ne pas craindre d'utiliser charitablement ce que Georges Darien appelle le «Rasoir national» (p. 354), la Révolution bien sûr, à condition de s'entendre, nous le verrons, sur ce terme, «panier de son» dans lequel la France molle, liquéfiée, la France simulacre, dupliquée «laissera couler ses dernières baves» (p. 65) bien davantage que sa tête, qu'elle a perdue depuis des lustres. La Révolution, selon Darien, est «la seule attaque possible à la France», alors que «la défense nationale n'est qu'une farce ridicule» (p. 181), car elle permettra de faire advenir, face à «la France des Nationalistes, c'est-à-dire la France de Rome», «la France des Protestants, des Intellectuels et des Cosmopolites» (p. 268), bien que nous ne pensions pas qu'en employant le terme «Intellectuels», Georges Darien ait pu un instant imaginer ce qu'il adviendrait de cette caste de mandarins à tête hydropique. Ce n'est pas tant son don de prescience qui a des limites : c'est plutôt l'abaissement de notre époque qui n'en a point. Il est assez étonnant, du reste, de constater de quelle liberté intellectuelle jouissait Darien qui, de nos jours, passerait pour un furieux anarchiste : drôle d'anarchiste, qui peut affirmer que le plus féroce des patriotes est aussi le plus ouvert aux autres peuples ! Drôle d'anarchiste que celui qui voue aux gémonies l'Armée, accusée non point de se battre mais de conserver comme une mère son nourrisson la paix sociale (cf. p. 181), autrement dit l'exploitation des pauvres par les riches, avec la bénédiction de l’Église !
Quoi qu'il en soit, il est après tout logique, sinon normal, qu'un pays qui se paie de mots, qui «se contente de chimères et ne demande pas autre chose» (p. 194) crève par la maladie qui affecte ces derniers : «Des mots, des mots, des phrases sonores, des déclamations pompeuses et vides» (p. 69), et il est normal, mais aussi logique, que le Français, «à cheval sur les principes, à genoux devant les traditions, et à plat ventre devant ceux que n'effrayent ni ses moulinets ni ses fanfaronnades» (p. 75), n'ait plus aucune envie d'aucune sorte, si ce n'est celle d'adhérer avec le plus de ferveur possible au mensonge généralisé, tout comme la France, qui est «toujours belle, comme autrefois, au grand soleil de messidor», a pourtant «cessé d'être grosse» : «Les sabres prussiens, à Sedan, lui ont enlevé les ovaires» (p. 76) !
Autant ne pas se raconter d'histoires et supposer la France morte, même si le cadavre bouge encore, comme le montre l'exemple du boulangisme (3) : «La seule politique que veuille la France, c'est une politique incolore, insipide, flasque; elle est prête à payer n'importe quoi pour avoir cette politique-là; et elle paye, et elle l'a. Moyennant quoi, elle peut dormir et, entre deux sommeils, se trémousser quelque peu afin de donner aux autres et surtout à elle-même l'illusion d'une agitation féconde» (p. 78).
Les causes de la dégénérescence de la société française sont profondes : l'emprise qu'exerce sur elle le curé bien sûr, nous y reviendrons, mais aussi la disparition de ce qu'il faut bien appeler la race française, que Georges Darien, lui, n'a aucun mal à qualifier (même s'il affirme par ailleurs qu'il n'y a de «race française que pour les animaux», p. 101), par l'absence même de ses caractéristiques : «On peut retrouver sur les faces des passants, dans une grande ville française, les caractéristiques, plus ou moins abâtardies, de toutes les races; on n'y peut jamais distinguer un seul trait purement français. C'est ma conviction qu'un type français exista, à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle; et qu'il a disparu» (p. 80). Nous n'en saurons pas davantage sur les raisons de cette disparition mais Darien, lui, comme Maurice Barrès et avant Guy Dupré, est persuadé que l'énergie morale de la France «diminue tous les jours», tout comme sa population d'ailleurs, qui «a cessé d'augmenter», et cela pour certaine raison autour de laquelle la colère de Darien se cristallise comme une gemme très pure (4), mais aussi parce que «La France a la haine de l'homme qui pense par lui-même, qui veut agir par lui-même, qui n'a pas ramassé ses idées dans la poubelle réglementaire et qui fait fi des statuts des coteries abjectes que patente la sottise envieuse. Cet homme est marqué au front, dès qu'il se montre, d'un signe à la vue duquel tout le monde s'écarte. C'est un pestiféré» (pp. 82-3), l'esprit bourgeois qui caractérise notre pays ayant tué beaucoup de grands hommes, dont l'étonnant et oublié Ernest Hello !
J'avoue que voir ainsi Georges Darien mentionner, dans la catégorie des grands hommes, celui qui fut l'un des plus remarquables inspirateurs de Léon Bloy m'a bouleversé (cf. p. 84). C'est peut-être d'ailleurs à la lecture des textes d'Hello que Darien a développé ce tropisme millénariste, réellement apocalyptique, qui n'est évidemment pas une singularité si on la rapporte à la littérature pamphlétaire : puisqu'il faut tout détruire, s'attaquer à l'empire universel du mensonge, puisqu'il faut aussi, d'abord peut-être, trancher le cou de la «tyrannie du larynx» (p. 291), autant prétendre raser (gratis) les bâtiments sans laisser même subsister une seule poussière de leur fondation.
C'est ainsi que nous pouvons lire ces quelques lignes (5) que n'eût point désavouées Léon Bloy, et aussi Hello : «Il viendra sans qu'on l'attende, et sans parler. Il n'aura pas besoin d'expectorer des discours et de polir des phrases pour se faire comprendre. Son geste muet dira que le temps est passé des lâches mensonges et des hypocrisies meurtrières. Il ne saluera point les croix auxquelles est crucifiée la Misère : il les renversera. Il ne demandera pas de couronne : il exigera la liberté et le bonheur de tous. Il déliera les opprimés et appesantira sa main sur les oppresseurs. Son épée, ce sera la faux qui fauche le cou des tyrans, entre ses deux manches rouges» (p. 94).
Nous avons vu plus haut que Georges Darien n'établit aucune différence entre la misère et la pauvreté, et, même, qu'il n'a le plus souvent qu'un profond mépris pour les pauvres (n'écrit-il point : «Les Pauvres, d'ailleurs, méritent l'insulte», p. 252), qui bien trop souvent cultivent leurs propres ulcères, pour le plus grand plaisir des catholiques, que Darien déteste si visiblement, plus encore peut-être qu'il ne hait les riches, à moins qu'il ne les confonde (6) dans le même mépris souverain, nietzschéen : «La charité devient une maladie d'essence religieuse, ridicule et terrifiante; la pitié se christianise jusqu'au dernier point de l'abjection; il y a, aujourd'hui, la folie du haillon et de l'abcès comme il y a la folie de la croix. Il s'agit toujours de se donner des sensations; mais la purulence doit devenir de plus en plus fétide, tangible» (p. 120).
Que veut donc Darien, dont le goût viril lui fait détester ces «charcutiers de la farce et les marmitons de l'anecdote» (p. 129) dont le pourtant vénéré Molière est l'exemple le plus illustre, mais aussi, n'oublions pas cette salope, «la presse littéraire, qui fut fondée pour répondre aux désirs avoués d'une population de coprophages» (p. 131) ? Il veut, c'est une évidence, des hommes libres et non des esclaves, des pauvres peut-être, mais des pauvres refusant d'être des pauvres, des pauvres ne supportant pas d'être des pauvres et, par leur révolte, fondant la véritable patrie qui seule compte à ses yeux, la patrie dont les fondations ont été profondément coulées dans la terre de la révolte, avec du sang en guise de ciment : «Si la souffrance était bonne à quelque chose», écrit ainsi Georges Darien, «elle aurait appris aux pauvres la nécessité de la révolte» (p. 143), et à venger «les 35 000 cadavres de la Commune» (p. 271).
Car il faut dire que le pauvre, auquel Darien, comme Bloy, accorde une majuscule, n'est pas un citoyen français : «L'existence du Pauvre n'est admise, en fait, qu'autant qu'elle est nécessaire à l'existence du bourgeois. La qualité de Français, que le Pauvre croit avoir achetée, il ne l'a pas. Ce n'est point un titre régulier qu'on lui a vendu; c'est un faux. En échange de l'argent qu'il a apporté, encore tout humide de ses sueurs et tout mouillé de son sang, on lui a donné une qualification sans valeur, sans signification. Un mot, de l'ombre, du vent. On l'a volé. Le seul droit qu'il ait acquis, c'est le droit d'exercer en France les vertus qui lui attirent les louanges de ses tyrans» (p. 141). Qu'est-ce que la pauvreté ? Je pense que nous ne nous tromperions pas en affirmant qu'elle est, aux yeux de Darien, d'abord, «la somme de toutes [les] lâchetés» (p. 150) des pauvres !
Il est parfaitement logique que le thème de la révolte des pauvres ne soit point fondamentalement différent de celui de la violence apocalyptique nécessaire, partout présente dans le livre de Georges Darien : «Les temps sont proches. L'heure des discussions, des croyances, et même des négations, est passée. Elle ne doit pas revenir avant l'abolition de la misère», puisque c'est à «l'action inflexible, à l'emploi nécessaire de la force», que «le Silence [...] doit préparer les Pauvres» (p. 153). Je ne résiste pas au plaisir de citer, à cet égard, le passage suivant, où le ton de Georges Darien se fait, à juste titre et avec une justesse confondante, prophétique, au sens que j'ai du reste pointé précédemment (le prophète annonce moins l'avenir qu'il ne révèle l'imposture qu'est le présent, Blanchot a vu juste sur ce point) : «Nous touchons à un âge d'extermination. Nous sommes déjà, en fait, dans un âge d'extermination. Rien de ce qui existait hier n'existe aujourd'hui; le jour qui vient le prouvera. Les choses se sont transformées sous nos yeux sans que (7) nous nous en apercevions; elles nous apparaîtront, soudainement, sous leur nouvel aspect. La guerre elle-même n'est plus seulement internationale; elle devient civile; son résultat n'est plus seulement politique; il est social. Ces choses sont tellement près de se manifester que je ne les énonce pas au futur. C'est demain que le fer doit donner au Pauvre la liberté et le pain – la terre qui produit le pain et proclame la liberté» (p. 158). Foin des petits arrangements et des guerres qui n'en sont point, au diable les mots menteurs (8), mais aussi la tolérance ayant remplacé l'intolérance «qui trempe le caractère de l'être et lui permet d'accomplir de grandes choses» (p. 220) (9), puisqu'une guerre «entre la France et un autre grand pays ne sera pas seulement une guerre internationale, politique; elle sera une guerre sociale, civile pour ainsi dire». Pourquoi ? La réponse est aussi simple que sidérante : «S'il devait en être autrement, par impossible et par malheur, la France n'aurait pas besoin d'engager la lutte; elle serait vaincue d'avance» (pp. 170-1). Vaincue, nous savons qu'elle l'est.
Puisque nous vivons, selon Darien, à une époque où les «frontières de la France circonscrivent son influence», dans un temps où la France ne peut plus «imposer son despotisme au monde» et où son «action morale même cesse peu à peu de se faire sentir» (p. 195), puisque l'homme moderne «n'est qu'un rouage infime dans l'immense et grossière machine de l'esclavage social», puisque l'homme libre s'est fondu dans l'homme des foules qui «se débat avec les circonstances, c'est-à-dire entre les pattes molles de la fatalité ridicule et artificielle à laquelle l'a livré une monstrueuse apathie qui le rendit indigne de la griffe du Destin» (p. 201), autant faire table rase : «Pour le moment, il est inutile d'espérer que les luttes qui marqueront l'avènement des temps nouveaux n'auront point un caractère bestial; il ne peut pas, hélas ! en être autrement» (pp. 199-200), table rase pour faire naître, enfin, «la France réelle, expression vivante de la liberté et de l'égalité, la Belle France» (p. 201).
La Belle France verra la conquête, par la femme (à laquelle Darien consacre des pages extraordinaires (cf. pp. 220-30), que les imbéciles féministes devraient apprendre par cœur si elles connaissaient ce livre, ce qui évidemment ne sera jamais le cas !), mais aussi par le Pauvre, d'une véritable liberté, qui sera la victoire définitive sur le «saltimbanque en soutane» (p. 215), sur le catholicisme (10), défini comme étant la «figure surnaturalisée de l'esclavage moderne» (p. 207), et puis encore sur les «vieilles institutions de l’Église, de la Famille et de l’État» qui hélas existent toujours, dont les «piliers vermoulus sont anxieusement étayés par les malheureux dont l'esprit infirme et lâche craint l'écroulement de prisons qu'ils sont descendus à aimer» (p. 218).
«On est catholique pour deux raisons : par imbécillité ou par intérêt» et, poursuit Darien, «dans les deux cas, parce qu'on n'est pas libre» (p. 207), mais certainement pas pour venir en aide au Pauvre, car ce n'est pas le Christ, ce «défroqué d'existence problématique qu'on donne comme le fils d'une vierge» (p. 210) qui, aujourd'hui, saigne et pantèle, mais le Déshérité. La chrétienté, singulièrement le christianisme gallican, est une imposture, née du ventre du «premier charlatan chrétien [ayant] bâti la première église», sortie tout droit de la croix qui «ferma de ses deux bras désespérants l'horizon du genre humain». Si le christianisme est une imposture, si le prêtre est «un mensonge vivant» et le chrétien «est le Mensonge» (p. 237), le Pauvre en est la première victime. La Belle France ne sera donc plus chrétienne, en tout cas plus extérieurement chrétienne, socialement chrétienne, salopement chrétienne : «Tant que les idoles auront des palais pour les abriter, il y aura des hommes qui n'auront pas de toit et des femmes qui mourront de froid le long des rues, avec leurs nourrissons dans leurs bras; tant qu'une église souillera la face de la terre, la terre ne sera pas libre; elle criera pour sa délivrance, mais l'homme ne l'entendra pas; il n'entendra que les hymnes qui chantent le bonheur céleste, les soupirs de l'orgue qui clament la beauté des Paradis menteurs» (p. 239). Si la Belle France veut naître et vivre, elle ne peut naître et vivre «avant que soit mort le prêtre» (p. 252). Ce meurtre du prêtre, auquel Darien accorde, comme au Pauvre, une majuscule, prend des allures de mystère moyenâgeux, l'Apocalypse, une fois encore, effaçant les vieilles catégories et offrant même une porte de sortie au nihilisme, un mot absent du livre de Darien, qu'il ne cesse pourtant de peindre sous ses différents masques : «L'ère de la critique et l'ère même de la négation sont passées; nous sommes entrés dans la phase de destruction. On ne discute plus. Voilà un signe tragique. Les grandes luttes qui vont s'ouvrir, quel que soit le caractère des nations qui y prendront part, ne seront point les guerres de religion que prédisent quelques-uns. Les vieilles croyances y apparaîtront en armes encore une fois, mais pour disparaître à jamais dans la fumée de la bataille ou pour sortir, purifiées de tout élément anti-humain, du feu terrible du conflit. La victoire n'appartiendra ni à un système, ni à une doctrine; elle appartiendra enfin au sens commun; elle sera à l'Homme, qui aura supprimé le prêtre en conquérant la terre» (p. 254).
Le sens commun dont parle Georges Darien est à considérer au sens premier, social, politique, et ce n'est pas sans raison que l'écrivain évoque, à la page suivante, la nécessité de «communaliser la terre. Il faut la communaliser par le moyen de l'impôt unique, de l'impôt sur la terre». Il ne faut donc pas nationaliser la terre, à savoir commettre de nouveau l'erreur que commit la Révolution, puisque cela reviendrait à «perpétuer le système de propriété individuelle du sol» (p. 255), à conforter de fait un peu plus encore l'assise du système clérico-nationaliste (cf. p. 269).
Ici, l'homme de gauche, s'il me lit (ce dont je doute fort) exulte, car il voit venir le moment où il va pouvoir faire de Georges Darien le héraut tonitruant des forces du Progrès, contre l'obscurantisme réactionnaire ! Mal lui en prendrait, car les coups que l'écrivain, décidément infatigable, réserve à ce qu'il appelle le socialisme scientifique (même s'il ne le sépare guère de son pendant utopiste), sont d'une violence rageuse, jubilatoire car, décidément aussi, la seule chose qui l'intéresse, ce sont les hommes et non les «automates» (p. 272), qui jamais ne pourront avoir de patrie pour vivre (puisqu'ils ne vivent pas mais survivent). Georges Darien n'a pas de mots assez salissants pour compisser «les portes du paradis collectiviste» (p. 281) : «La terrible omnipotence du capital, la guerre au Système capitaliste, la lutte des classes, l'union nécessaire, etc., sont des thèmes suffisant aux déclamations des Va-de-la-Langue qui rêvent de pousser l'humanité, dûment matriculée et embrigadée, vers le bagne du Bonheur forcé» (pp. 281-2). En quelques mots, Georges Darien semble nous annoncer l'Enfer que le communisme stalinien rebadigeonnera de riantes couleurs, dont la dominante sera celle d'un rouge sang obtenu par le broyage méthodique de millions de pauvres.
Voyons encore ce que Darien écrit sur le socialisme : «c'est la discussion, c'est le bavardage, c'est le compromis, c'est la temporisation; c'est tout ce qu'on veut; c'est tout ce que veut la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie, oui, qui fait mouvoir l'épouvantail dont on prétendait lui faire peur. Il ne fallait pas chercher à faire peur à la bourgeoisie, ni discuter avec elle. Il fallait la frapper» (p. 284), selon la certitude maintes fois exprimée par Georges Darien, qui vise à faire de la Révolution l'unique irruption de la colère, du renversement de l'ordre social : «Le Socialisme «scientifique» n'a rien fait, ne fait rien, ne fera rien. Il serait temps que les sans-culottes, s'il en reste et s'ils ne se sont pas encore taillé des pantalons dans le linceul des grands principes, jettent pour de bon le caleçon aux amateurs de la bourgeoisie» (p. 283). C'est que la société «ne peut pas être réformée», au rebours des prétentions socialistes, «mais simplement détruite», Darien ajoutant, aussi sobrement qu'ironiquement : «Voilà un diagnostic que l'autopsie, j'espère, confirmera avant peu» (p. 287).
Et l'écrivain intraitable d'enfoncer le clou sur la vieille chouette socialiste, histoire de réduire drastiquement l'élan de son vol irénique au-dessus des champs où le bonheur est cultivé comme du coton : «Ces doctrines ne sont pas seulement imbéciles; elles sont infâmes. Si elles étaient réalisables, elles mèneraient directement, ainsi que l'a démontré Herbert Spencer, à une nouvelle forme d'esclavage, plus hideuse que toutes celles qui firent jusqu'ici gémir l'humanité. En réalité, elles sont trop ineptes pour mener jamais à rien, sinon à l'abrutissement d'une partie de la population, à la constitution de troupeaux veules et d'esprit obtus, qui n'ont en fait d'idée que la seule croyance irraisonnée dans des réformes dérisoires et dont l'unique souci est le respect maladif de la légalité» (p. 286).
Ces lignes sont non seulement terrifiantes, mais aussi effrayantes pour les lecteurs que nous sommes, revenus des massacres du bétail humain dans les prisons à ciel ouvert des paradis communistes, et ne peuvent que nous assurer de la hauteur de vue (de vision, plutôt), d'un écrivain qui sans relâche affirme que les «masses ne peuvent agir efficacement que si elles savent se forger, de toutes pièces, une politique qui soit comme l'éperon du grand navire qui porte les opprimés d'aujourd'hui sur le séculaire océan de la douleur humaine» (p. 296) et qui, cette fois sans la moindre précaution d'ordre oratoire, pose cette évidence : «La politique de tous les partis qui ne sont pas le parti des pauvres, n'a qu'un but : l'exploitation des pauvres» (p. 297).
Dès lors, nous comprenons mieux quel était le sens, pour le moins paradoxal, de ce communisme intégral que prône Georges Darien, qui affirme que «si les peuples ont un grain de bon sens», «l'impôt unique sur la terre conduit immédiatement à la suppression de la propriété individuelle du sol» et, partant, «à son remplacement par la propriété communale du sol» (p. 299), qui elle-même confère son sens au patriotisme intégral que revendique l'auteur : «la patrie, c'est la terre de la patrie» et, pour «arriver à la posséder, il faut se résoudre à se délivrer à jamais de toute servitude. Il eût fallu, ajoute Georges Darien, en un mot, faire du Socialisme un Nationalisme réel» (pp. 284-5).
Seule cette politique, évidemment drastique puisqu'elle sera menée par et pour les pauvres, mettra fin «à la division de l'humanité en riches et en pauvres, en êtres qui ont tout et en êtres qui n'ont rien», et seule cette politique, rêve sanglant de tous les millénarismes et, nous le voyons, de certains écrivains qui n'ont pas tenu une plume pour rire comme disait Bernanos, peut «donner à tous les hommes l'assise nécessaire au bonheur qu'ils auront à développer en beauté et en intelligence : une Patrie» (p. 300).
Comme Herzen l'affirmait, son indignation était son droit et il refusait de faire la paix. Darien, lui, est l'homme de l'intolérance dont il vante les mérites, l'écrivain qui n'a pas peur d'écrire que son propre livre «est comme une cloche qui commence à tinter, qui sonne, qui sonnera bientôt à toute volée». Et de filer la métaphore : «Que sonne cette cloche ? Elle sonne le glas. Que sonne-t-elle ? Elle sonne le tocsin? Elle sonne le glas et le tocsin. Elle appelle ceux qui veulent vivre. Elle bafoue ceux qui doivent mourir. Au cercueil ! Aux armes ! Deux lumières seulement peuvent percer la nuit compacte qui s'étend sur la France : les lueurs des cierges, épinglant leur clarté pâle au drap des catafalques; ou la rose aurore des temps nouveaux, avivée du reflet des torches qui précédèrent sa venue, et firent leur œuvre» (pp. 300-1).
Homme radicalement libre, jouissant de cette formidable liberté que confère une méchanceté trouvant sa meilleure arme dans un style, il est amusant de constater que Georges Darien reprend mot pour mot, à quelques exceptions près, les analyses désabusées qu'il adresse aux «chef du Nationalisme» («nullité sanguinaire des Nationalistes de parade» et «nullité plus complète et plus sanguinaire encore des Nationalistes honteux», p. 87) et à ceux de «l'Anti-nationalisme» (cf. pp. 304-5), les dernières pages de son livre monstrueux s'intéressant à approfondir ce que l'auteur entend par le patriotisme réel, intégral (11), à savoir «la conquête de la terre» (cf. p. 309) et, corollaire, l'idée du «grand Quesnay», l'économiste physiocrate, sur l'impôt unique «sur la valeur de la terre» (cf. p. 332), mis à mal par la Révolution elle-même dont Darien affirme, ultime surprise, qu'elle a été, «d'un bout à l'autre, un mouvement catholique-romain» (pp. 335 et sq.) et même qu'elle est la cause directe de «la guerre de 1870» (p. 352), et enfin que les désordres qu'elle a provoqués au sein de la société française ne pourront qu'être amendés par la véritable Révolution, «la Révolution sociale, de demain» (p. 355). L'une apportera, du moins c'est ce que pense Darien, la liberté aux pauvres, l'autre, «qui promettait la Liberté, l’Égalité et la Fraternité, n'a donné ni la Liberté, ni l’Égalité, ni la Fraternité» car, «plus d'un siècle après elle, c'est l'Inégalité qui règne» (p. 362).
Ne nous attardons pas sur ces points qui n'intéresseront que les historiens des idées, mais citons plutôt, une dernière fois, tel passage témoignant non pas d'un don de visionnaire, mais d'une lucidité qui ne pouvait faire de Georges Darien que l'orphelin absolu de son siècle, lui qui, finalement, puise son souffle littéraire dans la Bible (12) probablement davantage que dans n'importe quel autre livre écrit par ses contemporains, lui qui se montre impavide devant la certitude qu'il sait qu'il doit se passer de maître (cf. p. 155), quoi qu'il en coûte, toujours. De toute façon, c'est l'époque elle-même qui nous met à nu, et nous commande d'être durs : «La situation générale de l'Europe, grâce surtout à la position équivoque de la France, est une situation d'attente anxieuse, d'angoisse poignante, qui réclame impérieusement un dénouement. L'air est lourd, étouffant, comme chargé de clameurs qui crient l'immense fatigue des efforts perdus, et les ténèbres commencent à descendre, précédant la tempête. Les cent ans qui viennent de s'écouler ont poussé à des conclusions qui terrorisent; semblent avoir creusé, au seuil du nouveau siècle, un abîme devant lequel l'humanité s'arrête prise de vertige. La France donnera-t-elle, encore une fois, le signal des bouleversements ? Ou préférera-t-elle mourir, munie des sacrements de l’Église ?» (p. 317).
Nous en sommes là, nous encore plus que Georges Darien, horriblement libre au moins (13), cet homme joyeux mais sans gaieté (cf. p. 132), pitoyables esclaves que nous sommes devenus d'une «Kermesse de Servitude» (p. 37) puisque, comme «l'homme misérable» dont il dresse le portrait sordide (cf. pp. 329-32), nous devons poser notre chique, «et faire le mort» (p. 33) et que, de toute façon, l'inventaire n'est pas un droit mais un devoir, puisqu'il nous faut «vider sur la place publique, une fois pour toutes, le trésor douteux de la Basilique révolutionnaire» (p. 351) : «Cependant, il faut prendre une décision; il n'y a plus à chercher refuge dans les ruines du passé ni dans les brumes de l'avenir; c'est le présent qui vous confronte. Et le présent, c'est la bataille. Il faut vouloir vivre ou il faut se résigner à crever» (p. 313).
Bouleversante actualité de ce grand livre sur le peuple français, puisque soit «l'audace et l'énergie lui ouvriront une vie nouvelle», soit «l'apathie le conduira au tombeau» (p. 152). Il est plus que jamais urgent de choisir entre ces deux voies, et de regarder sans ciller «la face livide des idoles» (p. 219), mais que nous sommes seuls !, car, contrairement à ce que semblait penser Georges Darien, le destin ne semble plus «mettre les hommes sur la voie qui mène à l'action, en les laissant à leurs propres forces»; et encore moins, «lorsqu'il voit qu'ils n'avancent point, comme il faut que l'acte s'accomplisse», se décider à «intervenir lui-même et suscite son instrument, l'homme d'action» (p. 249).
Si l'homme providentiel, le grand homme, est aussi inconcevable que funeste, ce sont les travailleurs, les pauvres, qui «doivent vouloir avec une énergie terrible» la Belle France, que la vieille France, qui veut vivre à tout prix, empêche de naître. C'est la vieille France qui doit crever : «Il faut que le vainqueur l'empoigne par ses jambes de squelette et la jette dans la rue; et qu'elle se brise la tête sur le pavé, et que les chiens viennent, et qu'ils pissent dessus», car franchement, «elle pue trop pour qu'ils la mangent» (p. 357).
Notes
(1) Georges Darien, La Belle France (Prairial, 2014). Plusieurs éditions de ce texte existent dans le commerce, qu'il est plus ou moins facile de se procurer, outre l'édition originale, publiée chez Stock en 1901.
(2) Rappelons que Léon Bloy, selon Nicolas Massoulier qui a finement évoqué l'auteur de La Belle France, s'appropria (récupéra ?) consciencieusement tels mots de Georges Darien, après toutefois les avoir soufflés à l'intéressé. Je cite Massoulier : «Et je ne savais pas encore que Georges Hippolyte Adrien – car c’est là son vrai nom – fut l’ami de Léon Bloy, qui parle sous son costume de Marchenoir avec une tonitruance moirée d’éclairs dans Les Pharisiens, où Darien règle ses comptes avec l’éditeur Savine et la bande à Drumont. Bloy fut si rudement marqué des propos que lui prête Darien qu’il s’abandonna au plaisir de se les approprier. Si bien qu’aujourd’hui encore on trouve dans les études bloyennes les plus éminentes le discours inventé par Darien pour Marchenoir : «Pamphlétaire !… Ah ! je suis autre chose, pourtant… mais si je suis pamphlétaire, moi, je le suis par indignation et par amour; et mes cris, je les pousse, dans mon désespoir morne, sur mon Idéal saccagé…». Il est amusant de voir que tant tombent dans le panneau, que Wikipédia indique même Belluaires et porchers. Or si Bloy y reprend bien son hurlement, c'est en biseautant du rugissement, en vrai truand de la vocifération, omettant avec un brio bruyant de dire que les cordes vocales étaient dariennes… Mais ne fut-il pas, au dire d'un témoin du Chat Noir et plus qu'Alphonse Allais, «un mystificateur» ? (Maurice Donnay : «des deux, c'était Bloy le mystificateur», in L'esprit Montmartrois. Interviews et souvenirs, Laboratoires Carlier, 1938, p. 34).
(3) Parlant de la France, Darien écrit que ses «emballements sont factices. Ses enthousiasmes sont superficiels, proviennent de causes extérieures, quelconques; n'affectent, pour ainsi dire, que l'épiderme. Je crois qu'il en a toujours été ainsi, au moins depuis longtemps. Le boulangisme, en dépit de son extension, n'eut jamais de racines. [...] Chacune des personnes attachées au parti boulangiste souhaitait plus ou moins vivement de voir ses confrères monter à l'assaut du pouvoir et réussi le coup d’État; c'est certain; mais à ce souhait, souvent peu ardent et surtout peu dicté par la confiance, se bornait tout l'effort. Personne, même parmi les meneurs du parti, ne croyait au succès; les plus zélés s'efforçaient d'espérer qu'il se produirait tout de même, miraculeusement. Et bien peu de gens furent surpris de la grotesque cascade qui termina l'aventure» (pp. 88-9).
(4) Cet événement est la Commune : «L'épouvantable crime commis par les Nationalistes de 1871, le massacre des ouvriers parisiens, a saigné la France du meilleur de ses énergies. On ne sait pas ce qu'a coûté au pays, ce que lui coûte encore, cette tuerie immonde et imbécile. Elle lui a enlevé toute virilité, toute confiance en soi, l'a condamné à l'impuissance honteuse, a fait de ses prétentions démocratiques quelque chose de sinistrement burlesque. Non, une république qui s'était établie sur des piles de cadavres ne pouvait pas être une vraie république; et tous les efforts tentés afin d'en faire quelque chose de propre, devaient échouer piteusement. Elle ne pouvait être qu'un simulacre, une ridicule image, un attrape-gogos; et elle ne deviendra une réalité que lorsqu'elle se sera écroulée, avec la calotte crasseuse qui lui sert de bonnet phrygien, dans le sang dont elle est sortie» (pp. 270-1). Ailleurs, Darien affirme que la France, «il serait puéril de le nier, ne s'est jamais relevée du coup qui lui fut porté en 1870», alors que les «ressources de l'Allemagne en hommes, etc., augmentent tous les jours» (p. 193). Ailleurs, Darien affirme que «la dépopulation de la France n'est un mystère pour personne» (p. 269).
(5) Mais répétées souvent dans La Belle France, comme lorsqu'il évoque la possibilité d'une guerre, seul événement susceptible de sortir la France de sa torpeur, ce qui fait de Darien, en fin de compte, un optimiste qui, s'il avait vécu vieux, eût été cruellement floué par la réalité : «Je ne crois pas qu'une guerre soit absolument nécessaire à la formation d'une Patrie réelle; mais, vraisemblablement, elle en provoquera la création», car «un événement considérable» pourra «seul amener une modification aussi importante dans l'état général d'un grand pays» (p. 107). Georges Darien semble annoncer les futures déroutes françaises, lorsqu'il écrit : «Avant longtemps, la France sera attaquée ou sera obligée d'attaquer elle-même. Dans les deux cas, si elle ne transforme point radicalement son état social et politique, elle ne peut attendre qu'un résultat de la lutte : la défaite, la défaite irréparable, définitive» (p. 152).
(6) «Le crime le plus horrible des riches envers les pauvres est de s'être arrogé le droit de leur distribuer la justice et l'assistance, de leur faire la charité. Ce sont les misérables qui paient eux-mêmes, avec des intérêts usuraires, les frais de la justice dérisoire, de l'assistance immonde et de la charité dégradante qu'ils sont assez vils pour quémander et recevoir. Voilà le comble de la lâcheté, de la dérision et de l'hypocrisie» (p. 121).
(7) J'ai supprimé la virgule qui se trouve à cette place et qui me semble fautive.
(8) Rappelant l'adage de Voltaire («Les mots font en tout plus d'impression que les choses»), Georges Darien écrit ainsi : «Ils font même tant d'impression qu'on en oublie leur sens réel, le caractère de la chose qu'ils représentent, qu'on n'ose même plus supposer qu'ils puissent avoir une signification» (p. 174). Suit cette très belle comparaison : «Les peuples sont comme ds enfants captifs torturés par des mots. Les mots, les mots vides de sens, sont les geôliers des peuples modernes; les principes, qui sont tous des phrases ridicules et mensongères, des enfilades de mots creux, sont les tortionnaires des nations» (p. 175). Dans cette même page, Georges Darien poursuit plus avant sa dissection des mots menteurs, écrivant : «Des mots. Des mots ! On s'asservit, on se ruine, on se sacrifie pour des mots. Ont-ils une signification, ces mots ? On ne sait pas. Oui, ils ont une signification. Laquelle ? On ne sait pas. On ne veut pas savoir. Les mots arrivent, avec de grandes escarcelles, qu'il faut remplir. Les principes chargent les canons, avec une poudre qu'ils ont mouillée, sournoisement. Il ne faut pas que les canons partent. Ou, s'ils partent, il ne faut pas qu'on sache pourquoi. Il faut que les multitudes, gangrenées d'apathie morale et pourries d'ignorance voulue, descendent dans l'arène sans savoir pour quelle raison, saluant et acclamant les mots – ces Césars des peuples modernes, libres et éclairés – pour lesquels elles vont mourir». La propagande des grandes dictatures, Georges Darien le sait, est d'ores et déjà en germe sous son regard qui voit tout, et, surtout, murmure sa petite musique aigre qui deviendra bien vite un scherzo démoniaque pour son oreille absolue.
(9) «L'intolérance est permanente; elle n'a cure de la justice; c'est la défiance qui vibre en elle; elle ne veut pas de réformes, mais des suppressions totales. Il faut être intolérant pour être libre» (p. 220).
(10) Il faut lire d'une traite, et partir d'un grand rire, la description que fait Darien d'une messe catholique (cf. p. 213), de laquelle toute présence surnaturelle est chassée, au profit d'un pitoyable raout de demi-mondaines et de godelureaux. Il faut encore lire ce que Darien écrit de la contemplation de Dieu, comme substitut «de ce qui existe» interdisant «la contemplation de la douleur des pauvres» (p. 214), pour se dire que bien des traits le rapprochent, décidément, de Léon Bloy : «Plus les souffrances du pauvre deviennent intolérables, plus le prêtre exagère les souffrances de son Dieu; il l'a doué d'un sacré cœur dans lequel une croix est plantée, où sont enfoncées des épines, qu'entoure une chaîne et qui suinte du sang. Tant que les Pauvres n'auront pas un cœur comme ça, ils n'auront pas le droit de se plaindre» (p. 215).
(11) «Oui, nous tuerons le Passé. La France voudrait être cosaque ? Elle ne le sera pas. Elle sera libre. Et son territoire, cessant d'être la propriété d'une bande de coquins, appartiendra à tous ses habitants. La France aux Français» (p. 110, à la lettre, donc !).
(12) «Il y a beaucoup de belles choses écrites dans la Bible; et beaucoup de belles choses, aussi, qui n'y sont point écrites et qui y sont tout de même» (p. 27).
(13) Liberté extraordinaire, nous le supposons conquise de haute lutte, qui a dû effrayer les contemporains de Darien qui ne craint pas d'affirmer «qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'écrire pour dire quelque chose» (p. 263). Il suffit, du reste, de noter la très piètre opinion que l'auteur se faisait de la presse française de son époque (que dirait-il de la nôtre, par la barbe d'Aude Lancelin !) pour imaginer quelle formidable colonne de silence cette dernière dut ériger devant le pourfendeur ! : «Et voici, à mon avis, le journal français de demain : Une gazette de deux pages, d'un papier souple et solide; dont la première, imprimée, porterait au recto les indispensables calomnies quotidiennes et, au verso, quelques démarquages de télégrammes anglais ou américains; et dont la deuxième, toute blanche, avec initiale au gré de l'acheteur, servirait de mouchoir pour l'adulte ou de lange pour le nouveau-né» (p. 264).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, pamphlet, georges darien, éditions prairial |  |
|  Imprimer
Imprimer