Le mythe moderne du progrès de Jacques Bouveresse (09/08/2017)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
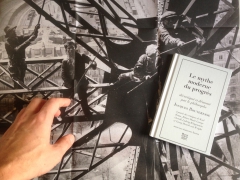 Acheter Le mythe moderne du progrès sur Amazon.
Acheter Le mythe moderne du progrès sur Amazon.Cet essai assez court, format de la collection oblige, est issu d'une conférence de Jacques Bouveresse donnée en 2001 à l'Institut finlandais de Paris ayant pour thème Georg Henrik von Wright, un philosophe pratiquement ignoré en France, pourtant auteur d'un ouvrage intitulé Le Mythe du progrès disponible à L'Arche depuis 2000. Autant dire qu'une nouvelle fois les éditions Agone font œuvre utile et même : de salubrité publique en publiant ce texte qui examine la question du progrès telle qu'elle est traitée, tout d'abord, par Karl Kraus.
Pour Jacques Bouveresse, excellent exégète de cet implacable contempteur de la parole de la Putain journalistique qu'est le Grogneur autrichien, «le but réel du progrès, s'il y en a un, est enfin devenu clair : tout se passe comme s'il n'était en fait rien d'autre que la continuation du progrès lui-même» (p. 13). Il est d'ailleurs étonnant, souligne Bouveresse, que nos contemporains, qui sans cesse nous répètent qu'ils sont devenus parfaitement sceptiques à «l'égard des grands récits de la modernité, à commencer par celui du progrès» (p. 28), ne cessent pourtant jamais de croire en la perpétuelle avancée de ce dernier. Le progrès progresse en somme, il n'est plus grand-chose qu'une force livrée à elle-même et qui ne peut plus être arrêté ni même ralentie, et c'est bien cela qui est goûté par l'homme moderne, incapable de tenir en place, lui-même animé d'un mouvement sans but, comme Max Picard l'a si bien montré : «le mot «progrès» n'a probablement jamais été autant utilisé et galvaudé (notamment dans le discours des hommes politiques, des technocrates, des économistes, des chefs d'entreprise et des financiers), l'obligation de servir le progrès aussi impérieuse et la prétention de le faire effectivement aussi affirmée» (p. 29). Il n'y a donc, contrairement à ce qu'affirme von Wright dans son essai, pas l'ombre d'un «rationalisme démythifié», à savoir «le rationalisme qui aurait réussi à se libérer de la croyance au mythe du progrès» (p. 35), tout en ne cédant pas à ce qu'il appelle «l'autorité de la Parole sur la vie de la connaissance, et de la religion sur la vie de l'action» (Bouveresse cite von Wright), proposition que commente ainsi Jacques Bouveresse : «il n'est malheureusement pas certain qu'on ait réussi jusqu'à présent à trouver un mode de démythification qui soit réellement libérateur et suffisamment distinct du rétablissement, sous une forme ou sous une autre, d'une autorité ancienne, en l'occurrence celle que la Parole avait exercée pendant longtemps sur la connaissance et sur l'action» (p. 36), d'où il appert que Jacques Bouveresse, bien qu'il le critique, n'en croit pas moins au mythe du progrès, puisqu'il ne saurait accepter (ni même concevoir ?) que sa très partielle éclipse puisse s'accompagner d'un retour de la Parole. Il concède d'ailleurs qu'il pense exactement la même chose que Zeev Sternhell qui affirme que «le monde tel qu'il est n'est pas le seul possible», et qu'il ne croit "nullement que l'idée de progrès soit morte ou nocive» (cité par l'auteur p. 95).
Je me range donc plutôt derrière Karl Kraus, qualifié de «conservateur de la valeur» (cf. p. 39) par Jacques Bouveresse, plutôt que derrière ce dernier, même s'il répète, au travers de son essai stimulant que, comme Kraus, «même si on ne sait pas ce qu'est le progrès, tout le monde est plus que jamais tenu de croire qu'une chose au moins est sûre, à savoir que nous progressons, que nous pouvons le faire de manière illimitée, et que l'obligation de continuer à le faire est une sorte d'impératif catégorique pour les sociétés contemporaines» (p. 38).
 Pourtant, Jacques Bouveresse, sur les brisées du fascinant Wittgenstein, semble penser que le progrès ne peut être, dans le meilleur des cas, que ralenti, mais que cette action non seulement est loin d'être suffisante, mais nous condamne probablement à un échec et, partant, à un asservissement catastrophique : «Wittgenstein semble avoir eu plutôt tendance à penser sur le mode révolutionnaire de la table rase suivie d'un recommencement radical que sur le mode mélioriste et réformiste qui est celui des représentants de l'idée du progrès continu et illimité» (p. 45). Plus loin, Jacques Bouveresse revient sur cette idée en affirmant que «Wittgenstein semble faire partie de ceux qui pensent, avec raison selon moi, que le problème de ce que 'on appelle les dégâts du progrès ne sera pas résolu par des corrections mineures introduites au coup par coup mais seulement par un changement d'attitude radical, qui est malheureusement peut-être devenu depuis un certain temps déjà impossible et qui consisterait à s'imposer une fois pour toutes une forme de sagesse et de mesure suffisamment rigoureuse, résolue et efficace dans la gestion des ressources naturelles et dans nos rapports avec la nature en général» (p. 69).
Pourtant, Jacques Bouveresse, sur les brisées du fascinant Wittgenstein, semble penser que le progrès ne peut être, dans le meilleur des cas, que ralenti, mais que cette action non seulement est loin d'être suffisante, mais nous condamne probablement à un échec et, partant, à un asservissement catastrophique : «Wittgenstein semble avoir eu plutôt tendance à penser sur le mode révolutionnaire de la table rase suivie d'un recommencement radical que sur le mode mélioriste et réformiste qui est celui des représentants de l'idée du progrès continu et illimité» (p. 45). Plus loin, Jacques Bouveresse revient sur cette idée en affirmant que «Wittgenstein semble faire partie de ceux qui pensent, avec raison selon moi, que le problème de ce que 'on appelle les dégâts du progrès ne sera pas résolu par des corrections mineures introduites au coup par coup mais seulement par un changement d'attitude radical, qui est malheureusement peut-être devenu depuis un certain temps déjà impossible et qui consisterait à s'imposer une fois pour toutes une forme de sagesse et de mesure suffisamment rigoureuse, résolue et efficace dans la gestion des ressources naturelles et dans nos rapports avec la nature en général» (p. 69).De Wittgenstein, Jacques Bouveresse nous dit qu'il semble, «peut-être en partie sous l'influence de Spengler, plus intéressé par des humanités particulières et par leurs formes de vies concrètes (2) que par l'idée de l'humanité en général et du progrès supposé de celle-ci. Et enfin il est opposé à l'idée, que Karl Kraus qualifie de paranoïaque, d'une prise de possession et d'assujettissement complets de la nature dans toutes ses parties et tous ses aspects, qui constitue, aux yeux de beaucoup de nos contemporains, le programme que l'être humain doit s'efforcer de réaliser par tous les moyens et qui s'identifie dans leur esprit au progrès lui-même» (p. 68). Il est dommage et frustrant que Bouveresse n'ait pas davantage évoqué les remarques mêlées du grand philosophe, comme celle-ci : «Il est tout à fait remarquable que nous soyons enclins à penser que la civilisation […] éloigne l’homme de son origine, de ce qui est élevé, infini, etc. Il semble alors que notre environnement civilisé, y compris les arbres et les plantes, soit enveloppé dans une cellophane bon marché et coupé de tout ce qui est grand, coupé pour ainsi dire de Dieu» (3), ou cette autre, qui montre bien la méfiance qu'éprouve Wittgenstein pour la modernité : «Ce dont il s’agit en réalité, c’est de parler, peut-être inconsciemment, la langue ancienne, mais de la parler de telle manière qu’elle appartienne au nouveau monde, sans pour autant appartenir nécessairement au goût de celui-ci» (p. 128).
Ce petit livre bien fait sur ce que von Wright et tant d'autres ont considéré comme une époque malade (cf. p. 94) se termine sur une leçon en demi-teinte, Jacques Bouveresse critiquant notre époque postmoderne comme étant «foncièrement optimiste» (p. 100). Il définit même le postmodernisme «comme étant la conception selon laquelle on sait moins que jamais où l'on va et on ne doit surtout pas chercher à le savoir, mais on sait en tout cas qu'il est important d'y aller le plus vite possible», «ce qui ressemble trait pour trait ou, en tout cas,beaucoup trop à ce qu'a fini justement par devenir l'impératif de la modernité lui-même» (pp. 100-1).
Notes
(1) Jacques Bouveresse, Le mythe du progrès (éditions Agone, coll. Cent mille signes, n°11, Marseille, 2016). Sans autre indication, les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(2) Curieux, j'aurais plutôt songé à Herder.
(3) Wittgenstein, Remarques mêlées (présentation par Jean-Pierre Cometti, Flammarion, coll. GF, 2002), p. 114, l'auteur souligne. Je cite cette autre remarque, qui montre toute la complexité de ce philosophe, apparemment beaucoup moins hostile que Bouveresse lui-même à cette Parole dont nous devrions nous émanciper : «Quel sentiment aurions-nous si nous n’avions pas entendu parler du Christ ? Aurions-nous un sentiment d’obscurité et d’abandon ?» (p. 67).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, philosophie, jacques bouveresse, progrès, éditions agone, karl kraus, robert musil, george orwell, ludwig wittgenstein, georg henrik von wright |  |
|  Imprimer
Imprimer