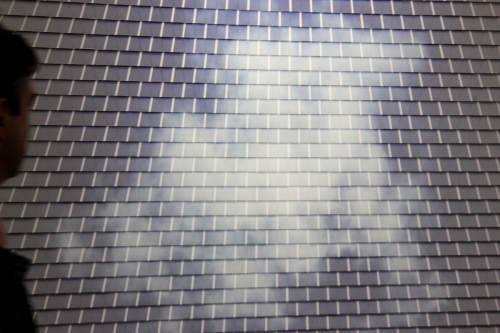Blade Runner 2049 : une parabole sur l'accession au désir autonome, par Radu Stoenescu (21/11/2017)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
Quoi que voudraient dire Ridley Scott ou Denis Villeneuve à propos de ces films, ce sont leurs œuvres que je vais laisser parler, non leurs auteurs, considérant qu'elles sont suffisamment grandes pour le faire sans que ceux-ci ne leur tiennent la main. En cela, ces œuvres sont abouties : si les réalisateurs avaient quelque chose à rajouter, ils auraient dû le mettre dans le film. Les deux Blade Runner sont explicitement des paraboles, à cause d'un indice présent dans la scène d'ouverture de chacun d'entre eux : le gros plan sur l’œil bleu du «blade runner», Deckard et respectivement Joe, dans lequel la caméra nous force à plonger : nous entrons dans leur âme.
Le drame qui s'y joue est celui qui tourmente chacun de nous : que veut dire «être humain» ? Quelle est la différence entre un réplicant et un humain véritable ? Le «blade runner» se trouve sur le fil du rasoir entre l'humanité et l'inhumanité, il court sur ce fil du rasoir, ce qui signifie qu'il vit dans la crise infinie de ce questionnement abyssal. C'est ce problème fascinant qui est posé dans le premier opus : les réplicants sont comme les humains, il est impossible de les distinguer d'après leur apparence, et eux-mêmes semblent incapables de se rendre compte qu'ils sont inhumains. Bien plus, ils s'humanisent de plus en plus avec le temps qui passe, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils doivent être «retirés» du service avant qu'ils ne parviennent à la pleine humanité.
N'y parviennent-ils pas, d'ailleurs, malgré tout ? Roy, le réplicant, dans la fameuse scène finale du premier film, n'est-il pas plus émouvant encore que Deckard, qui est théoriquement l'humain de l'histoire ? La confusion est totale, la question reste irrésolue : à la fin du premier volet, on ne connaît le critère ni pour reconnaître un humain, ni pour se reconnaître humain. Si un réplicant aussi a peur de la mort et veut vivre, s'il connaît la finitude sans avoir lu Heidegger, et s'il a eu une vie, certes brève, mais intense, comme le lui rappelle Tyrell, son créateur, lorsqu'il essaie vainement de le consoler de sa mort imminente, qu'a-t-il de moins qu'un homme ? Combien d'hommes d'ailleurs ne vivent-ils pas des vies beaucoup plus longues, mais aussi beaucoup plus ternes (2) ?
C'est par l'idée d'intensité que l'on s'approche de la solution de l'énigme : la différence entre le réplicant et l'humain, c'est sous les masques de la parabole, la différence entre le déprimé et l'homme qui croque la vie à pleines dents. Le réplicant est le symbole de l'individu sans désir propre, esclave du désir d'un autre, sans autre désir que celui de sa propre survie, c'est un membre d'un groupe de Bokanovky du Meilleur des mondes de Huxley, c'est un clone sans originalité, bref, sans «âme». Ryan Gosling joue à merveille ce réplicant, cet individu fade qui fait son travail, et qui rentre chez lui pour goûter la compagnie synthétique de sa poupée virtuelle, Joy. Plus que l'empathie, c'est l'intensité du désir, voire l'existence du désir tout court, qui distingue le réplicant de l'humain. Joe est l'opposé du jeune Deckard : le désir est tout entier du côté de la monstrueuse poupée aguicheuse, qui cherche désespérément à s'incarner, alors que dans le film de 1982, l'agent joué par Harrison Ford séduit d'une manière virile une Rachel déboussolée quant à l'authenticité de son désir (3).
Et pourquoi les réplicants n'ont-ils pas d'âme, c'est-à-dire pas de désir ? C'est parce qu'ils ne sont pas nés d'une femme, nous dit le deuxième film. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi le miracle, c'est la banale naissance d'un bébé ? Pourquoi tous les réplicants, comme Joe lui-même, auraient-ils aimé naître d'une femme ? Parce que pour avoir une âme, pour désirer soi-même, il faut avoir été désiré par un autre. Luv, la réplicante qui sert Wallace, dit d'une manière mélancolique à Joe : «C'est exaltant de se voir poser des questions intimes. Alors on se sent désirée». Car il ne suffit pas d'être au monde pour pouvoir désirer. Le diptyque Blade Runner fascine car il est hanté par la question enfantine : «d'où est-ce que je viens ?», à laquelle on ne peut répondre ni techniquement ni génétiquement, mais seulement psychologiquement.
Dans La violence de l'interprétation, la psychanalyste Piera Aulagnier précise que la bonne réponse à cette question doit être : ««À l’origine de la vie est le désir du couple parental auquel la naissance de l’enfant fait plaisir.» Quelle que soit la formulation explicite de la réponse entendue, elle doit pouvoir renvoyer implicitement à cette concaténation. Non seulement parce que cette dernière est seule à apporter une signification conforme à la logique du Je, mais parce que cette réponse donnée à la cause de son origine va être, rétroactivement, projetée par l’enfant sur la cause originaire de toute expérience de plaisir et de toute expérience de déplaisir. La cause de plaisir, et de tout plaisir, sera par et pour le Je reliée au plaisir que procure au couple le fait que lui existe» (4).
Voilà pourquoi les réplicants voudraient avoir été désirés par quelqu'un, et non pas clonés sous cellophane comme une marchandise jetable à volonté : le plaisir de vivre dépend du fait de se concevoir soi-même comme source de plaisir pour ses propres parents. De même, on sent avoir droit de désirer seulement à partir du moment où on se sait soi-même fruit d'un désir. Le film le montre : à partir du moment où Joe se croit l'enfant de Rachel et de Deckard, il se met à agir avec une volonté et un désir propre. Ainsi, il ment à son supérieur hiérarchique au sujet de l'enquête, alors que Luv explique que les réplicants ne peuvent théoriquement pas le faire. Or mentir est chez l'enfant une des premières manifestations d'autonomie psychique, source de joie de découvrir que ses parents ne lisent pas ses pensées, comme il le croyait au départ. La déception de découvrir qu'il n'est en fait qu'un réplicant comme les autres replonge Joe dans une stupeur poignante, admirablement soulignée par l'écrasement que l'on ressent à le voir dominé par l'hologramme gigantesque de Joi. Celle-ci essaie d'émoustiller de désir de Joe, mais en vain, malgré sa perfection plastique, car son désir s'est évanoui avec la perte de son origine fantasmée : il n'a pas de parents qui ont voulu le mettre au monde (5).
Ce film est une parabole sur les enfants non-désirés. Le nom de réplicants leur va particulièrement bien, car du point de vue psychopathologique, un des corollaires de cette absence d'une mère qui aurait un désir/plaisir d'enfant, c'est « l’impossibilité pour la mère d’investir positivement l’acte procréateur, le moment de la naissance, et tout ce qui viendrait prouver qu’en donnant la vie on engendre un être «nouveau», et du «nouveau», qui n’est pas le retour d’un «enfant» qui avait déjà été, ni d’un moment temporel qui ne ferait que se répéter», écrit Piera Aulagnier, et elle précise que cela prédispose à la schizophrénie. Wallace est bien la figure horrible de ce producteur d'enfants – il se targue d'en avoir des «millions» – incapable d'en aimer aucun, cette «mère réfrigérateur» selon l'expression de Bettelheim, qui voit sans regarder, et dont les yeux ne sont pas un miroir pour l'enfant. Les réplicants, ce sont ces nombreux enfants qui ne sont ni un miracle, ni une promesse de recommencement et de renouveau, n'en déplaise à Hannah Arendt (6), qui pensait que tous le sont et qui n'aurait peut-être pas dû mépriser autant la psychanalyse.
Le porteur du désir, celui par lequel le miracle s'est accompli, c'est bien sûr Deckard, le père de l'enfant de Rachel. Le miracle est ce désir-même pour une réplicante, que Luv aimerait bien connaître aussi. Comment arrive-t-il d'ailleurs à la désirer, dans le premier film, surtout s'il est censé être lui-même un réplicant? Regardons les détails du premier film, et la présentation des femmes qui s'y trouvent. Les deux réplicantes, Zhora et Pris, que Deckard exécute sans état d'âme, symbolisent deux femmes néfastes : Zhora, par son spectacle indécent avec le serpent artificiel, évoque de toute évidence Ève, la mère pécheresse primordiale, tandis que Pris est à la fois une poupée de plaisir et une femme-soldat, c'est-à-dire une pute dangereuse. Ainsi, elles incarnent deux craintes majeures de l'homme : la mauvaise mère et la femme profiteuse et violente, toutes deux usant de leur charmes pour arriver à leurs fins perverses. Si Deckard tombe amoureux de Rachel, alors qu'il devrait aussi la neutraliser, n'est-ce pas parce qu'elle le sauve en tuant Leon ? «Je ne peux pas vous tuer, je vous dois la vie», lui dit-il. La formule doit être volontairement ambiguë : Rachel est devenue comme une «bonne mère» pour lui. Quels que puissent être ses résultats au test de Voight-Kampff, la vie l'a soumise à un autre test qu'elle a passé brillamment : son acte est plus fort que mille paroles erronées. C'est Deckard qui peut désormais lui faire confiance et l'aimer, car Rachel a fait la première un geste indéniable d'amour, de protection maternelle.
Joe part à la recherche de Deckard en pensant que c'est son père, pour comprendre l'origine de son désir, et lui demander : Eli, eli, lama sabachtani ? Avant de lui poser la question, il traverse un décor jonché de poupées géantes terrassées, rendues à la poussière rouge du désert de Las Vegas, signe que la tentation a été vaincue, qu'à cet endroit règne sans partage le père seul. «Vous n'auriez pas un peu de fromage ?», demande Deckard en rencontrant Joe. C'est la question que pose le pirate Ben Gunn au jeune Jim Hawkins lorsqu'il le rencontre sur l'île où il était abandonné depuis des années, dans L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Ben Gunn, c'est celui qui avait retrouvé le trésor caché par les pirates, convoité aussi par l'affreux «Long John» Silver. Cette allusion littéraire veut dire ici que Deckard a trouvé le trésor que Wallace recherche aussi. Ce trésor m'évoque irrésistiblement un autre : «Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ» (Matthieu 13-44).
Aux récrimination du fils, la réponse du père est magnifique : «Il y a des fois où pour aimer une personne on doit lui rester étranger». L'initiation de l'homme est complète : il a été désiré, mais celui qui l'a désiré s'est effacé pour se laisser remplacer, le père a dû mourir pour céder la place au fils. Cela répond magnifiquement au désir d'immortalité de Roy dans le premier film : l'immortalité n'est pas un rallongement indéfini de la vie, mais la transmission du désir de vivre de père en fils (7).
Mais le désir doit être soumis à la tentation, il doit faire les preuves de sa force et de sa réalité. C'est le rôle de Wallace, le sadique créateur de la nouvelle génération de réplicants, qui incarne le mauvais parent par excellence : celui qui regarde sa créature comme un produit qui ne lui procure aucun plaisir, un avorton remplaçable qu'il ne sait ni ne veut rassurer, qu'il peut éviscérer à loisir comme un enfant curieux démembre ses jouets pour voir ce qu'il y a dedans. Il joue de toute évidence un rôle démoniaque : fasciné par ce qu'il n'a pas, à savoir un désir réel, une âme, il teste l'authenticité du désir de Deckard.
«Si pulpeuses étaient ses lèvres, si rapide fut votre complicité, susurre la voix de Wallace. Il ne vous a jamais traversé l'esprit que c'était pour cela que l'on vous avait convoqué ? Ni plus ni moins que prédestiné à tomber amoureux d'elle sur le champ. Dans le seul but d'engendrer cet unique et parfait spécimen. Si, bien sûr, vous avez été prédestinés. Amour ou précision mathématique ?» Plus précisément, Wallace est la voix archaïque du parent du stade primaire, c'est-à-dire du stade de développement du psychisme où l'enfant conçoit aussi bien le plaisir que le déplaisir, comme des effets du désir de sa mère. C'est pour cela que le maléfique généticien présente d'abord à Deckard un sosie de Rachel, synonyme de bonheur, puis devant son rejet, il lui promet les tourments de l'enfer. «Je fais vivre et je fais mourir, Je blesse et je guéris, Et personne ne délivre de ma main.» pourrait-il citer encore une fois l'Ancien testament (Deutéronome, 32-39). La tentation de Wallace, c'est la tentation de régresser à ce stade infantile terrifiant, de douter de son indépendance psychique, et de se percevoir agi par un autre tout-puissant auquel il serait redevenu transparent, comme il croyait l'être par rapport à ses parents dans la petite-enfance.
Wallace veut discréditer l'amour en arguant de la répétabilité de l'expérience (8). «Vous aimez souffrir, apostrophe-t-il Deckard. La souffrance vous rappelle que le bonheur ressenti jadis était vrai. Plus de bonheur donc !» Le syllogisme destructeur de Wallace est le suivant «Si tu peux revivre les sensations uniques de la première fois où tu as croisé les regards de ton grand amour, c'est que ces sensations n'étaient pas uniques, donc la première fois n'avait aucune valeur particulière, et l'amour n'existe pas». Autrement dit : si tu aimes plusieurs fois, c'est que tu n'aimes jamais. Là encore, Wallace cherche à attirer Deckard dans une conception infantile, celle du «grand amour», de la «première fois», et de «la tendre moitié», survivances du mythe de l'androgyne de Platon. Cette conception peut être dite aussi féministe ou maternelle, et elle sert souvent à culpabiliser le désir masculin, qui est loin d'être naturellement monogame, pas plus que celui de la femme d'ailleurs (9).
C'est là où le film est faible, mais il aurait été peu probable que Deckard le torturé accepte d'embrasser joyeusement le clone de Rachel ! Imaginez-vous la scène, après la conversation biblico-hamletienne entre Wallace et Deckard, voir Rick, après trente années d'abstinence, sauter sur cette Rachel redivivus comme une bête sauvage ! On peut toujours rêver... Mais cela aurait été la bonne issue du pseudo-piège de Wallace : s'en moquer. Le diable ne déteste rien autant que le fait que l'on rie de lui. C'est que Deckard est devenu aussi bien sérieux après toutes ces années dans le désert. Il rappelle le vieux Rocky, infiniment ridicule et fidèle à la mémoire de sa chère Adrian disparue, conversant avec elle sur sa tombe...
La plaisanterie n'est pas gratuite : cette séquence de la tentation de Deckard est une réécriture de Solaris. Dans ce film, comme dans le roman de Stanislas Lem, sur la planète-Dieu qui donne chair aux monstres de l'inconscient de chacun, le héros, Kelvin, est hanté par les réincarnations successives de sa femme suicidée, qui lui demande comme le clone de Rachel : «Alors, tu ne m'aimes pas ?». Chaque jour, il l'élimine à nouveau, et chaque jour, l'océan pan-conscient fait apparaître miraculeusement un nouveau clone, comme si l'océan exauçait le désir de vengeance de la morte et culpabilisait à l'infini son amant négligeant. Mais la solution à l'horrible répétition du même, c'est que Kelvin finit par accepter de vivre avec la matérialisation de son souvenir, qui en retour prend conscience de sa nature. C'est pourquoi un jour, l'océan fait disparaître les êtres inquiétants qu'il avait tiré de l'âme de chacun, signe que la douleur du drame a été apaisée, que Kelvin s'est pardonné lui-même.
«Je sais ce qui est réel» marmonne Rick, sans véritablement convaincre. Il veut dire qu'il est persuadé de l'authenticité de son désir passé, que la Rachel redivivus ne fait pas vaciller la flamme de son souvenir. Or Philip K. Dick avait dit que «La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire...» C'est pourquoi Deckard aurait pu et dû plonger avec confiance dans les bras du clone de Rachel, car même s'il superposait aux impressions charnelles de son amour passé, de nouvelles sensations de bonheur, cela ne souillerait en rien l'authenticité de ce qui s'est passé avec la mère de son enfant. Rachel a été réelle, même s'il cesse d'y croire, même s'il l'oublie, la preuve en est l'enfant qu'elle lui a donné. En repoussant le clone de Rachel, il traite réellement la morte adorée comme si elle n'avait été qu'un souvenir, un fantasme comme Joi, un enregistrement sur son disque dur intérieur, qu'un second enregistrement risquerait d'effacer à jamais, comme Joy a été effacée, comme les photos d'enfance du gardien des archives Tyrell pendant le Black out, comme l'enregistrement de la rencontre avec Rachel, rediffusé par Wallace, a été corrompu par la catastrophe. Il y a des fois où pour aimer une personne, on doit l'oublier, c'est cela que Rick aurait dû répliquer à Wallace. Mais le vieux Blade runner agit et pense selon le principe contraire à celui de Philip K. Dick : «la réalité, c'est seulement ce dont on se souvient...». Le film donne l'impression que Deckard a résisté à la tentation, qu'il a passé avec succès le test de l'authenticité de son amour, alors qu'il l'a en fait échoué.
C'est le sens des retrouvailles entre Deckard et sa fille, qui est justement créatrice de faux souvenirs à l'usage des esclaves de Wallace. En plus de modifier le thème évangélique, et de faire naître une fille à la place d'un fils, cette fin est une inversion de la fin de Solaris : là, c'était le fils qui allait retrouver le père pour se prosterner devant lui, ici, c'est le père qui retrouve sa fille pour lui ramener son jouet en bois ! Triomphe de l'impuissance : le miracle, c'est cette femme-bulle qui fabrique des souvenirs mièvres pour adoucir le sort des réplicants. C'est elle qui est l'élue, celle qui mènera en temps voulu leur révolte, qui «conduira leur armée» ! Il lui a suffi de naître, et d'être pleine de bons sentiments, pour fomenter une révolution radicale (10). On sent que Wallace en tremble d'avance. Je veux voir dans cette fin une touche de sarcasme envers le féminisme et sa pensée positive : associer la révolte au raisonnement émotionnel, pour les discréditer tous les deux simultanément. Alors qu'il neige réellement sur Joe souffrant, voire mourant sur les marches de «l'usine à illusions» de la fille de Deckard, celle-ci s'émerveille des flocons virtuels qui tombent dans sa bulle, signe de sa coupure radicale avec la dure réalité. On se dit que s'il survit, Joe va être dans de beaux draps sous le commandement de cette artiste.
«Je suis qui pour toi ?» demande Deckard à Joe. Celui-ci ne répond pas, il lui sourit. Il ne peut pas lui dire «mon père», pourtant, il a senti ce que c'était qu'être désiré, il se l'était imaginé pendant quelque temps, et il avait agi sur cette base. Un enfant peut être adopté, et même un parent peut l'être. Joe et Deckard ne se sont-ils pas tacitement et mutuellement adoptés à Las Vegas, après leur bagarre ? «On peut continuer à se cogner dessus ou bien on peut aller boire un verre». «Aux étrangers» avait trinqué Joe. Ils se sont reconnus, adoptés, et sans doute aimés, c'est pour cela qu'ils se sont tapés dessus, ou plutôt, c'est Deckard qui a frappé Joe, tandis que celui-ci encaissait stoïquement, se refusant de lever la main sur celui qu'il pensait alors être son père. C'est par cette abstention qu'il lui montrait qu'il le révérait et qu'il l'élisait, pour être élu en retour – le père, c'est celui qu'on ne peut pas frapper et vivre (Exode, 21-15), car on tient de lui sa vie, c'est-à-dire son désir. À l'opposé de cette rencontre virile, Deckard ne peut toucher sa fille, et dans la dernière image, avec sa main sur la bulle protectrice, il semble faire ironiquement le salut du capitaine Spock : «Live long and prosper».
Pourtant, il y a quand même un message d'espoir : alors que Deckard a échoué devant Wallace, Joe est sorti victorieux de son épreuve. Freysa, la borgne qui guide les aveugles en attendant la révélation de l'élue, lui avait ordonné de tuer Deckard, soit-disant afin que le maléfique généticien ne la retrouve pas, et avait anéanti le pauvre Joe, en lui apprenant que le vieux blade runner n'était pas son père. Tout comme Deckard avait une dette envers Rachel, Joe doit son salut à Freysa, et celle-ci en joue. Ce qui est mis en scène ici, c'est la volonté de la mère folle de se passer du père : Freysa, la représentante de la mère morte, dit en fait au fils que son père n'a pas voulu de lui, qu'il doit sa vie à elle seule. Elle prétend que le père est désormais un danger pour elle, suggérant au fils de se venger contre le père de son manque d'amour. Devant l'horreur de l'acte qu'elle lui enjoint d'exécuter, elle essaie de lui apaiser la conscience : «Tout ce que voulait Deckard était que son bébé soit à l'abri, et il l'est». Paranoïaque, elle se fait l'interprète exclusive du désir du père, le réduisant à une fonction protectrice. Deckard est jetable, tu ne le tues pas vraiment, il voudrait lui-même que tu le tues, si de cette manière tu sauves son enfant, voilà ce que lui explique la borgne militante des droits des réplicants.
Pourtant, Joe désobéit, et sauve son père adoptif au lieu de le tuer. Il ne semble pas très sensible aux discours de la matriarche, et passe outre ses craintes excessives. Il se révolte contre la politique du «risque zéro» de Freysa, identique en esprit à celle de son supérieur assassiné par Luv, qui lui avait demandé de «retirer» l'enfant, pour garantir le maintien de l'ordre. Peut-être que Wallace retrouvera Deckard, et à travers lui Freysa, et à travers celle-ci la fille de Deckard, pour écraser dans l’œuf la révolution, c'est un risque à prendre, mais qui mérite d'être pris, car Rick a une valeur intrinsèque, il n'est pas sa fonction (11). Par son geste, Joe indique qu'il y a une autre manière d'être humain que de «mourir pour une juste cause », que cette morale sacrificielle ne libère pas vraiment les réplicants, mais n'est que la reconduction de leur servitude. Seule l'accession à l'individualité, au sentiment de valeur irremplaçable de chaque personne en particulier est une libération véritable. Joe sauve Deckard tout simplement parce qu'il est unique, et indique ainsi que toute cause qui oublie l'unicité de chacun ne mérite pas que l'on meure pour elle. Sa désobéissance et son attachement à un être concret est la signature définitive qu'il a désormais un désir autonome, qu'il n'est donc plus un réplicant. Deckard peut se réjouir : un fils lui est né !
Blade runner 2049 est un film mystique, parce qu'il laisse apercevoir en creux ce que l'on perd lorsque l'on perd Dieu, c'est-à-dire justement Celui qui désirait tout le monde, qui se souciait de chacun (12). Contrairement à ce qu'affirme le satanisme contemporain, et à sa manière de réinterpréter les siècles de lumière passés, Dieu ne brime pas le désir, au contraire, sans Dieu, il n'y a pas de désir. «Sans Dieu, rien n'est permis» écrivait Lacan dans ce sens, en prenant le contre-pied de Dostoïevski. Joe s'étend face contre ciel, dans la dernière scène du film, à l'inverse aussi du Stalker de Tarkovski, qui étreignait la terre. Il saigne de côté, comme un Adam auquel Dieu viendrait d'arracher une cote pour en façonner la femme, comme le Christ transpercé par la lance de Longinus. Se relèvera-t-il ?
Notes
(1) Je mets au défi quiconque de trouver un lien autre que superficiel entre le roman des frères Strougatski, Pique-nique au bord du chemin, et Stalker de Tarkovski, qui est censé en être l'adaptation !
(2) Jacques Brel disait dans l'interview de Knokke : «Ce qui compte ce n'est pas la durée d'une vie, mais l'intensité d'une vie». Pour une généalogie de cette conception, voir Tristan Garcia, La vie intense. Une obsession moderne (Éditions Autrement, 2016).
(3) C'était bien sûr avant les campagnes de «balance ton porc». L'idole virile des années 80 est maintenant dénoncée par des citoyens vigilants comme ayant contribué à la «culture du viol». Voir cette analyse imbécile qui dénonce Indy comme un promoteur de la «prédation sexuelle» : https://www.youtube.com/watch?v=wWoP8VpbpYI J'attends le moment où on censurera Autant en emporte le vent, parce que Rhett emporte dans la chambre sa Scarlett sans tenir compte de ses protestations https://www.youtube.com/watch?v=_36zsAP-Wh0, et qu'elle exulte de joie le lendemain matin. https://www.youtube.com/watch?v=TuTmEdteAs0
(4) La violence de l'interprétation (PUF, 1975, republié en 2003 dans la coll. Le fil rouge).
(5) «Qu'on me donne l'envie», c'est le cri muet des replicants qui n'entendront jamais la chanson de Johnny. Celle-ci indique une fausse source du don de l'envie de vivre : l'ascétisme et le jeu des contrastes. Toute pénitence ou abstinence ne palliera jamais le manque d'être soi-même désiré.
(6) «Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, “naturelle”, c’est finalement le fait de la natalité, dans lequel s’enracine ontologiquement la faculté d’agir. En d’autres termes : c’est la naissance d’hommes nouveaux, le fait qu’ils commencent à nouveau, l’action dont ils sont capables par droit de naissance. Seule l’expérience totale de cette capacité peut octroyer aux affaires humaines la foi et l’espérance, ces deux caractéristiques essentielles de l’existence que l’Antiquité grecque a complètement méconnues, écartant la foi jurée où elle voyait une vertu fort rare et négligeable, et rangeant l’espérance au nombre des illusions pernicieuses de la boîte de Pandore. C’est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse dans la petite phrase des Évangiles annonçant leur “bonne nouvelle” : “Un enfant nous est né”», Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne (traduction de Georges Fradier, Calmann-Lévy, 1993), p. 278.
(7) Voir à ce sujet les analyses de Slavoy Zizek dans ce film-essai étonnant The pervert's guide to ideology.
(8) Les lecteurs du roumain pourraient se rappeler ces vers de la Quatrième lettre de Mihai Eminescu (1850-1889), qui disent la même chose de l'amour : Să sfinţeşti cu mii de lacrimi un instinct atât de van / Ce le-abate şi la pasări de vreo două ori pe an ? / Nu trăiţi voi, ci un altul vă inspiră – el trăieşte, / El cu gura voastră râde, el se-ncântă, el şopteşte, / Căci a voastre vieţi cu toate sunt ca undele ce curg, / Vecinic este numai râul : râul este Demiurg : «Sanctifier avec des milliers de larmes un instinct si vain / Qui agite aussi les oiseaux deux fois par an ? / Ce n'est pas vous qui vivez, c'est un autre qui vous inspire, c'est lui qui vit / C'est lui qui rit avec votre bouche, c'est lui qui s'enchante, qui chuchote / Car vos vies entières sont comme l'onde qui passe / Éternel est seul le fleuve : le fleuve est le Démiurge» [NdJA : traduction de l'auteur].
(9) Éric Zemmour avait partiellement expliqué cela dans Le premier sexe : «Si les femmes ont pour la plupart renoncé à se comporter comme des hommes, elles se refusent à abandonner le rêve romantique qui les guide de toute éternité; elles ont tiré de ce paradoxe une conclusion radicale mais néanmoins logique: puisqu'elles n'ont pas réussi à se transformer en hommes, il faut donc transformer les hommes en femmes» (pp. 52-3). Pour une vision plus complète, voir The evolution of desire de David Buss, The Mating Mind : How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature de Geoffrey Miller et The Red Queen : Sex and the Evolution of Human Nature de Matt Ridley.
(10) Ici, on retrouve la même incohérence que dans Metropolis de Fritz Lang, où une gentille femme aux discours lénifiants est censée mener la révolte des opprimés.
(11) «Même le plus noble idéal, national, social ou religieux, ne peut excuser l'injustice faite à un seul homme», in La vingt-cinquième heure de Constantin Virgil Gheorghiu (traduction du roumain de Monica Lovinescu créditée sous le nom de Monique Saint-Côme – il n'y a qu'à voir la production de Gheorghiu après ce livre... ! – , qui fut le réel auteur de ce livre, Plon, 1949).
(12) Voir ce roman qui vient de sortir : «Pour Dieu, il n'y avait pas d'homme en trop, chacun du plus misérable au plus glorieux, relevait de son administration miséricordieuse», Patrice Jean, L'homme surnuméraire (Éditions Rue Fromentin, 2017).
Lien permanent | Tags : cinéma, critique cinématographique, blade runner, philip k. dick, ridley scott, denis villeneuve, blade runner 2049, science-fiction, radu stoenescu |  |
|  Imprimer
Imprimer