De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts de Thomas De Quincey (01/02/2018)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Thomas De Quincey dans la Zone.
Thomas De Quincey dans la Zone.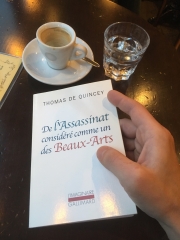 Acheter De l'assassinat comme un des beaux-arts sur Amazon.
Acheter De l'assassinat comme un des beaux-arts sur Amazon.C'est dans un Portrait de Thomas De Quincey assez juste inclus dans Le Mal absolu que Pietro Citati dit de lui qu'il «n’était pas seulement un écrivain : il était, à lui seul, toute une littérature» (1), et c'est ce même Thomas De Quincey qui, pour un Borges, a pu représenter l'une des plus parfaites incarnations de ce qu'était à ses yeux la littérature (2). Dans les deux cas, il est frappant de constater qu'un nom peut représenter la littérature elle-même dans son incroyable diversité, mais aussi dans sa totalité. Les raisons purement factuelles de cette incarnation symbolique de la littérature en un écrivain, ne fût-elle rien de plus qu'une manière de dire, sont aisément compréhensibles : le plus anodin des textes écrits par Thomas De Quincey, mélange de folle érudition, de morceaux de provenances diverses (3), mais aussi d'humour noir, peuvent nous laisser penser que cet écrivain n'ignorait absolument rien du labyrinthe infini que constituent tous les livres, qu'il semble bien avoir lus jusqu'au dernier, quitte à ce qu'il invente celui-ci. C'est peut-être que chacun des livres qu'il a lus ne peut qu'évoquer une des innombrables facettes de sa personnalité complexe : «Son véritable désir est de se fuir lui-même; et d’écrire un livre qui soit aux marges de son livre, ou même hors du livre» (Citati, op. cit., p. 119) comme si, enfin, par cet acte de sortie de la littérature réalisé par le truchement paradoxal d'encore plus de livres, de textes et de langage, il parvenait, enfin, à se dénuder et se retrouver, vierge de toute empreinte littéraire, comme au premier jour de conscience qui ne serait point encore contaminé par le virus des milliers de livres point encore lus, pourtant déjà présents comme en rêve dans l'esprit de l'enfant.
Je ne suis pourtant pas certain, pour citer encore Pietro Citati, que ce soit «avec des yeux hallucinés [que] De Quincey contemple l’irruption du Mal Absolu sur la scène du monde» (op. cit., p. 114), tant il nous montre au contraire une admirable capacité à raisonner, à se défier de toute forme d'hallucination ou de cette sidération démoniaque qu'il voit à l’œuvre dans Macbeth, tout en poussant jusqu'à l'absurde ces échafaudages intellectuels qui sont sa marque la plus visible, comme le montre l'extrait suivant de notre texte : «Mais la vérité est que, si répréhensibles qu’ils soient per se, relativement aux autres spécimens de leur genre, aussi bien un voleur qu’un ulcère peuvent avoir d’infinis degrés de mérite. Tous deux sont des imperfections, c’est vrai, mais être imparfait étant leur essence, la grandeur même de leur imperfection devient leur perfection» (p. 31), car le meurtre, comme tout art qui se respecte, ne peut que progresser dans ses techniques d’exécution (c'est le cas de le dire !) au travers des âges (cf. p. 36), la civilisation romaine ayant «trop peu de génie en quelque art que ce fût pour réussir là où avait échoué son modèle», la Grèce bien sûr, et «la langue latine [s'affaissant] sous l'idée même de meurtre» (p. 37). Thomas De Quincey aura ainsi à cœur de plier sa propre langue à l'évocation du meurtre.
Le temps s'accélère à dessein, dans le seul but dirait-on de parvenir à l'époque contemporaine de celle de l'écrivain, où le bel art qu'est l'assassinat a gagné en subtilité, puisqu'il est désormais possible de «concevoir un meurtre secret perpétré pour une raison privée comme enclos dans une petite parenthèse sur la vaste scène d’un carnage guerrier», ce qui ne peut que ressembler «au subtil stratagème de Hamlet d’une tragédie à l’intérieur d’une tragédie». Cet exemple concerne l'assassinat du roi de Suède qui, selon l'auteur, peut à coup sûr être étudié «avec profit par le connaisseur avancé», à tel point que l'on peut dire de lui : «Nocturna versate manu, versate diurna»; nocturna surtout», ajoute ironiquement De Quincey, préférant visiblement les modèles (au sens d'exempla) nocturnes aux modèles diurnes. La littérature est une telle forêt que la lumière du soleil ne pénètre que fort rarement dans certaines de ses parties les plus reculées, les mieux abritées des regards des badauds.
Nous sommes désormais entrés dans l'ère des meurtres raffinés, pleinement conscients d'eux-mêmes : ils doivent en effet, pour prétendre appartenir à la catégorie de l'art, s'élever au-dessus de basses considérations morales, et toucher une espèce de fin en soi, expression d'ailleurs utilisée par le traducteur sinon l'auteur de ce texte, qui évoque l'exemple d'un meurtrier ne voyant pas «dans l'assassinat un simple moyen d'atteindre une fin, mais aussi une fin en soi» (p. 154). Curieux hasard, dès lors, que l'exemple de Kant arrive à point nommé ! Nous apprenons, par la bouche du narrateur de De Quincey, que le grand philosophe a semblé retenir l'attention d'un assassin (outre celle de l'auteur dans un autre texte fort célèbre) qui s'en est finalement détourné pour lui préférer un jeune enfant. En effet, «un vieux professeur, se dit-il, pouvait être chargé de péchés. Non pas un jeune enfant. Sur cette considération, il se détourna de Kant au moment critique et bientôt après assassina un enfant de cinq ans. Telle est la version allemande de l'affaire; mais mon opinion à moi, c'est que l'assassin était un amateur, qui sentit combien il serait de peu de profit pour la cause du bon goût d'assassiner un vieux métaphysicien aride et desséché; il n'y avait là nulle possibilité d'effet, étant donné que l'homme ne pourrait pas ressembler davantage à une momie, une fois mort, qu'il n'avait fait vivant» (p. 57).
Ce n'est pas encore l'horreur à son comble, bien que nous nous en approchions selon notre esthète féru de meurtres présentant «la conférence Williams (4) sur l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts» (p. 27) à une société d'amateurs d'un genre particulier. Il est cependant fort à craindre que, malgré l'opinion de Pietro Citati plus haut citée, nous ne sachions rien de l'horreur absolue car Thomas De Quincey, pour figurer le Mal, ne fait rien d'autre que de le suggérer, son narrateur remplissant lui-même un rôle d'aiguillon : il apprécie les meurtres subtils mais en aucun cas il ne saurait commettre le plus petit acte de violence car, comme Horace le dit dans son Art poétique (V, v. 304-305), il ne fera que jouer le rôle de la pierre à aiguiser, capable de rendre la lame coupante sans être elle-même apte à couper (5). Ainsi, il faut exagérer, ne pas craindre d'exagérer son effet, car c'est de cette façon seulement que ce qu'un des narrateurs appelle une «bagatelle», autrement dit le compte rendu d'un meurtre, sera capable «d'effleurer le bord de l'horreur et de tout ce qui, le vît-on vraiment réalisé, inspirerait le plus grand dégoût» (pp. 101-2), Thomas De Quincey prenant le soin de moraliser, en somme, son affaire, car c'est «l'excès même de l'extravagance» qui, «en suggérant continuellement au lecteur que toute cette spéculation n'est que vent, constitue le plus sûr moyen d'exorciser chez lui l'horreur qui, sinon, risquerait de l'accabler» (p. 102).
De Quincey, à l'évidence, quelque précaution qu'il fasse prendre à son narrateur, est fasciné par le meurtrier, ne serait-ce que parce qu'il considère «le formidable pouvoir laissé à la disposition immédiate de tout homme qui peut se résoudre à abjurer toutes les entraves de la conscience, pour peu qu'il soit en même temps parfaitement libre de crainte» (p. 108), et aussi parce qu'il a compris, bien avant le déferlement des serial killer, qu'un homme doté d'une telle volonté pouvait parfaitement se transformer en «assassin méticuleusement vétilleux dans ses exigences», et devenir ainsi «une sorte de maître des cérémonies pour l'ordonnance scénique et le drapé du détail de ses meurtres», en amateur exquis de «préparatifs aussi raffinés» (p. 158) qu'il est.
De Quincey est aussi fasciné par les assassins car leurs crimes, surtout s'ils sont frappants, lui permettent de s'adonner à l'une de ses activités favorites, comme Poe le fera de l'autre côté de l'Atlantique, à savoir le déchiffrement des signes, mais aussi l'échafaudage conceptuel censé proposer au lecteur un déroulé cohérent de tel ou tel meurtre («Apparemment le cours des événements, une fois l'assassin entré dans la chambre, avait été le suivant», p. 147). C'est ainsi qu'il «est vraiment merveilleux et captivant de suivre les pas successifs du monstre, et d’observer avec quelle certitude absolue les hiéroglyphes silencieux de l’affaire trahissent tout le processus et chacun des mouvements du drame sanglant», non moins sûrement, ajoute l'auteur, «non moins pleinement que si nous avions été cachés nous-mêmes dans la boutique de Marr [l'assassiné, donc] ou que si nous avions contemplé du haut des cieux de merci ce milan de l'enfer qui ne savait pas ce que la merci voulait dire» (p. 122).
Et ce sont encore des signes, mais cette fois-ci indéchiffrables et grouillant comme de la vermine dévorant un cadavre d'assassin, qui nous permettent de comprendre que les temps nouveaux, notre époque donc, allaient longtemps résonner de l'horreur que Thomas De Quincey, supposé n'y jeter qu'un seul regard halluciné, a au contraire annoncée de façon ironique, drôle et parfaitement maîtrisée comme étant le nouveau maitre intraitable et l'idole de fer que les hommes ont choisis de se donner : «Williams, comme je l’ai dit, a péri de sa propre main; et, conformément à la loi en vigueur, il fut enterré au centre d’un quadrivium […] avec un pieu fiché dans le cœur. Et par-dessus lui passe à jamais le tumulte de l’infatigable Londres !» (p. 177). C'est peut-être cette toute dernière phrase du livre qui mérite, elle, le qualificatif d'halluciné, comme si Thomas De Quincey comprenait l'intrusion prochaine, dans la vaste histoire du crime universel, qui semble désormais s'accélérer, de l'homme des foules des grandes métropoles qui jamais ne dorment, vecteur pâle mais méticuleux d'une horreur banalisée que plus aucun écrivain ne prend désormais la peine de sonder comme l'auteur l'a fait dans De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts, avec un esprit aussi vif que méticuleusement précis.
Notes
(1) Pietro Citati, Le Mal Absolu. Au cœur du roman du dix-neuvième siècle [Il male assoluto, 2000] (Gallimard, coll. L’Arpenteur, traduit de l’italien par Brigitte Pérol, 2010), p. 103.
(2) Dans La fleur de Coleridge, le grand Argentin écrit ainsi : «Pendant de nombreuses années, j'ai cru que la littérature, certes chose presque infinie, était toute dans un seul homme. Cet homme, ce fut Carlyle, ce fut Johanes Becher, ce fut Whitman, ce fut Rafael Cansinos Asséns, ce fut De Quincey», Enquêtes suivi de Entretiens (Gallimard, coll. Folio essais n°198, 1992), p. 29.
(3) Règle à laquelle n'échappe pas le texte qui nous occupe, puisque la Conférence débutant ce dernier a paru en 1827 dans le Blackwood's Magazine, tandis que le Mémoire supplémentaire a été publié en 1839 dans ce même magazine, et que le Post-scriptum clôturant l'ensemble a été ajouté en 1854. Pour notre édition, se référer à Thomas De Quincey, De l’Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts suivi de Mémoire supplémentaire et de Post-Scriptum (Gallimard, coll. L’Imaginaire, traduction et préface de Pierre Leyris, 2002). Les pages simplement indiquées entre parenthèses renvoient à notre édition.
(4) Du nom de l'assassin John Williams qui sera de nouveau évoqué dans le Post-scriptum de l'ouvrage.
(5) Dans le texte original : «Ergo fungar vice cotis, acutum / Reddere quae ferrum valet, exsors ipsa secandi», cité par De Quincey à la page 77 de son livre.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, thomas de quincey, de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, éditions gallimard, collection l'imaginaire, pierre leyris, pietro citati, borges, macbeth |  |
|  Imprimer
Imprimer
