Révolution et contre-révolution nationales-socialistes, par Francis Moury (04/09/2018)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
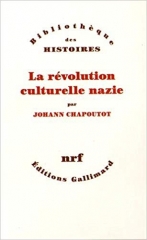 Notes de lecture sur Johann Chapoutot, La Révolution culturelle nazie (éditions Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque des histoires, 2017). Acheter ce livre sur Amazon.
Notes de lecture sur Johann Chapoutot, La Révolution culturelle nazie (éditions Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque des histoires, 2017). Acheter ce livre sur Amazon.«La Guerre, comme un géant de fer, s’avança parmi ces alanguis et, s’enfuyant aux accents de sa voix terrible dont retentissaient les montagnes, ils cherchaient la protection de leur mère, en qui ils avaient cessé de croire. Mais, avec la foi, leur revint cette vérité : la prospérité ne peut naître que de la force, le combat fait rayonner la divinité, comme la mort fait rayonner la vie ! Oui, Ludwig, voici venue une époque fatale […] nous percevons clairement, de nouveau, la voix de la puissance éternelle.»
E.T.A Hoffmann, Kreisleriana, Le Poète et le compositeur (1815), préface d’André Schaeffner, traduction d’Albert Béguin (éditions Gallimard, N.R.F. 1949, pp. 250-251).
Ce recueil, rassemblant des études publiées ces dix dernières années et d'autres inédites, forme la dernière partie du triptyque de Johann Chapoutot, professeur germaniste d'histoire à la Sorbonne (Paris-IV), à savoir Le Nazisme et l'antiquité (PUF, 2008), La Loi du sang : penser et agir en nazi (Gallimard NRF, 2014), La Révolution culturelle nazie (Gallimard NRF, 2017). C'est à la page 274 que l'hypothèque un peu gênante de la connotation maoïste du titre – inévitable pour un lecteur français se remémorant les années 1960 à 1970, période où l'expression «révolution culturelle» était synonyme de «maoïsme» – est levée. L'auteur précise que la révolution, pour les nazis, n'avait nullement le sens que lui donnaient les révolutionnaires français de 1789 ni celui que lui donnèrent les révolutionnaires communistes marxistes de 1848 ou les maoïstes de 1930. Il s'agissait non pas d'une révolution abolissant le passé pour ouvrir sur un avenir artificiel car conventionnel (si on préfère, résultant artificiellement d'une convention humaine), mais tout au contraire d'un retour aux origines naturelles, donc d'une révolution au sens philologique premier du terme. En quoi cette révolution nazie originale a-t-elle pu s'insérer dans le courant d'idées contre-révolutionnaires classiques anglaises et françaises du dix-neuvième siècle et comment ses intellectuels et ses cadres l'ont-elle définie ?
C'est bien tout l'intérêt de ce troisième volume de vouloir répondre en priorité à cette question, au carrefour de l'histoire générale et de l'histoire de la philosophie. Ce sont surtout, à vrai dire, ses deux premières parties qui comportent des articles relevant expressément de la seconde discipline, notamment La Dénaturation de la pensée nordique : du racisme platonicien à l'universalisme stoïcien (initialement parue en 2008 sous le titre plus généraliste : Régénération et dégénérescence : la philosophie grecque reçue et relue par les Nazis) et À l'école de Kant ? Kant, philosophe «nordique» (initialement parue sous le titre encore plus savoureux de L'Impératif catégorique kantien sous le IIIe Reich), mais, en réalité, une grande partie du livre en relève dans la mesure où il complète très utilement des études classiques antérieures qui, en raison de leur date, ne couvraient évidemment pas la période considérée et qui ne pouvaient pas non plus, pour cette même raison, tirer certaines conclusions rétrospectivement clairement contenues dans plusieurs de leurs prémisses ou bien dont ce n'était pas l'objet premier non plus. C'est ainsi que les lecteurs philosophes de Lucien Lévy-Bruhl (1), Charles Andler (2 et 3), Émile Boutroux (4), Victor Basch (5), Jean-Édouard Spenlé (6), Émile Bréhier (7) ou, plus récemment André Glucksmann (8), profiteront d'une intéressante mise à jour en lisant ce livre. Même chose d'ailleurs pour les lecteurs historiens ou étudiants en sciences politiques qui estimaient un peu légère la section consacrée aux idées nazies dans la commode étude de Claude David, Hitler et le nazisme (PUF, 1967) ou dans la plus ample anthologie de Jean Imbert, Henri Morel et René-Jean Dupuy, La Pensée politique des origines à nos jours (PUF, coll. Thémis, section Textes et documents, 1969) et qui souhaitaient un accès à des documents plus récents. Depuis 1945, au demeurant, les études historiques mondiales ont accumulé une quantité remarquable de recherches sur les origines de la pensée et de la doctrine nationale-socialiste. Cette nouvelle synthèse permet d'avoir accès aux travaux allemands, anglais et français les plus sérieux et les plus récents, scrupuleusement cités en notes. Ce n'est pas un de ses moindres mérites.
Sur le pur plan de l'histoire de la philosophie, certains noms classiques sont cités et c'est en priorité à eux que le lecteur philosophe s'intéressera le plus : Platon, les Stoïciens et Kant, au premier chef. (9)
Concernant l'interprétation de Platon par l'histoire nazie de la philosophie, il faut bien convenir, à s'en tenir aux citations ici traduites et examinées, qu'elle semble très pauvre (elle sacrifie l'étude de la métaphysique des Idées au profit des idées morales, sociales et politiques de Platon), mais qu'elle n'est ni absurde en soi ni, surtout, inédite. Lorsque Mgr. Auguste Diès (1875-1958) préfaçait en 1932 l'édition-traduction par Émile Chambry de La République (10) de Platon (dans la Collection des Universités de France, éditée sous les auspices de l'association Guillaume Budé, aux éditions des Belles lettres), il débutait sa préface ainsi : «Platon n'est venu à la philosophie que par la politique et pour la politique.» C'est exactement le point de vue des historiens allemands de Platon que Johann Chapoutot rattache ici au nazisme. Cette même affirmation de Diès introduira sa préface, mot pour mot, à la réédition de la traduction seule de Chambry lorsque cette dernière paraîtra dans la belle collection des Grandes œuvres de l'antiquité classique traduites en français, chez le même éditeur, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Globalement, Platon exalterait aux yeux des historiens nazis les valeurs de Sparte et de sa rigoureuse sélection raciale et militaire. Son propos témoignerait d'un génie nordique pas encore altéré en Grèce classique par les guerres civiles puis par la période hellénistique et romaine. Le stoïcisme serait au contraire le système incarnant précisément le point de vue universaliste triomphateur durant la période hellénistique, séparant définitivement l'individu de sa communauté biologique et primitive pour le livrer à l'impératif désincarné et abstrait d'un moralisme individualiste. Lisons à présent la page 30 de l'article d'Auguste Diès consacré en 1936 à la désormais classique monographie de Léon Robin sur Platon (11). Diès y complimente Robin d'avoir écrit un solide chapitre sur la morale et la politique de Platon. Il ajoute : «[...] dois-je signaler le paragraphe où Robin montre que la raison est, pour Platon, la loi de la Cité universelle, et nous laisse entrevoir le magnifique développement que cette idée prendra dans la morale cosmologique et universaliste des Stoïciens ? Mais j'aurais l'air, en choisissant ainsi, de réserver mon adhésion sur le reste».
On le voit, Diès et Robin soutiennent la thèse opposée à celle de la philosophie nazie de l'histoire de la philosophie : Platon annoncerait, par son rationalisme, le stoïcisme lui-même. Elle n'est pourtant pas plus vraie que l'autre. En réalité, Platon ne peut pas davantage être réduit à un théoricien raciste spartiate qu'à un rationaliste universaliste pré-stoïcien. Le Platon réel est bien plus complexe : la lecture de la monographie de Robin (plus tard celle de François Chatelet, très bonne aussi mais qu'il ne faut lire qu'après celle de Robin, afin d'honorer l'ordre chronologique et historique de l'histoire de la philosophie, le seul restituant la vie réelle de la pensée) en donne d'ailleurs un fidèle portrait qui ne peut évidemment pas être réduit à une ou deux formules sans être par là-même trahi. Ce qui est certain, c'est que Platon fut un penseur politique absolument totalitaire mais un penseur politique qui considérait la politique comme un art inférieur à celui de la métaphysique, uniquement chargé d'adapter ses résultats au monde sublunaire sensible et contingent. Platon, contrairement à ce qu'écrivait Diès, n'est donc venu à la politique que par et pour la philosophie, pour tenter de réaliser (avec une mémorable constance) sur Terre le modèle métaphysique qu'il apercevait dans le ciel des idées et dans le ciel cosmique et astronomique. Raison pour laquelle les lois de la république platonicienne sont inapplicables à moins de considérables ajustements dont Platon était parfaitement conscient. Sur le problème posé par La République, Le Politique et, surtout, par Les Lois, je renvoie à mon propre article paru ici même il y a dix ans sur Le Dernier travail de Platon (12) qui examinait les tenants et aboutissants historiques et philosophiques de la réédition augmentée de la thèse belge de Marcel Piérart, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des «Lois» (Les Belles lettres, 2008).
Ce premier chapitre consacré à la philosophie antique est aussi intéressant, au second degré, pour l'historien de l'histoire de la philosophie, car deux noms importants y sont cités : celui de Werner Jaeger et celui de Max Pohlenz.
Il était impossible d'étudier en France le système d'Aristote, durant la seconde moitié du vingtième siècle, sans constamment lire le nom de Jaeger, auteur d'une thèse célèbre sur l'évolution génétique du système d'Aristote marqué par un passage progressif du platonisme à l'anti-platonisme. En 1953, lorsque Paul Ricœur professa son célèbre cours de Strasbourg sur Être, essence et substance chez Platon et Aristote, il précisa qu'il prenait «pour fil conducteur l'interprétation de Werner Jaeger» (13). Dix ans plus tard, précisément dès 1962, Pierre Aubenque faisait justice de cette thèse de Jaeger en détails : elle développait en effet d'une manière excessivement systématique ce qui relevait initialement du simple bon sens et ses résultats n'étaient pas particulièrement probants. On connaît beaucoup moins chez nous les idées de Jaeger sur Platon et la citation de l'article de Jaeger fournie par Chapoutot (traduite d'un article paru dans la revue nazie Volk im Werden (Peuple en devenir, I, 3, 1933, extrait traduit de la p. 46) vaut donc d'être reproduite : «Le Platon de notre génération est un créateur d'États, un législateur. Ce n'est plus le systématicien néo-kantien et l'honorable scholarque philosophique que nos prédécesseurs avaient vu en lui». Chapoutot précise que, dans le même article, Jaeger attaque vigoureusement le dix-huitième siècle et son humanisme individualiste. Intéressante précision mais, en réalité, la charge de Jaeger est directement conduite, je pense, contre la célèbre étude du kantien Paul Natorp (1854-1924), Platons Ideenlehre (Leipzig, 1903, puis seconde édition en 1921). Cette attaque est cohérente avec l'anti-kantisme profond du nazisme : il n'était pas question pour le nazisme de laisser récupérer Platon par le kantisme, y compris le néo-kantisme de l'École de Marbourg à laquelle appartenait Natorp. Mais il faut bien mesurer que pour un historien moderne de Platon, la lecture kantienne de Platon effectuée par Natorp était déjà douteuse par elle-même, indépendamment de tout contexte politique.
Encore vers 1965, il était non moins impossible de préparer l'agrégation si le stoïcisme antique était au programme sans lire la mention bibliographique du célèbre ouvrage de Max Pohlenz, Die Stoa, Geschichte einer geistigen Bewegung (, Leipzig, 1942, puis Gottingen 1946-1949 et éditions sans cesse revues et augmentées par la suite). Jean Brun, dans son cours d'agrégation Le Stoïcisme : direction et instruments de travail, professé vers 1965 (sa mention bibliographique la plus récente date de 1963 et concerne d'ailleurs précisément la seconde édition de sa propre étude Le Stoïcisme, PUF, 1963) et dactylographié par le C.N.T.E., situe ainsi l'œuvre de Pohlenz : «étude érudite en deux volumes mais qui ne remplacent cependant pas les ouvrages français cités ci-dessus», à savoir les études classiques d'ensemble de Ravaisson, Brochard, Rodier, Bréhier, Goldschmidt. Étude cependant bien évidemment lue et citée par le moindre article français traitant du sujet depuis 1950. Parmi les thèses intéressantes de Pohlenz, on trouve l'idée d'une déviation intellectualiste chez Chrysippe (280-210 avant J.-C.) qui aurait, au sein du courant général de l'ancien stoïcisme, rompu avec le naturalisme originel de Zénon de Cittium (336-264 avant J.-C.) et de Cléanthe (331-232 avant J.-C.). Chapoutot cite à la page 47 la remarque de Pohlenz selon laquelle «Nous rencontrons dans la doctrine stoïcienne bien des traits qui nous rappellent que ses fondateurs n'étaient pas des Grecs». Vers 1965, Jean Brun confirme qu'ils ne sont pas des Athéniens, qu'ils viennent d'Asie mineure, ajoutant : «comme d'ailleurs la plupart des pré-socratiques». On soulignait, ajoute Brun, leur accent étranger voire leur grec entaché de barbarismes. Armand Jagu, dans Zénon de Cittium, son rôle dans l'établissement de la morale stoïcienne (éditions Vrin 1946, p. 49 et sq.) s'est posé la question de savoir si on pouvait trouver dans leur doctrine des influences sémites ou orientales. Dans l'état actuel des textes, il ne reste, semble-t-il, guère de place que pour des hypothèses, mais la question est parfaitement légitime et mérite encore aujourd'hui d'être posée. Sur le rapport de Platon et des stoïciens, j'en profite pour signaler que l'étude de Jagu, Épictète et Platon – Essai sur les relations du Stoïcisme et du Platonisme à propos de la morale des Entretiens (éditions Vrin, 1945) demeure encore aujourd'hui l'étude française la plus suggestive. Rapportée à l'ensemble des citations traduites par Chapoutot, celle de Pohlenz est donc assurément dans l'air du temps nazi mais elle n'est pas philologiquement ni historiquement inexacte par elle-même. Il est, de même, parfaitement exact de prétendre que le cosmopolitisme des Stoïciens est une idée neuve à une époque où la pensée grecque distingue encore essentiellement Grecs et barbares d'une part, hommes libres et esclaves d'autre part.
Sur la récupération nazie de Kant, l'article de Chapoutot vaut d'être lu, en dépit du fait que le cheminement fondamental qui mène de Kant aux postkantiens (Fichte, Schelling, G.W.F. Hegel) et qui, de la sorte, détermine toute l'histoire de la pensée allemande moderne et contemporaine, soit pratiquement passé sous silence. L'auteur qui écrit d'abord un livre d'histoire et non pas un livre d'histoire de la philosophie mais qui en sonde régulièrement certains éléments, part de l'étonnement d'Hannah Arendt lorsque, journaliste au procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961, elle l'entendit citer une «définition approximative mais correcte» (p. 111) de l'impératif catégorique kantien au président du tribunal israélien. Eichmann : «Je voulais dire, à propos de Kant, que le principe de ma volonté doit toujours être tel qu'il puisse devenir le principe de lois générales». En quoi le penseur par excellence de l'Aufklärung (les Lumières allemandes du dix-huitième siècle) pouvait-il avoir inspiré Eichmann ? Chapoutot explique, au troisième paragraphe de sa page 117, que «lois générales» traduit mal ce qui doit s'entendre comme «lois universelles» de la raison. Une remarque est nécessaire à ce sujet : la première définition de l'impératif catégorique (in Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785) est : «Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle» (14). Il est exact que «loi générale» ne saurait, ainsi que le fait justement remarquer Chapoutot, traduire correctement «loi universelle». Mais Kant fournit une seconde définition, une page plus loin, qui stipule : «Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature». Pour un nazi lisant pour la première fois ce traité, la seconde définition est très facilement compréhensible puisque le nazisme est d'abord et avant tout une philosophie de la nature, une «bio-logie» au sens le plus philologique du terme. Il suffit, d'un point de vue raciste, de rajouter mentalement «nature allemande» ou de remplacer «nature» par «sang allemand» (dont les exigences sont traduites directement par Adolf Hitler et par les théoriciens racistes SS, exigences connues par cœur par Eichmann) pour ne pas être trop dépaysé en terre kantienne. D'autant moins que les notes 111 et 112 de la page 137 de la traduction de Victor Delbos expliquant en quoi les lois universelles sont l'élément formel de la nature et en quoi cette seconde définition précise la première sans la modifier, peuvent sembler tout de même un peu embarrassées puisque Delbos est alors contraint, pour faire comprendre la modification, de la mettre en parallèle avec le schématisme de la raison pure. À celui qui, en revanche, comme Eichmann, est électromécanicien de formation et qui n'a aucune culture philosophique mais qui a pourtant fait l'effort de lire la Critique de la raison pratique (1788, notamment la première partie, chapitre 2 où cette définition est présentée, selon Delbos, «un peu différemment» [sic]) sans avoir en revanche aucune idée de la Critique de la raison pure (1781, puis seconde édition en 1787) ni de la Critique de la faculté de juger, (1790), les choses peuvent paraître plus simples qu'à Victor Delbos, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres de l'Université de Paris, auteur en 1903 d'une thèse de doctorat sur la philosophie pratique de Kant qui fait d'ailleurs, encore aujourd'hui et à juste titre, autorité.
Sur le reste, excellente mise en perspective des relations entre contre-révolution anglaise et française d'une part et révolution nationale-socialiste d'autre part. Les penseurs nazis (notamment le philosophe catholique Carl Schmitt dont la pensée se situait alors au carrefour original de la théologie marcioniste (15) et de la philosophie du droit : il est naturellement cité à plusieurs reprises) reprennent à leur compte une partie mais pas la totalité de l'héritage contre-révolutionnaire. Ce n'est ainsi pas Dieu (du moins pas le Dieu des Juifs ni le Dieu catholique, auxquels ils ne croient pas) ni sa religion qui constituent, comme pour Burke, Joseph de Maistre ou Louis de Bonald, le support organique permettant de renverser l'individualisme pseudo-rationaliste et anti-social enfanté par la révolution française mais la «science» raciste de la fin du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle, d'une part, le nationalisme d'autre part. Alors que la Révolution française est parfois considérée comme accoucheuse de l'idée moderne de nationalisme (droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droits de l'homme, etc.), la pensée nazie émet une réserve allemande qui ne vaut que pour le peuple allemand mais qui vaut inconditionnellement. Tout comme la Guerre de Trente ans ou plus tard la Première Guerre mondiale, la Révolution française a été une mise en danger de l'Allemagne (à cause notamment des guerres défensives puis d'invasion menées par Napoléon) et non pas une chance d'émancipation. Ni la philosophie de l'histoire ni la philosophie de la nature sur laquelle se fondaient les révolutionnaires français de 1789, héritées de modifications philosophico-juridiques induites par la prépondérance juive en Europe à partir de l'époque hellénistique, ne peuvent donc lui servir de modèles. Elle doit, au contraire, renoncer à l'abstraction d'un droit individualiste romain (contraire au droit primitif germanique car permettant d'aliéner la terre allemande à des étrangers raciaux), à la philosophie égalitariste et universaliste (moyens juifs pour s'approprier les terres étrangères sur le plan juridique) pour revenir au droit primordial et à la morale primitive de la Germanie ancienne, seuls garants de son salut géopolitique, de la permanence de sa race, de celle de son espace vital (Lebensraum), que seule une conquête inégalitaire peut assurer, conquête commandant sa survie sous forme d'un combat permanent, celui du Troisième Reich. Je signale notamment l'excellent chapitre 8, sur les modifications alors considérées comme nécessaires à l'ordre sexuel et social afin de parvenir plus rapidement au but visé : réévaluation du plaisir sexuel et dévaluation des normes religieuses du mariage, réévaluation sociale des enfants naturels illégitimes, dissolution des unions stériles, eugénisme sélectif et euthanasie sélective, abolition de la monogamie au profit de la polygamie.
Le chapitre 11 intitulé Contamination et extermination s'ouvre, des pages 239 à 243, par une intéressante critique du film La Habanera (All. 1937) de Detlef Sierk (1897-1987), envisagé dans son rapport à la propagande nazie biologique et raciste. Malheureusement, elle est relativement invalidée par une méconnaissance gênante de l'histoire du cinéma. Outre l'absurde définition qu'elle fournit du film à trois reprises (La Habanera n'est absolument pas une «comédie musicale» (pp. 239 et 243) encore moins une «comédie réjouissante» (p. 240) mais un drame psychologique tendu et parcouru d'instants parfois proches du cinéma expérimental surréaliste, ponctué par la tragique chanson qui lui confère son beau titre), elle ignore – ou ne tient absolument pas compte du fait ? – que son cinéaste quitta l'Allemagne nazie, tout comme Fritz Lang à qui il est comparable sur bien des points, pour poursuivre sa carrière à Hollywood. Je renvoie donc le lecteur, au sujet du film et de son cinéaste, à mon article paru ici-même il y a presque dix ans : Le romantisme allemand de Douglas Sirk (16). D'autre part, la portée de l'intrigue était, aux yeux du cinéaste Detlef Sierk-Douglas Sirk, anticapitaliste d'abord, romantique ensuite mais nullement antisémite ni raciste. Je rappelle en outre à Chapoutot que Hitler's Madman (États-Unis, 1942) de Detlef Sierk-Douglas Sirk fut non seulement son premier film américain mais le premier film tout court consacré, presque en temps réel, dans l'histoire du cinéma mondial à l'assassinat de Heydrich par les résistants tchèques, tourné avant même le beaucoup plus connu Hangmen Also Die [Les Bourreaux meurent aussi] (États-Unis, 1943) de Fritz Lang avec qui Brecht avait collaboré pour l'occasion et qui fut, à la différence du film de Sierk-Sirk, distribué en France après la guerre et doublé en français par son distributeur alors que le film de Sierk-Sirk demeura inédit dans notre pays. Encore aujourd'hui, il n'en existe aucune édition vidéo numérique française : ce film de Sierk-Sirk demeure matériellement invisible en France alors qu'il est le premier titre d'une série importante de films historiques de guerre qui s'étendent de 1942 à 2017 (17). Chapoutot aurait été, je pense, mieux inspiré s'il avait pris comme exemple l'admirable film Les SS frappent la nuit [Nachts wenn der Teufel kam] (All., 1957) de Robert Siodmak qui constitue pour sa part, en décrivant soigneusement les rapports qu'entretiennent les autorités SS (sur les plans de la propagande, du droit criminel et du «droit racial») avec l'affaire policière historique authentique du criminel psychopathe Bruno Lüdke, une impeccable illustration de son livre, livre et film se répondant pour le coup en profondeur sur la plupart des plans essentiels distingués par ses chapitres.
Notes
1) Lucien Lévy-Bruhl, L'Allemagne depuis Leibniz (éditions Hachette, 1890).
2) Charles Andler, Le Pangermanisme (éditions Armand Colin, 1916).
3) Charles Andler, Le Pangermanisme philosophique 1800 à 1914 (éditions Louis Conard, 1917).
4) Émile Boutroux, Études d'histoire de la philosophie allemande (éditions posthume Vrin, Bibliothèque d'histoire de la philosophie, 1926).
5) Victor Basch, Les Doctrines politiques des philosophes classiques de l'Allemagne (éditions Félix Alcan, 1927).
6) Jean-Édouard Spenlé, La Pensée allemande de Luther à Nietzsche (éditions Armand Colin, 1934 et rééditions).
7) Émile Bréhier, Histoire de la philosophie allemande, mise à jour par Paul Ricœur (éditions Vrin, B.H.P., 1954).
8) André Glucksmann, Les Maîtres penseurs, (éditions Grasset, 1977).
9) Faute d'un index des noms cités en fin de volume, cet ouvrage est d'un maniement peu commode par l'étudiant ou l'honnête homme cultivé qui sont ses deux destinataires naturels. Voici quelques indications (sélectives et non exhaustives) comblant cette fâcheuse lacune : Louis Aragon, p. 53, Aristote, pp. 33, 77, Maurice Barrès, p. 75, Oskar Becker, p. 24, Marc Bloch, p. 17, Caracalla, pp. 48, 68, 106, H. S. Chamberlain, p. 66, 107, J. G. Fichte, p. 85, Sigmund Freud, pp. 26 et 27, Gobineau, p. 47, Goethe, p. 93, G. W. F. Hegel, pp. 85, 111, Martin Heidegger, p. 35, Homère, p. 33, Werner Jaeger, p. 30, Immanuel Kant, pp. 30, 56, 85, 110-131, E. Levinas, p. 111, Erich Ludendorff, p. 99, Karl Marx, p. 26, M. de Montaigne, p. 83, Friedrich Nietzsche, pp. 26 et 27, Platon, pp. 28 à 50, 56, 107-108, Protagoras, p. 31, Max Pohlenz, pp. 47 et 49, J.-J. Rousseau, p. 76, Carl Schmitt, pp. 138, 146-7, 165-169, Sénèque, p. 107, les Stoïciens, pp. 23-52, Tacite, p. 55, Thucydide, p. 33, Jean-Pierre Vernant, p. 45, Winckelmann, p. 27, Xénophon, p. 33., Émile Zola, p. 75.
10) Platon, Œuvres completes, texte grec et traduction, tome VI, La République livres I-III, introduction d’Auguste Diès, texte grec établi et traduit par Émile Chambry (éditions Les Belles lettres, Collection des Universités de France, publiée sous le patronage de l'association Guillaume Budé, 1932, dernier tirage 2002). Au troisième paragraphe de la p. 29 du livre de Chapoutot, j'en profite pour signaler une coquille gênante : l'absence de majuscules aux titres respectifs traduits en français des trois ouvrages de Platon, La République, Le Politique, Les Lois. Le lecteur prendra soin de les rajouter mentalement après avoir lu cette note.
11) Léon Robin, Platon (éditions Félix Alcan, collection Les Grands philosophes, 1935 puis réédition PUF, même collection avec bibliographie mise à jour par Pierre-Maxime Schuhl, 1968). Le compte -rendu élogieux de Diès sur l'étude de Robin est paru dans le Bulletin de l'association Guillaume Budé n°51 d'avril 1936, pp. 24-31. Le spécialiste ou celui qui vise à le devenir, ne peut évidemment pas se contenter de cette monographie ni d'aucune autre, simples introductions. Il devra lire la grande et la petite thèse de Robin d'une part, ses articles recueillis par la suite en volumes d'autre part. Il devra bien évidemment aussi lire les études classiques françaises de Victor Brochard, Georges Rodier, Albert Rivaud, Auguste Diès, Joseph Moreau, Émile Bréhier, Pierre-Maxime Schuhl, Jean Brun, Victor Goldschmidt et posséder à fond l'édition Budé CUF des œuvres complètes grecques de Platon, sans négliger les éditions anglaises et allemandes complètes, ni les éditions spéciales de certains dialogues, lorsqu'elles sont munies d'un commentaire important.
12) Ici.
13) Werner Jaeger, Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte seiner Entwickelung, Berlin 1923, traduction anglaise 1934 et 1948, référence citée par Paul Ricœur, p. 82 de la version dactylographiée de son cours, à la seconde page de l'introduction à la seconde partie consacrée à Aristote. Ricœur précise, à la troisième et dernière page de cette même introduction, en note de bas de page : «“Je dois dire ma dette à l'égard des travaux de Mansion, Le Blond, Ross, Tricot et surtout Owens, The Doctrine of Being in the Metaphysics of Aristotle (Toronto, 1953) à qui je suis redevable de l'interprétation développée ici, de l'ordre systématique de la Métaphysique d'Aristote.»” Le plus dommageable, historiquement, pour Ricœur est que ces deux interprétations, celle de Werner Jaeger et celle d'Owens, furent précisément les deux thèses principalement – et à juste titre – critiquées par Pierre Aubenque, Le Problème de l'être chez Aristote, éditions PUF, collection BPC, 1962 et rééditions. Paul Ricœur répondit aux thèses de Pierre Aubenque dans son cours de licence Introduction aux problèmes du signe et du langage aux pages 44 et 47 de la version dactylographiée par l'UNEF-FGEL (Cahiers de philosophie, volume I, n°8, stencils mis en forme, revus et corrigés par MM. Michel Masson, Michel Narcy, Gilbert Ollandini, sous la supervision de Paul Ricœur, 1962-1963). Ricœur comprenait parfaitement que les objections contenues dans la grande thèse d'Aubenque invalidait totalement son cours de 1953 qui présente encore aujourd'hui, en revanche, l'intérêt d'être une vulgarisation et une traduction partielle des travaux, rédigés en allemand et en anglais, de Jaeger et de Owens, offrant ainsi un état fiable des études aristotéliciennes internationales avant que la grande thèse d'Aubenque ne renouvelle fondamentalement la question tout en la mettant très précisément à jour.
14) Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), traduction nouvelle avec introduction et notes par Victor Delbos (éditions Delagrave, tirage de 1962, pp. 136-137).
15) Cf. mon article de 2010 paru ici même sur Le Rationnel et l'irrationnel dans la pensée allemande sur deux livres respectivement consacrés à G.W. F. Hegel d'une part, à Carl Schmitt d'autre part.
16) Ici.
17) Hitler's Madman (États-Unis, 1942) de Douglas Sirk, Hangmen Also Die [Les Bourreaux meurent aussi] (États-Unis, 1943) de Fritz Lang, Operation Daybreak [Sept hommes à l'aube] (G.-B., 1975) de Lewis Gilbert, Operation Anthropoïd (G.-B.-Tchéc., 2016) de Sean Ellis, HhhH (États-Unis-G.-B.-Fr.-Belg., 2017) de Cedric Jimenez.
Lien permanent | Tags : histoire, philosophie, philosophie politique, essais, nazisme, révolution, contre-révolution, johann chapoutot, éditions gallimard, francis moury |  |
|  Imprimer
Imprimer
