Un fils de notre temps d'Ödön von Horváth (02/10/2018)
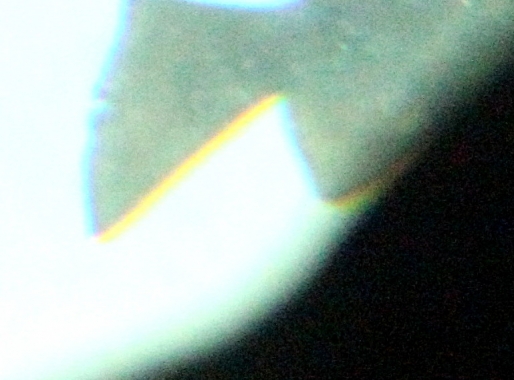
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Finis Austriae.
Finis Austriae. Finalement, la meilleure des jauges, pour distinguer un bon roman d'un mauvais, n'est affaire que de chronologie et, surtout, de hasard, ironie adressée à tous les amateurs de petites grilles de lectures et de jugements universitaires rancis. C'est ainsi que, lisant Un fils de notre temps (d'abord traduit Soldat du Reich) (1) juste après Mauvaise passe de Clémentine Haenel, il m'a semblé pour le moins facile non seulement de rapprocher ces deux textes dans leur sécheresse et leur concision, mais, surtout, de les différencier presque immédiatement. L'un est bon, l'autre est mauvais; l'un vaut quelque chose, l'autre ne vaut pas grand-chose, pas grand-chose de plus que ce que la réclame publicitaire et, hélas, journalistique, n'est capable d'offrir à un mauvais roman, à un texte facile : une gloire éphémère de quelques heures, voire, au mieux, jours.
Finalement, la meilleure des jauges, pour distinguer un bon roman d'un mauvais, n'est affaire que de chronologie et, surtout, de hasard, ironie adressée à tous les amateurs de petites grilles de lectures et de jugements universitaires rancis. C'est ainsi que, lisant Un fils de notre temps (d'abord traduit Soldat du Reich) (1) juste après Mauvaise passe de Clémentine Haenel, il m'a semblé pour le moins facile non seulement de rapprocher ces deux textes dans leur sécheresse et leur concision, mais, surtout, de les différencier presque immédiatement. L'un est bon, l'autre est mauvais; l'un vaut quelque chose, l'autre ne vaut pas grand-chose, pas grand-chose de plus que ce que la réclame publicitaire et, hélas, journalistique, n'est capable d'offrir à un mauvais roman, à un texte facile : une gloire éphémère de quelques heures, voire, au mieux, jours.Le texte d'Ödön von Horváth, comme celui de Clémentine Haenel, est lui aussi composé de phrases non seulement courtes mais simples, assez peu reliées entre elles puisqu'elles sont juxtaposées, comme s'il ne s'agissait, bien davantage que d'un roman, de banales didascalies qu'une facétie de l'auteur, par ailleurs grand amateur de théâtre nous le savons, aurait fait se suivre sans autre commentaire, mais cette simplicité, ce dénuement, certains diraient même : cette indigence stylistique n'est absolument pas celle de Clémentine Haenel. Il n'y a pas là qu'une question d'air du temps ou de sujet : le marivaudage d'Haenel eût pu sans peine supporter une écriture digne de ce nom, tout comme les aventures finalement assez maigres du Fils de notre temps se complexifier dans la méthodique évocation d'un Heimito von Doderer. Le premier, Ödön von Horváth, écrit naturellement des phrases simples, parce que son sujet est merveilleusement adapté à son moyen d'expression (l'inverse étant aussi valable), alors que la seconde, dont les carences sont aussi visibles que le nez de Philippe Sollers au beau milieu de l'Infini, se force à la simplicité et n'a, surtout, strictement rien à dire : elle évoque l'absence d'histoire d'une paumée aux goûts troubles de la même façon, à la virgule près, qu'elle pourrait décrire la passionnante croissance d'une courge ou la dernière seconde d'existence d'un moucheron de pissotière.
Il est en revanche plus étrange qu'Un fils de notre temps me fasse songer, par son titre même, à l'un des plus grands romans de Joseph Conrad, Lord Jim, dans lequel Marlow ne cesse de répéter, justement à propos du personnage principal et marin tourmenté de son état lunatique, qu'il est un des nôtres comme si, en somme, nous pouvions faire de ces deux créatures poursuivies par des fantômes, celle de Conrad l'étant bien plus que celle de Von Horváth, des parangons d'une médiocrité ontologique toute contemporaine : autrement dit, Lord Jim comme le jeune soldat du Troisième Reich sont des hommes creux.
L'un et l'autre auront vite fait de comprendre qu'ils se sont engagés dans une mauvaise voie, mais il manque au texte de Von Horváth la dimension réparatrice, assez romantique pour que Marlow s'en moque plus d'une fois, qui caractérise les faits et gestes du marin conradien. D'une certaine manière, il n'y a pas la moindre transition ontologique entre le jeune soldat enrôlé dans les armées de Hitler, tout fier de pouvoir accrocher de nouvelles médailles à sa veste d'uniforme impeccable, capable de proférer la phrase typique de tous les violents («Par l'amour, on monte au ciel, par la haine, nous irons plus loin...», p. 29) et celui qui va se laisser mourir, peut-être parce qu'il vient de découvrir qu'il n'est finalement pas autant de son temps qu'il le croyait, peut-être parce qu'un suicide se cache derrière un acte incompréhensible d'inconscience, peut-être encore parce qu'il ne parvient pas à rejoindre celle dont la toute banale rencontre l'a ébloui, et qu'il ne reverra pas : «Car celui qui n'est pas de son temps, on ne doit pas lui couper la corde. Qu'il pende haut et court à la potence qu'il s'est choisie, jusqu'à ce que les corbeaux l'emportent !» (p. 91), opinion obéissant à une logique bien connue de surhomme et qui ne saurait souffrir la moindre exception mais qui, pourtant, sera en fait assez vite sapée dans ses fondements friables.
Autre hypothèse, sans doute plus vraisemblable que la précédente ou même qu'une pure interrogation («Je regarde le capitaine et songe : es-tu de ce temps ? Et je me demande : suis-je de ce temps ?», p. 72) : c'est justement parce qu'il est bel et bien le parfait fils de son temps que notre soldat peut tenter de secourir son capitaine allant vers une mort certaine, et, en même temps, donner la mort ou bien, tout autant, se laisser mourir, comme le suggèrent les toutes dernières lignes du texte : «Comprends donc : il ne savait pas quoi faire d'autre, il était bien un fils de son temps» (p. 157), comme si l'homme creux ou médiocre obéissait essentiellement à cette absence de cohérence magnifiquement caractérisée par Max Picard comme étant l'une des caractéristiques de l'homme nazi, autant dire : de l'homme du néant, de l'homme contemporain.
Cette faille intime, nous la repérons bien sûr dans l'absence criante de Dieu qui fait qu'on «ne s'y retrouve plus» (p. 63), et dans la surrection, consécutive à la disparition stupéfiante, de forces obscures défiant notre entendement (2) ou, plus simplement encore, dans tel motif répété au sein du texte, qui nous fait soupçonner que notre héros vit dans un monde purement fantasmatique composé de reflets (3) tout à coup brisés quand une blessure le contraint à la démobilisation, le contraint, tout simplement, à penser, à se rendre compte qu'un enfant de son temps n'es pas grand-chose de plus qu'une brute incapable de donner le moindre sens aux événements stochastiques qui se produisent sous ses yeux, et auxquelles il ne peut prêter le moindre sens, à moins de ne supposer qu'ils sont régis par un démiurge ironique et facétieux qui, toujours, saura aisément ridiculiser les prétentions intellectuelles les moins avouables. : «C'est que je n'ai plus peur de penser depuis qu'il ne me reste plus rien d'autre. Et je suis content de mes pensées, même lorsqu'elles me révèlent des déserts» (p. 104).
Note
(1) Ödön von Horváth, Un fils de notre temps (Ein Kind unserer Zeit, 1938, traduction de Rémy Lambrechts, préface de Heinz Schwarzinger, Christian Bourgois, 2002). Sans autre mention, les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(2) «Voyez-vous, il y a des choses inexplicables dans notre monde, d'étranges mystères, des lois impénétrables» (p. 79) et, quelques pages plus loin : «Mais il y a justement dans notre vie des lois impénétrables, qui n'admettent aucune blague» (p. 89).
(3) «Et je remarque de nouveau que nous nous reflétons. Dans les vitrines des magasins chics» (p. 32), proposition pouvant sembler anodine qui sera répétée, presque à l'identique, plus loin : «Et tout en cheminant, je remarque de nouveau que je me reflète. Dans les vitrines huppées» (p. 111).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, nazisme, ödön von horváth, un fils de notre temps, clémentine haenel, mauvaise passe, éditions christian bourgois, joseph conrad, lord jim, max picard, l'homme du néant |  |
|  Imprimer
Imprimer
