Une adolescence au temps du Maréchal de François Augiéras (09/04/2019)
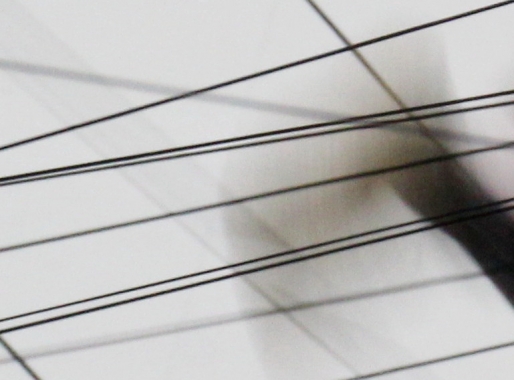
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Mâles lectures.
Mâles lectures.«Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan !»
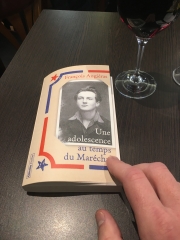 Acheter Une adolescence au temps du Maréchal sur Amazon.
Acheter Une adolescence au temps du Maréchal sur Amazon.Ceux qui ont connu François Augiéras, dont Paul Placet qui apparaît dans Une adolescence au temps du Maréchal (1), nous assurent que seule la passion peut nous permettre d'entrer dans l’œuvre de l'un des plus incontestables héritiers d'Arthur Rimbaud. De la passion, il en faut sans doute beaucoup, et même de l'aveuglement, pour vaincre l'agacement, parfois la franche répugnance éprouvés à lire certaines des pages de ce livre, à moins que, à l'instar de l'écrivain à propos du peintre Bissière, il ne nous faille confesser que ce diable d'homme nous intrigue, nous agace et nous attire (cf. p. 314) tout autant. Certes, le style de ce livre est bien souvent admirable, et l'on sait assez vite que François Augiéras était un écrivain aimant la peinture, la pratiquant de façon constante, en restant frappé devant telle image médusante où il saisit la vérité d'un être. Tout est dit, ainsi, en quelques mots qui nous le montrent en un chromo édifiant et cruel, sur André Gide, et la scène finale de leur brève relation nous a immédiatement fait penser, par sa vertu non seulement symbolique mais trivialement figurative, à Monsieur Ouine tentant d'amadouer le jeune Steeny, l'ancien professeur de langues étant, nous le savons, l'une des figurations romanesque possibles de l'auteur des Nourritures terrestres : «Il tient mon bras de nouveau, avec une force incroyable, presque sauvage, et je sens s'enfoncer lentement dans les veines de mon poignet les ongles durs de Gide, pénétrant toujours plus profondément dans ma jeune chair, cherchant le sang, cherchant la vie. Je ne bronche pas sous cette dure étreinte, le temps passe; soudain, il porte mes veines à ses lèvres, et s'abreuve à moi, longtemps. Puis me quitte. - Adieu, lui dis-je» (p. 238). Bien réelle ou enjolivée, l'une et l'autre sans doute, cette scène est remarquable.
Ce n'est pas tant l'éternel sourire du sale gosse content des tours qu'il fait (par exemple à son oncle, dans un chapitre pénible, Un printemps au Sahara, ou encore au peintre Bissière), ni même le très grand contentement de soi (à la lettre : Augiéras se contente de lui-même, comme tous les narcissiques; quand il va vers les autres, c'est encore lui-même qu'il poursuit, lui qui se parle au niveau de son âme et qui, pour ce faire, a «besoin de solitude et de paix», p. 144), ce ne sont pas ces amusements plus ou moins graves qui nous gênent. Après tout, même le plus naïf des universitaires finit par se douter que la cohabitation, fût-elle épisodique, avec l'auteur des Illuminations ne devait pas être de tout repos ! Ce n'est même pas l'atmosphère homosexuelle, parfois même franchement pédérastique, qui imprègne tant de pages qui saurait nous choquer : tout est suggéré, et c'est encore pire de mièvrerie que si Augiéras appelait un chat un chat, sauf lorsqu'il écrit noir sur blanc que son oncle, Marcel Augiéras, colonel à la retraite perdu au fin fond d'El-Goléa, le prend. Ce qui m'a très vite franchement agacé, au point que plus d'une fois j'ai jeté ce livre au diable pour y revenir tout de même, c'est l'exposition répétée de la croyance pour le moins confondante de naïveté en un progrès de l'homme censé non seulement se débarrasser d'une civilisation pourrie, mais rejeter le christianisme et, comme toujours, revenir à une nature qui n'est primordiale que dans l'esprit des doux rêveurs. Combattre le nihilisme qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer est une chose, et Augiéras ne sera certes pas le premier à quitter l'Europe aux vieux parapets, mais prétendre mener le combat au nom d'un lendemain désamarré de toute pesanteur affadissante est une lubie d'adolescent attardé ou de fou bien réel, dont la folie est le rempart le plus puissant contre les assauts du monde.
Le refus de la vie moderne, surtout de Paris qu'Augiéras déteste bien cordialement, et cela dès les toutes premières pages de son livre («Je garderai un souvenir horrifié de mon enfance parisienne», p. 24) s'accompagne, dans le même mouvement, d'un crédo répété de page en page, et qui là encore nous est donné d'entrée de jeu : «je chercherai d'autres mondes, persuadé toujours davantage que l'avenir de l'homme va se jouer loin des grandes concentrations humaines qui ne sont plus que des tares, que des empêchements pour aller de l'avant» (pp. 24-5). Le même rejet, qui lui aussi ira se répétant, est exprimé à propos du christianisme, dont François Augiéras a «assez» (p. 35), lui qui aspire «à la demi-barbarie» comme il le déclare dans un passage qui nous donne son programme d'horrible travailleur : «La chute de Paris, la ligne de démarcation, les intellectuels réfugiés dans le Sud, le néo-paganisme germanique à l'horizon, la mise en veilleuse de la civilisation occidentale rationaliste, humaniste et chrétienne trouvent en moi des échos, et raniment un fond de sauvagerie dans mon sang. Le christianisme est fortement menacé; on revient à la terre, les imbéciles en profitant pour faire du Giono, du pétainisme et du provincialisme» (pp. 38-9), ce dernier triple reproche pouvant du reste, je le crains, s'appliquer à bien des pages d'Une enfance au temps du Maréchal.
Dédouanons tout de suite Augiéras de l'accusation, sotte, qui a pu lui être jetée, d'être un maréchaliste : plus d'une fois il répètera qu'il n'a pas beaucoup de goût pour le vieillard, dont l'accession au pouvoir ne sera finalement, à ses yeux, que la chance, pour la France et même l'Europe, de retrouver le sens d'une «fraternité sauvage» (p. 42) et la possibilité d'une vie «parmi les forces de la Terre et du Ciel» (p. 48), mais, surtout, la perspective d'une Terre et d'un Ciel enfin rendus à leur pureté d'avant le christianisme : «L'Europe, enfin débarrassée de Jésus, retrouvait-elle son âme sur les premiers contreforts des vastes monts d'Auvergne, au temps du Maréchal ?» (p. 50). Dans une note, il dira tout ce qu'il a à dire sur ce point, qui le rapproche il nous semble de Gustave Thibon : «Un instant, mettons de côté ses erreurs, ses responsabilités criminelles, surtout à partir de 1943, supposons que le régime de Vichy ait duré très longtemps; une curieuse civilisation agricole serait apparue, composée en majorité d'intellectuels venus à la terre, de gens se réunissant le soir pour faire de la musique, du théâtre, du tissage, de la céramique, pour parler philosophie; régressée, peut-être, une civilisation d'artistes, de poètes» (p. 66), par quoi l'on voit que ce qui caractérise, d'abord, François Augiéras, est une confondante naïveté, que l'on jugera, au choix, comme l'apanage du jeune démon plein de forces et de vigueur entraînant les autres dans son sillage, ou comme la pose insupportable de l'adulte revenu de tout. Hélas ou heureusement, François Augiéras ne semble être revenu de rien, et avoir conservé jusqu'à son dernier souffle, lui qui est mort à 46 ans, l'ardeur primitive, la verte primitivité, agaçante à la dent comme la chair point encore mûre d'une pomme acide, qui en a fait un voleur de feu ne dédaignant pas, à l'occasion, en allumer quelques-uns dans le cœur et l'esprit de ceux qu'il a croisés.
De page en page, c'est la même antienne, bien sûr déchristianisée, que François Augiéras nous répète : il s'agit de trouver ou plutôt de retrouver l'ancien, le primordial, ce qui date du «commencement de la vie» (p. 64), de revenir au paganisme, le triste état de la France qu'il constate au moment de son adolescence tardive devant en somme servir de terrain d'expérience idéal et de jeu spirituel, afin de «tenter de progresser rapidement vers un nouveau paganisme, vers le ciel étoilé des nouvelles aventures de l'esprit». Il est ici étrange de constater, et ce sera un des motifs les plus constants de la toile ou du tapis que compose Augiéras, que ce retour aux sources ne peut décemment advenir qu'au prix d'une transformation que l'écrivain ne manque jamais de saluer comme un progrès, aussi invisible qu'essentiel, puisqu'il doit en tout premier lieu affecter celui qui écrit. Rendons ici un hommage à un écrivain de race qui n'a jamais cru pouvoir séparer son écriture d'une expérience constante dont sa propre vie trépidante est le terrain premier, rimbaldien nous l'avons dit, Augiéras n'hésitant pas à profiter «de ce moment de rupture, de cette hésitation de l'Histoire pour entrevoir des mutations possibles, un nouvel élan de la vie» (p. 70). Du reste, lui qui se considère comme «un autre Rimbaud», un «Rimbaud au temps du Maréchal» (p. 129) c'est écrit noir sur blanc, il est persuadé de son grand destin, depuis qu'un astrologue du nom de Raoul Théret lui a appris qu'il resterait, «disons, dans la mémoire des hommes, comme l'une des personnalités les plus originales de notre époque», qu'il connaîtrait aussi la réussite, «une gloire tardive», de l'influence, des imitateurs et même des disciples acquis en traversant une existence «de dangers, de souffrances, de solitude» (p. 94).
Mais qu'il est difficile de s'extraire de la gangue de boue, de se débarrasser de la vieille peau recouverte de saletés et d'excroissances, quand tous ceux qui vous entourent ont peur, à l'instar du peintre Bissière qu'un orage affole puisque les Européens, décidément, «même lorsqu'ils prétendent avoir quitté le christianisme, y reviennent à la première occasion; ils vont se jeter aux pieds de Jésus sans avoir trouvé mieux !» (pp. 76-7), car ils ne voient pas l'avenir, «ils font du mystère périmé, ils font du Moyen Âge» (p. 79), face à un Augiéras qui, lui, inflexiblement, «appelle tous les possibles dans une sorte de songe» et «cherche des pouvoirs et des pressentiments, l'avenir probable» (p. 83), prenant du reste le peintre Bissière, à moitié aveugle au volant de sa deux-chevaux et obéissant au doigt et à l’œil à son horrible femelle, pour une espèce de mage auquel lui-même, Augiéras, souhaite confronter ses pouvoirs d'apprenti sorcier !
«Tu n'es pas de ce siècle, mais déjà du futur» ou «ta destinée est orientée essentiellement vers l'avenir, avec de curieuses remontées d'un passé lointain» (p. 93) : ce mouvement double vertèbre tout le livre et lui conférant une curieuse verticalité, le pied dans l'humus des forêts ou dans le sable chaud du désert où il s'agit en tout cas d'être païen (cf. p. 132), la tête dans les étoiles ou, plus prosaïquement, le regard rivé au «beau ciment gris» (p. 131), symbole à nos yeux passablement sordide du nouveau monde qu'il entrevoit. Voici cette double aspiration ou inspiration résumée en quelques mots : «Oui, je suis un artiste... persuadé qu'on va vers de nouveaux rapports avec les forces du monde ! Qu'il y a de l'avenir davantage près des forêts que dans les rues de Paris ! qu'un nouveau type humain va naître, loin des villes : je ne suis pas en régression, mais en mutation volontaire; je veux être de ceux qui, les premiers, s'avanceront du côté des arbres et des astres. Je veux aussi changer de religion» (p. 148), puisque le christianisme n'est, selon l'auteur, qu'un «abâtardissement des Grandes Initiations», rien de plus qu'une «religion tardive, simpliste, déjà populacière, à l'usage des boutiquiers d'Alexandrie» (p. 153).
Et cela, ce mouvement essentiel de retour au passé et de main portée en visière, reprend une nouvelle fois, car l'immobilité est la mort, quelles que soient les péripéties qui attendent l'écrivain ou plutôt, qu'Augiéras semble traverser avec un sourire : «un nouvel univers, de nouveaux rêves» (p. 155) accompagnant la certitude que le christianisme, comme toute religion qui touche à sa fin, «berce toujours de ses bras maternels, l'ignorât-elle, une autre déjà née» (p. 156) dont l'auteur se voudrait sans doute bien le mystagogue, lui qui ne cherche justement qu'une seule et unique chose, «répondre en ce monde» à «un appel venu de l'avenir et de tous les possibles» (p. 159), autrement dit l'incarner. Rimbaud encore, jamais plus directement présent que dans ce beau passage que tant de tristes professeurs et de ridicules imitateurs, s'ils l'ont lu, auraient dû apprendre à la virgule près ! : «Qui prolonge Rimbaud ? Sans la pacotille et le mauvais goût des imitateurs de Rimbaud ! De l'auteur des Illuminations je n'ai retenu que la santé, que le courage, que l'adolescence. Je me suis astreint à une analyse de ses œuvres complètes : les mots simples, les impressions matinales, un vigoureux accord avec le monde l'emportent statistiquement sur les mots décadents, le pourrissement. Telle me paraît la leçon de Rimbaud» (p. 162). Leçon claire, leçon franche, leçon qui ne s'embarrasse pas d'être exposée derrière un pupitre, les petites gorgées bues à un verre d'eau rythmant la leçon répétée de tribune en tribune. Il s'agit ainsi, sur soi-même, d'éprouver et d'expérimenter toutes les ivresses, tous les plaisirs, selon le rigoureux programme du Voyant, l'art moderne n'étant pour Augiéras qu'une «première tentative pour modifier l'homme dans ses rapports avec lui-même et le monde» (p. 163).
Et partir, comme toujours, car c'est le mouvement essentiel qui ne saurait souffrir aucun retard, aucune lâcheté : même au fin fond de la France, François Augiéras croit entendre «de lointains déferlements de vagues du côté de l'Afrique; des trains partent, le jour se lève ailleurs» (p. 176).
Ailleurs, en Afrique, plus précisément en Algérie qu'il évoquera magnifiquement, ainsi que les Arabes, violents et doux, d'une «douceur [de] gestes qui date des premiers temps du monde, quand je ne sais quoi de Dieu persistait chez les hommes» (p. 219), en Algérie, à El-Goléa précisément, où le jeune Augiéras rejoint son oncle vivant avec son serviteur noir dans une espèce de fortin, matière du Vieillard et l'enfant : «Qu'un homme prenne la place de Dieu dans le cœur d'un enfant, c'est la plus profonde des intrigues, la seule grave» (p. 213), phrase aussi profonde que maléfique, maléfique par le poison qu'elle distille, et qui nous donne tout entier François Augiéras, comme la scène rapportée plus haut nous donnait le fond de l'âme d'André Gide, comme Monsieur Ouine nous donne le fond ontologique du désir pédérastique, qui est un désir de paraître Dieu pour autrui, d'avoir droit de vie et de mort sur lui.
Ce que cherche François Augiéras, c'est la Connaissance bien sûr, mais cette quête, il ne saurait la séparer durablement d'une âme et d'un corps à étreindre, puis il est seul, voilà ce qui compte au final, quand bien même il adorerait ou serait adoré comme Kurtz en son repaire de ténèbres ! : «Ce que j'ai vécu, voilà surtout ce qui m'importe. C'est aussi la meilleure manière de s'élever contre les hommes. Pouvoir leur dire un jour : je me suis emparé d'une puissante part de la réalité, de la façon que je voulais, pour moi seul, sans vous demander votre avis, ni votre permission, loin de vous, malgré vous, sans vous, pas en rêve, pas en art, mais au cœur même du réel; voilà ce qui, peut-être, à la fin de ce siècle, quand on fera le bilan, pèsera le plus lourd» (p. 217).
François Augiéras ne se trompe pas, la brièveté de sa vie signant la vigueur, la sincérité de sa quête, et le fait qu'il a su mettre ses pas, sans pourtant chercher à le singer, dans ceux d'Arthur Rimbaud jusqu'à pouvoir dire que lui aussi est «très brûlé, tanné par le soleil, amaigri, vêtu presque de loques», avec «un terrible sourire sur [s]es lèvres, inquiétant, sauvage, heureux» (p. 223), sans prendre la pose de l'artiste maudit ou, pire encore, de l'universitaire assis rapportant de son périple en Abyssinie quelques photographies passables et de creux rébus sur l'énigme Rimbaud. Combien rares sont les François Augiéras et combien communs les vieux faunes increvables tels un Gabriel Matzneff préoccupé, au gramme près, par son poids de jeune fille, le cheptel des grains de beauté étant méthodiquement passé en revue, tous les matins au sortir du lit, les premiers et les seconds, les aventuriers et les esthètes ne cherchant bien sûr rien d'autre qu'eux-même, les premiers nourrissant «l'arrière-pensée d'épuiser tous [leurs] doubles jusqu'à [se] rencontrer un jour seul, face à face, démasqué, devant [leur] âme éternelle» (p. 240), les seconds paraissant la fuir de corps en corps, de bras en bras portés, jusqu'à la crampe mortelle, le rictus final d'un Don Juan de carton-pâte perclus et cacochyme se jouant la comédie de la jeunesse.
Bien sûr encore, cette quête n'évitera pas le ridicule, surtout lorsque François Augiéras, toujours si désireux de rencontrer «l'Homme bien vivant», celui qui pour lui est «l'Homme à naître, plus heureux, mieux doué que l'Homme actuel» (p. 280), se découvrira des pouvoirs lui permettant à loisir de déclencher en lui «une période évolutive» quand il le voulait, «quand les circonstances [lui] paraissaient favorables» (p. 291), métamorphose grandiloquente bien éloignée des facéties dirigées contre son oncle ou Bissière et racontées par le menu. Cette reprise de l'être par lui-même, pour le dire encore avec l'auteur, est l'effort de tous les mystiques et saints, plus benoîtement de tout homme désireux d'accorder ses actes et ses paroles à ses pensées : bonnes ou mauvaises, grandes ou ridicules, tout cela ensemble sans doute, nul ne pourra prétendre que François Augiéras n'a pas tenté (coûte que coûte, formant à lui-même l'une des lettres, qui sait l'une des syllabes peut-être, de stupeur et de facétieux ravissement, mais aussi de sordide et de tragique, de la phrase immense, inconnue et absente qu'est la vie) d'abattre la mince cloison séparant celles-ci de leur manifestation poétique.
Note
(1) François Augiéras, Une adolescence au temps du Maréchal (Bartillat, coll. Omnia Poche, 2017).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, françois augiéras, éditions bartillat, arthur rimbaud, andré gide |  |
|  Imprimer
Imprimer
