L’impératif de l’adaptation : la soumission du droit, de l’économie et du management à l’imaginaire de la biologie moderne, 3, par Baptiste Rappin (27/04/2020)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone.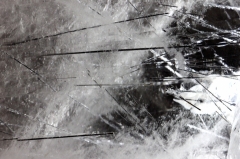 L’impératif de l’adaptation : la soumission du droit, de l’économie et du management à l’imaginaire de la biologie moderne, 1.
L’impératif de l’adaptation : la soumission du droit, de l’économie et du management à l’imaginaire de la biologie moderne, 1. L’impératif de l’adaptation : la soumission du droit, de l’économie et du management à l’imaginaire de la biologie moderne, 2.
L’impératif de l’adaptation : la soumission du droit, de l’économie et du management à l’imaginaire de la biologie moderne, 2.5 – La mutation cybernétique du concept d’organisation
Le concept d’organisation n’est donc pas neuf et vierge quand surviennent les conférences Macy entre 1946 et 1953 (1); il possède même déjà une histoire conséquente, liée à l’abandon de l’histoire naturelle au profit de la biologie, et déborda très vite le cadre du vivant pour gagner le champ du social et même les locaux de l’usine et des bureaux. Le tour de force de la cybernétique fut en réalité d’articuler à l’organisation une seconde notion scientifique, celle d’information. À suivre Jérôme Segal, auteur d’une monumentale «Histoire de la notion scientifique d’information», Le Zéro et le Un, la scientificité du concept d’information se forge dans la première partie du XXe siècle au confluent de trois disciplines : «À partir des années 20, en physique, en statistiques et dans le domaine des recherches sur les techniques de télécommunication, on assiste à la définition de l’information comme notion scientifique et technique bien distincte des sens communs du mot» (2).
Que ce soit en physique, en statistique ou dans l’étude des télécommunications, la formation de la notion scientifique d’information est conditionnée à la mesure d’une grandeur immatérielle qui allait déboucher sur la théorie mathématique de la communication de Claude Shannon : «The semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem» (3), le sens se résumant à n’être plus qu’une option parmi un ensemble de combinaisons possibles. Modélisant la communication comme un système mettant un jeu un signal qui part d’une source (émetteur) pour arriver à une destination (récepteur) et se trouve soumis à des bruits, le mathématicien tente de dégager les économies possibles grâce à la structure statistique du message original.
Si Shannon s’en tient au registre des télécommunications et aux problématiques de l’encodage et du décodage, l’esprit encyclopédique de Norbert Wiener n’hésite pas, quant à lui, à élargir le spectre de la réflexion et à envisager une nouvelle conceptualisation du vivant à partir du nouveau concept scientifique d’information : «Pour décrire un organisme, nous n’essayons pas d’en analyser chaque molécule et de le cataloguer bribe par bribe, mais plutôt de répondre à certaines questions qui révèlent le modèle : un modèle de plus en plus significatif et moins probable à mesure que l’organisation devient, pour ainsi dire, plus pleinement organisme» (4). Au fond, un organisme n’est rien d’autre qu’un message structuré qui se perpétue dans le temps («Un modèle est un message et peut être transmis comme un message» (5)) avant que l’énergie nécessaire à sa conservation ne finisse par s’épuiser : c’est le phénomène de vieillissement qui, s’il touche le corps, ne concerne pas l’information, laquelle se transmet par la reproduction et atteint d’une certaine façon une forme d’immortalité. C’est la raison pour laquelle Wiener peut écrire que l’identité personnelle est en fin de compte peu liée à la constitution physique de l’individu, et que le seul obstacle à la réussite de la téléportation est de nature technique, et non pas conceptuelle.
De ce point de vue, l’homéostasie ne désigne plus seulement l’interdépendance des éléments d’un système qui persévère en son être, mais la préservation de ce milieu intérieur par le traitement de l’information interne et externe. Car tout, sous la plume de Wiener, devient information : «Information est un nom pour désigner le contenu de ce qui est échangé avec le monde extérieur à mesure que nous nous y adaptons et que nous lui appliquons les résultats de notre adaptation» (6). Par les sens, qui assument une fonction de capteurs, le système nerveux récolte l’information de l’environnement que le cerveau traite en vue de réagir de façon adaptée à la situation présente. Les dimensions cognitives et comportementales sont ici indissociables. Et en fin de compte, la loi du vivant se formule ainsi : «Vivre, c’est vivre avec une information adéquate» (7). Mais tout cela revient à faire de l’organisation, quelle que que soit sa taille, microcellulaire, nationale ou mondiale en passant par les stades intermédiaires, quelle que soit sa nature, biologique, psychologique ou sociale, une machine à traiter de l’information : «L’une des leçons de ce livre est que tout organisme maintient sa cohésion par la possession de moyens d’acquisition, d’usage, de rétention et de transmission de l’information» (8).
Précisons toutefois encore les choses : la cybernétique est une science de l’efficacité en ce qu’elle modélise les actions orientées par un but. Pour Wiener, la science classique, celle de Galilée et de Newton, comprend la recherche de causes comme l’antécédence de la détermination, c’est-à-dire comme la mise à jour de causes motrices. Pourtant, comme le montre les acquis de la biologie et de la psychologie modernes, l’intention, le projet, la finalité peuvent déclencher un comportement, non seulement chez l’homme mais également dans tout type d’organisation, naturelle ou artificielle. Accompagné d’Arturo Rosenblueth (1900-1970) et de Julian Bigelow (1913-2003), Wiener propose dès 1943 de cerner le concept de «but»à travers lequel les auteurs tentent de compléter le manque de profondeur du behaviorisme : si en effet ce dernier courant en reste à l’étude des comportements observables, l’introduction de la notion de but a pour conséquence la prise en compte de la structure et des propriétés de l’organisme étudié. Raisonnement somme toute logique si l’on considère que le comportement téléologique se base sur «l’action volontaire» (9) qui, quant à elle, ne relève pas de l’arbitraire subjectif mais bien d’un fait physiologique. Par ailleurs, certaines machines déploient également des actions orientées vers un but : on parle alors de servomécanismes. En d’autres termes, dès le début de ses réflexions qui l’amèneront vers la thématisation de la cybernétique, Wiener ne s’intéresse pas à un type d’être (le vivant, l’homme, la machine, etc.) mais à un type de comportement pouvant être adopté par une pluralité d’êtres : et plus précisément, il concentre ses efforts sur les comportements orientés vers un but et soumis à un phénomène de rétroaction (feedback). Ici prend racine la puissante homologie entre le cerveau et l’ordinateur qui ne laissera pas de guider les réflexions du mathématicien.
Cinq ans plus tard, en 1948, dans Cybernetics, la rétroaction se trouve pleinement associée à l’information : elle est d’ailleurs définie comme «retour d’information», et la chaîne qui intègre la transmission et le retour d’information se nomme «boucle de rétroaction» (10); cette dernière n’est autre que l’essence de l’organisation telle que la conçoit la cybernétique et telle que nous la concevons encore de nos jours. Norbert Wiener illustre son propos avec plusieurs exemples – le thermostat, le régulateur à boules de Watt et de Maxwell, le mouvement du bras cherchant à atteindre le paquet de cigarettes – et met en évidence que l’action et sa correction, son affinement progressif, proviennent d’une comparaison entre le but et la position présente, entre l’objectif et le chemin déjà parcouru : «Le retour de l’information au centre de contrôle tend à compenser l’écart entre la grandeur asservie et celle qui la commande» (11). La décision du comportement se prend ainsi en fonction d’une récolte et d’un traitement d’informations, en l’occurrence d’un calcul d’écart entre la destination souhaitée et la trajectoire réelle. Et l’on comprend également le rôle de la mémoire, c’est-à-dire du stockage des données, dans ce contexte : car plus la connaissance des conditions initiales est complète, plus le calcul des écarts est établi avec précision, et plus l’ajustement a des chances de se révéler efficace.
Wiener distingue deux types de rétroaction : d’une part, celle qui reconduit perpétuellement l’action à la finalité fixe prédéfinie, comme c’est le cas de l’homéostasie du corps humain qui maintient, par exemple, sa température constante; d’autre part, celle que le mathématicien nomme «prédictive»et qui concerne des buts évolutifs, à l’image des batteries anti-missiles qui doivent anticiper le tir adverse. On reconnaît dans ces deux formes de feedback, négatif et positif, les deux types d’apprentissage que Wiener distinguera dans son ouvrage suivant en 1954 : d’un côté la société des fourmis, à laquelle se trouve assimilé le régime fasciste, dans lequel le système, rigide et figé, se reproduit indéfiniment lui-même; de l’autre, les sociétés modernes et démocratiques fondées sur l’apprentissage, c’est-à-dire, au fond, sur l’innovation : «Comme je l’ai dit, la rétroaction est la commande d’un système au moyen de la réintroduction, dans ce système, des résultats de son action. Si ces résultats ne sont utilisés que comme données numériques pour l’examen et le réglage du système, nous obtenons la rétroaction simple que connaissent bien les automaticiens. Si, par contre, l’information portant sur l’action effectuée est capable de modifier la méthode générale et le modèle de celle-ci, nous disposons d’un processus que l’on peut bien nomme apprentissage» (12). Il est donc deux types d’organisation : celle qui reproduit mécaniquement ce qu’elle sait faire, au risque de disparaître suite à une perturbation de l’environnement; celle qui est capable d’apprendre et par voie de conséquence de s’adapter aux changements externes.
6 – Conclusion : l’industrialisme ou l’extension du domaine de l’adaptation
Avant de rentrer dans le vif de la conclusion, signalons alors ceci, afin de jeter un pont entre les développements précédents et la cohérence globale de notre argumentation : la cybernétique, bien que son nom tombât en désuétude dès les années 1950, n’en infiltra pas moins la quasi-totalité des champs du savoir. Jean-Pierre Dupuy en livre un premier inventaire : «elle aura, en vrac et sans souci d’exhaustivité : introduit la conceptualisation et le formalisme logico-mathématique dans les sciences du cerveau et du système nerveux; conçu l’organisation des machines à traiter l’information et jeté les fondements de l’intelligence artificielle; produit la «métascience» des systèmes, laquelle a laissé son empreinte sur l’ensemble des sciences humaines et sociales, de la thérapie familiale à l’anthropologie culturelle; fortement inspiré des innovations conceptuelles en économie, recherche opérationnelle, théorie de la décision et du choix rationnel, théorie des jeux, sociologie, sciences du politique et bien d’autres disciplines; fourni à point nommé plusieurs «révolutions scientifiques» du XXe siècle, très diverses puisqu’elles vont de la biologie moléculaire à la relecture de Freud par Lacan, les métaphores dont elles avaient besoin pour marquer leur rupture par rapport à des paradigmes établis» (13). Céline Lafontaine, quant à elle, mit en exergue l’influence loin d’être négligeable de la cybernétique dans la formation de la pensée postmoderne, démontrant d’indéniables éléments de continuité entre la révolution info-organisationnelle et les pensées de Jacques Lacan, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, etc. (14). De son côté, Maxime Ouellet s’est intéressé aux liens, que l’on jugera consubstantiels après avoir lu son ouvrage, entre le capitalisme contemporain et la cybernétique, soulignant, entre autres, que Friedrich Hayek conceptualisa le marché comme un système cybernétique de rétroaction de l’information dès les années 1940 (15). Pour notre part, nous mîmes au jour les racines cybernétiques du management contemporain qui se constitua lors de la période de l’après-guerre et continue à être enseigné et diffusé aujourd’hui (16). Bref, le concept d’«organisation» occupe une place absolument centrale dans la science moderne et c’est la raison pour laquelle nous pouvons raisonnablement soutenir qu’elle s’est substituée au cosmos en tant qu’imago mundi. Comme l’écrit Ludwig von Bertalanffy, biologiste et pionnier de l’approche systémique, «nous recherchons maintenant un autre regard fondamental sur le monde, le monde en tant qu’organisation» (17).
Que nous apprennent au fond tous ces développements sur l’organisation ? Que l’extension du domaine de l’adaptation ne saurait être appréhendée sans le recours à une généalogie de la biologie moderne et au transfert de ses catégories dans les sciences humaines et la philosophie politique. Telle est à notre sens la principale limite des travaux de Johann Chapoutot et de Barbara Stiegler qui, quoique hautement stimulants, pèchent en faisant de la théorie de l’évolution un point d’arrêt, c’est-à-dire une origine intellectuelle qui concerne tant le régime national-socialiste que le néolibéralisme, au lieu d’inscrire le système de Darwin et de ses épigones plus ou moins fidèles (comme Herbert Spencer) dans la brèche ouverte par la biologie moderne au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. En effet, on ne saurait, sans commettre une grossière faute, imputer la conception de l’idée révolutionnaire d’une contingence du vivant, en prise avec son milieu, à la théorie de l’évolution : on la trouve déjà dans le catastrophisme fixiste de Cuvier car chaque époque géologique se caractérise précisément par l’adaptation du vivant à son milieu, mais également dans la philosophie zoologique de Lamarck. De telle sorte que la théorie de l’évolution ne constitue qu’une des justifications possible de l’impératif d’adaptation.
Il nous reste, pour conclure notre raisonnement, à envisager le corollaire de l’extension du domaine de l’adaptation qui prend pour nom, aujourd’hui, «transformation digitale [= cybernétique, ni plus ni moins] de la société» mais poursuit le mouvement initié par l’industrialisme saint-simonien. C’est évidemment le droit qui se trouve exposé en première ligne, dans la mesure même où Saint-Simon considérait, déjà à son époque, le système législatif comme une abstraction métaphysique de l’ancien monde. Il en résulte alors deux issues logiques : soit le droit «classique» disparaît – par exemple, le recours de plus en plus fréquent à la négociation et à l’arbitrage court-circuite la loi et la médiation institutionnelle –, soit il se soumet à la nouvelle norme en vigueur, l’adaptation ou l’efficacité, qui se substitue alors à son ancienne raison d’être, la justice – par exemple, l’évaluation de l’activité d’un tribunal en fonction d’indicateurs quantitatifs. Les deux sont d’ailleurs loin d’être incompatibles, ainsi qu’en témoigne, par exemple, la théorie des parties prenantes (18) qui représente aujourd’hui le fer de lance de la gouvernance.
Concluons, pour donner encore un peu plus de force à nos propos, sur cet exemple de la théorie des parties prenantes en nous appuyant sur cette citation d’Yvon Pesqueux : «La «partie prenante» fonde son omniscience par rapport à des normes qui lui sont propres [les intérêts du groupe représenté], omniscience légitimée au nom du principe de liberté et de la légitimité accordée à la proximité, ce qui déclasse d’autant l’omniscience générale des pouvoirs publics de l’État administratif, ramené au simple statut de «partie prenante»» (19). Ce qui se joue, au fond, dans l’apparition de la Responsabilité Sociale, c’est la substitution progressive d’un modèle à un autre : la centralisation de l’État, fondée sur la souveraineté et assurée par la Loi, s’efface devant une régulation décentralisée et réticulaire dont l’organisation, sous la forme privilégiée de l’entreprise, devient le cœur, peut-être même l’âme. C’est là ce que précisément Alain Supiot qualifie comme étant le passage «du gouvernement à la gouvernance» : et si le premier se caractérise par l’administration juridico-politique des lois, la seconde renvoie à un «magistère technoscientifique» (20), c’est-à-dire à un pilotage issu de la cybernétique (21). Autrement formulé, la régulation, c’est-à-dire l’adaptation à l’environnement, dame le pion à la législation et à la réglementation.
Notes de la troisième et dernière partie
(1) Les actes des Conférences Macy sont disponibles depuis peu : Cybernetics. The Macy Conferences 1946-1953. The Complete Transactions (Zurich-Berlin, Diaphanes, 2016). Quant à leur histoire, elle se trouve relatée dans l’ouvrage suivant : Steve Joshua Heims, The Cybernetics Group (Cambridge, Massachussetts, The MIT Press, 1991).
(2) Jérôme Segal, Le Zéro et le Un. Histoire de la notion scientifique d’information au 20e siècle (Éditions Syllepse, coll. Matériologiques, 2003), p. 4.
(3) Claude Shannon, «A Mathematical Theory of Communication», The Bell System Technical Journal, Vol. 27, 1948, p. 379.
(4) Norbert Wiener, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains (trad. Pierre-Yves Mistoulon, Éditions du Seuil, coll. Points Sciences, 2014), p. 124.
(5) Ibid., p. 125.
(6) Ibid., p. 50.
(7) Loc. cit.
(8) Norbert Wiener, La cybernétique. Information et régulation dans le vivant et dans la machine (trad. Ronan Le Roux, Robert Vallée et Nicole Vallée-Lévi, Éditions du Seuil, coll. Sources du savoir, 2014), in n. 28, p. 287.
(9) Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener, Julian Bigelow, Behavior, Purpose and Teleology, in Philosophy of Science, 1943, Vol. 10, n°1, p. 19.
(10) Norbert Wiener, La cybernétique. Information et régulation dans le vivant et dans la machine, op. cit., p. 191.
(11) Ibid., 192.
(12) Norbert Wiener, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains, op. cit., pp. 91-92.
(13) Jean-Pierre Dupuy, Aux origines des sciences cognitives (La découverte, coll. Sciences humaines et sociales, 1999), pp. 34-35.
(14) Céline Lafontaine, L’empire cybernétique : des machines à penser à la pensée machine (Éditions du Seuil, 2004).
(15) Maxime Ouellet, La révolution culturelle du capital. Le capitalisme cybernétique dans la société globale de l’information (Québec, Les Éditions Écosociété, 2016).
(16) Baptiste Rappin, Au fondement du Management. Théologie de l’Organisation, Volume 1 (Nice, Éditions Ovadia, coll. Chemins de pensée, 2014); De l’exception permanente. Théologie de l’Organisation, Volume 2 (Nice, Éditions Ovadia, coll. Les carrefours de l’être), 2018). Pour une synthèse, voir l’article suivant : Baptiste Rappin, Une brève histoire cybernétique du management contemporain, in La Revue des Sciences de Gestion, n°293, pp. 11-18.
(17) Ludwig von Bertalanffy, Théorie générale des systèmes (trad. Jean-Benoit Chabrol, Dunod, coll. Idem, 2012), p. 192.
(18) Un autre exemple pertinent et d’actualité aurait pu être celui des crypto-monnaies utilisant la blockchain : dans ce cas, le réseau peer-to-peer court-circuite toutes les instances de contrôle, au premier rang desquelles les banques centrales.
(19) Yvon Pesqueux, Gouverner avec ou sans les parties prenantes ?, dans Alice Le Flanchec, Odile Uzan et Michel Doucin (dir.), Responsabilité Sociale de l’Entreprise et Gouvernance Mondiale (Économica, coll. Gestion, 2012), p. 159.
(20) Alain Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit (Éditions du Seuil, coll. Essais, 2005), p. 226.
(21) Ibid. , p. 227.
Lien permanent | Tags : management, philosophie, cybernétique, baptiste rappin, johan n chapoutot, pierre legendre, jérôme segal, nobert wiener, jean-pierre dupuy |  |
|  Imprimer
Imprimer
