« Le masque de la Mort Rouge d'Edgar Allan Poe | Page d'accueil | Órdago d'Álvaro de la Rica »
13/04/2020
L’impératif de l’adaptation : la soumission du droit, de l’économie et du management à l’imaginaire de la biologie moderne, 1, par Baptiste Rappin

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone.Baptiste Rappin a prononcé cette conférence le 10 mars 2020 à l’École doctorale de Sciences Économiques, Juridiques, Politiques et de Gestion (SEJPG) de l’Université Clermont Auvergne. Ce n’est que pour des raisons de commodité de lecture que cette étude a été coupée en trois parties.
Introduction générale : l’émergence d’un soupçon, la construction d’une hypothèse
En premier lieu, et cela tient à la fois des formalités du protocole et de l’expression de ma gratitude, je tiens à remercier chaleureusement le Professeur Dounot pour son invitation à m’exprimer ici, à Clermont-Ferrand, à cette tribune de l’École doctorale des Sciences Économiques, Juridiques, Politiques et de Gestion. Et quand il me formula cette proposition, il me précisa derechef que le conférencier avait pour mission de s’adresser à l’ensemble des disciplines concernées. Une gageure que j’acceptai sur le champ, mais qui posait d’emblée un questionnement méthodologique : fallait-il partir de ma discipline de rattachement, les sciences de gestion, afin d’exposer comment les problématiques qui y sont traitées concernent ses disciplines voisines ? Cette démarche me semblait artificielle tant elle reproduisait les logiques sclérosantes de la segmentation du travail universitaire.
J’optai donc pour un programme plus ambitieux, plus audacieux, peut-être même un poil trop téméraire : il prend pour objectif minimal, pour seuil d’entrée, l’établissement d’un plus petit dénominateur commun et pour idéal la mise en exergue d’un même mouvement métaphysique à l’œuvre dans le droit, le politique, l’économie et le management. Et, pour préciser d’emblée les choses, ce dénominateur commun, ce serait l’intrusion des catégories de la biologie moderne dans les disciplines concernées; quant au mouvement métaphysique, il résiderait en une naturalisation des œuvres culturelles produites par l’esprit humain, au premier rang desquelles les lois de la cité (1).
«Pourquoi la biologie ?», me rétorquerez-vous à juste titre ? Permettez-moi dans ces propos introductifs de me contenter d’un bref constat. Du côté du droit, on note depuis une décennie maintenant la prolifération des formes de droit souple (traduction de l’anglais soft law, parfois encore rendu en français par «droit flexible»), ensemble de chartes, de règlements, de recommandations, de lignes directrices, qui produisent des normes sans force contraignante. Étrangement, la nécessité de la loi et de la règle de droit ne fait pas partie de leur puissance normative. Quant à l’économie, elle ne cesse de recourir d’une part à la notion de flexibilité : flexibilité des prix, flexibilité des marchés, flexibilité des entreprises, pour rendre compte de variations ou de capacités de variation, et d’autre part à la notion d’élasticité pour désigner la variation provoquée par une autre variation (par exemple, le lien entre variation des volumes et des prix). Enfin, les sciences de gestion et le management n’ont qu’un mot à la bouche depuis maintenant deux décennies : l’agilité des hommes, des équipes et des organisations, c’est-à-dire leur aptitude à s’ajuster en temps réel et à innover qui serait synonyme d’avantage concurrentiel pérenne. Qu’il s’agisse de souplesse, de flexibilité ou d’agilité, nous sommes dans chaque cas renvoyé à la mobilité du corps, ainsi qu’en témoigne cette image de couverture de l’ouvrage Le manager agile, écrit par Jérôme Barrand en 2002, qui met en scène un petit singe se déplaçant adroitement de liane en liane (2).
Par conséquent, je souhaiterais dans cette conférence enquêter sur cette intuition d’une pénétration de l’imaginaire de la biologie dans le droit, le politique, l’économie et le management. Je débuterai par trois coups de sonde afin d’ancrer mon hypothèse dans l’histoire et dans l’actualité de l’histoire des idées : le cas du régime national-socialiste pour le droit et le politique; une analyse des fondements philosophiques du néolibéralisme pour l’économie; une généalogie de la résilience pour ce qui concerne les sciences de gestion. Je procèderai ensuite à ce que le philosophe Martin Heidegger nomme un «pas en arrière» (ein Schritt zurück) afin de montrer que l’imaginaire de la biologie est consubstantiel à la révolution industrielle et à la naissance de la société industrielle. Enfin, je m’interrogerai sur sa diffusion hégémonique rendue possible par la cybernétisation et la managérialisation de la société qui conduiraient toutes deux à la régression animale de l’être humain, à la naturalisation du domaine de l’esprit et de l’action, autrement dit : à sa négation. Pour le dire autrement, l’enjeu d’une intrusion de la biologie dans ce que Hannah Arendt nommait «les affaires humaines» n’est rien d’autre que la pérennité ou l’effondrement de la civilisation et de ses structures porteuses.
1 – Du côté des sciences juridiques et politiques : l’imposition de la norme biologique sous le troisième Reich
Pour aborder ce premier temps, nous nous appuierons sur les travaux de l’historien Johann Chapoutot, non pas sur sa dernière publication qui fit grand bruit médiatique mais dont le titre et le contenu m’apparaissent à bien des égards critiquables, je veux parler de Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui (3), mais sur l’ouvrage intitulé La loi du sang et sous-titré «Penser et agir en nazi» qui, plus que sa thèse publiée sous le titre Le nazisme et l’Antiquité (4), me semble constituer le cœur de sa pensée (5).
Quel est le point de départ de Johann Chapoutot ? Il refuse deux explications traditionnelles du phénomène nazi et, notamment, de la solution finale. D’une part, il rejette l’analyse morale voire théologique qui consiste à rendre compte de l’horreur par la présence du mal : les nazis ne furent pas des créatures diaboliques, mais bel et bien des êtres humains comme nous. D’autre part, il critique la thèse de Hannah Arendt selon laquelle la bureaucratie nationale-socialiste aurait créé un tas de petits fonctionnaires serviles ayant chacun accompli leur mission en respectant les procédures. Telle fut d’ailleurs la défense d’Adolf Eichmann lors de son procès : mais plutôt que d’y voir un plaidoyer sincère, Chapoutot y décèle une stratégie de défense mûrement réfléchie (6). Dans les deux cas, recours au mal et à la barbarie ou mise en exergue de la logique bureaucratique, le moteur de l’action collective se trouve masqué : nous autres êtres humains agissons en raison de croyances, en raison de notre adhésion à une vision du monde, en raison d’un octroi de légitimité à une instance tierce, en raison de notre soumission à la «Référence» car, comme le rappelle Pierre Legendre, «une humanité ne peut être organisée […] sans l’institution d’un espace où ça sait, où ça sait absolument» (7).
Et quelle est donc cette Référence brandie par les nazis ? Lisons ici l’historien, au moment même où il formule son projet : «Pour savoir quoi faire, comment agir et pour quelles raisons vivre, tout un corpus nazi de textes, de discours et d’images s’élabore qui enjoint à se tourner vers ce qu’il y a de plus concret, de plus intime, de plus tangible : dans un contexte où les idées se contredisent et se valent toutes, où les religions s’anathémisent entre elles, il reste comme recours et référence le sang, la chair, la "race". La substance biologique a en outre l’avantage de ne pas être strictement individuelle : elle est partagée par les membres d’une même famille, d’une même "communauté", d’une même "race" – membres vivants, morts et à venir. La préservation et le développement de cette substance offrent une fin claire et aisément compréhensible, constituent une communauté et donnent un sens à la vie de l’individu» (8).
La vie, durant le troisième Reich, s’est imposée comme ultime valeur, comme norme suprême, se trouvant ainsi à l’origine de tous les discours normatifs, qu’ils soient politiques, juridiques, éthiques, médicaux, économiques ou encore esthétiques. Par exemple, dans le cas du droit, le primat de la vie, de sa fluidité, de son élan, a pour corollaire la dévalorisation de l’ensemble des sources écrites – les codes, les traités, les décrets, etc. –, par définition abstraites et coupées du réel, qui figent et fixent les lois dans le marbre au risque de nuire à leur potentiel d’adaptation à l’environnement et à ses mutations. C’est de ce travers issu de la sclérosante tradition romaine et catholique – donc juive – qu’il faut se débarrasser en ressuscitant les pratiques juridiques germaines; cette opération se déploie plus précisément dans deux directions : d’une part, en supprimant les catégories individualistes du droit romain («chose», «personne»…) et en accentuant le caractère communautaire du droit nazi (à travers le droit foncier, la modification des règles de l’héritage, etc.); d’autre part, en confiant au juge le rôle de «faire vivre le droit» (9) car, devant l’impossibilité (et la contradiction logique qu’il y aurait à le faire) de formaliser un nouveau droit, c’est à lui que revient l’exercice d’interprétation des textes existants à l’aune de la vision du monde nazie.
Toutefois, dans le cadre de cet article, ce n’est pas tant l’incroyable puissance normative de cet ensemble de discours qui touche à la fois le droit, les relations internationales, la procréation, l’alimentation, le sport, l’extermination des Juifs, etc., que nous voudrions mettre en exergue, que la généalogie de cette thèse radicale et proprement moderne que la vie puisse constituer une norme ultime (c’est-à-dire le fait, un droit sacré) pour les collectivités humaines. C’est en effet le darwinisme social qui constitue l’arrière-fond de cette vision du monde; de ce point de vue, nature et culture sont régies par les mêmes lois, celles de la lutte pour la survie ainsi que le résume le théoricien nazi Falk Ruttke : «Le national-socialisme est une vision du monde qui embrasse tous les domaines de la vie. À ses yeux, la vie est une confrontation entre la race et son environnement. Il professe que notre planète n’occupe aucune place particulière dans l’univers et que l’homme n’est qu’un être vivant parmi d’autres» (10). Partageant avec les penseurs antispécistes le postulat d’une égalité des espèces, les nazis en tirent, quant à eux et contrairement aux premiers, la conséquence de l’impératif de performance : toute la communauté allemande doit être orientée vers l’efficacité afin que la race aryenne puisse non seulement survivre mais également triompher de son ennemie juive. C’est dans ce cadre-là qu’il faut comprendre l’intérêt de certains dignitaires, et plus particulièrement de Reinhard Höhn, pour les méthodes d’organisation et le management (11).
2 – Du côté des sciences économiques : la genèse du néolibéralisme
Après avoir parcouru les recherches de Johann Chapoutot, je voudrais à présent m’attarder sur la dernière publication de Barbara Stiegler (12), que nous devons derechef inscrire dans une lignée de travaux récents portant sur les origines du néolibéralisme, et sur la prise de conscience, tardive, de l’importance qu’y joua en particulier un homme : Walter Lippmann. Plus précisément, Pierre Dardot et Christian Laval ont montré, dès 2009 dans La nouvelle raison du monde, toute l’importance du «colloque Lippmann», qui se tint en 1938 à Paris, dans la genèse du néolibéralisme d’après-guerre; pour leur part, Jurgen Reinhoudt et Serge Audier ont consacré en 2018 un ouvrage entier à l’analyse de cet événement, intitulé The Walter Lippmann Colloquium. The Birth of Neo-Liberalism. Barbara Stiegler complète ces études en ne se penchant plus sur le «pendant» ou sur l’»après», mais sur l’»avant» : car si un événement scientifique est organisé dont l’objet est de renouveler le libéralisme à partir de l’œuvre d’un penseur, en l’occurrence La cité libre de Walter Lippmann, c’est que ce penseur jouissait déjà d’une forte réputation avant même le colloque de 1938. De quoi justifier, par conséquent, cette enquête de plus de trois cents pages.
Quel est au fond l’enjeu principal ? Il s’agit en réalité de lever un certain nombre de confusions qui assimilent, bien trop hâtivement, libéralisme, capitalisme, économie néoclassique et néolibéralisme. Plus particulièrement, on sait depuis les travaux de Michel Foucault que si le libéralisme classique se fonde sur un naturalisme spontané qui fait confiance aux penchants naturels pour assurer le bon fonctionnement du marché et de la société, le néolibéralisme, tout au contraire, n’hésite pas à recourir à l’artifice étatique pour réguler ces comportements. Faut-il pour autant en déduire que le néolibéralisme est un artificialisme ? Assurément non : et tout le travail de Barbara Stiegler de précisément consister à mettre en exergue ses racines biologiques issues de la révolution darwinienne.
Walter Lippmann subit l’influence de Graham Wallas, qui fut le théoricien de la Great Society et dont il suivit le séminaire à Harvard en 1910. Pour ce dernier, la révolution industrielle a complètement chamboulé les relations de l’homme et de son environnement, engendrant un décalage sans précédent qui ne peut plus être comblé par une adaptation, lente, graduelle et progressive, à la manière de l’évolutionnisme darwinien. Et contrairement à Herbert Spencer qui concevait l’adaptation de manière passive et subie, c’est-à-dire purement mécanique, Wallas assume que la tâche de la civilisation consiste justement à modifier l’environnement, à créer des conditions qui correspondent aux dispositions existantes et actuelles de l’homme. Le volontarisme supplante la passivité, l’adaptation change de cible : non plus l’être humain et ses capacités, mais son milieu. Voici un renversement de perspective qui retient toute l’attention de Walter Lippmann et justifie son projet d’une démocratisation de la société industrielle dont l’horizon est la coopération; mais il convient à cette fin de cesser de prendre le travailleur pour une simple force de travail, ce qui n’est rien d’autre que de le réduire au statut de machine, et plutôt de l’envisager comme un collaborateur, comme un partenaire – une «partie prenante» dirait-on de nos jours – qui fait partie intégrante de la fabrique de l’intelligence collective. Mais ce programme revient à changer les mentalités des organisations industrielles : le rôle de l’éducation y est par conséquent prépondérant, mais non plus entendue à la façon des Lumières comme le processus de formation du jugement, mais bien comme l’acquisition d’une nouvelle façon d’agir et de se comporter dans la nouvelle société des grands ensembles industriels (13).
Aussi, si l’éducation devient une tâche prioritaire, alors il n’est guère étonnant que Walter Lippmann ait accordé un intérêt si prononcé pour les experts qu’il charge d’œuvrer à la «manufacture du consentement» (expression que Noam Chomsky reprendra plus tard à son compte). En effet, au sein d’un monde devenu complexe, le ressort démocratique de la représentation s’avère irrémédiablement dépassé en raison de son inefficacité : de telle sorte qu’une autorité indépendante et objective devient nécessaire pour informer les consciences et fournir aux décideurs l’ensemble des données requises à la bonne conduite du pays. En d’autres termes, la nouvelle démocratie que promeut Lippmann ne relève plus du politique, puisque la question de la souveraineté se trouve de fait évacuée : la source du pouvoir n’est plus le peuple, mais la science dont les résultats sont détenus et transmis aux élus par des experts. Mais il ne suffit pas d’influencer les décideurs sur le fond : encore faut-il leur donner les armes nécessaires à la fabrique du consentement au sein du peuple. C’est la raison pour laquelle les sciences humaines occupent une place centrale dans ce dispositif; citons ici Barbara Stiegler commentant Public Opinion (1922) : «Il s’agit d’une nouvelle forme d’expertise, que seules peuvent fournir les sciences humaines en général et la psychologie en particulier. Son rôle d’indiquer aux dirigeants comment gouverner la masse statique, amorphe et hétérogène de la population, rigidifiée par ses stéréotypes, en la conduisant dans la bonne direction : celle d’une réadaptation à son nouvel environnement, mobile, imprévisible et mondialisé» (14). Aussi constate-t-on que la refonte du libéralisme, et sa mue en néo-libéralisme, procède moins d’une hégémonie des sciences économiques et de la théorie néo-classique, que d’une promotion des sciences humaines dont la mission n’est plus de rendre compte de l’action, individuelle et collective, que de transformer cette action afin de réadapter l’espèce humaine à son nouvel environnement.
Néanmoins, si l’espèce humaine ne peut, en raison de sa finitude cognitive, s’ajuster en temps réel à l’évolution de la société industrielle, cela signifie alors que son rythme d’adaptation sera graduel, incrémental, à la manière de l’évolution darwinienne. Pour la tradition néolibérale, il revient alors au droit d’assurer le perfectionnement progressif des règles; Louis Rougier, cité par Barbara Stiegler, synthétise parfaitement : «Être libéral […] [c’est] être essentiellement progressif dans le sens d’une perpétuelle adaptation de l’ordre légal aux découvertes scientifiques, aux progrès de l’organisation et de la technique économiques, aux changements de structure de la société, aux exigences de la conscience contemporaine» (15). Somme toute, le laisser-faire est une fiction métaphysique; en réalité, le libéralisme n’a pu se développer et s’imposer qu’en raison de l’interventionnisme de l’État qui, par le droit, fixe le cadre et les règles du jeu. De ce point de vue, le droit lui-même change de nature : il n’est plus tant un ensemble de lois légitimes visant le bien commun, qu’un outil pragmatique d’adaptation de l’espèce humaine aux multiples évolutions de son milieu : telle est la thèse de La cité libre (1937) dont Hayek retint la leçon. Il s’ensuit assez naturellement une judiciarisation des rapports sociaux, processus au cours duquel les tribunaux se substituent au Parlement pour devenir le principal lieu de régulation du corps social, chaque décision constituant une petite étape dans le procès d’ajustement de l’homme à la société industrielle.
3 – Du côté des sciences de gestion : une généalogie de la résilience (16)
Venons-en aux sciences de gestion, et nous choisissons ici pour illustration de notre thèse le concept de «résilience». Si celui-ci se trouva popularisé auprès du grand public par le psychiatre toulonnais Boris Cyrulnik (17), il trouve également un écho dans le domaine du management dans la mesure où il apparaît comme la promesse d’une résistance aux multiples crises qui secouent les organisations. Mais d’où vient ce concept et que signifie-t-il au fond ?
En la matière, c’est le très beau travail d’Amélie Nillus (18), son mémoire de Master 1 intitulé Généalogie du concept de résilience, qui nous sert de guide; car il s’agit, à notre sens, de l’étude conceptuelle la plus sérieuse menée sur ce sujet. Si l’étymologie latine du terme (resilere) dirige l’interprétation dans deux directions, d’une part celle du saut en arrière, d’autre part celle de la rétractation (comme dans le cas de la résiliation d’un contrat), force est toutefois de constater que son utilisation scientifique est liée à la Révolution industrielle et au développement des sciences modernes qui y sont associées. La physique des matériaux fait office de pionnière : ici, la résilience désigne en premier lieu l’une des formes de résistance à une action externe, sens que l’on peut encore déceler derrière les expériences de crash test automobile. Il s’agit plus précisément de situer le point de non-retour du matériau étudié, car la contrainte trop forte vient à bout de la résistance et conduit à la fracture. Toutefois, comme le précise utilement Amélie Nillus, pour Thomas Young qui le premier utilise le terme de résilience, il existe deux types d’action externe et deux types de réaction associée : d’une part, la pression constante qui met à l’épreuve la solidité du matériau, d’autre part, l’impulsion qui sollicite la capacité de résilience du corps concerné. En d’autres termes, dès ses origines, la résilience désigne un type de réaction bien identifié qui correspond à l’aptitude à faire face à un choc, c’est-à-dire à une force soudaine qui déstabilise l’équilibre du repos et de la pression constante. De telle sorte que l’urgence, sa temporalité, sa violence, paraît consubstantielle au concept de résilience.
Une telle définition de la résilience ouvre alors la porte à deux voies de recherche principales. La première s’enquiert des conditions extérieures, étudiant les différents types de force, les variétés d’impact, s’attachant à dégager des idéaux-types situationnels. La seconde, quant à elle, portera à rebours sur l’analyse des propriétés et des formes des matériaux. En particulier, Henry Moseley s’attachera à mettre en évidence l’élasticité des corps, c’est-à-dire leur capacité à retrouver leur position après avoir subi une déformation due à l’action d’une force externe. Cette évolution est importante, car elle impose encore largement à la résilience son sens contemporain : ce n’est plus en effet la fracture qui constitue le point-limite du matériau résilient, mais l’impossibilité de retrouver sa forme originelle.
C’est en premier lieu de cette propriété élastique, et notamment celle des poumons, dont s’empare la biologie du XIXe siècle. Malléable, l’organe respiratoire retrouve sa forme après chaque expiration : de ce point de vue, la résilience recouvre parfaitement la définition qu’en donnait la physique des matériaux. Relativement discret durant le XIXe siècle, le concept va alors s’enrichir d’une nouvelle dimension qui se substitue à la notion physique de résistance : celle de l’adaptation qui traduit la permanence des fonctions biologiques indispensable à la survie de l’organisme, ainsi que le maintien de l’équilibre corporel, que Walter Cannon baptisera plus tard du nom «homéostasie». Comme le rappelle Amélie Nillus, Herbert Spencer est l’un des premiers à explorer cette veine, mais le concept sera repris dans les études portant sur le stress («syndrome général d’adaptation») et également étendu aux problématiques écologiques.
Que retenir de ce bref descriptif généalogique de la résilience ? De quelles couches sédimentaires cette dernière est-elle déjà chargée lorsqu’elle émigre vers la psychologie et les sciences humaines ? Il nous semble que les trois éléments suivants constituent le noyau commun de la résilience : tout d’abord, la résilience est la réaction à une force soudaine et intense (un décès, un cyclone, une fusion, etc.); ensuite, elle désigne une aptitude à l’élasticité du système concerné, que celui-ci retrouve son fonctionnement initial ou qu’il en invente de nouvelles modalités (phénomène d’apprentissage); enfin, elle représente la dynamique même de l’adaptation à l’environnement et à ses multiples dimensions et contraintes. Bref, elle est, au fond, l’autre nom de l’avantage sélectif.
En dernier lieu, notons que la résilience nous semble correspondre, ni plus ni moins, à une réactualisation de l’approche systémique. Cela est tout d’abord vrai d’un point de vue opérationnel car les méthodologies préconisées recommandent toutes d’identifier les paramètres en jeu, leurs interrelations, le lien de l’organisation avec son environnement, son mode de fonctionnement à l’équilibre, etc. Mais cela se constate également quand les auteurs partent en quête de fondements théoriques à la résilience : ainsi Guy Koninckx et Gilles Teneau (19) se réfèrent-ils non seulement à la Théorie générale des systèmes du biologiste allemand Ludwig von Bertalanffy, qui étudie la régulation homéostatique des systèmes ouverts, mais également aux travaux d’Ilya Prigogine qui mettent en évidence la possibilité pour un système de survivre loin de son point d’équilibre initial. Dans les deux cas, l’approche systémique substitue à la simplicité de la causalité linéaire la complexité d’une étiologie circulaire et multifactorielle; elle vise en outre à s’assurer que les stratégies choisies se trouvent en adéquation avec la nature de l’environnement.
Notes de la première partie
(1) Remarque : quand je parle ici d’«œuvres culturelles produites par l’esprit humain», je ne souhaite en aucune façon prendre présentement parti dans le débat qui oppose droit objectif et droit subjectif, droit naturel et droit positif, mais plus simplement signaler que l’établissement de lois, c’est-à-dire d’un ordre symbolique, me semble le propre de l’animal humain.
(2) Jérôme Barrand, Le manager agile. Vers un nouveau management pour affronter la turbulence (Dunod, coll. Progrès du Management, 2006). L’auteur n’hésite pas à faire de Tarzan, le héros d’Edgar Rice Burroughs, le modèle du manager : «Le talent particulier de Tarzan est avant tout d’être sensible aux signaux pertinents dans la jungle, univers d’ombres et de «bruit», univers de turbulence fait de menaces d’espèces concurrentes et d’opportunités végétales et animales ! Son talent a alors été d’inventer tous les jours des solutions innovantes pour survivre puis de trouver un équilibre et surtout de communiquer malgré tout avec tous les acteurs de son environnement […]» (p. XX). Sauf mention contraire, le lieu d’édition est toujours Paris.
(3) Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui (Éditions Gallimard, coll. nrf essais, 2020).
(4) Johann Chapoutot, Le nazisme et l’Antiquité (Presses Universitaires de France, coll. Quadrige, 2012).
(5) Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi (Éditions Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2014).
(6) Johann Chapoutot, La révolution culturelle nazie (Éditions Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2017), p. 215-228.
(7) Pierre Legendre, Leçons II. L’empire de la vérité. Introduction aux espaces dogmatiques industriels (Fayard, 2001), p. 38.
(8) Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, op. cit. , p. 22-23.
(9) Ibid., p. 173.
(10) Cité par Johann Chapoutot, ibid. , p. 201.
(11) Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, op. cit. , p. 77-91.
(12) Barbara Stiegler, «Il faut s’adapter». Sur un nouvel impératif politique (Éditions Gallimard, coll. nrf essais, 2019).
(13) On notera qu’Elton Mato, auteur phare de l’école dite des «relations humaines», expose le même raisonnement dans son ouvrage The Social Problems for an Industrial Civilization (London, Routledge & Kegan Paul, coll. International Library of Sociology, 1975) : la barbarie de la PremièreGuerre mondiale, et la crise de civilisation de façon plus générale, seraient dues à une inadaptation de l’espèce humaine à son nouvel environnement industriel; d’où l’urgente nécessité de la formation et de la mise à jour des compétences sociales.
(14) Ibid. , p. 65.
(15) Ibid. , p. 197.
(16) Nous avons eu l’occasion d’accorder un plus long développement à cette analyse dans la communication suivante : Au régime de l’adaptation : la résilience, le changement et l’empreinte de la biologie moderne sur le management contemporain, in Congrès de l’Institut Psychanalyse et Management, 2019.
(17) Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur (Éditions Odile Jacob, 2002).
(18) Amélie Nillus, Généalogie de la résilience, Mémoire de Master 1 «Histoire de la Philosophie», soutenu à l’ENS Lyon sous la direction du Professeur Samuel Leze, 2018.
(19) Guy Koninckx et Gilles Teneau, Résilience organisationnelle. Rebondir face aux turbulences (Bruxelles, Éditions De Boeck, coll. Manager RH, 2010), p. 21 et sq.





























































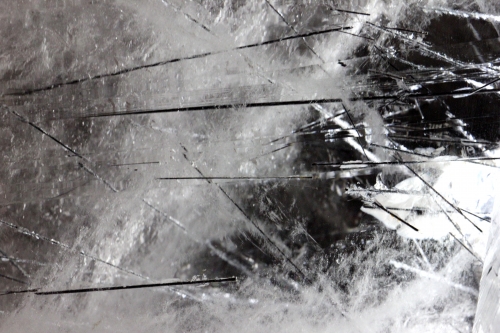

 Imprimer
Imprimer