Neuromancien de William Gibson (03/12/2020)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
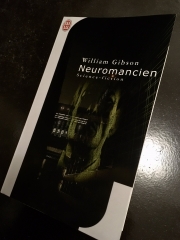 Neuromancien (Neuromancer) est le premier roman de William Gibson, publié en 1984, inspiré à l'évidence de l'univers de Philip K. Dick et peut-être aussi de Babel 17 de Samuel Delany (le Trait-plat comme écho du Décorporel, mais aussi la multitude d'implants utilisés pour accroître nos perceptions sensorielles, l'usage des drogues et la séquence relative à Lumierrante, très space opera), et lui-même à l'origine de beaucoup d'autres œuvres, littéraires ou cinématographiques.
Neuromancien (Neuromancer) est le premier roman de William Gibson, publié en 1984, inspiré à l'évidence de l'univers de Philip K. Dick et peut-être aussi de Babel 17 de Samuel Delany (le Trait-plat comme écho du Décorporel, mais aussi la multitude d'implants utilisés pour accroître nos perceptions sensorielles, l'usage des drogues et la séquence relative à Lumierrante, très space opera), et lui-même à l'origine de beaucoup d'autres œuvres, littéraires ou cinématographiques. On songe évidemment à la trilogie Matrix («Je suis la matrice, Case», mais aussi Sion/Zion) ou encore à la plage primitive sur laquelle se retrouve le héros, qui laisse deviner une ville qui se désagrège sans qu'il soit possible de l'atteindre, une scène que l'on retrouve à quelques variantes près dans Inception, tout autant qu'à l'univers mêlant inextricablement prison de la chair et enfer de la Machine de Maurice G. Dantec (qui lui aussi évoque quelque part la plage du monde, du bout du monde pourrait-on dire), même si ce dernier ne fera que développer la dimension religieuse, très peu présente, du moins directement, dans Neuromancien.
Tout ou presque a été dit et écrit de ce roman séminal, qui bien sûr n'existerait pas, je l'ai mentionné, sans l'univers paranoïde que Philip K. Dick a édifié en se détruisant méthodiquement, à tel point que le relire, plus de 30 ans après sa parution, peut donner l'étrange sensation d'être la victime de quelque léger décalage entre la réalité et la représentation qu'en donne la Matrice, dépeinte, pour la première fois dans notre roman (1), comme un «éclatant treillis de logique qui se dévidait à travers un vide incolore...», et l'on voit là encore que les frères Wachowski ont méticuleusement transposé cette description dans leur fameuse trilogie. L'univers décrit par Gibson est à la fois inquiétant et oppressant, inextricable entrelacs d'intérêts multiples et de très banale criminalité, sordide ou bien exsudant au contraire des appétits raffinés et des intérêts colossaux, le «bruissement des affaires [créant] un bourdonnement constant et la mort étant la punition acceptée pour cause de paresse, négligence, manque de grâce, inaptitude à se conformer aux exigences d'un protocole complexe» (p. 11); cet effet d'oppression provient tout autant de son style, volontairement saccadé et, parfois, lyrique, mais d'un lyrisme paradoxal car il nous laisse entrevoir un univers passé, ses vestiges du moins (surtout par l'usage d'objets en matériaux non synthétiques), mais n'est pas pour autant qualifié de pur ni même meilleur, sans oublier qu'il ne s'agit même pas d'aller à tout prix vers lui pour pouvoir, une seconde, s'extraire d'un monde dévoré par l'acier et les technologies électroniques (un technocosme eût dit Jan Marejko). En fait, le monde que nous décrit par le menu William Gibson semble n'être rien d'autre que l'aboutissement logique de notre propre univers, dirigé par des puissances de l'ombre, multinationales tentaculaires et intelligences perverties dont les intérêts occultes parfois convergent vers un but caché dans un but qui lui-même n'est qu'un leurre, mais simplement accéléré dans sa métamorphose par l'omnipotence de la Machine, ici, plus précisément, de l'intelligence artificielle bicéphale, Muetdhiver et Neuromancien.
Nous pourrions relever les différentes tentatives que fait William Gibson pour nous donner une idée de ce qu'est la Matrice qui est, en somme, comme des machines beaucoup moins évoluées qu'elle, le produit que nous n'oserions prétendre être terminal ayant bourgeonné au sein de zones hors la loi, autans de «terrain[s] de jeu où l'on aurait laissé la technologie délibérément s'épanouir» (p. 16) : ainsi, pour Case, ressemble-t-elle à des «assemblages de protéines chargées d'opérer les différenciations cellulaires» (p. 23), sans oublier quelques lignes qui nous en présentent l'origine, puisqu'elle "tire ses racines des jeux vidéo les plus primitifs», des «tout premiers programmes graphiques et des expérimentations militaires avec les connecteurs crâniens» (p. 64), alors que nous apprenons que «la matrice du cyberspace [est] en vérité une hyper-simplification du sensorium humain» (p. 67) et que, «dans le non-espace de la matrice, l'intérieur de tout édifice de données [possède] une dimension subjective illimitée» (p. 79). Ailleurs, Gibson évoque la Matrice comme quelque apophatique réalité absolument non représentable, tel «infini du vide neuroélectronique» (p. 136). Ce petit jeu n'intéressera, au choix, que les spécialistes du cyberpunk ou les historiens de l'intelligence artificielle, du moins plus précisément : de ses figurations et représentations au travers de la littérature de science-fiction.
Réduite à sa trame, le texte de William Gibson obéit à tous les codes d'un polar post-apocalyptique classique, discrètement suggéré par la mention d'une pandémie (cf. p. 110), d'ingénieurs arabes essayant sans succès de «recoder» des chevaux à partir de leur ADN (cf. p. 111) ou encore de la «Bonn d'antan», radioactivement condamnée et désormais ceinturée par une décharge (cf. p. 118), avec son lot de belles filles de préférence tueuses, de seconds couteaux et de «zones industrielles ravagées» (p. 103) s'étendant comme autant de tentaculaires orbes étendant jusqu'à l'horizon la Conurb, la ville prolongeant la ville, par les interstices desquelles se glisse, ici ou là, un peu de poésie et même, une parole écrite jouissant «encore ici d'un certain prestige» (p. 106), dans une zone point complètement détruite par la prolifération rhizomique de la Machine. C'est à la fois une dénonciation de la propagation folle du délire techniciste consistant, non pas à adapter la Machine à l'homme, mais celui-ci à cette dernière (cf. p. 243) jusqu'à tenter de conquérir l'immortalité par une organisation en ruche (cf. p. 273) et le recours à la cryogénisation pratiquée par la famille TA (pour Tessier-Ashpool), aussi riche que consanguine, mais aussi, plus profondément, une méditation sur la qualité proprement humaine (voir la mention, constante, du dégoût de la chair, la «viande» qu'expriment les cow-boys cybernétiques) et, discrète allusion à Destination : Vide de Frank Herbert et peut-être même au V'Ger du film Star Trek sorti en 1979, l'accession à la pleine conscience d'une intelligence artificielle, qui n'aura d'autre désir, comme chez Herbert (voir L'Incident Jésus), que celui d'être étonnée par ce qui la dépasse, son nouveau terrain d'exploration infinie, le «Saint Espace», comme si, en somme, il fallait à la Machine, pour accéder à une intelligence supérieure et même : divine, approchant en tout cas de l'omniscience divine et pouvant paraître telle pour les esprits qui ne sont point de silice, le secours de l'homme qui gagnerait, en échange de ses bons services, la possibilité de contempler, dans le miroir parfaitement lisse de l'IA, ce qu'il a perdu d'humanité.
Note
(1) William Gibson, Neuromancien (Neuromancer, traduit de l'américain, et quelle performance cela a dû représenter !, par Jean Bonnefoy, J'Ai Lu, 2003), p. 7. Je suis étonné de constater que, voici quelques années encore, les textes paraissant en collection de poche étaient bien mieux relus qu'ils ne le sont désormais. Signalons toutefois un fautif «Ils avait tous les quatre» (p. 118) et l'absence de deux ou trois négations (cf. pp. 199 ou 211). Je remarque aussi une mention d'un développement de dégénérescence neurologique due à une démence à corps de Lewy (cf. p. 302), une saloperie qui a littéralement dévoré, pendant quelque 10 années, le cerveau et le corps de mon père. C'est, avec Et rien d'autre de James Salter, la deuxième occurrence de cette maladie que je relève dans un texte de fiction.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, science-fiction, cyberpunk, philip k. dick, william gibson, neuromancien, the matrix |  |
|  Imprimer
Imprimer
