« La vérité sur le cas de M. Gracq | Page d'accueil | Spectres et trous noirs. Sur La Littérature à contre-nuit, par Jean-Luc Evard »
18/01/2008
Babel 17 de Samuel Delany

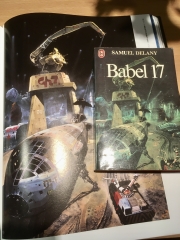 Remise en une d'une modeste note publiée en 2004, consacrée à l'excellent roman intitulé Babel 17 du prodige américain de la science-fiction, Samuel R. Delany. Avec quelques autres romans de Dick, Herbert, Heinlein, Wolfe, Bradbury ou encore Brunner, Babel 17 fait partie d'une petite poignée d'ouvrages que je relis avec plaisir, lorsque j'ai quelques heures de détente à consacrer à ces livres dont le prestige qu'ils avaient à cet âge de mon enfance où je les volais sans vergogne, n'ayant pas d'argent, s'est hélas considérablement estompé.
Remise en une d'une modeste note publiée en 2004, consacrée à l'excellent roman intitulé Babel 17 du prodige américain de la science-fiction, Samuel R. Delany. Avec quelques autres romans de Dick, Herbert, Heinlein, Wolfe, Bradbury ou encore Brunner, Babel 17 fait partie d'une petite poignée d'ouvrages que je relis avec plaisir, lorsque j'ai quelques heures de détente à consacrer à ces livres dont le prestige qu'ils avaient à cet âge de mon enfance où je les volais sans vergogne, n'ayant pas d'argent, s'est hélas considérablement estompé.Qu’est donc, réellement, le langage, pour que le simple fait d’en effleurer la texture, même ridiculement, même superficiellement, nous ouvre des gouffres inexplorés ? D’Héraclite jusqu’à Ferdinand de Saussure, des méditations de la Kabbale jusqu’au Traité des chiffres ou secrètes manières d’écrire de Blaise de Vigenère (ouvrage paru en 1586), innombrables sont les auteurs qui ont interrogé les arcanes du verbe, imaginant une langue capable de signifier véritablement, de coller aux choses, non plus dans un rapport extérieur et imparfait, arbitraire, unissant illusoirement le signifiant au signifié comme Foucault l’analysait, mais dans une incomparable investiture, par des paroles magiques, de la réalité, cette dernière désormais sœur des premières : une langue, pour pasticher George Steiner, devenue – ou redevenue, puisque perdure au travers des âges le mythe d’une langue adamite oubliée – réelle présence. Héraclite pose ainsi l’existence d’un langage, détenu par le «Maître» dont «l’oracle est à Delphes» qui ne «dit ni ne cache mais signifie» tandis que Ferdinand de Saussure se désole que la «loi tout à fait finale du langage est, à ce que nous osons dire, qu’il n’y a jamais rien qui puisse résider dans un terme, par suite directe de ce que les symboles linguistiques sont sans relation avec ce qu’ils doivent désigner […].» (1)
Émile Benveniste a pu parler, à ce propos, du «drame» de Saussure (2) et c’est cette même affliction face au fossé séparant les mots et les choses qui est le motif secret ayant donné naissance à nos plus grands écrivains et poètes.
Babel 17, l’un des meilleurs ouvrages de Samuel Delany, remet au goût du jour le vieux thème d’un langage capable d’agir sur le réel et de façonner directement celui-ci, de façon bien plus crédible et poétique que ne l’ont fait les décevants Langages de Pao de Jack Vance ou même L’Étoile et le fouet de Frank Herbert. Et, parce que la façon la plus radicale de modifier la réalité est selon toutes apparences la violence de la guerre, Babel 17 sera le nom de code donné par les terriens à l’arme qui neutralise les réseaux radio de l’Alliance assiégée, arme conçue donc, en apparence, par les ennemis extraterrestres. Rydra Wong, poétesse surdouée chargée par l’armée de résoudre l’énigme et de neutraliser le langage mystérieux et destructeur pour en livrer ensuite à ses supérieurs l’inestimable puissance, s’embarque à bord du vaisseau spatial Rimbaud, se rendant sur les bases militaires victimes des sabotages orchestrés par Babel 17. Double barrière d’étrangeté autour de la langue secrète : car, si Babel 17 est un langage caché par son lieu de provenance, les lignes ennemies, Rydra Wong va très rapidement comprendre qu’un seul homme est capable d’en maîtriser la phénoménale puissance de destruction. Un seul homme et non quelque savante machine de guerre comme cet androïde-tueur et logocrate inventé par le baron Ver Dorco, le directeur des arsenaux d’Armsedge. Un seul homme, qui s’appelle le Boucher, homme étrange ou plutôt créature étrangère devrait-on dire, murée dans la solitude de l’idiot ou de l’enfant (infans, celui qui n’a pas la parole), puisque le Boucher tue sans éprouver la moindre émotion, puisque la langue bizarre, Babel 17 justement, qu’il parle maladroitement à la suite d’un traumatisme qui lui a fait perdre la mémoire de son passé, ne lui permet pas d’établir la plus petite différence entre «Je» et «Tu». De manière certes un peu forcée, Delany fait bien sûr l’apologie de la différence – on se souvient ainsi de la ligne de partage qui scinde, dans le roman même, les Migrants des Stables ou de cette même thématique érigée comme axe central du complexe et foucaldien roman intitulé Triton –, différence qu’il va s’agir, non pas de combler, mais d’assumer, de prendre en charge, car on ne peut assumer que cela qui est encore, peu ou prou, humain. Et le Boucher, qui certainement est plus proche de la bête que de l’homme, est donc celui-là même qu’il faut parvenir à ramener dans le giron de l’humanité. Et l’amour qu’éprouve pour lui Rydra Wong est cela seul qui, on s’en serait douté, réussira le prodige de cette véritable renaissance du Boucher à l’humanité du langage.
Cette langue inhumaine, délétère, Babel 17, parlée par une presque bête, par une créature qui autrefois fut un homme, va être pourtant apprise par Rydra Wong, au prix exorbitant d’une possible folie, puis rendue tout entière à la sphère d’humanité que la poétesse a su déceler en elle, gardant en mémoire le commandement souverain de Térence selon lequel rien de ce qui est humain ne saurait rester étranger à l’homme, a fortiori au poète, ce gardien de l’homme parce qu’il est gardien du langage. Bien des éléments narratifs, dans notre roman, évoquent ainsi la singulière aliénation de l’homme, la présence d’une entité étrangère et mauvaise, qu’il s’agisse de la situation exorbitée de guerre entre les humains et les extraterrestres jusqu’au fragile dialogue que Rydra Wong tente d’instaurer avec le Boucher, de même que ces vers badins («Quelque part, dans le jardin d’Éden, en ce moment même, un ver… un ver…») qui placent toute l’histoire imaginée par Delany (3) sous la seule lumière d’une quête rédemptrice : celle de l’unité perdue puis retrouvée, de la réconciliation finale entre la bête et l’homme (qui nous permettra de découvrir le mystère du Boucher), de la recomposition de l’androgyne initial – s’il est vrai que Rydra Wong et le Boucher ne sont que les deux moitiés d’une même créature –, quête déroutant, par la seule compréhension et maîtrise d’une langue évoquant nos ténèbres les plus secrètes, l’image grimaçante trop tôt levée dans la pénombre du miroir.
Notes
(1) Notes inédites de Ferdinand de Saussure, in Cahiers Ferdinand de Saussure, n°12, 1954, p. 58.
(2) «Ce silence cache un drame qui a dû être douloureux, qui s’est aggravé avec les années, qui n’a même jamais trouvé d’issue», in Benveniste, Problèmes de linguistique générale (Gallimard, 1966), p. 37.
(3) Je ne comprends toujours pas par quel mystère d’aveuglement quelque réalisateur américain (de grâce, uniquement américain, à tout le moins anglo-saxon ; que l’on nous évite le drame d’une adaptation débile par Kassowitz, Besson ou… Bilal) n’a pas encore décidé de porter à l’écran le roman de Delany, ouvrage qui se distingue pourtant par ses incomparables et évidentes qualités visuelles ainsi que par une trame narrative qui paraît presque avoir été pensée dans le but de faciliter une adaptation cinématographique.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, science-fiction, samuel delany, babel 17 |  |
|  Imprimer
Imprimer


























































