L’impardonnable sprezzatura de Cristina Campo : celle qui souffrait en nous sauvant, par Gregory Mion (21/05/2022)

Crédits photographiques : Wong Maye (EAP).
 Cristina Campo dans la Zone.
Cristina Campo dans la Zone.«Et nous devons enfin peindre des croix dans nos âmes, c’est-à-dire assumer les macérations de la pénitence.»
Jacques de Voragine, La légende dorée.
«Dieu nous garde du malheur de l’envieux qui nous envie.»
Naguib Mahfouz, Impasse des deux palais.
«Ne siège pas avec ceux qui ricanent.»
Psaumes (premier d’entre les Psaumes, cité par François Esperet dans Heureux est l’homme).
Qui sont les impardonnables ? Portrait de celles et ceux que la civilisation n’aurait jamais pensé à condamner si elle n’était d’abord elle-même immuablement et parfaitement indéfendable
 En admettant que le XXe siècle ne fut que l’instrument d’une force noire dont nous subissons aujourd’hui encore les sordides éclaboussures, une femme telle que Vittoria Guerrini, appelée à devenir Cristina Campo sous les latitudes du Parnasse, ne pouvait que mourir tôt, trop tôt, un catastrophique jour de janvier 1977 à Rome, d’une insuffisance cardiaque officielle et d’une officieuse divergence avec notre monde perdu. Il faut oser croire que sa malformation du cœur a moins été l’œuvre du hasard de la nature que la conséquence nécessaire d’une grande âme originellement blessée, primitivement sidérée, instantanément bouleversée de coexister avec l’ambiance fasciste de l’Italie des années 1920. Tout était peut-être déjà joué, donc, ce 29 avril 1923, lorsque Vittoria Guerrini vint au monde à Bologne, marquée du sceau de ces étoiles prématurément filantes. Elle était d’emblée impardonnable de naître si glorieuse au milieu d’une terre si infamante. Elle était même en quelque sorte la plus impardonnable de ses impardonnables qui décréteront le titre de sa prodigieuse anthologie de textes critiques sur laquelle se fonde tout notre propos (1).
En admettant que le XXe siècle ne fut que l’instrument d’une force noire dont nous subissons aujourd’hui encore les sordides éclaboussures, une femme telle que Vittoria Guerrini, appelée à devenir Cristina Campo sous les latitudes du Parnasse, ne pouvait que mourir tôt, trop tôt, un catastrophique jour de janvier 1977 à Rome, d’une insuffisance cardiaque officielle et d’une officieuse divergence avec notre monde perdu. Il faut oser croire que sa malformation du cœur a moins été l’œuvre du hasard de la nature que la conséquence nécessaire d’une grande âme originellement blessée, primitivement sidérée, instantanément bouleversée de coexister avec l’ambiance fasciste de l’Italie des années 1920. Tout était peut-être déjà joué, donc, ce 29 avril 1923, lorsque Vittoria Guerrini vint au monde à Bologne, marquée du sceau de ces étoiles prématurément filantes. Elle était d’emblée impardonnable de naître si glorieuse au milieu d’une terre si infamante. Elle était même en quelque sorte la plus impardonnable de ses impardonnables qui décréteront le titre de sa prodigieuse anthologie de textes critiques sur laquelle se fonde tout notre propos (1).Redisons-le alors en guise d’hommage appuyé : elle ne pouvait être qu’inexcusable de naissance et même au stade embryonnaire, cette petite fille d’Émilie-Romagne, atipica bambina, aussitôt inadmissible, illicite au tout premier jour tant elle irradiait au moment où tout avait l’air de s’assombrir. Elle tenait dans l’une de ses mains vulnérables, proprio all’inizio, l’encensoir de la beauté dont elle répandait à son insu les divines nuées sur le sarcophage d’une époque qui ne se savait pas morte de bassesse et qui avait l’obscénité de son infecte ignorance. Et plus tard, jusqu’au bout de sa dotation vitale, jusqu’aux dernières limites de sa miraculeuse existence, elle n’eut pourtant jamais «cette cassandresque persévérance des annonciateurs d’apocalypses et de désastres» (2) symptomatique des barons du pessimisme, car, bien au contraire, s’il est arrivé à Cristina Campo de déplorer telle ou telle signature patente de la destruction, elle a surtout travaillé à sauver ce qui pouvait demeurer de beauté parmi les invasions de la laideur – que ce soit par une pratique adamantine de la langue italienne ou que ce soit par son entêtement à vivre dans la foi et une mystique subséquemment développée aux côtés de son compagnon : l’écrivain Elémire Zolla. Dès lors incarne-t-elle une synthèse de puissances spirituelles qui fit un temps obstruction aux funestes éclipses de l’aura et de tous les palladiums afférents. De telle sorte que sa courte vie passée en cohabitation avec le Mal priapique d’un siècle innommable peut se comparer à un rempart, à un produit retardant, à une fragile mais décisive présence qui sut maintenir à distance les trop nombreuses manœuvres du démon. Il est certain qu’elle en a payé une accablante rançon, qu’elle a dû se lamenter, parfois, d’être ultimement différente d’une civilisation en proie aux pires pulsions exterminatrices. C’est pourquoi, au fond, elle a hérité d’un cœur malade et d’une vie de réclusion, de discrétion, de contemplation, mais, conjointement, elle a sauvé le monde, semblable à ces figures sacerdotales qui savent par intuition que ceux qui sont destinés à être des sauveurs sont également ceux qui doivent monter à l’échafaud. En cela elle continue d’être inspirante, d’être ce rai de lumière qui transperce le maximum de la nuit, adressant à chacun de ses lecteurs l’orgueilleuse et ascétique obstination d’une trappiste du sublime, leur inculquant la volonté de talonner la perfection malgré l’avilissement généralisé de l’humanité contemporaine.
Il ne serait d’ailleurs pas du tout exagéré de poursuivre cette apologie de Cristina Campo en soutenant qu’elle évolua peu à peu jusqu’au degré d’une véritable concrétion de grâce. Au fur et à mesure de son parcours de sainteté, elle résolut l’écueil de l’isolement spirituel en trouvant le point de jonction qui unit la solitude à la plénitude, ou, pour mieux l’exprimer, le culminant point de passage où une carmélite accomplie étend son amour singulier à l’échelle de l’universel, faisant de son indécelable présence une intensité planétaire, une espèce d’activité latente et omni-englobante calquée sur l’ubiquité de Dieu. Aussi Cristina Campo était-elle nulle part et partout à la fois (hors des réseaux mondains et au centre de la Création), invisible et néanmoins flagrante, capable de rendre légères les choses pesantes et peut-être même capable de personnifier un modèle de vertu fantasmé par tant de philosophies, l’esampio finissimo qui aurait exaucé le vœu indirect de Kant : tailler tout à fait droit au sein de la nature humaine tout à fait bancale (3). Se déploie ici l’une de ces prédestinations salutaires comme il n’en advient qu’une par siècle et par nation, l’un de ces corps séraphiques aux élytres luminescents qui humilient les crépuscules, l’un de ces astres reliés à d’autres astres par-dessus les temps et les espaces finis, d’où, en toute rigueur, cette parenté a priori nécessaire et a posteriori éternelle entre Cristina Campo et Simone Weil, la première ayant traduit la seconde dans la langue de Dante, puis la seconde ayant engendré la première par les secrets détours d’une insondable métaphysique des archanges.
Ainsi, au-delà du règne physique des cités humaines tentées par les séductions du diable, il convient d’imaginer – ou d’entériner – un règne archangélique où les aberrations d’en bas sont neutralisées par les probités d’en haut. Les lois surnaturelles ne sont pas compromises par les lois contingentes de la plus égarée des humanités, et, de ce fait, quelque bref que fût le voyage terrestre de Cristina Campo, il n’en a pas moins été, à lui seul, da solo, le foyer de relativisation des appétits néfastes. Preuve s’il en est que le sacré ne disparaît pas en dépit des incalculables profanations d’ici-bas, preuve, dans le langage de Cristina Campo, que ceux qui seraient «étrangers au contexte» d’une actualité corruptrice (p. 116), ceux-là, dussent-ils être en minorité persécutée, ne le sont en vérité que par leur plus essentielle appartenance au texte édifiant et inactuel de Dieu, devenant plus prépondérants dans le temps long que toutes les insistances du Mal qui n’ont de crédit que dans le temps court. En étant adossés depuis toujours à l’alphabet des pensées vénérables, ces envoyés du ciel, recrutés par le mystère, s’opposent frontalement ou obliquement aux plus mauvais contextes sociaux. Ils nous indiquent les conditions de possibilité d’une impérative dé-contextualisation de ce qui mortifie le genre humain, les prérequis d’un irrésistible sanctuaire, les éléments d’un impardonnable déracinement de l’inférieur pour nous ré-enraciner dans ce qui est supérieur, pour nous réhabiliter dans ce scrupule de l’éternité qui préoccupa tant l’inimitable mage du Danemark : le fulgurant Kierkegaard. Quelles que soient donc les férocités qui contribuent à justifier des époques de «beauté bannie» (p. 116), quels que soient les certificats de barbarie qui ne nous pardonnent pas de rechercher les sources de la bonté adamique, ces hommes et ces femmes d’exception, sans relâche, irrémissiblement, nous montreront le Nord au milieu de nos égarements. Et quand bien même il est scandaleux que ces dignes éclaireurs ne puissent s’attarder parmi les peuples hallucinés de fausse lumière, soit qu’on les assassine, soit qu’on les marginalise, soit qu’une maladie les emporte en révélant leur inadaptation à l’éther décomposé que presque tout le monde respire dorénavant, il n’en reste pas moins que leur «suprême aristocratie» (p. 100) se sera ici ou là engouffrée, qu’elle aura ménagé un intervalle pour que leurs successeurs apparaissent et réveillent par intermittence la meilleure part d’une fraction des hommes. Il n’y a pas de petites victoires à l’heure des effondrements d’envergure et il est indispensable de se répéter, comme un Ave Maria, que ce qui a réussi dans les raccourcis des horloges temporelles échouera dans les infinis des horloges spirituelles.
Au regard de ce qui précède, on pourrait presque attribuer à Cristina Campo une propension à la rébellion, à savoir, précisément, une faculté innée de résister aux réalités blasphématoires afin de légitimer un idéal de l’ordre juste auquel toute vie pleinement pieuse aspire. Le blasphème commence à l’endroit où la parole de Dieu décroît et il triomphe à l’endroit où cette même parole ne peut plus s’entendre ou n’a jamais été entendue. En tant que missionnaire du Verbe, en tant qu’apôtre de la parole divine mise en chair, Cristina Campo, à la moindre de ses phrases, intervient au chevet des parties du monde les plus décharnées en leur ajoutant – au risque d’être inaudible et illisible – la dimensionnalité qui leur fait défaut. Elle met en valeur «ce qui perdure» (p. 102), ce qui a vocation à s’affilier au substrat des archétypes, et, à l’instar des nobles mandats qu’elle identifie chez Gottfried Benn, lui aussi forcément impardonnable, elle «[creuse] un sillon dans les anciens millénaires» tout en «[prophétisant] sur les cycles les plus lointains de l’avenir» (p. 102). En d’autres termes, elle archaïse ce qu’il y a de plus platement moderne autant qu’elle entonne le renouveau de ce qu’il y a de plus banalement conservateur, rattachant les esprits désorientés aux origines primordiales et inventant des lendemains viables pour nos frères et sœurs encore à naître. Cela procède d’une alliance des morts, des vivants et des individus ultérieurs, de ce que l’on devrait appeler un gouvernement de toutes les présences, en lien, évidemment, avec la pure Présence. Quoi de mieux en fin de compte pour lutter contre les propagandistes de toutes les formes de l’absence ? Quoi de plus efficace pour désarmer l’obscène vacuité du fascisme et sa novlangue pseudo-fédératrice ? Comme les réfractaires que Jünger décrit au zénith de ses Falaises de marbre, comme ces vaillants ennemis de la violence barbare, Cristina Campo façonne une langue surpuissante en piété afin de brandir une parole qui serait similaire à «l’épée magique dont le rayonnement fait pâlir la puissance des tyrans» (4).
Et du reste, pour stationner plus longtemps dans les rafraîchissants quartiers de Jünger, pour continuer d’homologuer la rébellion de l’ottima sacerdotessa, nous songeons bien sûr au Traité du rebelle évoquant cette disposition particulière qui consiste à se déporter hors des sentiers battus, à s’aventurer littéralement ou figurativement dans un fécond désert en vue d’échapper aux agitations mortelles, et, plus expressément, en vue de s’insurger contre les faux progrès qui ont semé une sournoise régression. En stricte anachorète, Cristina Campo connaissait l’inestimable cotation de ces déserts prospères en oasis, elle était imprégnée du silence qui en émane, et, d’ailleurs, elle se réfère à la mystique de l’Islam pour nous remémorer que le désert y est apparenté à une «caverne du cœur» (p. 81). Sans doute alors est-ce au désert ou au sein de notre désert intérieur que l’on est susceptible de progresser vers une déclinaison plus fervente de la résistance (5). C’est en outre l’un des centres névralgiques de la doctrine révoltée de Jünger, une phase qui s’amorce explicitement dans son Passage de la ligne et que l’on sent affleurer un peu partout dans son Traité du rebelle à un niveau accru, ce moment crucial où le désert va se muer en partage érotique, en communion amoureuse à travers laquelle Éros se défait des pressions de Thanatos lorsque la bannière du totalitarisme flotte à des altitudes impies. L’union souveraine de deux subjectivités suffit indéniablement à constituer une citadelle imprenable (6), tout comme elle est prompte, en proportion de son exemplarité, à susciter de plus vastes unions, à faire des émules, élargissant notre champ de vision jusqu’à ces «caves» où l’on «écorche vifs nos frères humains» (7), bousculant notre confort personnel pour nous amener à présager – et à fustiger – la souffrance exorbitante de tous les damnés de la Terre. Or puisque c’est le désamour qui anime le fascisme, puisque ce régime infernal de la politique s’alimente dans toutes les cuisines de la désunion, il ne peut atteindre la sphère exclusive de celles et ceux qui ont adhéré senza condizioni aux sensibles serments de l’amour (que ce soit sous les espèces d’un amour sentimental ou sous les espèces d’un amour humaniste, les deux, chiaramente, pouvant être concomitants). Tels furent Cristina Campo et Elémire Zolla qui savaient pertinemment que le fascisme ne s’était pas décomposé avec les cadavres exhibés de Mussolini et de Clara Petacci, telles furent aussi toutes les affinités sélectives d’hier et telles se déclarent les fastes affinités d’aujourd’hui, telles seront celles de demain, innumérables arches tendues entre des consciences exaltées, arcs-de-triomphe surplombant les ténèbres massives de l’inhumanité forcenée, rien moins que des terres promises impénétrables, des jardins secrets inatteignables pour n’importe quel furieux tentacule de n’importe quel furieux Léviathan étatique.
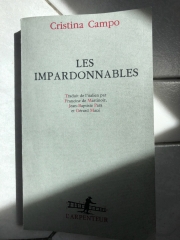 Cette indiscipline vis-à-vis des malédictions matérielles traduit une discipline envers les bénédictions immatérielles qui devraient nous servir de référence à dessein de rapatrier la mesure de Dieu au cœur de la démesure des hommes. Ici même domine l’impertinente silhouette du poète que Cristina Campo sanctifie comme la plus pertinente manière de vivre pour réparer ce qui est désormais quasiment irréparable, pour raccommoder quelques morceaux de ce que Gabriel Marcel eût tristement nommé un monde cassé. Ainsi le poète trône au sommet de l’intimidante région des impardonnables : on lui en veut de ne pas s’avérer compatible avec la parole prédatrice des dictatures, et, par extension et par hypothèse, une fois vaincus les Duces et les Führers, l’opinion écrasée de pacifisme béat le rejette en raison de son inaptitude à rallier le camp des antifascistes (qui ne sont que les séides d’un fascisme capitaliste encore plus nuisible que sa version initiale où l’on pouvait malgré tout deviner une molécule de transcendance).
Cette indiscipline vis-à-vis des malédictions matérielles traduit une discipline envers les bénédictions immatérielles qui devraient nous servir de référence à dessein de rapatrier la mesure de Dieu au cœur de la démesure des hommes. Ici même domine l’impertinente silhouette du poète que Cristina Campo sanctifie comme la plus pertinente manière de vivre pour réparer ce qui est désormais quasiment irréparable, pour raccommoder quelques morceaux de ce que Gabriel Marcel eût tristement nommé un monde cassé. Ainsi le poète trône au sommet de l’intimidante région des impardonnables : on lui en veut de ne pas s’avérer compatible avec la parole prédatrice des dictatures, et, par extension et par hypothèse, une fois vaincus les Duces et les Führers, l’opinion écrasée de pacifisme béat le rejette en raison de son inaptitude à rallier le camp des antifascistes (qui ne sont que les séides d’un fascisme capitaliste encore plus nuisible que sa version initiale où l’on pouvait malgré tout deviner une molécule de transcendance).Autrement dit le poète ne saurait être tranquille où que ce soit, à quelque échelon que ce soit des éons qui ont forgé la galaxie. Son souci superlatif de la beauté le conduit toujours à se dissocier des fascinations populaires, des charismes fantoches, des appels du pied mystificateurs – il ne tombe pas dans les embuscades rusées des idéologies qui essaient de renverser les valeurs du Beau en les confondant aux plaisirs de l’agréable. À l’abrutissement des multitudes, à la confortable grossièreté de tous les millénaires, le poète répond par un esprit de finesse. Il se rend conséquemment «coupable de finesse» (p. 103), accusé d’inactualité, inculpé de crime «de lèse-majesté envers les masses» atomisées (p. 103), tel ce fameux prince de Lampedusa, dissonant monarque insulaire, baron et duc par surcroît, phare du dégringolant pays de Sicile, écrivain poétique fabuleux, inévitable conscrit parmi la lande opprimée des impardonnables. Doté d’une «ironie titanesque» et d’une «prodigieuse indifférence à l’égard des faux problèmes» (p. 103), l’auteur du Guépard est de ces majestés orthogonales qui «[s’éclipsent] du grand bal avec un sourire, une minute avant que les lustres ne scintillent de tous leurs feux» (p. 104), sachant d’un savoir antédiluvien que ce genre de posture sotto i riflettori démasque l’imposture des spécimens dépourvus d’une psychologie vertébrée. À cela s’annexe le poids d’une érudition outrageante (cf. p. 104), l’affront d’un homme des livres et même du Livre au milieu d’une ère d’inculture croissante, une ère où des autodafés ont provoqué des érections appuyées chez certains professeurs ou académiciens réputés. De sorte que Lampedusa, unique en son genre, auréolé de ses incantatoires suprématies, à rebours de notre «civilisation de la perte» et de ses «inventaires de l’horreur» (p. 146), fait assurément partie de ces providentiels topographes «des continents engloutis» (p. 147). Ces vérités pélagiennes qui réverbèrent la netteté des firmaments ne sont accessibles qu’à ceux qui s’expriment depuis «les fonts baptismaux» (p. 158), nageurs à contre-courant qui ne se laissent pas décourager par les torrents de l’abomination dont le débit compromet la vision des abysses et la vision des crêtes, tantôt scaphandriers, tantôt aéronautes, systématiquement proches des révélations qui ne se montrent qu’aux suppliciés des abîmes et des cimes, jamais confédérés aux remous intermédiaires de la médiocrité. C’est là en effet que vécut Guiseppe Tomasi di Lampedusa, très profondément ou très éminemment, souvent des deux manières à la fois, crucifié par la vulgarité, mais magnifique dans ses descentes ou ses élévations, féodal dans ce registre du pèlerin des absolus, rarissime représentant de l’orecchio assoluto à même d’entendre le diapason «d’une cloche d’or parmi tous les carillons de l’Histoire» (p. 158), en l’occurrence la musique de Dieu sous le manteau cacophonique des destins crapuleux et endiablés.
Ces maîtres du gabarit de Lampedusa sont de charitables exorcistes qui parcourent les provinces possédées, s’avisant de «la haine des splendeurs traditionnelles» et de l’immense «impulsion suicidaire» (p. 157) qui se sont emparées de nos semblables. Ces conjurateurs émérites s’acharnent à dénouer toutes les nodosités malsaines qui confèrent à la misère de vivre et aux espérantos de l’Antéchrist, lesquels espérantos (et autres volapüks lucifériens) empêchent la pratique d’une «langue de l’extase» (p. 150) et un traité de la paix intérieure. Mais tant qu’il y aura des hommes et des femmes d’une stature propre aux chevaliers de l’enthousiasme, tant qu’il y aura des cicérones dévolus à la transhumance des alpages intimes, des guides attitrés au déblaiement des chemins aventureux de la purgative «migration intérieure» (p. 267), les désastres du dehors ne seront pas encore assez avancés pour menacer les derniers temples du dedans. Le divorce entre l’empreinte divine qui a marqué tous les hommes et cette même trace divine extériorisée dans la nature ne sera pas tout à fait complet tant que l’on se souviendra que la Terre compta un indissoluble cénobite aggloméré au rocher de Lampedusa, un si performant régisseur des concordes vitales, un être dont l’existence devait probablement sous-entendre l’immédiate coexistence avec «un jeune homme [qui pouvait] encore veiller toute la nuit sur un texte immémorial» (pp. 178-9). Et cet adolescent rivé à je-ne-sais-quel parchemin des annales gnostiques, traversé d’une libido sciendi radicalement introuvable sur les bancs de l’Université, Cristina Campo l’imagine se promener de nuit «dans un colombaire de banlieue» (p. 178), conscient plus que tout autre de ses généreux devanciers, impressionné sûrement par les cendres qui l’entourent et lucide quant à sa responsabilité de ne pas saboter ce moment, de ne pas passer à côté de la chance de lire un texte qui serait le stupéfiant translateur de cette poussière d’humanité. Or ce texte supposément instituteur d’une connaissance ultime, en Italie, on devrait pouvoir le localiser chez le premier de tous les impardonnables transalpins, dans la poésie dantesque, dans cette «langue de Dante [qui se dresse] au-dessus des parlers italiens» (p. 195), cette langue d’entomologiste qui associe les phénomènes autant que leurs élans voilés, une langue capable, donc, de transcrire aussi bien «le bleu inexprimable d’une aile de libellule» (p. 109) que la latitude et la longitude d’une chromatologie prétendument indéchiffrable.
Suppléments déontologiques indexés sur les mirobolantes mensurations de la sprezzatura
Il est clair maintenant que la catégorie des impardonnables érigée par Cristina Campo relève d’une assignation au pardon éternel et qu’elle amnistie celles et ceux qui ont été injustement culpabilisés – voire criminalisés – par une succession de sociétés occidentales hostiles à la beauté. Mais cette caractérisation ne serait pas réellement loyale si elle faisait l’économie de cette notion qui tient une bonne place dans l’œuvre et la vie de Cristina Campo : la sprezzatura (cf. pp. 127-145). Il s’agit d’un terme plurivoque, difficile à restituer, mais il est possible de le rapprocher tour à tour d’une vertu théologale, d’une substance aristocratique et d’une façon de voler au secours de la beauté, une façon d’être à toute heure du jour et de la nuit, in qualsiasi momento, une «aide à la beauté» (p. 127).
À cet égard nous dirons que les dépositaires de la sprezzatura, en toutes leurs actions et en toutes leurs méditations, manifestent un inlassable irrédentisme du Royaume. Ce sont des intelligences brillantes en ce sens qu’elles sont parvenues à dépasser le génie des prières spéculatives pour agir simultanément au plein midi des choses concrètes. À l’exemple de ce que l’on observe dans les usages du christianisme orthodoxe à propos desquels Cristina Campo livre des pages illuminées (cf. pp. 277-286), toute intelligence, nonostante tutto, ne paraît achevée qu’à partir de l’instant où elle a réussi à faire descendre l’esprit dans le cœur. Et à l’issue de cette déférence de l’esprit devant le cœur, tandis que les pouvoirs de l’intelligible ont rejoint les trésors du sensible, l’explosion de la lumière se produit, le cœur vole en éclats photoniques, comme cela est arrivé sous l’œil foudroyé de Nikolaï Motovilov quand saint Séraphin de Sarov a effleuré d’une main humaine la dramaturgie surhumaine de Dieu (cf. p. 284). Selon toute vraisemblance et indépendamment de l’aspect incroyable d’une telle scène, les réalisations de Séraphin de Sarov découvrent l’axe d’une haute et inégalable sprezzatura, et même, mieux encore, les signes de cette mystérieuse force de rétention consignée dans la Deuxième Épître aux Thessaloniciens, lorsque saint Paul aborde l’imperceptible autorité qui contrarie pour l’heure la besogne de Satan, le retenant de s’adonner complètement à ses ravages, ajournant les circonstances de l’apostasie généralisée qui annoncera la venue de l’Imposteur, laquelle, promet-on, sera suivie d’une fracassante victoire de l’Authenticité. Par ailleurs, bien que la majorité des commentateurs s’accordent pour dire que saint Paul s’en remet à l’Empire de Rome lorsqu’il aborde le sibyllin garde-fou qui nous protège de la débâcle, il n’en demeure pas moins que la charge métaphorique de son interpellation autorise à postuler un prolongement de la romanité dans les cœurs les plus solidement arrimés à l’énergie blanche (le flux de l’édification) qui tient en respect l’énergie noire (le flux de la démolition). Et faut-il souhaiter que cette opiniâtre occlusion du Mal s’écroule enfin pour que survienne censément la durable Réparation après que les calamités auront terriblement et librement frappé le monde ? Rien n’est moins sûr car il n’est jamais anodin d’assister à l’assiduité d’une minorité vertueuse pendant que les foules ont l’air d’avoir capitulé sous les assauts d’une vicieuse matrice.
Ainsi, osons le dire forte e chiaro, tous les détenteurs de cette sprezzatura tournée vers il regno di Dio sont les agents visibles d’une invisible spoliation des volontés sataniques, les membres d’une confrérie dont la fraternité lumineuse permet de retenir passagèrement le déluge des ténèbres. Ils sont ce κατέχον (kathekon) énigmatique de saint Paul, cette insaisissable et pourtant active obstruction à la venue de l’enfant de la perdition, toutes et tous émissaires délibérés ou tacites de la Bonne Nouvelle – toutes et tous proclamateurs de l’Évangile et de l’irréversible souffle du Seigneur qui vaincra in fine les miasmes démoniaques, pour autant que ce pneuma salvateur ne soit pas déjà en train de gagner la bataille. Dans les temps de détresse où les événements chaotiques s’accumulent et rendent dissymétrique la métrique des divins commencements, ces frères et sœurs du flamboiement suprême, disséminés de par le monde au fond de leurs éclectiques ermitages, perpétuent les représailles d’une géométrie cosmique avant que ne se lève définitivement le soleil de justice. Nul n’ira contester que Cristina Campo fût de ces géomètres et de ces délégués du ciel. Elle avait ce tempérament spécial des inoubliables rédempteurs, cette «attitude morale» (p. 128) plutôt risquée en un siècle de jubilante immoralité, cette flamme insolemment glorieuse qui détonnait avec le laisser-aller des instincts de mort démocratiques.
Outre une physionomie intérieure de grande tenue, les titulaires de la sprezzatura peuvent également se repérer en fonction de leur physionomie extérieure (cf. pp. 128-9), comme si leur âme avait poussé sur leur corps, comme si la forme de leur intériorité seconda a nessuno avait déterminé les apparences de leur extériorité. C’est la raison pour laquelle Cristina Campo stipule que certains portraits suspendus aux murs des «vieilles demeures» affichent cette «qualité mystérieuse» de moralité paroxysmique (p. 128), tel ce cimetière pictural qui ouvre le roman Adrienne Mesurat de Julien Green, montrant des visages verticaux, des visages d’antan sculptés par le marteau du Décalogue, jugeant peut-être l’horizontalité péjorative de quelques-uns de leurs héritiers. Doivent être aussi admis à cette galerie de distingués portraits nombre de médaillons fixés sur les tombeaux marmoréens de toutes les nécropoles. Quiconque a marché dans les allées de ces nécropoles se rappelle forcément une image, la déconcertante photographie d’un physique discordant, témoignage iconographique de la «survie d’une substance ancienne» (8), irréfutable motif dans le tapis de l’immortelle droiture. Se déroule par le truchement de ces représentations le palimpseste d’une exclusive épaisseur ontologique, une subsistance de l’Être même, un gisement qui pourrait désaltérer même ceux qui n’ont pas soif, une «implacable hauteur» (p. 129) désavouant d’emblée tous les rabaissements inhérents à la «léthargie bourgeoise» (p. 129). Et dans le regard de ces docteurs en sprezzatura, dans l’œil de ces législateurs du sacré, l’on aperçoit les anneaux olympiques du «risque», de «l’audace» et de «l’ironie» (p. 130), l’extraordinaire contenance du dompteur qui se sent assez de zèle pour obliger le Léviathan à sauter sur les tabourets de son choix comme n’importe quel animal domestiqué le ferait pour les besoins d’un cirque ambulant. Pour ceux qui sont animés de cette ardeur, Cristina Campo parle de «rythme moral», de «musique de la grâce intérieure» (p. 130), ce que nous requalifions opportunément dans la terminologie d’une vivante et insistante sophiarythmie.
Il existe par surcroît une langue spécifique pour ces titans de la sagesse, une langue qui refuse d’employer des «mots obliques» et qui préfère une «parole directe» (p. 130), un modèle éventuel de la parole donnée si chère à Louis Massignon. Cette sincérité dans les mots engage sûrement ceux qui les prononcent à s’écarter de toutes les variantes de l’obliquité, de tout ce qui peut être l’objet d’une hypocrisie, d’une racine fallacieuse, d’où, per forza, le réquisit d’un «détachement presque complet des biens de ce monde» ou «une constante disposition à y renoncer quand on en possède» (p. 131). On a là un plaidoyer de la pauvreté en hédonisme et de la richesse conçue en tant qu’eudémonisme, les biens ordinaires abandonnés se trouvant transfigurés en occasions de pourchasser le Bien. Nous ne sommes plus ici les dupes d’une société qui nous enjoint de rechercher le plaisir tout en nous aliénant, mais nous sommes passés du bien narcissique (se faire du bien) au bien centrifuge (faire le Bien). Telle était Cristina Campo, à la vigie de son prochain et aux aguets de son lointain, l’égo entièrement dissolu, l’équation de sa diffamation terrestre – écusson de tous les impardonnables qu’elle a mobilisés – résolue dans l’océan céleste de son innocence.
Et sa sprezzatura, au même titre que celle de tous les bienheureux, franchit encore un cap en acquérant «une indifférence évidente à l’égard de la mort» redoublée d’un «profond respect pour ce qui est plus haut que soi et pour les formes impalpables, ardentes, ineffablement précieuses qui en sont ici-bas l’emblème» (p. 131). De cette façon, le haut et le bas ne sont pas séparés, les hiérarchies banales sont congédiées, haut et bas multipliant à ce degré de compréhension les reflets d’une incommensurable créativité. Cela nous remet d’ailleurs en mémoire que le Christ a su descendre, qu’il a su s’abaisser, dévoilant autour de nous, dans la gravitation même, les symptômes de la lévitation. Là réside apodictiquement l’aveuglante primauté d’un grand style existentiel où la vive teneur d’un langage implique la vive teneur d’une densité dans les actes et les idées. Du reste, au vu de cette réciprocité, on a le pressentiment que l’un des traits communs des acteurs de la sprezzatura concerne le quotidien de «l’aventurier» (p. 139), le quotidien de ceux qui n’ont pas peur de «[sauter] à travers le feu» (p. 137), fakirs, marabouts et chamanes dilapidés sur les deux hémisphères mondiaux, sorcières et sirènes également, proscrits, pestiférés, lépreux et sidaïques allégoriques, toutes et tous lestés d’un grelot à la cheville, maudite clochette sonnant le coefficient de leurs impardonnables penchants pour la Beauté. Leurs noms masculins pourraient être Antonin Artaud, Thierry Metz, Jacques Besse, et leurs noms féminins Emily Dickinson, Catherine Pozzi, Rachel Bespaloff, toutes et tous ayant connu des «rencontres divines», toutes et tous s’étant consumés de leur «don juvénile» (p. 139), mis au pilori par le ressentiment d’un occidentalisme sénile. Par conséquent il est vraiment possible qu’ils n’aient été qu’à un cheveu «de la religiosité pure» (p. 140), à quatre ou cinq atomes d’être des jumeaux monozygotes du Christ, échos étincelants «de la Source même de la lumière» (p. 143). En cela, ne l’oublions pas, ils sont à l’unisson de l’impressionnante «sprezzatura de certains mendiants» (p. 145), ils sont élus au panthéon de «l’amour parfait» (p. 144), élus de cet amour éblouissant qui «exige que tous les liens soient rompus avec ce qui est calculable et ce qui est apparent, ce qui est passionnel et ce qui est approuvé» (p. 144), élus de cet amour qui a compris que «prendre et laisser sont une seule et même extase» (p. 145).
Notes
(1) Cristina Campo, Les Impardonnables (Gallimard, coll. L’Arpenteur, 1992). Traduction de Francine de Martinoir, Jean-Baptiste Para et Gérard Macé. On peut également lire La noix d’or, une autre anthologie d’études, une autre collection de textes rares et vitaux (Gallimard, coll. L’Arpenteur, 2006).
(2) Claude Simon, L’Acacia.
(3) Cf. Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique.
(4) Ernst Jünger, Sur les falaises de marbre (cité par Julien Hervier dans sa belle introduction aux Essais de Jünger – Le Livre de Poche, coll. La Pochothèque, 2021).
(5) Il ne faut en outre pas manquer les visions de Cristina Campo sur les Pères du désert (cf. pp. 263-276).
(6) Cf. Ernst Jünger, Passage de la ligne.
(7) Ernst Jünger, Traité du rebelle ou le Recours aux forêts.
(8) Ibid.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, cristina campo, gregory mion, elémire zolla, ernst jünger |  |
|  Imprimer
Imprimer