« Les dieux habitent toujours à l'adresse indiquée de Patrick Reumaux | Page d'accueil | Portrait d'Éric d'Éric Werner »
26/07/2010
L'éclipse de l'intellectuel d'Elémire Zolla

Photographie (détail) de Juan Asensio.
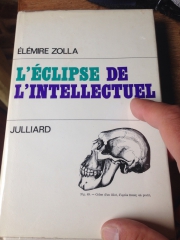 Acheter L'éclipse de l'intellectuel sur Amazon.
Acheter L'éclipse de l'intellectuel sur Amazon. Cristina Campo dans la Zone.
Cristina Campo dans la Zone.Le nom d'Elémire Zolla (la première de couverture de notre ouvrage a francisé le prénom en Élémire) est en France pratiquement inconnu, tout comme l'est celui de Max Picard, que j'ai récemment évoqué avec l'un de ses ouvrages les plus étonnants, L'Homme du néant.
C'est en 1959 que celui qui fut le fascinant compagnon de Cristina Campo publia Eclissi dell’intellettuale, texte traduit moins de dix années plus tard en France par François Vallery-Radot et Michèle Causse. Bien évidemment, cette Éclipse de l'intellectuel est un ouvrage épuisé, alors même que, l'année de sa parution, l'ouvrage de Zolla reçut le Prix Crotone.
Auteur et ouvrage sont tombés dans un oubli commun. Il est vrai que Cristina Campo elle-même, qui vit en Elémire Zolla, fils d'une musicienne anglaise, Blanche Smith et d'un peintre franco-italien, Venanzio Zolla, l'une des intelligences les plus fulgurantes de son époque, n'est connue que de quelques belles âmes. Sur la passion qui lia ces deux êtres d'exception (alors que Zolla se maria avec une certaine Maria Luisa Spaziani l'année même de sa rencontre avec Cristina Campo), je renvoie le lecteur au bel ouvrage que Cristina De Stefano a consacré à l'auteur des Impardonnables, Belinda et le monstre. Vie secrète de Cristina Campo (Le Rocher, 2006, voir par exemple le chapitre 6, pp. 103-112).
J'évoquerai dans cette note l'Anthropologie négative qui est un des trois textes, le premier, composant l'ouvrage de Zolla. De plus, cette évocation ne fera que souligner l'une des manifestations que Zolla donne de ce qu'il appelle l'ère de l'homme des masses ou homme-masse. Cette analyse concerne la dévaluation du langage et ne se veut qu'un petit complément à ma série de notes évoquant les différentes formes de recomposition de la société humaine après une catastrophe d'ampleur planétaire.
Pour Zolla qui n'imagina point, à la différence de London, un conte relatant les faits et gestes d'une petite communauté ayant survécu au désastre, il semble assez clair que la détérioration du langage n'est pas une chimère d'artiste ou de visionnaire mais bel et bien une réalité que toute personne ayant l'oreille fine peut, douloureusement, constater par elle-même. Cette détérioration provient de l'usage du jargon qui tend irrémédiablement à remplacer une langue commune comprise de tous, du temps où le spécialiste (1) aurait semblé un monstre grotesque. Qui peut aujourd'hui comprendre, demande ainsi Zolla, le langage savant d'un médecin, celui d'un juge voire, exemple le plus ridicule, celui d'un commentateur sportif s'il ne s'est pas quelque peu penché sur les arcanes de cette technicité tournant à vide ? : «La langue unique a disparu au profit d’une multitude de langues qui recouvrent les diverses branches de la spécialisation. Mais quand l’homme moyen ne travaille pas, quelle langue utilise-t-il ? Alors que dans son travail il adopte une langue grotesque, fort comique, mais parlée le plus sérieusement du monde, durant ses loisirs, il parle une langue mortellement triste dont il use sur le mode badin. Son langage quotidien est triste, parce qu’il n’est ni choisi ni hérité, mais ramassé çà et là, accepté par inadvertance et conformisme. Il se compose de termes «lancés» par les journaux, par les programmes de «variétés» ou les chansons du moment. En dehors des néologismes nécessaires aux réalités nouvelles, il se forme constamment de termes superflus. Leur seule utilité est de s’adapter parfaitement à l’esprit de «masse», c’est-à-dire d’être tout à la fois indéterminés et péremptoires. Ce sont tout juste des signaux, des flèches indicatives, des enveloppes sans contenu métaphorique. Il peut également s’agir de mots du langage traditionnel, mais employés de telle sorte qu’ils semblent vides de toute évocation sensible ou rationnelle, trahissant toujours une sorte de dévaluation du sentiment, de dégradation banalisante» (2).
J'ai plusieurs fois signalé dans mes ouvrages et mes notes l'un des textes les plus déroutants et fascinants de Walter Benjamin, évoquant la tristesse du monde privé de parole à cause du péché de l'homme, péché dit de surdénommination.
Quel est l'unique miracle que l'homme moderne, l'homme-masse, est capable d'accomplir ? La multiplication des langages répond Zolla, mais ce miracle est un miracle noir qui, en outre, assèche les gosiers au lieu de les étancher. Zolla poursuit, avançant des preuves concrètes (et italiennes bien sûr) de ses dires, que son ouvrage détaille : «La langue traditionnelle, prise d’assaut par les jargons professionnels et par ce langage à l’accent anonyme et sportivement sexuel, ne peut que déchoir. Ce qu’il en reste se détériore toujours plus, perd sans cesse ces éléments de différenciation et de précision que l’«homme-masse» considère avec méfiance. Ainsi le subjonctif disparaît, les adjectifs qui ne sont pas de simples clichés n’osent plus se maintenir, et les pronoms personnels perdent leur genre et leur déclinaison» (p. 45).
Hélas Elémire Zolla ne fait pas de la question de la dégénérescence du langage l'axe essentiel de sa réflexion; le langage n'y est qu'un exemple, une station pourrait-on dire, qui nous rapproche du cœur des ténèbres, en une lente progression qui, selon la logique diabolique définie par Jean-Luc Marion (la personne de Satan n'existe pas, la personne du Mal est une impossibilité ontologique; in fine, le mal ne peut que décevoir celui qui l'a commis, d'où l'unique issue, le suicide...), nous rapproche un peu plus d'un puits où, à la différence de ce qu'avait imaginé Dante, nul Prince des Enfers ne trône : «Mais en vérité, l’on n’accuse pas la civilisation de «masse» d’être plus cruelle, on lui reproche d’être plus blême et plus désolée, moins vive et, partant, quand elle est cruelle, de l’être techniquement, et donc sans bornes» (p. 68). Autre rapprochement possible, avec le ténébreux roman de Marcel Beyer, Voix de la nuit que j'avais évoqué dans une note pointant justement la dilution de l'horreur dans l'anonymat du fait divers.
C'est dans cette absence de toute norme, dans cette disparition des repères et des valeurs, dans cet étirement quasi infini vers le non-sens et la platitude, dans cette monstrueuse mise au monde qui n'est plus le signe de la nouveauté et de la joie (3), dans cet activisme effréné au sens que Benedetto Croce donnait à ce terme (4) que réside l'essence secrète des temps modernes selon Zolla. Temps modernes qui, dans le meilleur des cas, ne font que rejouer, mais affublés d'oripeaux de bouffons, les vieux drames sacrés des initiations et des cérémonies par lesquelles les hommes honoraient les dieux eux aussi éclipsés (5).
Notes
(1) Dans le texte intitulé Éclipse de l'intellectuel, Elémire Zolla liera le basculement de la société dans l'immoralité ou plutôt l'amoralité à l'émergence du spécialiste : «L’immoralité est consacrée, le déchirement qui, malgré tout, pouvait exister jadis entre la vocation d’intellectuels et la prostitution du talent, se trouve aujourd’hui résolue, car il ne se pose pas de problèmes moraux ni de responsabilité générale à des gens devenus spécialistes d’une industrie où la responsabilité est technique, restreinte à la prestation individuelle, anonyme», in L’éclipse de l’intellectuel [1959] (traduction de l’italien par Michèle Causse et François Vallery-Radot, Julliard, 1968), p. 122.
(2) Op. cit., pp. 40-1.
(3) «En vérité, l’«homme-masse» ne fait pas des enfants pour les élever, mais pour apprendre de leur bouche comment supporter sa vie telle qu’elle est» (p. 93).
(4) «La culture, telle que la conçoit Croce, est toujours liée à l’antique georgica animi, à l’idée que la tâche de l’intellectuel consiste à résister, avec les armes qui lui sont propres, c’est-à-dire avec la pureté de sa recherche scientifique ou artistique, à la dégénérescence culturelle et sociale dont Croce fixe les prodromes aux alentours de 1870. Il appela cette dégénérescence activisme, ou culte de l’activité en soi, de la convulsion inerte, qui impliquait naturellement le culte du machinisme, du sport, de la production, indifférente aux besoins réels de l’homme, la transformation des peuples en masses maniables, la langueur et le vide spirituel, générateurs du pragmatisme, du positivisme et, au pôle opposé, des irrationalismes de toutes sortes» (pp. 124-5). Zolla fait ici référence à l'ouvrage de Croce intitulé Histoire de l'Europe au XIXe siècle. Nous pourrions encore illustrer cet activisme privé de raison (et de coeur) par la carrière de Willy Stark telle que l'a dépeinte Robert Penn Warren.
(5) Dans un de nos trois textes intitulé Les régressions dans la drogue, Zolla écrit : «Il ne faut pas confondre la drogue liturgique avec le simple extrait végétal, la drogue ordonnée au divin avec la drogue en soi et pour soi. Il ne faut pas confondre le derviche tourneur, le brahmane désireux d’imiter Indra, en retenant le divin au moyen du soma, avec l’homme déraciné, qui dans sa prison individuelle tente de créer, indépendamment de sa misérable condition, une disposition à la fête. Ce pauvre Arabe, qui respire les lambeaux des mythes ataviques dans les fumeries, cet Aztèque asservi, qui mastique le peyotl pour s’abrutir et supporter un quotidien fastidieux, insensé. Il n’est plus possible de rétablir la fête ni le rite. Vouloir les ressusciter artificiellement, ce serait s’exposer à une grotesque désillusion. La volonté abstraite ne peut redonner vie à ce qui ne dépend pas de la volonté, à ce qui par essence est spontané. Que fut le fascisme, sinon une tentative de rétablir des cérémonies mortes, d’imprimer des secousses galvaniques à des sociétés déjà cadavériques ? Le voyage d’Antonin Artaud, en quête du cérémonial magique du peyotl, est-il autre chose qu’une tentative de restaurer une vie organique par des artifices» (p. 162).



























































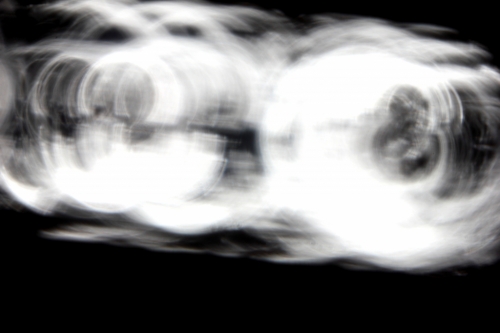

 Imprimer
Imprimer