Mélancolie française d'Éric Zemmour (03/04/2010)

Crédits photographiques : Oli Scarff (Getty Images).
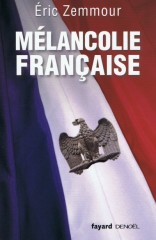 À propos de éric Zemmour, Mélancolie française (éditions Fayard / Denoël).
À propos de éric Zemmour, Mélancolie française (éditions Fayard / Denoël). LRSP (livre reçu en service de presse).
Quel livre que Mélancolie française ! Récemment, j'affirmais que je n'avais aucune compétence philosophique particulière pour juger l'ouvrage de Gérard Guest sur Wittgenstein. La réponse, d'une stupidité et d'une vulgarité inimaginables mais hélas parfaitement réelles, que me fit Alexandre Gambler/Andréas Guest, m'incite à penser qu'un agrégé peut n'avoir aucune compétence particulière ni même, dans notre cas, guère d'intelligence : la preuve en a été faite avec cette ridicule défense et illustration, par le propre fils du professeur de philosophie, de la pensée guestienne et surtout de l'écriture guestienne qui est une impuissance, notre penseur conséquent et écrivain raté ne sachant visiblement pas, las !, danser selon le commandement de Nietzsche ! Incapable de faire miroiter son intelligence par son écriture, nous voici donc devant un monstre sans voix et, il s'en lamente bien assez, sans livre (le sien, l'unique ayant fini au pilon), comme s'il était un Monsieur Teste podagre et privé de vie, fût-elle seulement littéraire, une marionnette affaissée sans un Paul Valéry capable d'écrire ses pensées tout autant qu'animer ses gestes. Un idiot en somme, au sens étymologique du terme qui évoque l'enfermement du pauvre diable dans un cachot hermétique. On a vu avec quelle intrépidité le propre fils de Gérard Guest, un penseur faisant les délices du petit cercle meyronno-haenélien, s'est chargé de libérer son père et de laver son honneur souillé ! Il l'a plutôt repoussé dans sa cellule, l'y enfermant à triple tour. De l'air ! De l'air ! Un jour je vous prie, même minuscule, une ouverture percée de toute urgence dans l'épaisse muraille de pierre, derrière laquelle se morfond notre vestale de l'intelligence, souffrante de n'être point reconnue ! Un baiser de reine pour Gérard Guest, que notre captif soit transformé en prince du savoir chantant et poète d'un verbe qui, chez lui, pour le moment, a autant de légèreté qu'un dragon échappé du Mordor !
Lisant Mélancolie française, il me faut donc affirmer que, pas plus qu'en philosophie, je n'ai de compétences particulières en histoire. Demeure un fait : Éric Zemmour, historien amateur pour les uns, histrion professionnel pour les autres, sait écrire, à la différence de Gérard Guest, si lourd de son savoir catastrophiquement pataud. Il faut voir avec quelle impatience, avec quelle colère devant l'idéal saccagé le célèbre journaliste parcourt, pressé de parvenir au but irréel de sa course, notre époque qui rejoue la chute de l'Empire romain, les siècles splendides et grondant de bruit et de fureur d'une France qui a, selon toute évidence pour l'auteur, raté sa vocation qui eût dû être de devenir le chef, la tête sacrée de l'empire romain qui, mort de sa belle mort barbare et chrétienne, a continué de vivre pourtant, comme Albert Sorel l'affirmait du Grand Empire, par ses lettres, sa façon de penser, ses lois, ses routes, son vin et même ses aqueducs ! Paris, capitale de la France, non point la seconde mais la nouvelle Rome, une puissance à l'échelle du continent européen tout entier, seule capable de prétendre pouvoir tenir tête à l'irrésistible ascension de la thalassocratie anglo-saxonne aux mille comptoirs, aux cent mille espions tout pressés d'entraver l'ennemi détesté, y compris en manipulant le pourtant diabolique Talleyrand. La France a failli concrétiser la réalisation de son rêve millénaire avec «l'Europe des Six comprenant l'Hexagone, la Belgique, le Luxembourg (réclamé encore par Napoléon III), l'Allemagne rhénane (et non prussienne), et l'Italie du Nord. La France de Tilsit, avant les folies espagnoles et russes. C'est l'Europe riche. La grande nation. La France idéale» (p. 173) mais, quoi qu'il en soit, rien à faire, la mélancolie coulait déjà, à cette époque, dans les veines françaises : «Une souffrance, une tristesse, une mélancolie française commence en effet [au XIXe siècle] à imprégner notre pays. Les esprits les plus avisés, les plus fins ont tout senti. L'impasse stratégique de la monarchie capétienne; les enthousiasmes révolutionnaires sans lendemain; la gloire impériale ternie par les défaites finales. L'Europe continentale sous domination française est une chimère qui s'éloigne. Le mouvement des nationalités, inventé par la France, se retourne contre elle, au profit de l'Allemagne qui trouve partout des hommes parlant un dialecte germanique. Une nasse géostratégique, celle du ni mer ni terre succède à l'abondance du passé : et terre et mer» (p. 124).
Un écrivain qu'Éric Zemmour, que m'importe que son livre, comme son éditeur, historien de formation, le confiait au jury du Prix du Livre incorrect, ait été visiblement très travaillé, alors qu'on ne lui donne que du journaliste, quelle injustice tout de même. La tactique est bien connue et au moins aussi parfaitement rodée que celle qui consiste, pour un homme de gauche, à traiter son adversaire de fasciste, selon le commandement rusé et diablement efficace de la IIIe internationale : ici, un écrivain sera appelé journaliste, ou, pis, publiciste. J'en connais un, Renaud Camus, que l'on nous présente comme un écrivain et qui l'est incontestablement, du moins de temps en temps, j'en connais un qui ne semble plus savoir faire qu'une seule chose, l'office monotone de journalier voire de journaliste de très bas étiage lorsque, sans beaucoup de sensibilité, sans beaucoup de vivacité, sans beaucoup d'écriture même mais avec un luxe stupéfiant d'insignifiantes précisions qu'il semble vouloir, comme une lamproie abouchée à sa proie, vider de leur maigre substance, il nous joue, sans jamais se lasser, l'aigre ritournelle de la fuite des jours heureux et celle des tuyaux de plomberie, l'affaissement de la belle culture française et celui de ses couilles (du moins de l'une d'entre elles, si mes souvenirs sont bons, dans un précédent tome de son Journal), la défiguration dramatique des paysages français et même européens allez, mondiaux et la détérioration du micro-climat qui enveloppe précautionneusement les petites cervelles obtuses sinon camuses de ses sociétaires, pieuses (mais aussi ironiques, voire irrévérencieuses) Véronique voilées d'un nouveau genre qui attendront la photographie quasi quotidienne, que le maître mettra en ligne avec une régularité de métronome, pour y déceler les plus minuscules traces d'une passion. Une passion ? Ah oui, c'est que Renaud Camus, en son château, par monts et par vaux qu'il parcourt sans relâche pour en faire des ouvrages lus par une petite poignée de lecteurs (dont je suis), souffre. Cette souffrance, hélas, n'est point donnée à la multitude, ni même à ses plus fidèles lecteurs bien incapables de former une communauté. La souffrance de Renaud Camus, que je n'ai aucune raison de ne point croire sincère, n'est absolument pas versée pour la multitude en une effusion aussi secrète que pudique mais analysée, démembrée, désossée, ratiocinée, documentalisée, commentée à l'infini par une troupe comique qui, en marche à la queue-leu-leu sur les flancs de l'Etna, s'aviserait de sortir un thermomètre pour prendre la température du monstre. Et Dieu sait que, si je devais filer ma métaphore, Renaud Camus serait fumerolle plutôt que bouche crachant le feu... Cette ritournelle parénétique devenue aigre, rancie comme une crème qui aurait tourné, Renaud Camus la pousse avec un filet de voix qu'il s'agit d'envelopper de précautions extraordinaires de minutie qui feraient passer les si monotones Carnets noirs de Gabriel Matzneff pour une symphonie inouïe de tons et de couleurs et ses monocordes et acéphales parties de jambes en l'air pour l'élancement, sur l'océan inconnu de Lord Tennyson, d'un Ulysse vieillard redevenu vif comme un dauphin !
De grâce, qu'un vent, même léger, une simple brise fragile, secoue les pages engluées d'ennuis et de petitesses cacochymes du dernier tome du Journal de Renaud Camus, Une Chance pour le temps, sauf pour le nôtre hélas, aurait-on envie d'écrire par boutade, œuvre solipsiste qui comiquement sombre dans la flache sirupeuse du plus orthodoxe soi-mêmisme lorsqu'il prétend stigmatiser, à très juste titre n'en déplaise à Sylvain Bourmeau auteur, comme toujours depuis qu'il nous afflige de ses textes, d'un papier lamentable, le marasme barbare de la société française contemporaine vue par le judas d'une impuissance et d'une envie mille et mille fois recuites !
Cet air, ce souffle du grand large, je les ai trouvés dans Mélancolie française d'Éric Zemmour qui, contrairement à Renaud Camus et pour autant que ce point soit digne d'intérêt ailleurs que dans les coteries parisiennes, n'a aucune prétention particulière d'écrivain alors que l'autre en joue, se mirant au miroir, toujours flatteur, de l'horrible travailleur ayant voué sa vie et son âme au labeur littéraire inouï. Peu m'importe que les thèses historiques que Zemmour expose dans son ouvrage soient (forcément) contestables, ni même que sa fin, à thèse, manque du souffle de son début, qui se lit comme un véritable roman. Je ne suis pas historien je l'ai dit, même si j'aime assez que l'auteur nous rappelle quelques évidences, par exemple sur la provenance politique (la gauche dreyfusarde et pacifiste) de quelques-uns des plus fameux collaborateurs ayant déshonoré la France (1), et je fais mon miel du style de l'auteur mais aussi des textes littéraires qu'il a lus et auxquels il fait référence comme la Vie de Napoléon de Stendhal, l'admirable Grand Coucher de Guy Dupré et la somptueuse et crépusculaire Confession d'un enfant du siècle de Musset qui écrit : «Trois éléments partageaient donc la vie qui s’offrait alors aux jeunes gens : derrière eux un passé à jamais détruit, s’agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles des siècles de l’absolutisme; devant eux l’aurore d’un immense horizon, les premières clartés de l’avenir; et entre ces deux mondes… quelque chose de semblable à l’Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages […]; le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l’avenir, qui n’est ni l’un ni l’autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l’on ne sait, à chaque pas qu’on fait, si l’on marche sur une semence ou un débris» (2). À notre époque, les choses n'ont absolument pas changé pour les jeunes gens, même si j'ai un peu peur que les «premières clartés de l'avenir» ne soient à leur tour qu'une maigre lueur de feu follet dansant sur les tombes de nos ancêtres. Au moins certains d'entre eux moururent-ils pour une cause qui dépassa le petit égoïsme frivole et bourgeois qui consume nos vies depuis des lustres, alors même, comme Zemmour le rappelle dans une belle formule, que «l'homme risque son existence en faisant la guerre, mais il perd son essence en ne la faisant pas».
Pour quelle guerre les Français de 2010, placés devant une situation catastrophique qui ne concernerait pas que les soldats de métier, accepteraient-ils de mourir, eux qui, selon le mot de Peter Sloterdijk, sont sortis, comme d'autres peuples européens, comme tous les peuples européens peut-être, de l'héroïsme par (et pour, devrait-on ajouter à la suite du philosophe) le consumérisme ? C'est pourtant le sang d'un peuple je crois qui empêche ce dernier d'être effacé de la scène de l'Histoire, n'est-ce pas ? Erreur affirme Zemmour, les plus grands sacrifices auxquels la France a consenti ne l'ont point empêchée d'être rayée symboliquement de la carte des puissances, comme François Mauriac l'avait parfaitement compris au lendemain de Yalta, écrivant dans Le Figaro : «Je doute que nous devions feindre de prendre légèrement le coup qui nous atteint : pour la première fois dans l'histoire, les grands se réunissent et le fauteuil de Talleyrand et de Chateaubriand demeure vide. Même après ses désastres, la France avait toujours occupé, dans l'assemblée des nations, la place qui lui était due, ses amis lui refusent aujourd'hui ce que ses ennemis les plus haineux au cours des siècles, n'eussent jamais songé à lui disputer».
Que nous reste-t-il ? À survivre peut-être par notre esprit et notre culture plus que par notre puissance économique, militaire, politique, démographique même («La France est un borgne démographique au pays des aveugles européens», p. 214 (3)), devenue chimérique à l'heure des géants que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, bientôt le Brésil. C'est d'ailleurs ainsi que survécut Rome, dont la déchéance est rejouée selon Zemmour par une France obsédée par le paganisme des droits de l'homme et du multiculturalisme, détruite, en tous les cas rongée de l'intérieur par «l'internationalisme d'extrême gauche [ayant] servi d'idiot utile au capitalisme financier anglo-saxon» (pp. 234-5), la France qui ne voit pas, ou alors qui ne le voit que trop et est finalement secrètement ravie de cette situation mortelle, que les barbares ne sont plus à ses portes mais dans ses villes.
La France, qui comme l'Europe «subit une histoire qu'elle n'écrit déjà plus» (p. 186), ne retrouvera sa grandeur passée, n'en gagnera peut-être une nouvelle que lorsqu'elle essaiera de toutes ses forces de redonner sa vitalité à un rêve impérial aujourd'hui exsangue : «C’est de cette histoire, de cet échec, de ce renoncement, que nous ne nous remettons pas. Ce pays programmé depuis mille ans pour donner la «paix romaine» à l’Europe devait rentrer dans le rang. Cette blessure saigne encore, même si on fait mine de ne pas voir le sang couler» (p. 35). Prolongeons la thèse, implicite, de l'ouvrage d'Éric Zemmour et évoquons la source cachée de la mélancolie qui nous paralyse : la France ne retrouvera une quelconque grandeur politique et peut-être culturelle et spirituelle que lorsqu'elle aura de nouveau enté sa geste immense, par-delà la blessure que constitua l'échec de Napoléon (4), sur la légitimité. C'est là, nous dit Pierre Legendre (5), un «enjeu généalogique, autant dire le fondement de son être pour l'espèce parlante, la source de son rapport à la causalité pour le sujet du discours.» En effet, poursuit le grand penseur, sur «les moyens de ne pas douter de sa propre existence, et partant de soutenir le principe de raison, aucune société ne lésine. Partout dans l'humanité, c'est sur la base de cette dépendance logique que s'échafaude la légitimité, c'est-à-dire le pouvoir de fonder le pouvoir».
Voilà bien ce que la France a perdu, le pouvoir symbolique, donc éminemment précieux, vital, de fonder le pouvoir.
Notes
(1) Voir, de Jean-Paul Sartre dans le texte publié en 1945 intitulé Qu'est-ce qu'un collaborateur ?, qui d'ailleurs établit un lien pour le moins polémique entre homosexualité et complexion collaboratrice, ces lignes : «Si par exemple le pacifisme français a fourni tant de recrues à la collaboration c'est que les pacifistes, incapables d'enrayer la guerre, avaient tout à coup décidé de voir dans l'armée allemande la force qui réaliserait la paix. Leur méthode avait été jusque-là la propagande et l'éducation. Elle s'était révélée inefficace. Alors ils se sont persuadés qu'ils changeaient seulement de moyens : ils se sont placés dans l'avenir pour juger de l'actualité et ils ont vu la victoire nazie apporter au monde une paix allemande comparable à la fameuse paix romaine. [...] Ainsi est né un des paradoxes les plus curieux de ce temps : l'alliance des pacifistes les plus ardents avec les soldats d'une société guerrière», cité par Éric Zemmour page 147 de son ouvrage. Sur cette question, l'un des ouvrages de référence est celui de l'historien israélien Simon Epstein, Un paradoxe français qui écrit : «Les dreyfusards, sous l'Occupation, verseront majoritairement dans le pétainisme ou d'autres formes de collaboration, au point qu'on peut dire [...] que la collaboration, pour beaucoup d'entre eux, fut bien plus la continuation du dreyfusisme qu'elle n'en fut la négation. Cette vérité est indicible, elle porterait durement atteinte au message éducatif porté par l'Affaire et elle heurterait de front l'un des acquis les plus sacrés de l'idéologie franco-républicaine. Préserver l'aura du dreyfusisme et la pureté des dreyfusards est d'une simplicité déconcertante : il suffit de ne pas prolonger les biographies au-delà, mettons, de la Première Guerre mondiale. Les années ultérieures se perdent dans un épais brouillard que les historiens, dans leur quasi-totalité, ne chercheront pas à dissiper», cité par Éric Zemmour, op. cit., pp. 145-6.
(2) Alfred de Musset, La confession d’un enfant du siècle [1836] (Gallimard, coll. Folio classique, 1996), pp. 24-5.
(3) «Notre dynamisme démographique est branché sur le moteur à explosion maghrébin et africain; les dissimulations imprécatoires de Lyssenko de l'INED n'y changeront rien», pp. 218-9.
(4) «C’est toujours la même histoire recommencée depuis deux siècles. Les maîtres changent, Anglais, Allemands, Soviétiques, Américains, le choix impérial reste. Quel que soit le maître choisi, tous ses servants français tirent les mêmes conclusions de la défaite française de Waterloo, de son incapacité à dominer et unifier l’Europe continentale», pp. 160-1.
(5) Pierre Legendre, Le grand frisson. Parcours d'un fantasme dans le Texte d'Occident. Note marginale, préface à L'Antéchrist à l'âge classique de Jean-Robert Armogathe, Éditions Mille et une nuits, coll. Les Quarante piliers, 2005, p. 14.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, histoire, mélancolie française, éric zemmour, éditions fayard, gérard guest, renaud camus |  |
|  Imprimer
Imprimer