Des villes dans la plaine de Cormac McCarthy (20/01/2011)

Crédits photographiques : Adrees Latif (Reuters).
 Cormac McCarthy dans la Zone.
Cormac McCarthy dans la Zone. Sur De si jolis chevaux.
Sur De si jolis chevaux. Sur Le grand passage.
Sur Le grand passage.«And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt.»
King James Bible, Genesis, 19, 29.
«Le critique est un écho, sans contredit. Mais n’est-il pas aussi la voix de la montagne, à laquelle s’adresse la voix du poète ? Le critique ne se tient-il pas devant le poète comme le poète devant les appels de son propre cœur ? C’est pourquoi, au moment d’en parler, il doit l’avoir déjà entièrement subi : le restituer non comme un simple miroir, mais bien comme un écho : imprégné de tout le chemin parcouru, dans la nature, par l’une et l’autre voix.»
Cristina Campo, Le parc aux cerfs, in Les Impardonnables [Gli Imperdonabili, 1987] (traduit de l’italien par Francine de Martinoir, Jean-Baptiste Para et Gérard Macé, précédé de Cristina, par Guido Ceronetti, Gallimard, coll. L’Arpenteur, 2002), p. 185.
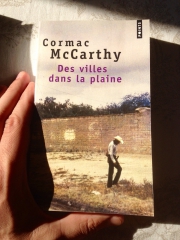 Acheter Des villes dans la plaine sur Amazon.
Acheter Des villes dans la plaine sur Amazon.Bien sûr, après le sommet que constitue Le grand passage, je ne m'attendais à rien de bien particulier avec Des villes dans la plaine, tout au plus à lire une suite parvenant à clore dignement, puisqu'il faut bien refermer ce qui a été ouvert, cette très belle trilogie : John Grady Cole et Billy Parham, les deux personnages auxquels McCarthy a consacré les deux premiers volumes de la Trilogie des confins, deviennent amis (nous ne savons comment), puis le second mourra d'avoir défié au couteau un maquereau amoureux d'une putain qu'il aura égorgée, celle-ci ayant essayé de lui échapper pour se marier avec le jeune Grady Cole. Demeurent, dans ce roman inférieur à ceux qui le précèdent, quelques fulgurances métaphoriques (1), d'admirables descriptions de la nature (souvent associée aux temps les plus anciens (2), comme de coutume chez l'écrivain) et des bêtes domestiquées ou (redevenues) sauvages (3), mais aucune de ces miraculeuses dilatations temporelles qui faisaient du Grand passage un roman oraculaire, apocalyptique, au sens premier du terme : ses meilleures pages semblaient bruire de mille voix, cristallines ou immondes, qui annonçaient à Billy Parham de noirs lendemains, et racontaient d'étranges histoires chargées de tous les mystères du monde.
Et voici que, m'approchant de la fin du roman et quelque peu déçu de constater que Cormac McCarthy ne fait que décrire plutôt qu'écrire, je commence la lecture de ses toutes dernières pages, que l'auteur a pris le soin de distinguer du reste de son roman en les ayant regoupées dans un Épilogue, où Billy Parham, devenu vieux et clochard, rencontre, sous un pont, un de ses semblables qui lui raconte le rêve qu'il a fait.
Ce rêve admirable, difficile, énigmatique même, spéculaire (puisqu'il s'agit d'un rêve dans un rêve dont le caractère second ou dupliqué est évoqué par l'image d'un sceptre dans un sceptre (cf. p. 303), et même d'un rêve annoncé par un autre rêve, à moins qu'il ne s'agisse d'un seul et unique rêve, évoqué en début de roman (4)) mériterait, à n'en pas douter, une exégèse subtile à lui tout seul, tant il me semble constituer le nœud de la réflexion d'un grand romancier, où sont inextricablement nouées les questions évoquées dans notre trilogie (la parole, le pouvoir d'ordonner le monde par le récit, les frontières troubles entre la réalité et le rêve, le monde et sa représentation, l'enchaînement de l'homme à la nécessité (5), l'imbrication extrême de tous les actes humains, qu'ils soient ceux de vivants ou de morts (6), etc.). Son importance est d'autant plus grande qu'il me semble avoir été annoncé à Billy dans Le grand passage par un vieillard aveugle, en ces termes : «Il dit que le jeune homme trouverait l’endroit où les actes de Dieu et les actes des hommes se confondaient. Où on ne pouvait distinguer entre les uns et les autres.
Et quelle sorte d’endroit c’est ? dit Billy.
Des endroits où le fer est déjà dans la terre, dit le vieillard. Des endroits où le feu a brûlé.
Y como se encuentra ?
Le vieillard dit qu’il n’était pas question de trouver un tel lieu mais plutôt de le reconnaître à l’instant où il apparaissait. Il dit que c’était en de tels lieux que Dieu résidait et conspirait à l’anéantissement de ce qu’il s’était donné tant de peine à créer» (p. 57). Or, le vagabond décrit à Billy le paysage de son rêve de la façon suivante : «En tiempos antiguos. Il [le personnage du rêve, lui-même décrit comme un vagabond] était arrivé à un col très haut dans les montagnes et il y avait là un grand rocher tabulaire et c'était un rocher très ancien et il s'était détaché dans les premiers temps de la terre de la paroi d'un escarpement dans la montagne et reposait dans la cuvette du col et il offrait aux intempéries et au soleil son flanc plat scié net. Et sur la face de ce rocher on pouvait voir encore les taches de sang laissées là par ceux qui y avaient été mis à mort pour apaiser les dieux. Le fer contenu dans le sang de ces créatures disparues avait noirci la roche et y était encore visible» (p. 297).
Le rêve dans le rêve qui clôt ce troisième volume de la Trilogie des confins a donc une valeur symbolique patente.
Rêve crucial où sont encore énoncés les thèmes que Cormac McCarthy développera dans La Route, comme l'inéluctable déclin du monde (7) et, même, le déclenchement de quelque mystérieuse dévastation qui obligera l'homme, peut-être, à maudire son inutile Sauveur et à partir sur les routes pulvérulentes, le fils devant porter l'homme («En vieillissant / Je serai ton enfant / Porté par toi / Et toi tu seras moi»), l'homme devant aussi porter le fils pour l'aider à survivre parmi les loups.
La leçon, malgré les détours qu'emprunte le narrateur, peut être résumée de la façon suivante : l'homme ne peut se prétendre étranger au monde, encore moins à ses semblables. L'histoire du vagabond rêvé par le vagabond est celle de tous les hommes, de John Grady Cole à l'évidence, de Billy Parham bien sûr, marchant seul sur les routes et espérant que des amis l'attendent (cf. p. 317), mais aussi du lecteur.
Observons ces principales articulations.
L'étrange dialogue (s'étendant des pages 296 à 317 de notre roman) entre Billy Parham devenu vieux et un vagabond décrit comme étant un homme sans âge (comme le sera celui qui, dans La Route, croisera le chemin du père et de son fils), dont on ne sait s'il est bien réel où s'il n'est pas la mort elle-même venue rendre visite au vieil homme sans toit qu'est devenu Billy, cet étrange et fascinant dialogue a des liens profonds avec le rêve évoqué par le mendiant. Unité de temps, de lieu : quelques heures tout au plus, un maigre refuge sous une passerelle au pied d'une autoroute. Effets de réel (la notation du décor où s'inscrit la rencontre, l'humour de certaines reparties, l'humilité des propos et attitudes, la maigre nourriture échangée entre les deux hommes) qui ne parviennent pas à contrebalancer l'impression que ces quelques pages, pourtant essentielles, auraient parfaitement pu s'intégrer à l'une de ces nombreuses rencontres que nous avons mentionnées dans Le grand passage et qui constituent autant de haltes, de bulles extra-territoriales si je puis dire, dans la quête du héros. La critique génétique nous dira peut-être quelque jour à quel moment ces pages ont été écrites : simplement, comme la conclusion évidente mais néanmoins problématique de la trilogie ? Au moment de la rédaction du deuxième volume ? Au début, même, de l'écriture de ce qui allait devenir une trilogie romanesque ?
Quoi qu'il en soit, c'est par l'évocation d'une thématique familière à Cormac McCarthy que débute notre Épilogue, que nous intitulerons l'Épisode de la carte du Mexique (pp. 295 puis 300), carte que le vagabond a décidé de tracer après qu'il a fait, justement, le rêve : «Au milieu de ma vie, dit le vagabond à Billy, j’en ai tracé le parcours sur une carte que j’ai longuement étudiée. J’essayais de voir le dessin qu’elle faisait sur la terre parce que je croyais que si je pouvais voir ce dessin et en connaître la forme alors je saurais mieux comment continuer. Que je saurais mieux ce que devait être mon chemin. Que je pourrais lire dans l’avenir de ma vie» (p. 295). Le rêve, fidèle à la plus immémoriale tradition, a valeur de présage d'autant plus fort qu'il divise la vie en deux parties, tout comme celle de l'explorateur des Enfers le plus célèbre de l'Occident : il enseigne le sens de tel ou tel événement, peut-être même est-il constitué d'une matière qui est celle, mais ici donnée dans son essence réelle, invisible, de l'événement qu'il annonce.
«À quelles genres de choses elle ressemblait ? Cette carte, lui demande Billy.
D’abord j’ai vu un visage mais ensuite j’ai tourné la carte et je l’ai regardée de différents côtés et quand je l’ai remise comme avant le visage avait disparu. Et je n’ai jamais pu le retrouver» (p. 296).
Il s'agit en somme, comme le signifia le juge Holden dans Méridien de sang par le biais de ses carnets de note dans lesquels, au fur et à mesure qu'il les détruisait, il consignait l'existence des minéraux ou des fossiles qu'il découvrait, de retenir le monde par le prestige fallacieux d'une écriture, d'une image, de signes ou bien, comme ici, d'une carte qui nous semble être celle d'une contrée purement imaginaire. Je l'ai souvent écrit : le paysage que décrit Cormac McCarthy est inquiétant pour la raison qu'il se creuse d'une profondeur que nous ne pouvons que soupçonner, jamais véritablement connaître. Mais, là où Holden, dans un geste réellement démoniaque, consignait tout ce qu'il destinait à la destruction, le vagabond essaie de ramasser les membres épars de sa vie d'homme, comme il l'avoue à Billy : «Quand tu regardes le monde y a-t-il un moment où ce vu qu’on a vu devient souvenir ? Qu’est-ce qui distingue l’un de l’autre ? C’est ce que nous n’avons aucun moyen de montrer. C’est ce qui manque sur notre carte et dans l’image qu’elle présente. Et c’est pourtant tout ce que nous avons.
Tu n’as pas dit si ta carte t’avait servi à quelque chose ou pas.
L’homme se tapota la lèvre avec l’index. Il regarda Billy. [...] Tout ce que je peux dire pour l’instant c’est que j’avais espéré trouver une formule qui pourrait exprimer la convergence entre la carte et la vie une fois que la vie serait achevée. Car dans leurs limites il doit y avoir entre le dire et le dit une configuration commune ou un espace partagé. Et s’il en est ainsi l’image doit aussi indiquer une certaine direction aussi vague que soit l’indication et si tel est le cas tout ce qui va se produire doit suivre cette direction-là» (pp. 300-1, je souligne). Avant de se mettre en route, il faut, au vagabond, un signe, aussi infime soit-il, qui lui indique le chemin à suivre.
Le récit d'une vie, auquel nous assimilerons la carte rêvée (ou bien invisiblement réelle) du territoire mexicain, est non seulement puissance d'organisation mais de prédiction : dans le dit de l'action et des faits et gestes, il faut à tout prix tenir et surtout retenir le sens. Le vagabond trace les contours d'une carte parce que le rêve qu'il a fait lui a indiqué l'imminence d'un danger : la disparition du monde, la mort du vagabond sacrifié sur une pierre dont les antiques traces de sang n'ont pas été lavées par des millénaires d'intempéries.
Car le sens, Cormac McCarthy nous l'a suffisamment répété, n'est absolument pas une évidence, mais un effort de la volonté humaine, une quête harassante de lecture : il faut lire, donc apprendre à lire, puis interpréter. Admettre un sens à l'histoire, au monde qui peut-être glisse vers le chaos, c'est, plus que retenir, choisir, dans une intention (et une limitation) véritablement phénoménologique qui lie de façon inéluctable l'homme à ce qu'il contemple et tente de comprendre : «Et le substrat de ce passé n’est pas différent du tien ou du mien car la vie qui est un attribut de l’homme est ce qui nous assure de notre propre réalité et de la réalité de tout ce qui nous entoure. Notre vision privilégiée de cette nuit unique dans l’histoire de cet homme [le rêveur évoqué par le vagabond] nous oblige à admettre que toute connaissance est un emprunt et que chaque fait est une dette contractée par nous. Car chaque événement ne nous est révélé qu’au prix de notre renoncement à toute variante possible» (pp. 301-2).
D'une autre façon, ce choix peut être assimilé à la voie spécifique qu'emprunterait une question, à l'exclusion de tout autre. S'adresser au Sphinx comporte, nous le savons, des dangers mortels, puisqu'il faut ne pas se tromper de question. Écrire, narrer, c'est choisir mais c'est aussi poser une question : «Au commencement de cette histoire comme de toutes les histoires il y a une question» (p. 304), alors que Billy doute de cette affirmation : «Toutes les histoires ne tournent pas autour d’une question. Mais si lui répond le vagabond puisque, quand tout est connu il n’y a pas de récit possible» (p. 305).
C'est admettre que le mystère est indissolublement lié avec notre capacité de narration : nous ne racontons des histoires que dans le seul but d'une conquête inavouée, gagner au domaine du connu quelques parcelles d'inconnu, faire de cet homme, un étranger, un ami, tout du moins un être qui n'est plus seulement un parfait inconnu. Ainsi, nous nous tairons le jour où nous saurons tout ce que nous pouvons savoir sur l'univers, le jour où celui-ci, devenu pure transparence, ne pourra plus, n'aura plus besoin de refléter ses secrets et ses mystères dans le miroir, forcément ridiculement minuscule et en plus déformant, que lui tendra le récit de sa geste prodigieuse.
Un autre danger menace, bien sûr, puisque nous ne pouvons pas oublier qu'une multitude de signes, dans notre trilogie (et dans bien des autres romans de McCarthy), nous a discrètement livré quelques aperçus de ce que pourrait être un monde ravagé par la destruction, comme l'est celui que traversent les deux personnages de La Route. Sans nous donner la raison de ce soudain affaissement de notre volonté, le romancier affirme que nous pourrions être tentés de ne plus questionner l'univers et, ainsi, de renoncer à notre pouvoir le plus éminent, celui d'organiser en un Livre, compréhensible par tous, du moins celles et ceux qui ont appris à lire les signes, l'univers aux lois non point incompréhensibles mais étrangères à l'homme : «Le livre de bord du monde se compose de ses inscriptions mais n’est pas divisible entre ses rubriques. Et à partir d’un certain point ce registre transcende toute description possible qu’on voudrait en donner et c’est cela je crois qu’a compris le rêveur. Car à mesure que le pouvoir de parler du monde nous échappe du même coup l’histoire du monde se défait fil à fil et perd donc son autorité. Le monde à venir est nécessairement fait de ce qui est passé. Nous n’avons pas d’autres matériaux sous la main. Et pourtant je crois qu’il voyait le monde se défaire sous ses yeux. Les cheminements qu’il avait choisis pour son voyage semblaient maintenant un écho venu de la mort des choses. Je crois qu’il voyait d’atroces ténèbres approcher» (p. 314, je souligne).
Affirmation non point paradoxale mais énigmatique : pourquoi le rêveur, dont le vagabond nous décrit le rêve atroce, sait-il que le monde glisse vers d'inexorables ténèbres ? Nous ne le savons pas, Billy se moque de questionner à ce sujet le vagabond qui lui-même pose cette affirmation comme une évidence, peut-être parce qu'il a pris le soin de dire que le rêve était un langage primordial, absolu dans ses enseignements : «En tout cas c’était un rêve que faisait le rêveur profondément endormi et dans ces rêves-là il y a une langue qui est plus ancienne que la parole. C’est un idiome d’une autre nature dans lequel il ne peut y avoir ni mensonge ni travestissement de la vérité» (p. 308).
Un indice sans doute : si les rêves ne peuvent mentir, c'est qu'ils se rattachent à l'essence même du monde tel que l'ont du moins façonné des générations de femmes et d'hommes aujourd'hui morts, mais qui n'en continuent pas moins de hanter l'esprit des vivants et, de temps à autre, à l'occasion des rêves pourquoi pas, leur livrer de précieux enseignements dont il n'est même pas certain qu'ils parviennent à comprendre la profonde richesse...
C'est que «Le monde des anciens nous demande des comptes. Le monde de nos pères…» (Ibid.). C'est que «Le monde de nos pères réside en nous. Dix mille générations et davantage. Une forme sans histoire n’a pas le pouvoir de se perpétuer. Ce qui n’a pas de passé ne peut avoir d’avenir. Au centre de notre vie il y a l’histoire dont elle est faite et dans ce centre il n’y a point d’idiomes mais seulement l’acte de connaissance et c’est cela que nous partageons dans les rêves et en dehors des rêves. Avant que le premier homme ait parlé et après que le dernier se sera tu pour toujours» (p. 309).
Le rêve est donc l'acte de connaissance essentiel. Pas étonnant, dès lors, que ces «songes-là nous révèlent aussi le monde puisque, ajoute le vagabond, nous nous souvenons à notre réveil des événements dont ils se composent alors que le récit est souvent fugace et difficile à retenir. C’est pourtant le récit qui donne vie au rêve alors que les événements eux-mêmes sont souvent interchangeables. D’un autre côté les événements qui se produisent quand nous sommes éveillés nous sont imposés et le récit est l’axe insoupçonné autour duquel leur trame doit être tissée. Il nous appartient de peser et de trier et d’ordonner ces événements. C’est nous qui les assemblons pour en faire l’histoire que nous sommes nous. Tout homme est le poète de sa propre existence» (pp. 310-1) : surprenante affirmation, facile même qui, lorsque l'on considère le poids invisible (d'actes, de paroles, bref : de morts) pesant sur les personnages de Cormac McCarthy, n'est vraie qu'en partie seulement.
Étrange affirmation que Cormac McCarthy prend lui-même le soin de nuancer, ou plutôt, d'invertir, lorsqu'il admet que, justement, l'homme ne peut pas grand-chose pour contourner le mur de la réalité qui ne peut se dresser face à nous que de façon irrécusable, absolue : «Cette vie qui est tienne à laquelle tu accordes tant de prix n’est pas non plus ton ouvrage, aussi fort que tu l’affirmes. Cette forme a été imposée au néant dès l’origine et tout bavardage sur ce qui aurait pu tourner autrement est absurde car il n’y a pas d’autrement. De quoi pourrait-il être fait ? Où pourrait-il se cacher ? Ou comment pourrait-il se manifester ? La probabilité du réel est absolue» (p. 313).
Si la probabilité du réel est absolue, pourquoi donc accorder une telle importance à un rêve, moins même, au rêve dans un rêve, à l'ombre d'un rêve ? Nous ne sortons pas de la contradiction, sauf à parier sur le fait, nous l'avons dit, que le rêve est peut-être infiniment plus réel que la réalité elle-même, fût-elle la plus absolument inévitable, un mur sur lequel nous allons nous écraser, un couteau qui va déchirer notre ventre, non point parce que celui qui le tient est plus fort que nous mais parce que, une fois notre promise égorgée, quel intérêt aurions-nous donc à retenir une vie qui n'a plus de sens sans le sel et la joie de nos jours ?
Probabilité du réel absolue, non point comme une évidence de pierre, de fer ou de chair, mais comme la mystérieuse réalité qui constitue le soubassement même de chacun de nos actes, la force qui anime nos gestes, le dire qui remplit nos bouches de mots pas complètement éventés ni creux. De fait, nous dit le vagabond, si le monde est (et il est de façon tellement irrécusable qu'il n'a sans doute strictement rien à voir avec la créature humaine qui se déplace dans ses fabuleux paysages, qu'il porte sur son sol caillouteux...), il ne peut être en dehors de sa réalisation, de son effectivité pourrait-on dire, mieux, de son incarnation : «Il est vain de prétendre que les choses n’existent que dans leur manifestation. La matrice [la matriz du Grand passage, utilisée pour capturer les loups] du monde et de tout ce qui s’y trouve a été gravée il y a bien longtemps. Pourtant l’histoire du monde, qui est tout ce que nous savons du monde, n’existe pas en dehors des instruments de sa mise en œuvre. De même que ces instruments ne peuvent exister en dehors de leur propre histoire. Et ainsi de suite» (p. 315). De la réalité, si tant est qu'elle existe, nous ne savons rien et ne pouvons rien savoir, puisque nous en sépare le récit de ses manifestations. Or, qui d'autre que l'homme est-il le maître du récit ? Dieu peut-être, répondra McCarthy mais, de Lui, nous ne savons rien sinon ce qu'Il nous a donné à voir et déchiffrer : sa création, le monde...
Alors nous parvenons à la clé de voûte de l'art romanesque de Cormac McCarthy, qui à vrai dire a dû utiliser bien des détours pour nous apparaître dans son plus complet dénuement, arche frêle de résistance, défi aérien des courbes parfaites contre le temps, que parachève pourtant le savoir-faire entrelaçant des voûtes autant que des forces, cathédrale ou bien sculpture parfaite. Cette simplicité, bouleversante, quand même inattendue, la voici : «Cette vie qui est la tienne n’est pas une image du monde. Elle est le monde lui-même et elle n’est pas faite d’ossements ou de songes ou de temps mais d’adoration. Rien d’autre ne peut la contenir» (Ibid.).
Rien d'autre, hormis, si importants dans l'économie des textes de McCarthy parce qu'ils tissent la trame d'une histoire absolument étrangère à toute forme de représentation purement intellectuelle, le geste qui, à sa façon, est aussi tissu de rêves puisqu'il plonge son pouvoir dans les profondeurs du passé, d'un passé enrichi, informé par la multiplication miraculeuse du même geste sans cesse répété, et répété pour que, dans sa simplicité, il accomplisse le miracle demandé (8) : «Il s’accroupit et leva la main, la paume dehors.
Lève la main, dit-il. Comme ça.
C’est une sorte de serment.
Non. T’es déjà lié par serment. Tu l’as toujours été. Lève la main.
Il leva la main comme l’homme le lui avait demandé.
Tu vois la ressemblance ?
Oui ?
Oui» (Ibid.).
Ainsi, les dernières lignes de notre roman décrivent Billy Parham, accueilli dans la modeste demeure d'inconnus, face à la maîtresse des lieux : «Elle lui caressait la main. Noueuse, marquée par le lasso, tachetée par le soleil et les années de soleil. Les veines épaisses qui les reliaient à son cœur. Il y avait là tout ce qu’il faut pour faire une carte et que les hommes la déchiffrent. Tout ce qu’il faut à Dieu de signes et de prodiges pour faire un paysage. Pour faire un univers» (p. 320).
Finalement, la leçon des meilleurs romans de Cormac McCarthy est d'une simplicité et d'un dépouillement dignes d'éloges : face aux ténèbres qui viennent comme l'annoncent une multitude de signes discrets (9), l'homme peut (plus qu'il ne doit) survivre, si et seulement si il reste un homme, c'est-à-dire un être qui est capable de protéger cette merveille de l'univers qu'est la créature la plus faible (peu importe qu'elle soit cheval, louve, chiot, frère, femme, père ou bien fils (10)) qui, seule, lorsqu'elle erre sur les routes mauvaises, peut éprouver reconnaissance (11) mais aussi piété et amour : «La mort de tout homme est une doublure pour toutes les autres. Et puisque la mort est notre sort commun il n’y a pas moyen d’apaiser la crainte qu’elle inspire si ce n’est d’aimer cet homme qui est là à notre place. Inutile d’attendre que son histoire soit écrite. Voici longtemps qu’il est passé par ici. Cet homme qui est tous les hommes et qui est à la barre à notre place en attendant que notre heure arrive et que nous y soyons à notre tour et pour lui. L’aimes-tu, cet homme ? Honoreras-tu le chemin qu’il a suivi ? Écouteras-tu son histoire ?» (p. 317).
Notes
(1) «Billy contemplait le haut plateau désert. Les fils électriques ventrus qui faisaient la course avec la nuit»,
Cormac McCarthy, Des villes dans la plaine [Cities of the Plain, 1998] (traduction de l’anglais par François Hirsch et Patricia Schaeffer, Éditions de l’Olivier, 1999, Point, 2002), p. 24 et : «Puis ils s’assirent sur la route avec la ligne blanche sous les coudes et la nuit rutilante du désert là-haut, les myriades de constellations se déplaçant imperceptiblement sur les ténèbres comme une faune marine» (p. 38).
(2) «Ils étaient assis adossés à la paroi d’un escarpement sur les hauteurs des Franklins avec un feu devant eux qui tressautait au vent et leurs ombres projetées sur les rochers derrière eux enveloppaient les pétroglyphes gravés là par d’autres chasseurs un millénaire plus tôt» (p. 98). Encore : «[…] et ils passèrent au-dessous de pictogrammes gravés sur les énormes blocs de la paroi, des images de chasseurs et de chamans et de feux allumés pour une fête et de mouflons du désert, toutes dessinées en creux dans le rocher un millénaire plus tôt et davantage» (p. 182).
(3) Ces animaux, qu'ils soient domestiqués ou (redevenus) sauvages (comme une meute de chiens qu'ils s'agira de pourchasser et de tuer, cette scène donnant lieu à de magnifiques pages) sont pour McCarthy, dans ce dernier roman de sa trilogie des Frontières comme dans ceux qui l'on précédé, des créatures psychopompes qui établissent un passage entre l'homme (à condition, toutefois, qu'il soit extrêmement sensible à leur présence) et une réalité insoupçonnable : «Certains soirs au Mexique il les [renards] voyait sortir en terrain nu pour s’aventurer sur les tables de lave en surplomb des plaines et profiter de la vue qu’il y avait de là-haut. Pour voir quelles créatures d’espèces inférieures se risqueraient dehors au crépuscule. D’autres fois ils se contentaient de s’asseoir sur ces murs érigés par Dieu, dessinés en silhouette comme des icônes d’Égypte, silencieux et immobiles contre le ciel de plus en plus sombre, porteurs d’une réponse à toutes les questions» (p. 257). Ce sont bien souvent ces mêmes animaux qui sont par le romancier associés à tout un réseau de figurations symboliques, mythologiques et monstrueuses : «Quand le cheval vit la corde passer contre son oreille gauche il aplatit les oreilles et se précipita ventre à terre et la bouche ouverte comme une monstrueuse gorgone sur le bâtard [un chien] en fuite» (p. 178). Et encore : «La cage thoracique [d’un veau tué par les chiens errants] gisait sur le gravier ses pointes recourbées tournées vers le ciel, énorme plante carnivore guettant dans l’aube nue» (p. 175).
(4) Cormac McCarthy multiplie les jeux spéculaires savants : ce rêve, qui présente bien des similarités avec celui que racontera à Billy Parham l'inconnu, est celui de John Grady Cole, dont la jeune femme qu'il rêvera d'épouser sera sacrifiée par son maquereau : «Il rêva cette nuit-là de choses dont il avait entendu parler et qui étaient bien telles qu’on le disait mais dont elle ne parlait jamais» (p. 115) et «Au centre de tout cela une jeune fille en robe de gaze blanche allongée sur une planche de châlit comme une vierge offerte en sacrifice» (p. 116). Ce rêve, qui annonce celui que l'inconnu raconte à Billy Parham dans l'Épilogue, cf. pp. 296-316, est peut-être, bel et bien, le même que celui raconté par l'inconnu (il faudrait, dans ce cas, supposer que le vagabond du rêve est... John Grady Cole !) puisque dans les deux cas le rêveur semble se réveiller d'un autre rêve : «Quand il se réveilla il ne sortait pas de ce rêve mais d’un autre et la transition de l’un à l’autre lui échappait. Il était seul dans une contrée désolée où le vent soufflait sans relâche et où la présence de ceux qui étaient passés par là avant perdurait dans l’obscurité tout autour» (Ibid).
(5) «En ce monde tout acte irrémédiable en précède un autre, et celui-là un autre encore. Tissant un vaste, un interminable filet. Les hommes s’imaginent que dans les choix qui les attendent c’est eux qui vont trancher. Mais nous ne sommes libres d’agir que sur ce qui nous est donné. Le choix se perd dans le labyrinthe des générations et tout acte dans ce labyrinthe est lui-même un asservissement car il annule toute autre variante et nous enserre toujours plus étroitement dans les contraintes qui composent une vie» (p. 215).
(6) Imbrication visible mais aussi invisible : «Il lui raconta la soirée où il avait vu sa mère sur la scène du Majestic Theatre à San Antonio dans l’État du Texas et des jours où il partait à cheval avec son père dans les collines au nord de San Angelo et il lui parla de son grand-père et du ranch et de la piste comanche qui traversait le ranch à l’ouest et il lui dit qu’il partait à cheval sur cette piste au clair de lune à l’automne quand il était encore enfant ou presque et il lui parla des fantômes des Comanches qui passaient tout autour en route pour l’autre monde et il en venait de partout et d’autres encore car rien ici bas ne s’achève une fois commencé qu’une fois l’ultime témoin arrivé au terme du voyage» (p. 226).
(7) Déclin de la civilisation occidentale dont le maquereau mexicain se fait le curieux porte-parole, au moment où il affronte l'homme dont il a égorgé la promise, lui disant : «Ils nous arrivent ici [au Mexique] de votre paradis pourri pour trouver une chose qui est morte chez eux. Une chose pour laquelle ils n’ont peut-être même plus de nom. Comme ce sont des garçons de ferme le premier endroit où ils ont l’idée de chercher c’est évidemment un bordel» (p. 273). Dans les dernières pages de notre roman, qui décrivent un Billy Parham âgé de soixante-dix-huit ans, les immenses propriétés du ranch pour lequel Billy a travaillé étant jeune ont été rachetées par l'armée tandis qu'une terrible sécheresse a frappé le Texas occidental, vidant le paysage de ses troupeaux de bétail.
(8) «Il n’avait pas vu de timbale à une source depuis des années et il la tenait à deux mains comme des milliers d’autres avant lui qu’il ne connaissait pas mais qu’il rejoignait dans ce sacrement. Il plongea la timbale dans l’eau et la porta, froide et ruisselante, à ses lèvres» (p. 318).
(9) «[…] où la fumée des feux d’ordures brûlait à l’horizon comme la signature de hordes de vandales surgies des solitudes indéchiffrables qui s’étendaient au-delà» (p. 234).
(10) «Elle [la jeune prostituée dont John Grady Cole est tombé amoureux] traversa le boulevard du 16-Septembre les bras serrés contre sa poitrine et les yeux baissés dans l’éclat aveuglant des phares, à demi nue dans un tintamarre de klaxons, fantôme en guenilles expulsé de la nuit primordiale et traqué pendant un bref instant dans le monde visible avant de disparaître une fois encore dans l’histoire des rêves des hommes» (p. 231).
(11) «Un homme venait à sa rencontre sur la route avec un baudet chargé d’une grosse pile de bois de feu. Au loin les cloches des églises avaient commencé. L’homme lui sourit, la lèvre narquoise. Comme s’il y avait eu entre eux deux un secret. Quelque chose sur la jeunesse et le grand âge et leurs droits et la légitimité de ces droits. Et leurs servitudes. Sur le monde passé, sur le monde à venir. Leur commune fragilité. Et surtout la profonde certitude que beauté et deuil ne font qu’un» (p. 80).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, des villes dans la plaine, la trilogie des confins, cormac mccarthy |  |
|  Imprimer
Imprimer