Les Renards pâles : la nouvelle imposture littéraire de Yannick Haenel (04/09/2013)

Crédits photographiques : Joe Penney (Reuters).
 Cacographes (où Philippe Sollers et ses gitons sont longuement évoqués).
Cacographes (où Philippe Sollers et ses gitons sont longuement évoqués). Qui se souvient encore de Yannick Haenel et François Meyronnis ?
Qui se souvient encore de Yannick Haenel et François Meyronnis ?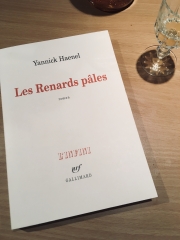 Jean Deichel, le pâle paumé initié (à quoi, pas grand-chose en fait, nous le verrons plus tard) dont Yannick Haenel se sert depuis Cercle comme misérable porte-voix de ses pseudo-thèses dolentes et masque dogon de sa criante absence de talent littéraire, lit, quelques pages après le début des Renards pâles, En attendant Godot de Beckett, et fixe son attention sur le dialogue que nouent les deux vagabonds, l'un s'interrogeant à haute voix et ne recevant aucune réponse, pas plus que nous n'en recevrons, nous : «Que faisons-nous ici, voilà ce qu'il faut se demander».
Jean Deichel, le pâle paumé initié (à quoi, pas grand-chose en fait, nous le verrons plus tard) dont Yannick Haenel se sert depuis Cercle comme misérable porte-voix de ses pseudo-thèses dolentes et masque dogon de sa criante absence de talent littéraire, lit, quelques pages après le début des Renards pâles, En attendant Godot de Beckett, et fixe son attention sur le dialogue que nouent les deux vagabonds, l'un s'interrogeant à haute voix et ne recevant aucune réponse, pas plus que nous n'en recevrons, nous : «Que faisons-nous ici, voilà ce qu'il faut se demander».Je me suis très vite demandé, à mon tour, ce que je faisais ici ou là en lisant le dernier roman de Yannick Haenel, galimatias didactique, livre inepte que l'on peut sans trop exagérer qualifier comme étant l'une des plus magnifiques courges de cette rentrée dite littéraire, comme toujours copieusement arrosée par le directeur de la collection L'Infini, Philippe Sollers qui a trouvé, en Yannick Haenel et François Meyronnis (auquel le livre du premier est bien évidemment dédié, ces deux-là étant inséparables dans leur commune nullité) ses deux plus féroces hongres, ses deux plus lamentables héritiers. Passons, le maître se reconnaît à ses élèves et les productions du potager à la qualité de son fumier.
Les lignes qui suivent immédiatement le passage cité ne m'ont, à vrai dire, qu'assez peu rassuré, puisque Yannick Haenel lui-même se demande ce qu'il fiche dans un roman aussi mauvais, celui-là même qu'il a écrit et qu'il est peut-être en train de relire, prenant conscience de son ridicule au moment où il relit (ou ajoute, allez savoir) ces mots : «cette phrase me parlait car, franchement, passer la nuit au volant d'une voiture immobile, entre un papyrus et une petite lumière bleue, alors que mon enthousiasme se calmait un peu et que mon dos commençait à me faire souffrir, tandis que les bruits de la ville se réveillaient, que la moindre sonnerie, le moindre éclat de voix, le moindre crissement de voitures qui démarrent, freinent, accélèrent et me frôlent en passant rue de la Chine détruisaient le silence, et avec lui la patiente élaboration de mon calme, il y avait de quoi se poser des questions, ou au moins celle-ci : qu'est-ce que je fichais là ?» (p. 28). Cette interrogation pathétique nous parle, comme dirait, dans son français invertébré, Yannick Haenel, car elle traduit peut-être l'unique prise de conscience véritablement littéraire de l'auteur devant sa chimère qu'il faudra au bout de quelques minutes à peine et en ouvrant largement les fenêtres, emballer de feuilles de papier journal, pourquoi pas celles du Monde des Livres, qui a toujours offert une tribune complaisante aux hongres sollersiens, afin de masquer l'horrible décomposition. Drôle de pays tout de même que la France, où quelques Champollions de la critique littéraire journalistique nous assurent que les œuvres de Yannick Haenel ne sont que la contrefaçon mystérieuse et sublime des hiéroglyphes égyptiens; à ce compte, on devrait les graver sur un obélisque pour donner du grain à moudre aux générations futures.
Décomposition disais-je d'un livre ne méritant pas d'être publié, encore moins lu. Décomposition d'un visage, celui, si peu expressif pourtant, de Yannick Haenel, au moment, à l'indicible seconde où il comprend que le pauvre Docteur Frankenstein qu'il s'est rêvé d'être n'a même pas été capable de donner vie à un livre phocomèle et même, prodige rare dans les annales de la tératologie, acéphale.
Les Renards pâles n'est pas seulement un pseudo-roman dont les lecteurs peuvent en effet se demander, une fois qu'ils en ont commencé sa lecture, ce qu'ils fichent à le lire, mais une imposture redoublée, c'est-à-dire une imposture d'abord bien évidemment littéraire, mais aussi une imposture morale, sans doute plus grave que la première. Toute imposture littéraire, comme par exemple celle dont peut se déshonorer un Antoni Casas Ros, un nom que nous retrouverons d'ailleurs plus bas puisque la médiocrité attire toujours la médiocrité, est une imposture morale, et je ne sépare les deux impostures, qui n'en sont qu'une seule en réalité, que dans un souci de clarté. Je vais donc ici plus loin que lorsque, publication dans un hebdomadaire oblige (Valeurs Actuelles), j'avais atténué le titre de ma critique consacrée à Jan Karski, où je n'avais parlé que d'un faux témoignage, avant que d'autres, plutôt rares mais d'autant plus précieux, n'affirment à leur tour que ce livre était un tissu d'âneries et même, une infection. Un faux témoignage ne constitue toutefois pas une imposture, qui suppose un style de vie fallacieux tout entier enté sur un mensonge permanent. Quel est le mensonge, certes très répandu et conforté par des organes de presse tels que le très sollersien donc ridicule Monde des Livres, mais pas moins inexcusable, de Yannick Haenel ? Se croire un écrivain.
Imposture littéraire du livre de l'auteur : passons sur l'absence de style de Yannick Haenel, absence creusée de livre en livre, ce qui tient d'une louable opiniâtreté. N'évoquons point son usage de l'italique, du plus haut ridicule puisqu'il est chargé, lorsque l'auteur ne sait plus quoi dire pour masquer son incompétence, adresser un clin d’œil appuyé aux lecteurs, aux happy few qui, du moins le suppose-t-on, sont censés pallier les carences affligeantes d'Haenel, qui facilement prend la pose habile d'une espèce de sphinx délivrant des vérités inouïes. Seulement, les vérités de Yannick Haenel sont connues de tous et, je l'ai dit, elles-mêmes plantées dans le terreau d'un mensonge permanent, celui de se croire un écrivain, celui de croire que Yannick Haenel sait écrire.
Las car, en guise de révélations inouïes, voici ce que l'indigent oracle nous livre, quelques miettes d'animisme ou de chamanisme, notre pâle sollersien se rêvant hiérophante et n'étant que fantaisiste vétérinaire : «Ma tête était si près de la gueule du chien qu'il me semblait que j'avalais ses convulsions. Je m'étais abandonné – entièrement ouvert. J'ai allongé mon bras pour entourer le chien. Dans son agonie, il répandait son souffle. Ses mâchoires se sont crispées, sa langue a cessé de s'agiter. Le sang versé vous soustrait à la logique, ceux qu'il attache ne disent plus moi : le chien et mon corps se substituent» (p. 51, l'auteur souligne).
Les exemples sont à vrai dire innombrables de ces sentences creuses que les italiques aimeraient parer d'une aura d'intelligence, et dont elles ne font qu'accroître la fausse profondeur. Ainsi : «La politique mange les corps qui ont encore la faiblesse d'y croire», formule frappante (comme telle autre : «Je me mets à penser que le traitement des déchets remplace la mort; et que cette substitution est le destin même des corps», p. 65) pour tel auteur qui, par exemple Harry Harrison dans un roman post-apocalyptique adapté au cinéma dans le très fameux Soleil vert, évoquerait une société qui a fait de la chair humaine la base de son alimentation. Mais quel est l'intérêt de cette remarque dans l'économie du roman creux de Yannick Haenel, surtout lorsqu'il ajoute, très platement : «Cette phrase définit ce que je pensais à l'époque», ce dont nous sommes vraiment contents, et qu'il ajoute qu'il ne s'agit là que de «l'expression d'un rire» qui, retournement nietzschéen bien fade, est supérieurement sérieux ?
À vrai dire, il n'y a, dans le roman de Yannick Haenel, aucune invention romanesque, aucun personnage solidement campé, aucune esquisse psychologique et même, aucun dialogue ou alors d'une pauvreté sidérante, comme celui qui suit :
«– Alors comme ça, vous êtes avec moi ?
– C'était pour vous venir en aide.
– Vous êtes un saint ?
– Saint Jean.
– Les saints savent-ils tirer au canon ?
– Au fusil plutôt, et ils lisent Marx» (p. 98). Nous pourrions gloser à l'infini, c'est le cas de le dire, sur cette quadruple absence (et même nous moquer fort méchamment de l'une des scènes sexuelles les plus ridicules qu'il m'a été donné de lire) mais, en fait, elle tient à peu de choses : Yannick Haenel, s'il est quelque chose (les journalistes disent : un écrivain. Nous en doutons fortement et avons plusieurs fois démontré qu'il n'en était pas un), n'est absolument pas un romancier c'est-à-dire, un homme capable d'inventer un monde sans planquer ses idées derrière quelques hardes empruntées aux dépouilles complaisantes de Debord ou de Marx, de Beckett ou de Rousseau, voire sur tel écrivain à succès encore bien vivant, Michel Houellebecq (cf. p. 46), pourtant détesté par les jumeaux, si mes souvenirs sont bons, sans doute parce que l'auteur de La Possibilité d'une île vend beaucoup plus de livres qu'eux deux réunis, et même toute l'écurie sollersienne.
Car enfin, si force est de constater que la thématique principale de son livre (la révolte d'une poignée, grossissant en armée de l'ombre ou secte versicolore qui bat en brèche, ou ne va pas tarder à battre, la société française telle que nous la connaissons) est pour le moins classique lorsqu'elle est mise en scène dans des ouvrages de science-fiction comme Le Rat blanc (Fugue for a Darkening Island) de Christopher Priest ou même Le Camp des Saints de Jean Raspail, nous ne voyons pas, dans Les Renards pâles, la plus petite trace d'invention. Il ne se passe à vrai dire rien puisque rien n'arrive à Jean Deichel, puisque rien ne lui est révélé de cette si invisible réalité indiquée par des slogans de potaches sur les murs parisiens, puisque rien ne se passe dans la seconde parte de notre roman (qui n'en est donc pas un), bien que son auteur, lui, trépasse... jusqu'au prochain de ses livres qui sera comme d'habitude édité par un directeur de collection qui ne mérite pas ce titre depuis bien des années.
Yannick Haenel, outre qu'il est un écrivain à peu près inexistant tout gorgé, comme une orange qu'il suffirait de presser, de mots creux qui plaisent aux journalistes et aux demi-mondaines (souvent les mêmes), est un romancier sans la moindre imagination, ce qui est tout de même moins grave que d'être un romancier qui n'en est pas un, ce qui est le cas de ce pauvre auteur sans œuvre véritable, puisque tout y est resucée, ersatz, thèses pour rire de cinquième ou sixième main. Ainsi, plutôt que de nous décrire, y compris de façon sommaire, les conséquences induites par un événement bouleversant les fondements mêmes de la société, comme par exemple nous le montre le remarquable roman de S. S. Held intitulé La Mort du fer ou, chez nos compatriotes, Avant de disparaître de Xabi Molia, Yannick Haenel se contente d'enfiler de magnifiques phrases dans la seconde partie de son texte, sans doute pour en faire un collier de truismes, où la seule trace d'un procédé stylistique notable consiste dans l'usage du pronom personnel «nous» dans lequel s'inclut bien sûr le narrateur, à seule fin de stigmatiser un «vous» dans lequel, tout aussi mécaniquement, nous devinons que se retrouve parqué l'ensemble des lecteurs, qu'il s'agit de frapper comme s'ils étaient les membres de l'ordre policier inébranlable qu'il faut à tout prix, justement, ébranler et même, culpabiliser. Pour notre auteur, tout Français doit se sentir coupable de laisser évacuer sa merde par un travailleur noir, voici je crois le meilleur résumé de la haute porté intellectuelle de son livre. Ainsi : «Nous n'avons pas eu grand-chose à faire pour allumer ce brasier : il est facile d'envoyer aux flammes un monde qui se consume depuis si longtemps dans son chaos. À chaque instant, celui que vous avez construit perd son équilibre, parce que dans ce monde tout se vaut : chaque chose y est égale à son contraire, autrement dit plus rien n'a de valeur» (p. 116, l'auteur souligne). Paresse donc que cette tirade grandiloquente, là où un des auteurs que nous avons cités, même maladroitement, essaierait de présenter une analyse plausible de l'évolution sociale due à un événement comme l'est une révolution, ce mot que Haenel ne cesse d'écrire et dont nous ne savons rien, ni même si ce n'est pas qu'un simple raout durant lequel les crétins confondent les pavés avec les petits fours, comme durant Mai 68 : «La contemplation d'un désert dont chacun de nous recompose le sable grain par grain fonde un minuscule verger; de ce bout de terre, de cette île dont nous sommes à la fois le roi et les brigands – les éternels pirates –, il est possible de jouir à l'infini. Une telle jouissance ne s'enferme pas sur elle-même : elle a pour vocation de se substituer à la France» (pp. 119-20).
Ce programme politique, d'un rousseauisme lacrymal absolu (enfin, d'un rousseauisme tel que Haenel l'a compris...) et d'une stupidité démagogique que d'autres que moi, plus qualifiés, apprécieront, s'étend et dure des pages entières, très exactement des pages 115 à 175. Par sadisme, j'aimerais que vous goûtiez, quand même bien moins que moi hélas, la nullité crasse des tirades haenéliennes, que l'on dirait tirées de quelque petit Livre Rouge à prétentions littéraires : «Dans le monde des masques, un champ de neige peut se couvrir de tourterelles qui chantent la victoire. Le sang peut gicler facilement d'un mot trop vivant qui entaille une certitude. Les barbelés, les matraques, les menottes, les bombes lacrymogènes circulent comme des mots raturés sur une page; ils sont en trop mais impossibles à effacer. En un sens, c'est eux qui donnent à notre action l'intensité qui la destine au combat» (p. 125).
Une analyse sociale voire politique quelconque, fût-elle réduite à quelques sommaires linéaments ? Aucune je vous l'ai dit, Yannick Haenel, qui se prend pour un écrivain, écrit vous dis-je !, et, comme il est un très probable lecteur inculte, il ne sait rien d'un Caesar's Column d'Edmund Bois-Gilbert (pseudonyme d'Ignatius Donelly), où la civilisation s'effondre à la suite d'une révolution anarchiste ultra-violente, ou même des Nouvelles de nulle part de William Morris. Après le baratin sentencieux plaisamment évoqué ci-dessus, voici à présent sa version ethnique (oui car les révoltés haenéliens s'inspirent des Dogons !) : «Dans nos corps instruits par la mort s'allument des scènes de chasse; elles défilent en hommage à nos deux frères [Issa et Kouré, qui se sont noyés en se jetant à la Seine, alors qu'ils étaient poursuivis par des policiers] qui connaissent comme chacun de nous l'esprit de l'antilope, l'esprit de la hyène et du rapace, l'esprit du lion que nos ancêtres [celui de Yannick Haenel ?] chassaient à l'arc» (p. 129).
Encore ? Bien sûr. Ne vous ai-je pas dit que jamais vous ne lirez autant de fadaises que je n'en ai lues, puisque, du moins je l'espère, vous ne lirez pas la rinçure de Yannick Haenel une fois terminée la lecture de cette note ? Du moins je veux que vous compreniez à côté de quel salmigondis, par chance et, surtout, grâce à mon dévouement, vous êtes fort heureusement passés : «Par le sang, la parole et le tournoiement [ah, le tournoiement, l'une des figures favorites des cacographes Yannick Meyronnis et François Haenel] des rhombes, c'est là que nous intervenons : au point précis, presque impossible à localiser, où à chaque seconde un monde se fait et se défait» (p. 132), ou bien : «Lorsque vous portez en vous un désert, vous cherchez une transparence capable d'en effacer la rudesse : vous allez vers l'eau» (p. 138), ou encore : «Même si nous sommes apatrides, à chaque instant s'ouvre un lopin, une parcelle, une marge. Ce pli argileux mangé d'orties entre deux pierres vous semble infime : il nous suffit. En y insérant notre joie, nous l'agrandissons; il se déplie comme les pans d'une carte du monde» (p. 150), ou encore : «commencer la journée en faisant des longueurs élargit le calme» (p. 89), ou encore : «Mon sang est froid, mais il arrive que cette froideur se change en cendres, comme si je m'éteignais; alors la torpeur me gagne : étrangement, elle brûle» (p. 76), ou encore : «Son crâne rasé [celui d'un certain Ferrandi, artiste qui prend des photographies des caméras de surveillance pour dénoncer leur présence dans une foudroyante rébellion] avait la violence d'un deuil qui vous déclare la guerre» (p. 74), ou encore : «La nudité des arbres creuse un trou dans l'univers où les humains croient exister; elle déjoue leur connerie» (p. 60) et enfin, parce que, décidément, je suis trop bon et que, à la différence de Karl Kraus, je ne puis décemment me contenter, à seule fin de ridiculiser un auteur, de citer les phrases qu'il n'a pas eu honte d'écrire, ce salmigondis ésotérique : «Ce chant que nous récitons, nous l'inventons à mesure. C'est un texte-falaise, sans cesse repris, complété, couturé d'incises : en nous détachant de votre emprise, il relance notre liberté. Nous ne respectons rien de ce qui fait barrage à la poésie. Et nous rions de ceux qui pensent qu'elle est un luxe. La déflagration qu'avec patience nous attendons, et qui seule à nos yeux est digne de troubler l'ordre du monde, ne se déclenche qu'avec la poésie : un détail agissant soudain sur des milliers d'esprits vivants illumine par ses prolongements jusqu'au monde des morts, c'est lui qui allume la mèche» (p. 156).
Ce dernier passage cité est intéressant pour une seule raison, puisqu'il met à nu l'unique pauvre ficelle de l'art littéraire de Yannick Haenel : le bazar. Bazar ésotérisant tout de même, car il est bon, ne serait-ce que pour faire frémir les journalistes et celles et ceux qui les liront, donc augmenter possiblement les ventes, de convoquer hâtivement quelques maigres notions que le compendium pourtant fort vulgarisateur de Louis Pauwels et Jacques Bergier, Le Matin des magiciens qui connut naguère un succès foudroyant, n'aurait même pas pris la peine de citer. Il est vrai que les connaissances ésotériques de notre écrivant, sorte de sous-Ballanche encore plus brouillon que l'auteur de La Vision d'Hébal, sont aussi maigres que l'est sa compassion de titi parisien pour les naufragés sans entrailles qui peuplent son livre, bouffonnerie convenue qu'une seule ligne de William Faulkner par exemple, où il évoque l'endurance de celle qui fut sa nourrice noire, ridiculise à jamais.
Il s'agit donc, dans le barnum haenélien, d'évoquer un pouvoir occulte, le ban et l'arrière-ban d'un anarchisme conspirationniste de salon parisien, d'une révolte et même d'une révolution si mal campées qu'un sifflet en plastique suffirait à en dissiper les instigateurs, il s'agit donc de camper, sans force mais avec beaucoup de béquilles et même un peu de glu, une indignation convenue, une résistance de salonnard de la rue Sébastien-Bottin. Mais, parce que Yannick Haenel, nous dit-on (il a même fini par s'en convaincre) est un écrivain, ce pouvoir déracinant (1) ne peut qu'être le fruit de la déhiscence d'une parole opérante, magique, que l'auteur et son compère à grelots François Meyronnis, feignent de rechercher de livre nul en livre nul : «Le livre [consacré au Renard pâle, dieu des Dogons du Mali, surnommé Godot par le personnage principal], en débordant de toutes parts, mettait ainsi en scène, dans sa forme, l'excès fabuleux dont il traitait; et c'était comme si le Renard pâle avait composé cet ouvrage lui-même avec ses pattes, lui donnant ce caractère tortueux, énigmatique, qui était le sien» (p. 111). Que fait Haenel de ce motif qui eût pu être intéressant, traité à la manière, par exemple, d'un Umberto Eco dans Le Nom de la rose ? Absolument rien bien sûr car Yannick Haenel, s'il est doué, paraît-il, pour enfumer (les imbéciles seulement, ce qui fait certes pas mal de monde), est incapable de penser un livre, de le construire savamment, d'en établir le plan complexe et le subtil agencement qui fera se répéter les motifs, jamais tout à fait les mêmes (comme dans la figure de la gyre chère au poète Yeats) mais ordonnés de façon à ce qu'ils se répondent et établissent une grille de correspondances, composant un récit digne de ce nom. Un grand roman est un labyrinthe, alors que Les Renards pâles ont l'épaisseur d'une synapse de puceron sauteur, dont la particularité serait de se déplacer de navet en navet.
L'imposture littéraire (enfin, pas même littéraire) que constitue le dernier roman de Yannick Haenel est, je l'ai dit, une imposture morale, qui appuie ses murs en carton pâte sur des fondations pourries, le tout constituant une étrange cahute à prétentions politiques hautement comiques. C'est la seule réussite du livre d'Haenel, je le signale au passage, que cette confondante ressemblance entre la pauvreté de l'idée ayant présidé au bouturage de son livre et le développement de sa très chétive tige. D'autres que moi évoqueront peut-être cette dimension, de loin la plus ridicule, des Renards pâles, que l'on dirait tout à la fois calquée des romans d'Antoni Casas Ros (2), du piètre V pour vendetta (cf. p. 159) et, pour les lecteurs les plus prétentieux, des analyses mal digérées de quelque épigone de Giorgio Agamben (cf. p. 160) qui aurait confondu une tentative d'analyse du concept de communauté avec un rébus pour emballage de confiserie : «Les Renards pâles forment-ils une communauté ? Nous n'exigeons rien de ceux qui agissent avec nous; chacun est seul avec son masque : ce qui a lieu sous notre nom n'existe qu'à travers cette solitude qui en défait la limite. L'absence de limite n'appartient à personne, pas même aux Renards pâles : c'est elle qui définit ce que nous entendons par communauté. Tant pis si vous n'y comprenez rien : nous en appelons à la communauté de l'absence de limite – c'est-à-dire à la solitude de chacun, à ce qu'il y a d'imprenable en elle» (p. 161). Si encore la lecture de telles sottises marmoréennes était entraînante, nous ne bouderions pas notre plaisir de potache, comme lorsque nous lisions les romans d'Eugène Sue ou de Gaston Leroux, mais notre Yannick Rouletabille, qui n'est jamais drôle, est seulement horriblement prétentieux, prétentieux comme seul peut l'être qui ne saurait douter une seule seconde de sa mission socialo-cosmique : Yannick Haenel veut nous ouvrir les yeux, sur le ravage qui grandit, le désert qui croît, les masques des Dogons qui font peur, les petits blancs friqués qui ont peur de ceux qui portent des masques guerriers qui font peur lorsqu'ils en ont assez de ramasser la merde des petits blancs friqués, lecteurs, sans doute, des romans de Yannick Haenel, ce qui leur permettra de se prétendre de gauche à peu de frais. Qu'ils s'avisent cependant de ceci : il n'y a réellement pas plus d'idée dans un livre quelconque de Yannick Haenel qu'il n'y a de mystère dans un cérémonial maçonnique, ou alors, c'est le même mystère, pas même dénaturé au rang de devinette, qui préside à ces cérémonies fantoches par lesquelles je le présume Yannick Haenel a dû recevoir, la toute première fois, les exemplaires de sa rinçure.
Une nouvelle fois, Yannick Haenel, qui n'est certainement pas un imbécile même s'il est un écrivain nul, se rend compte que ses propos, en plus d'être ridicules, n'ont tout bonnement aucun sens dans un roman et même, se contredisent. Car, si c'est ici la solitude ou plutôt l'absence (cf. p. 63) qui est vantée ou comme, en début de roman, le déclassement social (3), comment rapprocher, si ce n'est par le biais d'artifices de jésuite, cette solitude paraît-il révolutionnaire de l'action collective des Renards pâles ? Haenel, du reste, ne le sait pas, lui qui a été bien incapable de relier efficacement la première partie de son roman, qui décrit la vie dans sa voiture d'un désœuvré (cf. p. 17) que nous pourrions rapprocher, puisque le personnage de Haenel désire ne plus travailler (cf. p. 20), de la profession de foi faite par François Meyronnis dans son dernier texte, à la seconde, confuse bouillabaisse où surnagent des morceaux d'anarchisme militant et d'indignation sélective, de tiers-mondisme bon teint et de slogans lycéens contre les flics (4), le tout péniblement ajointé grâce à un brouet de mots creux comme «reste» (p. 117; tiens, Agamben, encore) et de phrases grandiloquentes et donc tout aussi creuses : «La loi n'a de cesse d'imposer sa volonté, mais il est donné à chacun de nous de détruire cette volonté. On peut faire un trou dans la loi avec du feu. On peut, avec des flammes, éloigner l'esprit mauvais qui nous traque. On peut faire partir en fumée l'envoûtement policier. On peut, avec nos yeux, nos mains, nos jambes, avec cette joie qui nous vient du Renard pâle, déjouer le sort qui veut nous astreindre» (pp. 141-2).
Examinons plus avant les fondations paraît-il politiques sur lesquelles Haenel a bâti sa bicoque en crotte séchée de chèvre du Larzac. Foin des grands mots que les jumeaux Meyronnis-Haenel aiment tant répandre dans leurs textes, pour que leurs courges démagogiques prennent quelques couleurs rappelant les cultures de plein air car, dans Les Renards pâles, l'auteur a décidé de nous démontrer la finesse de ses vues. Quel est le coupable ? L'argent bien sûr, la finance (5), face ténébreuse de la consommation effrénée qui ne peut se nourrir que de crise, l'antienne est originale n'est-ce pas ! Enfin si, discrètement, encore un gros mot et même deux («ravage» et «ruine») noyés dans le potage haenélien : «Mais votre monde n'a jamais fait que tourner mal : ce qu'il tourne et retourne à n'en plus finir, c'est son ravage. Votre monde est lui-même une crise, il s'est envoûté dans sa ruine. Plus rien de vivant ne s'y transmet, sinon des ordres que vous croyez donner et auxquels vous ne faites qu'obéir : l'envoûtement n'hérite que de lui-même, il détruit ceux qui ne parviennent pas à le briser» (p. 168, l'auteur souligne, on s'en doute).
Bien évidemment, il s'agit, pour Yannick Haenel, d'avoir bonne conscience et de faire feu de tout bois, surtout s'il vient d'Afrique et que, fort logiquement dans son optique, il n'a pu être arraché à sa terre que par d'infâmes colonisateurs dont le credo est rappelé par les mots de Kurtz, «Exterminez toutes ces brutes !» (p. 118), ce qui témoigne assurément que la lecture de Joseph Conrad n'aura rien inspiré à notre cancre, sinon des banalités pas mêmes dignes d'un Éric Vuillard dans ses derniers textes, La bataille d'Occident et Congo. De fait, comme notre écrivain défend les sans-papiers et attaque la finance, autant prononcer un discours que ne désavouerait pas un Mélenchon, en évoquant l'existence d'une guerre civile invisible qui mine la France : «une guerre civile divise la France, comme tous les pays qui suspendent le droit de certaines personnes en criminalisant leur simple existence. Elle oppose les étrangers «indésirables», comme vous dites, et les forces de police. Le plus souvent, elle est dissimulée pour des raisons politiques : ainsi reste-t-elle en partie secrète; mais il arrive, pour les mêmes raisons, qu'on l'exhibe : elle dégénère en spectacle, et les médias, en présentant les sans-papiers comme des délinquants qui enfreignent une loi, maquillent alors cette guerre en lutte contre l'insécurité» (p. 146). Quelle hauteur de vue que cette tirade vaguement debordienne à laquelle il ne manque plus que l'AOC de SOS Racisme, quelle littérature et surtout, quel style !
J'ai affirmé que Les Renards pâles constituaient non seulement une imposture littéraire mais encore morale, sans expliquer pour l'heure ce terme, qui peut choquer les tenants d'un art dédouané de tout impératif catégorique. Ce n'est pas notre conception, justement, de l'art, et singulièrement de la littérature : un beau livre élève, un mauvais livre abaisse et je crains que le mauvais livre que Sollers n'a pas eu honte, comme à son habitude, de publier, n'abaisse celles et ceux qui le liront en leur donnant peut-être de faux espoirs, en les trompant. Car, à l'évidence, tout n'est pas médiocre et faux dans le livre de Yannick Haenel et il est tout aussi clair que, malgré la pauvreté insipide de son art, la nullité de son talent de romancier, la banalité des constats qu'il pose, de pathétiques jeux de mots (6) ou encore la démagogie idéologique de ses fort maigres vues (7), telle de ses critiques politiques, bien que banale, vise juste : «Le renoncement s'était emparé de cette ville [Paris], où chacun, peu à peu, s'était replié sur ses compromis, en simulant des désirs qui n'étaient déjà plus que le réflexe de consommateurs tristes» (p. 26). Je n'affirme certes pas qu'un écrivain, fût-il aussi mauvais que Yannick Haenel qui a comme il se doit droit à de complaisantes et navrantes interviews mondaines dont le principe même me paraît tout de même assez éloigné de la misère tant décriée, n'aurait pas le devoir, s'il le souhaite, de parler au nom d'un peuple de l'ombre qu'il estime opprimé, mais n'est pas Charles Péguy (8) qui veut et la sympathie de Haenel pour les sans-grades nous semble, bien davantage qu'une réelle charité et même une véritable souffrance, un habile coup médiatique. Cet homme est un Assis, au sens rimbaldien du terme, certainement pas un marcheur et encore moins un sans-papier comme son personnage, et il serait sans doute méchamment démagogique mais néanmoins justement cruel de retourner le cynisme de Yannick Haenel contre lui-même, en lui demandant, devant témoins et caméras, pourquoi pas dans le bureau de son cher Philippe Sollers, onagre progressiste, de brûler sa carte d'identité et l'ensemble des papiers qui lui assurent une existence civile : enfin, il pourrait pleinement se consacrer à son art misérable, qui consiste à écrire des livres misérables.
La grande littérature est seule capable de donner voix aux humiliés et aux offensés et c'est se moquer d'eux, tout en se donnant belle et fière figure, que de les défendre d'aussi pitoyable et grossière façon que le fait Yannick Haenel, sans le moindre talent véritable mais avec un art consommé du cliché larmoyant et bien-pensant. Ajoutons qu'il les insulte, ces pauvres, mais depuis la rive opposée où un Richard Millet ou bien un Renaud Camus lâchent leurs petits pets xénophobes, tous deux de moins en moins écrivains à mesure que le chancre de l'idéologie confondue avec la politique les dévore.
Je ne sais si cet état de fait n'est finalement pas plus cruel que ne l'est l'irrévocable nullité littéraire de Yannick Haenel, qui n'a pour sûr jamais été, lui, et ne le sera certainement jamais, un écrivain.
Notes
(1) Puisqu'il s'agit, tout au long de ce livre, de se déraciner définitivement de toute appartenance à un pays visiblement détesté, la France, en se débarrassant de l'icône policière, donc fascisante, qu'est l'identité (cf. pp. 107, 160, 174), comme l'indique d'abondance la thématique des masques africains derrière lesquels nos paumés cachent leur fureur.
(2) Je ne sais si Yannick Haenel a lu les sornettes verbeuses d'Antoni Casa Ros mais il est évident que, chez ces deux écrivains en quête d'un sacré de foire à tout, le mysticisme s'est dégradé en érotisme convenu (cf. pp. 156-7) à prétentions révolutionnaires. De plus, la communauté de pseudo-artistes dans laquelle le personnage de notre livre échoue (cf. p. 38) n'est pas sans rappeler celle que Casas Ros a longuement décrite dans Enigma. Voyons ainsi quelle est la pauvreté du nouveau culte païen imaginé par Yannick Haenel, lorsqu'il s'agit d'honorer la mémoire d'un sans-abri déchiqueté par une benne à ordures : «Lorsque j'ai fait le geste de m'accroupir, ils ont fait comme moi; puis quand j'ai creusé un petit trou, planté un bâton et disposé des brindilles ils ont acquiescé et se sont tout de suite recueillis. Ils ont chacun sorti de leur poche un objet qu'ils ont déposé là, pour le mort : Issa, un caillou; et Kouré, un bout de ficelle rouge. Alors, j'ai versé un peu de vodka dans le petit trou, et on est resté là tous les trois, accroupis, sans rien dire. Kouré a disposé la ficelle rouge entre le bâton et les brindilles; Issa a placé le caillou au bord du trou. On ne bougeait pas. On attendait. J'ai pensé : trois qui attendent» (p. 68).
(3) Curieusement, comme si le livre de Yannick Haenel n'était pas suffisamment confus, voici qu'il nous propose une pseudo-analyse de ce qu'il nomme l'intervalle et qui se définit ainsi : «Personne ne sait ce qui arrive dans le vide. Personnellement, j'appelle ça l'«intervalle». Pas facile à décrire : une bouffée de joie, et en même temps une déchirure. Pas facile à supporter, non plus : une sorte d'immense souffle. Est-ce que ça étouffe, est-ce que ça délivre ? Les deux : c'est comme si vous tombiez dans un trou, et que ce trou vous portait» (p. 18). Je précise que l'auteur, selon toute vraisemblance, était à jeun lorsqu'il a relu les épreuves de son texte, sinon lorsqu'il l'a écrit. Voir encore page 34 : «Mais en sautant, je ne suis pas tombé : j'ai glissé à l'intérieur d'un vide – dans cet étrange intervalle d'où je vous parle».
(4) C'est bien simple, lire Yannick Haenel, c'est lire une feuille de choix anarchiste où quelques crétins sans beaucoup de plume, le plus souvent issus des beaux quartiers qu'ils affectent, comme leurs parents bourgeois, de mépriser, décident martialement de refaire le monde en alignant péniblement quelques vilains mots. Il est à ce titre assez pathétique de voir de quelle façon Yannick Haenel légitime les pillages auxquels les voyous se livrent, de plus en plus régulièrement, dans les grandes métropoles françaises : «Le long de la rue de Rivoli, rue de Castiglione et jusqu'à la place Vendôme, des vitrines ont été brisées; la foule commençait à saccager les boutiques de luxe. Dans certains cas, le pillage est la réponse naturelle à cet excédent de marchandises qu'est le luxe. En mettant le feu publiquement à des foulards haute couture et à des robes de prix, en pulvérisant sous nos talons des bracelets-montres à cinquante mille euros, on ne fait que révéler l'extravagante dépense qui affole votre monde», les policiers, comme nous ne pouvons que nous en douter, s'étant infiltrés dans la foule, puisqu'ils sont chargés par l'État «d'introduire de la violence dans les marches les plus pacifiques afin d'en légitimer la répression» (p. 169). J'avoue que de telles pleurnicheries, glanées sur des dizaines de sites militants, tous bords politiques confondus, qui relaient les événements propres à telle ou telle manifestation logiquement encadrée par la police, me laissent pantois. Je n'omets pas de citer tel passage où l'auteur compare l’œil des caméras de surveillance à un anus, ce qui donne : «Tu te rends compte de cette découverte : l’œil du contrôle est un anus ! En nous surveillant, ils nous violent : la vérité de la surveillance est anale» (p. 76, l'auteur souligne).
(5) Vous avez bâti un monde où la maîtrise elle-même vous ligote. La vie de chacun n'est-elle pas asservie au règne délirant de la finance – en proie à ses dérèglements calamiteux ? N'est-ce pas vous qui partez en fumée, lorsque des milliards de milliards d'euros disparaissent en une microseconde à travers la spéculation de vos marchés ?» (p. 167).
(6) Les révoltés d'opérette auxquels le personnage du livre s'est joint, une fois qu'ils ont jeté aux flammes leurs papiers et cartes d'identité, choisissent des noms d'emprunts plus ou moins fantaisistes. Parmi eux se trouve un certain «Jan Sobibor», probable mélange de Jan Karski, sur lequel, souvenons-nous en, Yannick Haenel a écrit un livre indigne, et de la thématique de la Shoah qui inquiète visiblement les jumeaux Haenel-Meyronnis.
(7) «Lorsque, pour se venger d'une rafle qui a échoué, les policiers passent ainsi à tabac l'unique perturbateur qu'ils ont capturé et qu'ils s'aperçoivent, durant la garde à vue, que ce dangereux saboteur est un universitaire acclamé dans le monde entier, un artiste dont ils ont vu le visage à la télévision, un acteur de cinéma – une vedette –, durant quelques secondes leurs traits se décomposent. C'est si bon de vous voir grimacer; nous savourons l'instant où vous vérifiez l'identité de l'honorable citoyen, de la célébrité que vos sbires viennent de molester» (p. 148). Dans ce passage, nous constatons que l'insurrection de pacotille qu'imagine Yannick Haenel s'arrête, fort heureusement, devant les fourches caudines de la célébrité journalistique.
(8) Je ne suis bien évidemment pas à l'abri des critiques mais enfin, lorsque j'ai tenté d'imaginer quel pourrait être le discours d'un de ces opprimés selon Yannick Haenel, le meurtrier antisémite Youssouf Fofana, je ne l'ai fait qu'en évoquant la thématique du langage vicié, qui d'ailleurs est bien loin de ne concerner que telle ou telle classe de la population française, refusant les facilités idéologiques composant le pseudo-roman de notre auteur.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, rentrée littéraire 2013, yannick haenel, philippe sollers, françois meyronnis, les renards pâles, éditions gallimard, collection l'infini |  |
|  Imprimer
Imprimer