Richard Millet tel qu'en lui-même l'érotisme guerrier le dresse : Tuer (06/12/2015)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Richard Millet dans la Zone.
Richard Millet dans la Zone. C'est par l'exposition publique de mon admiration pour les Éditions Léo Scheer que je commencerai cette note consacrée au dernier ouvrage publié de Richard Millet, cacographe à plein temps, dont il est difficile de savoir quel est, au juste, le dernier livre publié, tant cet écrivant écrivaillonne, tant les rhizomes pâles de sa prose à odeur de champignon s'étendent et, surtout, tant il parvient à se faire publier, ce qui est la preuve incontestable que les éditeurs français ne savent plus vraiment lire, ou bien alors qu'ils aiment les proses à odeur de champignon. Léo Scheer, lui, mon cher Léo Scheer n'est pas un de ceux-là, fort heureusement, et c'est un bonheur que de l'écrire ! Beaucoup d'éditeurs, tous sans doute ou peu s'en faut en fait, publient de grands et de forts mauvais livres. Ainsi, Actes Sud a édité Imre Kertész et W. G. Sebald, mais aussi Claro et Mathias Enard. Ainsi encore la maison Gallimard n'a-t-elle pas eu honte de publier dans sa collection de la Pléiade, de moins en moins prestigieuse il est vrai, et cela à mesure que les universitaires la surchargent de leurs gloses bien souvent inutiles (comme le montrent les deux récents volumes boursoufflés des romans de Georges Bernanos), Jean d'Ormesson, sans doute pour lui permettre d'ajuster sa future bière aux dimensions de son insignifiance, réduite à un petit volume au papier Bible. Ainsi enfin Albin Michel a trouvé absolument logique de faire paraître des textes du grand Elias Canetti, comme son autobiographie en plusieurs volumes, et L'homme idéal existe. Il est Québécois de Diane Ducret, dont nous attendons la suite avec une prodigieuse impatience, qui devrait s'appeler selon toute probabilité et habituelle poésie du marketing publicitaire : L'homme à cheval dont la femme était la maîtresse d'un dictateur péruvien est probablement un excellent amant antillais qui a même lu Claude Romano dont la pensée phénoménologique n'est pas (encore) interdite au Pays basque.
C'est par l'exposition publique de mon admiration pour les Éditions Léo Scheer que je commencerai cette note consacrée au dernier ouvrage publié de Richard Millet, cacographe à plein temps, dont il est difficile de savoir quel est, au juste, le dernier livre publié, tant cet écrivant écrivaillonne, tant les rhizomes pâles de sa prose à odeur de champignon s'étendent et, surtout, tant il parvient à se faire publier, ce qui est la preuve incontestable que les éditeurs français ne savent plus vraiment lire, ou bien alors qu'ils aiment les proses à odeur de champignon. Léo Scheer, lui, mon cher Léo Scheer n'est pas un de ceux-là, fort heureusement, et c'est un bonheur que de l'écrire ! Beaucoup d'éditeurs, tous sans doute ou peu s'en faut en fait, publient de grands et de forts mauvais livres. Ainsi, Actes Sud a édité Imre Kertész et W. G. Sebald, mais aussi Claro et Mathias Enard. Ainsi encore la maison Gallimard n'a-t-elle pas eu honte de publier dans sa collection de la Pléiade, de moins en moins prestigieuse il est vrai, et cela à mesure que les universitaires la surchargent de leurs gloses bien souvent inutiles (comme le montrent les deux récents volumes boursoufflés des romans de Georges Bernanos), Jean d'Ormesson, sans doute pour lui permettre d'ajuster sa future bière aux dimensions de son insignifiance, réduite à un petit volume au papier Bible. Ainsi enfin Albin Michel a trouvé absolument logique de faire paraître des textes du grand Elias Canetti, comme son autobiographie en plusieurs volumes, et L'homme idéal existe. Il est Québécois de Diane Ducret, dont nous attendons la suite avec une prodigieuse impatience, qui devrait s'appeler selon toute probabilité et habituelle poésie du marketing publicitaire : L'homme à cheval dont la femme était la maîtresse d'un dictateur péruvien est probablement un excellent amant antillais qui a même lu Claude Romano dont la pensée phénoménologique n'est pas (encore) interdite au Pays basque.Cette inconstance, terme aux vieux relents d'inquisition auquel les bonnes âmes préféreront celui d'équilibre subtil entre la merde et ce qui la sauve, la beauté et l'intelligence, est la marque de tout éditeur qui se respecte ou plutôt, qui ne se respecte pas. Cette inconstance n'est en tout cas pas celle des Éditions Léo Scheer qui, elles, quel que soit le bout de la lorgnette par lequel vous consultez leur catalogue, ne publient que des livres qui sont ou franchement nuls comme ces deux-là, ou, au mieux, tellement passables qu'ils s'oublient aussitôt refermés. J'hésite à placer Tuer dans l'une de ces deux catégories, tant la prose réputée magnifique de Richard Millet mériterait une catégorie pour elle toute seule, celle de l'insignifiance verbeuse parée d'une aura en papier aluminium de faux guerrier et de proscrit pour rire. Un mot commode, mais peu agréable à entendre et encore moins à lire, conviendrait sans doute davantage pour désigner le genre auquel les essais de Richard Millet appartiennent, ne serait-ce qu'en raison de sa concision martiale qui ne pourra que plaire aux oreilles de notre phalangiste corrézien : imposture.
Cette imposture, comme il se doit en Consanguinie, cette principauté où il fait si bon s'entrelécher, a été saluée par le brave petit soldat Romaric Sangars dans Causeur, Romaric Sangars, celui-là même qui prétendait gifler le vieillard pléiadisé, celui-là même que Richard Millet n'oublie pas de remercier en lui offrant une tribune dans la revue qu'il dirige, La Revue littéraire. Vous avez dit copinage ? Non voyons : chez ces gens-là, ceux du front, ce renvoi systématique d'ascenseur se nomme la fraternité des armes.
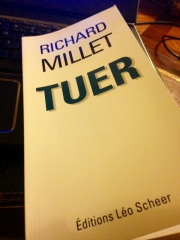 Tuer, sous-titré Récit, histoire de bien nous faire comprendre que Richard Millet n'a absolument rien inventé de ce qu'il raconte, s'ouvre sur une scène qui nous fait d'emblée douter de l'intérêt de poursuivre plus avant notre lecture : Richard Millet, en promotion de l'un de ses innombrables livres inutiles est confronté à une jeune femme qui lui demande s'il a tué un homme. Le dispositif scénique si je puis dire est bien rôdé : il s'agit de concentrer tous les regards sur le possible tueur, de différer sa réponse qui ne manquera pas de faire trembler l'Empyrée et de nous assurer, la main sur le cœur ou bien un peu plus bas, que la question d'une possible conclusion sexuelle ne se pose même pas entre ces deux êtres, la jeune femme posant sa question moins naïve qu'il n'y paraît, l'homme mûr conscient du charme qu'il exerce sur icelle, quoi qu'il en dise. Cette scène d'exposition qui semble aussi vieille que la littérature existe est traitée par Richard Millet avec les trémolos que nous lui connaissons maintenant bien, de livre en livre poussés comme une chansonnette à refrain niais faisant office de célinienne petite musique, autrement dit, de style : «Elle avait établi la souveraineté de l'attente. Elle suggérait aussi, dans sa pleine jeunesse, qu'elle était la nuit même, c'est-à-dire la profondeur du temps où nous pouvions choir ensemble et où ce qui s'oublie revient sous la forme du pardon ou de l'imprescriptible» (1). Ce premier extrait pourrait être point trop ridicule dans un de ces livres dits de littérature gothique, où les héroïnes sont toutes belles et mystérieuses, et succombent, non sans avoir fièrement résisté, aux mâles forcément un peu voire très ténébreux eux aussi qui, avant de songer à les ravir à la hussarde, se croient obligés de disserter en vers libres sur les voies, forcément impénétrables, de la Destinée qui les a forcément placés au carrefour narratif de mille trames. Julien Gracq, brodant sur ces comptines qui à quelques exceptions près ne valent pas tripette, a écrit Au Château d'Argol que je considère comme une de ces rédactions un peu longue qu'un jeune adolescent est capable de rédiger en creusant son répertoire d'images et de lectures. Hélas, Richard Millet n'est ni Mathurin ni Potocki, ni même Gracq et il n'est même pas un écrivain qui serait capable de ne point se ridiculiser, non en raison même de ce qu'il écrit, que parce que ce qu'il écrit est tout simplement disproportionné, n'a aucun sens de la mesure, de le tenue, et provoque, en raison de cette disproportion même, une irrésistible envie de rire et, en lui tapotant sur l'épaule, celle de lui suggérer de lire Trakl ou bien Celan, qui avaient, eux, l'hermétisme fulgurant, alors que notre cacographe toujours pressé d'ajouter un nouveau livre à sa pile de livres déjà publiés, lui, l'a pleurnichard, cet hermétisme à deux sous percés, et interminablement bavard par-dessus le marché ! (2) : «La vraie louange aussi appelle le silence. La vérité n'est pas silencieuse mais elle fait du silence le fond nocturne où briser le sceau d'un secret appelé à demeurer dans l'énigme de sa formulation. C'est là une de ses beautés, comme sa nécessité», ces phrases aussi ineptes que ridiculement disproportionnées je le disais (à l'enjeu, à la thématique, à la scène initiale, et même, à la taille modeste du livre) étant conclues par cette chute tout aussi énigmatique et brinquebalante dans sa volonté de suggérer un sombre mystère là où il n'y en a guère : «Tuer relève moins du secret que du fond ténébreux de la vérité», énigmaticité en toc elle-même complétée, au cas où nous n'aurions pas compris que Richard Millet est un veuf, un inconsolé, un marin errant de port en port comme celui de Coleridge, un Melmoth en éternelle disgrâce et aussi un chevalier aux yeux brûlant de tous les feux de l'Enfer, par cet autre sparadrap d'ésotérisme postillonneur que l'auteur a collé sous sa chaussure (de combat) : «Je marche sur cette ligne d'ombre» (p. 17), ce qui est une belle performance, jadis réalisée par l'immense Joseph Conrad qui, lui, à tout le moins, n'étant pas un poseur, s'enfonça dans le mystère, quitte à le suggérer par le biais des cérémonies inavouables auxquelles Kurtz se livrait, mais jamais ne prétendit être lui-même une espèce de mystère incarné, jamais ne surjoua son rôle de génial artisan.
Tuer, sous-titré Récit, histoire de bien nous faire comprendre que Richard Millet n'a absolument rien inventé de ce qu'il raconte, s'ouvre sur une scène qui nous fait d'emblée douter de l'intérêt de poursuivre plus avant notre lecture : Richard Millet, en promotion de l'un de ses innombrables livres inutiles est confronté à une jeune femme qui lui demande s'il a tué un homme. Le dispositif scénique si je puis dire est bien rôdé : il s'agit de concentrer tous les regards sur le possible tueur, de différer sa réponse qui ne manquera pas de faire trembler l'Empyrée et de nous assurer, la main sur le cœur ou bien un peu plus bas, que la question d'une possible conclusion sexuelle ne se pose même pas entre ces deux êtres, la jeune femme posant sa question moins naïve qu'il n'y paraît, l'homme mûr conscient du charme qu'il exerce sur icelle, quoi qu'il en dise. Cette scène d'exposition qui semble aussi vieille que la littérature existe est traitée par Richard Millet avec les trémolos que nous lui connaissons maintenant bien, de livre en livre poussés comme une chansonnette à refrain niais faisant office de célinienne petite musique, autrement dit, de style : «Elle avait établi la souveraineté de l'attente. Elle suggérait aussi, dans sa pleine jeunesse, qu'elle était la nuit même, c'est-à-dire la profondeur du temps où nous pouvions choir ensemble et où ce qui s'oublie revient sous la forme du pardon ou de l'imprescriptible» (1). Ce premier extrait pourrait être point trop ridicule dans un de ces livres dits de littérature gothique, où les héroïnes sont toutes belles et mystérieuses, et succombent, non sans avoir fièrement résisté, aux mâles forcément un peu voire très ténébreux eux aussi qui, avant de songer à les ravir à la hussarde, se croient obligés de disserter en vers libres sur les voies, forcément impénétrables, de la Destinée qui les a forcément placés au carrefour narratif de mille trames. Julien Gracq, brodant sur ces comptines qui à quelques exceptions près ne valent pas tripette, a écrit Au Château d'Argol que je considère comme une de ces rédactions un peu longue qu'un jeune adolescent est capable de rédiger en creusant son répertoire d'images et de lectures. Hélas, Richard Millet n'est ni Mathurin ni Potocki, ni même Gracq et il n'est même pas un écrivain qui serait capable de ne point se ridiculiser, non en raison même de ce qu'il écrit, que parce que ce qu'il écrit est tout simplement disproportionné, n'a aucun sens de la mesure, de le tenue, et provoque, en raison de cette disproportion même, une irrésistible envie de rire et, en lui tapotant sur l'épaule, celle de lui suggérer de lire Trakl ou bien Celan, qui avaient, eux, l'hermétisme fulgurant, alors que notre cacographe toujours pressé d'ajouter un nouveau livre à sa pile de livres déjà publiés, lui, l'a pleurnichard, cet hermétisme à deux sous percés, et interminablement bavard par-dessus le marché ! (2) : «La vraie louange aussi appelle le silence. La vérité n'est pas silencieuse mais elle fait du silence le fond nocturne où briser le sceau d'un secret appelé à demeurer dans l'énigme de sa formulation. C'est là une de ses beautés, comme sa nécessité», ces phrases aussi ineptes que ridiculement disproportionnées je le disais (à l'enjeu, à la thématique, à la scène initiale, et même, à la taille modeste du livre) étant conclues par cette chute tout aussi énigmatique et brinquebalante dans sa volonté de suggérer un sombre mystère là où il n'y en a guère : «Tuer relève moins du secret que du fond ténébreux de la vérité», énigmaticité en toc elle-même complétée, au cas où nous n'aurions pas compris que Richard Millet est un veuf, un inconsolé, un marin errant de port en port comme celui de Coleridge, un Melmoth en éternelle disgrâce et aussi un chevalier aux yeux brûlant de tous les feux de l'Enfer, par cet autre sparadrap d'ésotérisme postillonneur que l'auteur a collé sous sa chaussure (de combat) : «Je marche sur cette ligne d'ombre» (p. 17), ce qui est une belle performance, jadis réalisée par l'immense Joseph Conrad qui, lui, à tout le moins, n'étant pas un poseur, s'enfonça dans le mystère, quitte à le suggérer par le biais des cérémonies inavouables auxquelles Kurtz se livrait, mais jamais ne prétendit être lui-même une espèce de mystère incarné, jamais ne surjoua son rôle de génial artisan.Grands dieux, si, avec ces quelques pages d'une sobriété irrécusable, dans lesquelles Richard Millet coule sa statue de papier ridiculisant celle du fameux colosse de Rhodes, le premier lecteur mâle venu ne tente pas de s'engager pour mitrailler du Daéchois et la première lectrice ne fond pas comme un glaçon collé au cul d'un étalon en rut, c'est à ne plus rien comprendre de la soi-disant sorcellerie évocatoire de Baudelaire !
Ce lyrisme qui, comme toute écriture jaculatoire, ne peut tenir bien longtemps et se termine par une petite tâche, serait pardonnable dans une copie de jeune garçon fort en thème, qui composerait ses premières gammes et, peu expérimenté, mouillerait sa copie un peu trop vite. Richard Millet, un homme d'expérience n'en doutons point (rendez-vous compte, il a même tué un autre homme !), n'en reste pas moins pressé de conclure, la débâcle de sa grandiloquente ténébrosité apophatique s'accompagnant, ineptie posée comme un cataplasme humide sur la plaie de la sottise contente d'elle-même, d'un érotisme de première communiante ou plutôt, ce qui est bien plus pervers, d'un érotisme d'auteur (et homme mûr nous l'avons dit, et qui a même tué un autre homme nous le répétons pour nous provoquer quelques frissons) imaginant celui d'une première communiante, ce qui constitue un cas évident de matznévisme. Et, puisque le thème de ce dernier livre de Richard Millet est la guerre, nous devons bien nous douter que ce sera donc un érotisme guerrier dont il va nous poisser les yeux et même, au comble de notre excitation de lecteur admiratif, les doigts : «La guerre est venue à moi comme on rencontre une femme» (p. 21), déclaration d'une originalité absolument folle qui ne peut toutefois que nous faire hésiter quant à la vision des femmes qui est celle de Richard Millet. Veut-il nous dire que toute femme, pour lui, est une forteresse qu'il faut conquérir, une butte qu'il faut gravir, une arme dont il faut graisser et entretenir les différentes pièces qui la composent, une position qu'il faut tenir, une tranchée qu'il faut creuser, une rafale qu'il faut bien tirer, une grenade qu'il faut se résoudre à dégoupiller, un couteaux qu'il ne faut pas hésiter à planter ?
Bref, parce que Richard Millet est un homme, un vrai, comme il ne cesse de vouloir nous le rappeler, il ne peut que rapprocher, tout au long de son texte, l'expérience de la guerre de celle du sexe (cf. pp. 52 ou 53, où nous lisons : «ces femmes sont l'autre visage de la guerre»; à la page 67, elle, enfin, la mort «fait exulter le corps autant que la danse ou l'amour»), les comparaisons entre la guerre et le sexe ou l'amour, qui, comme chacun le sait, est une forme de guerre, étant le plus souvent d'une bêtise consommée, comme lorsqu'une milicienne lui dit qu'on «est touché par une balle comme par l'amour» (p. 68) et, quelques pages plus, lorsque nous apprenons que «les premières rafales transportent avec un tel bonheur qu'on songe alors à la souplesse de certains corps de femmes» (p. 74). Richard Millet étant, nous le savons depuis que tous les ânes le braient en chœur, un grand écrivain, et peut-être même, nous glissent, avec une mine de conspirateur, les combattants qui composent le dernier carré du bon goût, le dernier des grands écrivains français, il ne fait aucun doute que la guerre sera une expérience éminemment littéraire, constitutive de l'être transformé qu'est devenu Millet, retour de son dégommage de vilain musulman. C'est ainsi que la guerre est «la prière collective des combattants [l]e ramenant irrésistiblement à la syntaxe de l'invisible» (p. 66-7) et c'est tout aussi logiquement que Richard Millet considère que l'écriture de ses livres n'est que la prolongation de la guerre qu'il livre contre «la chiennerie du monde littéraire français» dans sa «condition d'irrégulier» (p. 66). L'expérience du combat enfin, appliquée à Richard Millet, ne peut qu'être rapprochée des exemples mythologiques les plus grandioses, comme celles d'Achille (cf. p. 79) ou bien d'Hector (cf. p. 63).
Richard Millet étant, nous ne pouvons désormais plus l'ignorer, un grand écrivain français dont la geste guerrière l'a à ce point marqué qu'il n'a jamais pu oublier ses «habitudes de guerre, notamment celle de dormir avec une arme près de [s]a tête» (p. 65), et homme devenu grand homme par et dans l'expérience de la guerre, il ne fait franchement plus aucun doute que l'expérience du combat et de la mort donnée à d'autres hommes soit, «par sa dimension mystique, bien plus que sacrée, la continuation d'une expérience intérieure» (p. 62) et aussi, bien évidemment parce que Richard Millet est un chercheur d'absolu, un cumulard de la verticalité, «une grâce qui se manifeste en nous et fait que l'on combat avec le sentiment d'être invincible, c'est-à-dire innocent, dans cette clarté quasi sacrificielle que donne par exemple la prière ou une syntaxe sûre et belle» (p. 87). Nous avons je crois atteint deux pôles qui ne sont pas opposés, comme en géographie ou en physique : le pôle de la prétention et celui de la confusion, et avouons qu'il sera fort difficile d'aller le chercher à de telles hauteurs délirantes, histoire de le ramener à sa plus juste proportion : un écrivant érotomane magnifiant un passé guerrier qui a la chance, avouons-le, d'être tellement secret qu'aucun témoin direct ne semble exister des exploits phalangistes de Richard Millet (comme lui-même feint de l'ignorer et s'en afflige, nous le verrons plus avant).
Grâce au petit livre inepte de cet auteur, un lecteur pressé pourra se faire une idée, certes fort imprécise puisque notre écrivant est par-dessus le marché un mauvais lecteur, de ce qu'est le lyrisme de la guerre, laquelle «a toujours quelque chose d'extraordinairement vivifiant» (p. 27) nous dit-il, comme expérience intérieure tant évoquée par Ernst Jünger, et apprendre que la grandeur de Richard Millet, son courage exemplaire proviennent du fait qu'il n'a refusé ni le risque, extrême mais assumé, de la guerre, ni celui, plus léger tout de même, de l'écriture. Il est ainsi logique qu'il écrive qu'il y a «dans le refus de la guerre et de l'ambition littéraire une concomitance qui reste à explorer et qui explique la postlittérature contemporaine, ce gigantesque déni du réel au sein de l'inversion générale des valeurs et de la prolifération des simulacres romanesques» (p. 30), proposition pas forcément fausse mais, hélas, que tous les essais de Richard Millet sont bien incapables de démentir, lui dont tous les textes désormais ne sont qu'un indigent bavardage de truqueur et de ventriloque. Que fait, après tout, Millet si ce n'est, avec ses livres grandiloquents et prétentieux, nier la réalité, sa propre réalité qui est tout ce que l'on voudra sauf la rude condition d'un pestiféré ? Un pestiféré, Richard Millet, qui rencontre Pierre-Guillaume de Roux qui a édité presque tous ses derniers ouvrages ? Un pestiféré, Richard Millet, qui rencontre Olivier Véron qui a publié son Israël depuis Beaufort ? Un pestiféré, Richard Millet, qui rencontre Léo Scheer qui a édité Tuer mais aussi Solitude du témoin et, non content de cela, lui a confié la direction de la Revue littéraire autrefois dirigée par le melliflu Florent Georgesco ? Un pestiféré, Richard Millet, qui n'en doutons pas un instant va continuer à faire publier ses bluettes journalistiques ? Un pestiféré, Richard Millet, accueilli dans bien des raouts comme l'illustration en acte d'un de ces penseurs de la contre-révolution qui se tenaient droit, eux au moins, et se tenaient droit par la grâce de leur pensée et de leur écriture précise et coruscante ?
La guerre est donc érotique, littéraire et mystique, mais elle est aussi, thématique plus discrète quoique constante, le royaume du secret. C'est ainsi «secrètement» (p. 88) que Millet nous déclare être retourné au Liban, en 2006, ce qui est bien commode tout de même lorsqu'il s'agit d'investir un événement des prestiges de la littérature, alors que le secret constitue le liant d'une bouillabaisse où surnagent quelques morceaux d'un René Char qui aurait perdu son sens (salutaire au demeurant) de la concision et d'un Louis Massignon qui aurait confondu l'hermétisme propre au langage dans lequel toute illumination doit s'efforcer de se dire avec un rébus de blague de friandise : «La guerre comme légendaire sans fin – ce qui est littéralement toujours à dire – et inlassable questionnement du silence, du commencement et de la fin, manière de proposer un sens à ce que le ressassement dérobe à l'obscur, et où les faits trouvent leur secrète architecture dans la parole, autant dire leur musique, célébration, thrène ou élégie, cette musique étant la vérité du mémorable – de ce qui est fait en mémoire de quelqu'un, compagnon d'armes, père, mère, amour défunt» (p. 35).
Ce passage illustre d'ailleurs assez bien l'indigence du style de Richard Millet, pourtant considéré comme un modèle de perfection verbale. Remarquons ainsi la répugnance de l'auteur à utiliser des verbes conjugués, lui qui leur préfère toujours des grappes de noms communs simplement juxtaposés avec, parfois, souvent même comme nous allons le voir dans l'exemple suivant, des participes présents censés mimer, du moins je le suppose, l'assise d'une concaténation, une station droite, celle d'une phrase vertébrée par un verbe conjugué. La phrase de Millet est à l'image de sa pensée : confuse, molle, empilative, assertive, parataxique, impressionniste, artiste si l'on veut, mais au plus mauvais sens de ce mot qui évoque les tourments du polygraphe qui ne sait plus quoi faire pour cacher aux autres les symptômes du mal qui le ronge, la recherche d'un sourire de son lecteur, l'accolade amicale, presque émue, qui persuadera Richard Millet qu'il est finalement moins seul qu'il n'est très mauvais écrivant. J'aimerais qu'un lecteur légèrement critique, histoire de ne point trop humilier notre écrivant dolent, prenne quelque peu sur lui, mette en sourdine ses remarques éventuelles et assure Richard Millet que sa voie n'est pas tant celle de l'écriture que celle, plus tranquille, lénifiante même, de la culture de saules pleureurs, impeccablement alignés dans l'arrière-cour du Bedford.
Je mets quiconque au défi, en évoquant les derniers essais de Richard Millet, de nous prouver l'existence d'une colonne vertébrale sémantique, d'un style qui n'est pas un perpétuel louvoiement, une ruse du combattant rasant les murs plutôt qu'il ne s'expose à un tir de sniper et qui, lorsqu'il fait mine de poser comme le Christ sur sa Croix, sous les feux des projecteurs des bourreaux, ne pense encore qu'à l'effet obtenu de cette ruse supérieure, consistant par masochisme plus que réelle modestie à parader sous le regard plus ou moins attentif de ses ennemis. Or, je l'ai dit dans mon article sur Israël depuis Beaufort, Richard Millet se méfie des liens de cause à effet comme un phalangiste chrétien d'un combattant musulman. Il semble même haïr toute forme de construction verbale faisant découler, dans un majestueux mouvement, une proposition d'une autre, et lorsqu'il utilise une cheville consécutive (par exemple : c'est-à-dire), c'est du bout des doigts, comme si, bien davantage que pour éclairer notre ignorance et nous expliquer le sens qu'il donne à un terme, Richard Millet se sentait obligé de masquer son indigence intellectuelle, l'indigence absolue de son style, miroir de sa pensée banale, lyrico-banale. Richard Millet excelle en revanche dans le débraillé, la parataxe, la juxtaposition de bouts de phrases nominales, sans verbe donc, ou celui-ci réduit à un simple adjectif, le collage de mots, ce que nous pourrions appeler une écriture impressionniste, fumeuse sinon fumiste. Voyons le long exemple qui suit, dont je prie mon lecteur de bien vouloir excuser l'étalage, celui-ci ayant tout de même, du moins je l'espère, des vertus propédeutiques : «Proche ou lointaine, la guerre constitue mon arrière-pays mental. La vérité de la guerre est inacceptable, dès qu'on s'écarte de sa dimension politique ou héroïque : cette vérité se dérobe même au récit, qui cependant témoigne de l'impossibilité comme moment véridique. Il faudrait alors recourir au poème de la force, comme disait Simone Weil à propos de l'Iliade, poème aujourd'hui moins prisé que l'Odyssée, qui marque la naissance de l'homme moderne par la ruse et le retour à l'origine, Ulysse prenant le relais d'Achille et le nostos [celui, ndJA] de l'ubris, et jouant l'aventure contre le destin, le poème devenant roman, et celui-ci la fatalité de la perte poétique : le nostos marque le lent renoncement à la colère et à la joie, au profit de la sédentarisation du héros qui devient un personnage, autant dire personne, après avoir échappé au chant des Sirènes et qu'Orphée eut été mis en pièces par les Ménades, c'est-à-dire par l'hystérie féminine, la femme commençant ainsi sa lente et irrésistible marche vers le statut de personnage à part entière, le travailleur prenant le relais du héros avant de n'être plus qu'un consommateur, dans l'aliénant miroir romanesque – cette épithète ne signifiant plus rien d'autre, aujourd'hui, qu'une déformation du réel par la puissance médiatico-culturelle» (pp. 32-3). Si j'étais professeur et que le sublime écrivant qu'est Richard Millet acceptât une remarque modeste sans l'interrompre d'une rafale d'arme de guerre, je lui conseillerais de reprendre son souffle, après une apnée si longue ! Non pas que notre plagiste s'enfonce très profondément dans l'océan de la phrase, mais parce que ses coups de palme désordonnés, qui ont dérangé des nageurs et des plongeurs bien plus expérimentés que lui, ne lui ont pas permis de s'enfoncer très loin, disons, à hauteur de tuba, sous les flots moins écumants qu'étales comme une mer d'huile. Ce passage, sans même que nous ne nous attardions sur la portée de ses affirmations qui ne sont tout de même pas des vues absolument révolutionnaires ni même, simplement, originales, est intéressant d'un point de vue stylistique, ce point de vue trahissant la façon de procéder du si grand écrivain qu'est Richard Millet lorsqu'il s'avise de penser, donc d'écrire. Notez ainsi l'abondance des participes présents (prenant, jouant, devenant, commençant, prenant de nouveau), cette façon, toujours, de tout ramener à soi pour en tirer de grandes vérités qui ne sont que des banalités exceptionnelles si je puis dire (3), comme cette identité posée péremptoirement entre les Ménades et l'hystérie féminine au moyen de l'habituel cache-misère sémantique c'est-à-dire qui ne dit rien, identité qui elle-même ne va pouvoir, dans la noria devenue folle de mots vides qu'est un texte de Richard Millet, qu'entraîner non pas une conséquence logique, mais une autre proposition juxtaposée utilisant une fois encore un participe présent. L'écriture de Richard Millet, je l'ai dit mais en voici la frappante illustration, ne procède pas par emboitement de propositions, dont nous pourrions dérouler la logique moyennant quelque rapide travail d'analyse grammaticale. Non, Millet répugne au lien entre la cause et la conséquence, et voilà une répugnance qui l'arrange si bien, lui qui ne procède que par génération spontanée de vagues truismes, d'affirmations idiotes sinon fausses qu'il ne développe jamais, et collage impressionniste, je l'ai dit aussi, de mots qui ne signifient plus rien, si ce n'est, justement, de vagues impressions, sur l'air du temps, forcément pollué, sur le monde comme il ne va pas ou plus ma bonne Madame, sur soi-même, si grand écrivain qu'il est incapable de s'oublier, face aux autres, la meute de tous les autres, tous ces salauds qui osent par exemple remettre en question la réalité de son expérience au Liban (cf. pp. 103-4).
Les dernières pages du petit livre de Richard Millet évoquent le combattant palestinien qu'il a tué, mal tué pourrait-on dire, car il a dû s'y reprendre plusieurs fois, cette procrastination nous valant quelques longs épanchements sur la mystérieuse fraternité et même le lien blanchotien (cf. p. 99) qui unit les ennemis, sur la déhiscence d'un état se situant au-delà du bien et du mal, de la beauté et de l'horreur, de la vie et de la mort (cf. p. 98), sur la vie redoublée qu'apporte le fait de tuer un autre homme (cf. p. 106), la mort, son apprentissage du moins, permettant à l'impavide tueur de chiots puis d'hommes de conquérir une pureté de ou dans «l'insoutenable» (p. 101), cette petite leçon lue un bon millier de fois dans n'importe laquelle ou presque de ces confessions qui se vendent dans les grandes surfaces commerciales comme des boîtes de sardines se concluant, comme toujours chez Richard Millet, par le retour au grand attracteur universel qu'est son ego démultiplié, aussi dévorateur qu'un de ces trous noirs qui fascinent tant les astrophysiciens, en l'occurrence, l'évocation de la nullité intellectuelle des élèves auxquels il tentera de parler de son expérience de la guerre (cf. p. 105), ou encore, tirade convenue, la perte de toute forme de verticalité (4), une verticalité que la prose avachie de Richard Millet est bien incapable de suggérer, à nos yeux.
Notes
(1) Richard Millet, Tuer (Éditions Léo Scheer, 2015), p. 13. Sans autre mention, les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(2) Il est dès lors d'autant plus drôle que l'auteur nous assure : «Ai-je appris d'eux [des hommes ayant fait la guerre, et que Millet écoute, encore jeune] une forme de laconisme, de pudeur narrative qui m'a fait rechercher le silence dans l'écriture bien plus que dans la voix vive ?» (p. 31).
(3) Puisqu'il fat parvenir à tout écrire dans une seule phrase, doit se dire Richard Millet, il s'agit d'utiliser ce que nous pourrions appeler le truisme en incise, comme cela, en passant, au milieu de stratosphériques vues sur la guerre, l'amour et la mort, truismes en incise mais pas du tout incisifs que Richard Millet prend la peine, ou pas c'est selon, d'indiquer entre parenthèses (cf. p. 83).
(4) «La démocratie a enterré les héros dans leurs simulacres cinématographiques. Les valeurs se sont entièrement inversées. Le faux règne en maître, jusque dans la littérature, pourtant un des lieux de manifestation de la vérité» (p. 109).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, tuer, tichard millet, éditions léo scheer, romarc sangars, la revue littéraire |  |
|  Imprimer
Imprimer