« Philosophie de la Shoah de Didier Durmarque, par Gregory Mion | Page d'accueil | Au-delà de l'effondrement, 47 : Guerre et Guerre de László Krasznahorkai »
18/05/2015
Suffirait-il d'aller gifler Romaric Sangars pour arranger un peu la gueule du journalisme français ?

Photographie (détail) de Juan Asensio.
Petits rappels, à l'attention des incultes, des pressés, et des incultes pressés au style jaculatoire
 De tous les spectacles navrants et ridicules auxquels nous expose notre époque, je n'en connais pas de plus pathétique et triste que celui qui consiste, pour un nain, à se jucher sur les épaules d'un autre nain, dans l'inappréciable but de gagner quelques centimètres. Peut-être s'agit-il ainsi de monter sur des chaussures dont la hauteur des talonnettes doit correspondre à la longueur bavarde du titre de cet ouvrage, seule véritable trouvaille d'ailleurs. Nous reviendrons toutefois sur la prétendue réussite de ce titre, du moins de sa mise en page, car les sots ne saluent jamais que leur sottise et ignorance, et non quelque prétendue originalité, fût-elle strictement graphique. Notons immédiatement que le danger de ce genre de titre, intéressant au demeurant, c'est de pouvoir être immédiatement repris et adressé à l'envoyeur, comme toute élémentaire technique de combat commence par apprendre à détourner l'élan de l'adversaire, à l'utiliser contre lui. Commençons par saluer Romaric Sangars ou plutôt, saluons son opportunisme, car notre journaliste s'était juré, à genoux devant son prie-Dieu portatif encadrant une photographie en noir et blanc de Trent Reznor entouré de roses (forcément noires) que, cette fois-ci, bon sang, il ne serait pas victime de la si fâcheuse hessélisation dont il avait subi l'ironie, c'est-à-dire que, cette fois-ci, bon sang, personne ne parviendrait à le priver d'un effet d'aubaine ou, en termes moins amènes, de la capacité, propre aux tiques et plus largement aux parasites, de sauter sur le premier passant d'un peu d'importance venu, afin de tenter de lui en extraire quelques gouttes de sang, de les digérer puis, calculant de nouveau leurs chances, de s'accrocher à tel autre à la faveur d'un courant d'air porteur. Il faudrait proposer, de la vie littéraire parisienne ou de ce qu'il en reste, un classement taxidermique faisant la part belle au phénomène fascinant et instructif du parasitage. En effet, voici quelque temps Romaric Sangars n'avait pu que publier un article inepte et verbeux, dont le début était d'ailleurs aussi sot et déclamatoire («S’il serait parfaitement absurde d’en nier l’incomparable utilité, il faut bien avouer que les ambulances agacent...»), nous le verrons, que celui de son livre, sur Stéphane Hessel, bien évidemment sur Causeur, le nouveau mastroquet où les plus oubliables plumes journalistiques (pléonasme) de droite, ou bien vaguement réactionnaires, refont le monde à grands coups de phrases apocalyptiques et de lectures du Reader's Digest pour premier communiant. Le pauvre Romaric fut donc privé (nous étions alors à la fin du mois d'avril 2014) de pouvoir savourer son petit quart d'heure de gloire médiatique, ce qui est une sacrée contrariété tout de même et, j'ose le dire, un sale coup du sort capable de briser net la trajectoire lumineusement ascendante d'un jeune premier à qui on ne la fait pas ! Un homme prévenu en valant deux, le voici donc qui s'est bien rattrapé, se répétant comme une morne litanie, certes, je t'ai loupé, Stéphane, et j'aurais dû, au moins, parvenir à greffer mon brûlot mort-né de moins de cinquante pages sur ta dépouille, vieux résistant serinant ta petite leçon cacochyme en étant exposé sous les feux de l'actualité qui finiront bien par me bronzer, moi aussi, mais je t'aurai, toi, mon Jeannot, ah oui, crois-moi, je ne te louperai pas, sois en certain ou plutôt, je m'accrocherai à ta vieille peau tannée comme un cuir de marin de grand large et te viderai bien, allez, d'au moins deux millilitres de ton sang fatigué, qu'on se le dise ! Puis il restera bien, ce serait tout de même le comble de la malchance dans le cas contraire, d'autres lamentables scribouilleurs qui entreront, de leur vivant, dans la Pléiade, Philippe Sollers pourquoi pas ou même Le Clézio. Oui mais, aucun qui ne me paraisse aussi décidément intéressant que Jean d'Ormesson, car il a la réputation d'être un catholique de droite, donc réactionnaire, tout en restant un grand jouisseur, comme Sollers d'ailleurs, autre écrivain du bonheur, ce qui signifie que, sur une telle face, ma baffe n'en sera que plus autorisée.
De tous les spectacles navrants et ridicules auxquels nous expose notre époque, je n'en connais pas de plus pathétique et triste que celui qui consiste, pour un nain, à se jucher sur les épaules d'un autre nain, dans l'inappréciable but de gagner quelques centimètres. Peut-être s'agit-il ainsi de monter sur des chaussures dont la hauteur des talonnettes doit correspondre à la longueur bavarde du titre de cet ouvrage, seule véritable trouvaille d'ailleurs. Nous reviendrons toutefois sur la prétendue réussite de ce titre, du moins de sa mise en page, car les sots ne saluent jamais que leur sottise et ignorance, et non quelque prétendue originalité, fût-elle strictement graphique. Notons immédiatement que le danger de ce genre de titre, intéressant au demeurant, c'est de pouvoir être immédiatement repris et adressé à l'envoyeur, comme toute élémentaire technique de combat commence par apprendre à détourner l'élan de l'adversaire, à l'utiliser contre lui. Commençons par saluer Romaric Sangars ou plutôt, saluons son opportunisme, car notre journaliste s'était juré, à genoux devant son prie-Dieu portatif encadrant une photographie en noir et blanc de Trent Reznor entouré de roses (forcément noires) que, cette fois-ci, bon sang, il ne serait pas victime de la si fâcheuse hessélisation dont il avait subi l'ironie, c'est-à-dire que, cette fois-ci, bon sang, personne ne parviendrait à le priver d'un effet d'aubaine ou, en termes moins amènes, de la capacité, propre aux tiques et plus largement aux parasites, de sauter sur le premier passant d'un peu d'importance venu, afin de tenter de lui en extraire quelques gouttes de sang, de les digérer puis, calculant de nouveau leurs chances, de s'accrocher à tel autre à la faveur d'un courant d'air porteur. Il faudrait proposer, de la vie littéraire parisienne ou de ce qu'il en reste, un classement taxidermique faisant la part belle au phénomène fascinant et instructif du parasitage. En effet, voici quelque temps Romaric Sangars n'avait pu que publier un article inepte et verbeux, dont le début était d'ailleurs aussi sot et déclamatoire («S’il serait parfaitement absurde d’en nier l’incomparable utilité, il faut bien avouer que les ambulances agacent...»), nous le verrons, que celui de son livre, sur Stéphane Hessel, bien évidemment sur Causeur, le nouveau mastroquet où les plus oubliables plumes journalistiques (pléonasme) de droite, ou bien vaguement réactionnaires, refont le monde à grands coups de phrases apocalyptiques et de lectures du Reader's Digest pour premier communiant. Le pauvre Romaric fut donc privé (nous étions alors à la fin du mois d'avril 2014) de pouvoir savourer son petit quart d'heure de gloire médiatique, ce qui est une sacrée contrariété tout de même et, j'ose le dire, un sale coup du sort capable de briser net la trajectoire lumineusement ascendante d'un jeune premier à qui on ne la fait pas ! Un homme prévenu en valant deux, le voici donc qui s'est bien rattrapé, se répétant comme une morne litanie, certes, je t'ai loupé, Stéphane, et j'aurais dû, au moins, parvenir à greffer mon brûlot mort-né de moins de cinquante pages sur ta dépouille, vieux résistant serinant ta petite leçon cacochyme en étant exposé sous les feux de l'actualité qui finiront bien par me bronzer, moi aussi, mais je t'aurai, toi, mon Jeannot, ah oui, crois-moi, je ne te louperai pas, sois en certain ou plutôt, je m'accrocherai à ta vieille peau tannée comme un cuir de marin de grand large et te viderai bien, allez, d'au moins deux millilitres de ton sang fatigué, qu'on se le dise ! Puis il restera bien, ce serait tout de même le comble de la malchance dans le cas contraire, d'autres lamentables scribouilleurs qui entreront, de leur vivant, dans la Pléiade, Philippe Sollers pourquoi pas ou même Le Clézio. Oui mais, aucun qui ne me paraisse aussi décidément intéressant que Jean d'Ormesson, car il a la réputation d'être un catholique de droite, donc réactionnaire, tout en restant un grand jouisseur, comme Sollers d'ailleurs, autre écrivain du bonheur, ce qui signifie que, sur une telle face, ma baffe n'en sera que plus autorisée. L'argumentaire de l'ouvrage de Romaric Sangars, disponible sur le site de l'éditeur, nous livre quelques miraculeuses formules telles que : éloge de la gifle contre l’emmerdement de la génuflexion ou bien le ras-le-bol d’un (jeune) franc-tireur qui en a..., ces points de suspension se prêtant aux plus folles interprétations dans le petit milieu peu éclairé mais très arrosé où poussent ces champignons de bar plutôt que de cave censés témoigner de la vitalité d'une pensée conservatrice à la française. Est-ce prétendre que Romaric Sangars en a marre ? Nous le comprenons. J'en ai moi aussi marre de perdre mon temps à lire de pseudo-brûlots dont la force n'est qu'illusoire et feinte puisqu'elle s'appuie sur un adversaire (ce que Jean d'Ormesson incarne ou plutôt, nous le verrons, désincarne) qui ne possède aucune consistance, brûlots tièdes comme une bière de rade, qui participent comme il se doit du bavardage général, contribuent à l'accroître et, finalement, ne nous apprennent rien, même s'ils nous confirment ce que nous savions déjà : Romaric Sangars ne sait pas vraiment écrire, mais nous en donne toutefois l'illusion, par le biais d'un romantisme échevelé qui est ridicule au-delà de 13 ans, consternant après 18 ans, hilarant après 23, franchement gâteux la trentaine passée. C'est là une vérité martialement affirmée, qui ne s'embarrasse pas guère de la polysémie discrète de la proposition que nous avons notée, laquelle pourrait, ma foi, s'interpréter de façon absolue, absolument virile : dire que Romaric Sangars en a ne correspond pourtant guère au langage très châtié auquel Pierre-Guillaume de Roux jamais ne déroge, mais, dans le doute et en l'absence de toute vérification personnelle, pourquoi ne pas admettre cette bravache affirmation, bien capable d'émoustiller quelques journalistes du sexe faible, et même du sexe fort, qui à leur tour, comme des piou-piou tout contents d'avoir déniché ce qu'ils croient être un condor caréné pour le vol stratosphérique, piailleront leur bonheur de n'être rien, leur joie de ne pas être, leur joie de prétendre que nous tenons, avec Romaric Sangars, un vrai pamphlétaire ayant écrit, mazette, un livre méchant et même, attention, violent ?
Dans un article où Sarah Vajda, qui ne manque pratiquement aucun des raouts organisés par Romaric Sangars et son inénarrable compère Jacques de Guillebon dans le cadre du Cercle Cosaque, elle qui a été plusieurs fois publiée par Pierre-Guillaume de Roux (1) à l'époque où il officiait aux éditions du Rocher, évoque sa propre misère fort bavarde de n'avoir été adoubée par aucun écrivain digne de Maurice Barrès (je ne sais ce que le remarquable Guy Dupré, l'intercesseur le plus érudit de l'auteur de La Colline inspirée, pense de cette dame, puisque nous n'avons jamais parlé d'elle) et joue son habituelle partition d'accordéon de guinguette sous-préfectorale sur trois notes continuellement répétées (Maurice (Barrès), moi (Sarah), tous les autres, qui ne valent à peu près rien face à lui et surtout face à moi), dans un long épanchement qui ne nous dit quasiment rien du livre de Romaric Sangars et beaucoup d'elle-même, ou plutôt, de sa volonté touchante de redessiner une histoire secrète de la France littéraire, toute magnétisée par quelques hautes bornes sous lesquelles elle attendra sa petite décharge d'électricité statique qui lui donnera la délicieuse sensation d'avoir été touchée par la foudre, Sarah Vajda, donc, rejoue la scène de l'adoubement, et prédit à l'auteur un avenir placé sous un double éclairage qui réduirait en poussière n'importe quel géant littéraire, comme le rai de lumière carbonise instantanément les bestioles à ailes que Rimbaud fait prospérer dans les pissotières.
Ce serait à se tordre de rire, si Sarah Vajda n'affirmait, dans ce même article, beaucoup de bêtises, sans doute emportée, comme toujours, par son lyrisme simpliste (une-deux-trois, une-deux-trois, moi-moi-moi), heureux d'en être, elle aussi, de la confrérie si commodément extensible des maudits, et pourquoi pas, même, d'en avoir, ce que nous n'avons pas non plus vérifié.
Première bêtise, concernant la collection de la Pléiade, dite prestigieuse, c'est même devenu une épithète de nature, prestigieuse, puisque dire de La Pléiade qu'elle est prestigieuse, c'est un peu comme dire de Sollers qu'il est nul, à laquelle Romaric Sangars accorde même une curieuse aura (cf. pp. 13 et 15) et qui, d'année en année, nous offre des exemples d'inflation d'un apparat critique parfois grotesque, comme dans le cas de Rimbaud, dont la dernière édition a été si bellement étrillée par le regretté Jean-Jacques Lefrère. Nous attendons d'ailleurs, avec beaucoup d'impatience, les deux volumes consacrés aux romans de Georges Bernanos, sous la houlette de la polygraphique Monique Gosselin qui fut notre très éphémère et parfaitement incompétente directrice de thèse et qui, devant témoins, jura ses grands dieux que pour rien au monde elle ne m'accepterait dans l'équipe de vieillards ayant composé ces deux tomes qui nous font par avance regretter la belle et sobre édition donnée par Messieurs Albert Béguin, Michel Estève et Gaëtan Picon. Revenons à la critique de Sarah Vajda. C'est sans doute par manque d'intérêt que celle-ci oublie que la série du Livre Club Diderot a offert les qualités des volumes de la Pléiade moins ses défauts, dont l'obésité bavarde je l'ai dit des notes universitaires, qui auront fini par remplir un des deux futurs volumes consacrés au Grand d'Espagne. C'est en tout cas l'une des maisons d'édition du Parti communiste, qui aura édité non seulement Simonov en deux volumes, mais aussi les œuvres autobiographiques de Gorki, Stendhal et Louis Pergaud, et toujours avec plusieurs cahiers photographiques. Même format, même papier que la Pléiade, moins de prétentions, moins de succès commercial bien sûr, mais je veux bien troquer ce dernier pour prix de la présence, dans de beaux volumes épais au fin papier, de quelques auteurs apparemment oubliés ou de moindre rang que Jean d'Ormesson : Léon Bloy, Sören Kierkegaard, Paul Gadenne, Robert Penn Warren, si abondamment évoqués dans la Zone, et tant d'autres écrivains au moins aussi bons que Jean d'O évoqués par tel lecteur estomaqué sur un site commercial.
Autre bêtise, la deuxième, qui concerne encore ladite prestigieuse collection de la Pléiade. Dois-je rappeler à Sarah Vajda que cette collection a longtemps eu pour unique visée de publier les auteurs de la NRF, comme le savait parfaitement Roger Peyrefitte parlant du bluff NRF ? D'autre part, cette collection se fixait comme but, pas même secret mais discret tout au plus, de publier les très grands hommes du Quai, bien que les relations entre Morand et la Carrière aient connu des fluctuations. Or, il se trouve que Wladimir, oncle du comte Jean et qui avait notamment été ambassadeur près le Saint-Siège, dont Plon a fait paraître un volume de souvenirs, est mort le 15 septembre 1973, alors que Jean d'O a été élu, lui, au fauteuil de Jules Romains (qui depuis la comparution d'Abel Bonnard en 1960 et jusqu'à la mort de celui-ci aurait pu être réclamé par l'auteur des Modérés) le 18 octobre suivant. Dès lors, ne pouvons-nous pas prétendre à bon droit que l'entrée chez les Immortels de Jean d'Ormesson a été hâtée par la mort de Wladimir ? Sa pléiadisation n'est en somme qu'un épiphénomène, la gloriole s'attachant à la gloriole, comme la déveine au guignon. Enfin, la colère de bourdon de Romaric Sangars, qui nous rappelle le Much ado about nothing de Shakespeare, aurait dû également se lever contre le fait que Jean d'Ormesson est désormais à la fois publié dans la collection Bouquins (soit la vraie Pléiade, selon J.-E. Hallier, encore un auteur que Sarah Vajda connaît bien puisqu'elle lui a consacré une biographie brouillonne) et, nous le voyons, en Pléiade. Faisons-nous l'avocat du diable, en rapportant cette anecdote, extraite des mémoires de Wladimir d'Ormesson (De Saint-Pétersbourg à Rome, Plon, 1969, pp. 71-72), et qui établissent un lien, quoique discret, si délicieusement discret qu'il en devient littéraire, entre la famille de Jean d'O et tel grand écrivain, dont se réclament tous nos sympathiques ludions : «De tous les voyageurs qui sont venus en Grèce pendant le séjour de mes parents, celui que je regrette le plus de n'avoir pas connu, c'est Maurice Barrès. Je venais de partir pour la France avec ma mère quand il débarqua à Athènes. Ma sœur Yolande lui prêta des ouvrages de Buchon sur l'épopée franque. Barrès les emporta dans son voyage à Sparte et s'en servit pour développer le thème de son livre. Vingt-trois ans plus tard, un lien émouvant devait unir ma sœur à la mémoire de Maurice Barrès. Au retour d'un voyage en Palestine qu'elle fit en 1923, ma sœur Yolande rapporta à quelques amis des crucifix qu'elle avait fait toucher au Saint-Sépulcre. Elle en remit un à Paul Bourget. Peu de jours plus tard, Barrès mourait subitement. Dès qu'il apprit la catastrophe, Paul Bourget courut à Neuilly et déposa sur le lit funèbre de son ami la petite croix de Jérusalem que ma sœur lui avait donnée. Mme Barrès, apprenant que ce crucifix venait en droite ligne de Terre Sainte, désira qu'il ne quittât plus son mari».
Troisième bêtise sous la plume digne de celle d'un prophète du rang d'Isaïe de Sarah Vajda, sans doute pas la dernière d'ailleurs (il y aurait ainsi beaucoup à dire au recours à Barrès, Breton et Aragon, mais passons, cette note n'est déjà que trop longue), mais plutôt celle que je me contenterai d'indiquer pour clore ma série de remarques. Je relève aussi comme Sarah Vajda que Pierre-Guillaume de Roux tente d'inscrire cette parution, par le graphisme de sa couverture, dans la lignée de la (ou plutôt des) collections Libertés créées et dirigées par Jean-François Revel chez Pauvert. Il s'agit, bien sûr, de frapper les esprits en touchant, d'abord, l’œil si paresseux du journaliste et, potentiellement, du lecteur. Rappelons toutefois à notre spécialiste barrésienne que la collection Liberté de l'Esprit de Raymond Aron, chez Calmann-Lévy, l'avait précédée, et l'une et l'autre annonçaient d'ailleurs la collection Libertés 2000 chez Robert Laffont, dirigée par Revel, puis co-dirigée par Georges Liébert avec Emmanuel Todd. Rappelons-lui encore que différents titres nouveaux ou anciens parus de manière concomitante en U.G.E. 10/18 visaient le même dessein, comme par exemple la réédition de La Réforme intellectuelle et morale d'Ernest Renan, qui s'ouvrait sur une préface de... Revel. Est-il besoin d'ajouter que le fondateur de cette collection de Christian Bourgois s'appelle Dominique de Roux ? Voilà des faits que Sarah Vajda, qui n'est tout de même pas une de ces jeunes oies à prétentions journalistico-littéraires et qui possède même une solide culture littéraire liée à une longue fréquentation de ces auteurs dits, rapidement, de droite, devraient connaître il me semble (2), à tout le moins exposer pour relativiser quelque peu l'empan intersidéral de son enthousiasme.
Long exorde, mais courte critique, ça compense
 Sarah Vajda, que nous avons choisie comme cicérone virgilien, hélas infiniment plus bavard que l'original, de notre exploration des limbes dans lesquelles, comme un impavide Dante, Romaric Sangars ne craint pas de s'enfoncer, affirme que notre «ouvrage [est] magistralement écrit». Certes, deux ou trois formules (3), pas davantage, font leur petit effet, mais enfin, la première phrase, interminable et copiant quelque improbable style savant fait d'emboîtements, tombe à plat, et nous laisse finalement aux prises avec cette évidence : il ne faut pas gifler Jean d'Ormesson, car molester un vieillard ne présente de nos jours plus le moindre intérêt, ou en tout cas un intérêt moindre que celui de gifler un cadavre. Aller gifler un cadavre préalablement déterré bien sûr, Romaric, pourquoi pas celui de Sartre, au cours d'un bon petit trip avec de la musique néo-gothisante à visée intellectuelle dans les oreilles, voilà qui t'eût consacré comme nouvel arsouille des lettres françaises si anémiées, manquant de souffle, si... limbiques comme tu l'écris ! C'est là, je crois, céder à l'humeur et à la facilité (cf. p. 12), malgré le fait que Romaric Sangars nous assure du contraire, tout comme c'est céder à quelque facilité digne du pire des journalistes, disons Joseph Macé-Scaron, que de se documenter un peu trop visiblement et surtout rapidement sur la signification de la Pléiade (cf. p. 15) et encore, nous l'avons vu, en se trompant en partie, sans doute parce que la page Wikipédia qui lui est consacrée (ainsi que celle évoquant les poètes de la Pléiade, référence oblige) ne mentionne pas les évidences que nous avons rappelées plus haut. Loin de nous, bien évidemment, le fait de prétendre que Romaric Sangars, comme son ami Jacques de Guillebon dont nous avions évoqué tel livre infâme tout embabouiné de copié-collé grossiers qui se répétaient même à quelques pages d'écart, s'inspirerait un peu trop d'une culture immédiate, faussement encyclopédique, qui remplacerait une connaissance véritablement personnelle du sujet dont il parle. Car, ce faisant, nous retournerions à ce jeune croisé des temps modernes, défenseur acharné d'une littérature à hauteur d'homme (nous y reviendrons) le compliment qu'il adresse à notre époque et à ses outres toutes gonflées de vent : le vide enté, si je puis dire, sur un discours proliférant, soit le byzantinisme décortiqué par l'impeccable et redoutable Julien Benda qui, ici, porte un autre nom, celui de romantisme de bazar, la phrase échevelée gonflée à l'hélium, la tension de faux biceps et l'inspiration d'une cage thoracique de crieur de boudoir, voilà qui nous donne ce genre de truisme dévitalisé : «Désormais l'usurpation éclate effrontément dans la nuit de la démission générale» (p. 16) ou bien tel autre propos, concernant la pourtant si commune et commerciale musique d'Arvo Pärt, laquelle semble néanmoins aux oreilles de Romaric Sangars, «osciller sans cesse entre l'écho du glas et quelque harmonique augurale» (p. 58). Et que dire des toutes dernières phrases du manifeste pressé de l'auteur, qui ressemble à l'un des éditoriaux de Jacques de Guillebon, à l'époque où il dirigeait feu la revue Immédiatement : «Gifle ou non, quoi qu'il en soit, puisse donc un tel bourdon retentir au plus intime de nos âmes infectées, puisse son écho se répercuter au cœur du disque. Que se répande en mille cercles la pédagogie du gong, que les vibrations ravivent au moins quelques astres. Véhiculés par des soleils derviches. Ainsi poursuivrons-nous. Au-delà des lignées brisées» (p. 59). Je précise que, dans le texte de notre livre, ces trois dernières phrases sont détachées du reste du paragraphe, preuve s'il en est que Romaric Sangars est un grand écrivain qui maîtrise les effets stylistiques les plus subtils et artistes. Cet homme-là, décidément, malgré quelques coupables barbarismes (4) qui ont dû faire s'étrangler le pauvre Renaud Camus d'ailleurs cité comme exemple de bon écrivain, a tous les dons et nul besoin, Sarah Vajda, de convoquer les plus hautes figures tutélaires de votre panthéon personnel au-dessus du destin de Romaric Sangars, nouvel Achille, à vous lire, dont les myrmidons se recruteraient chez Barak !
Sarah Vajda, que nous avons choisie comme cicérone virgilien, hélas infiniment plus bavard que l'original, de notre exploration des limbes dans lesquelles, comme un impavide Dante, Romaric Sangars ne craint pas de s'enfoncer, affirme que notre «ouvrage [est] magistralement écrit». Certes, deux ou trois formules (3), pas davantage, font leur petit effet, mais enfin, la première phrase, interminable et copiant quelque improbable style savant fait d'emboîtements, tombe à plat, et nous laisse finalement aux prises avec cette évidence : il ne faut pas gifler Jean d'Ormesson, car molester un vieillard ne présente de nos jours plus le moindre intérêt, ou en tout cas un intérêt moindre que celui de gifler un cadavre. Aller gifler un cadavre préalablement déterré bien sûr, Romaric, pourquoi pas celui de Sartre, au cours d'un bon petit trip avec de la musique néo-gothisante à visée intellectuelle dans les oreilles, voilà qui t'eût consacré comme nouvel arsouille des lettres françaises si anémiées, manquant de souffle, si... limbiques comme tu l'écris ! C'est là, je crois, céder à l'humeur et à la facilité (cf. p. 12), malgré le fait que Romaric Sangars nous assure du contraire, tout comme c'est céder à quelque facilité digne du pire des journalistes, disons Joseph Macé-Scaron, que de se documenter un peu trop visiblement et surtout rapidement sur la signification de la Pléiade (cf. p. 15) et encore, nous l'avons vu, en se trompant en partie, sans doute parce que la page Wikipédia qui lui est consacrée (ainsi que celle évoquant les poètes de la Pléiade, référence oblige) ne mentionne pas les évidences que nous avons rappelées plus haut. Loin de nous, bien évidemment, le fait de prétendre que Romaric Sangars, comme son ami Jacques de Guillebon dont nous avions évoqué tel livre infâme tout embabouiné de copié-collé grossiers qui se répétaient même à quelques pages d'écart, s'inspirerait un peu trop d'une culture immédiate, faussement encyclopédique, qui remplacerait une connaissance véritablement personnelle du sujet dont il parle. Car, ce faisant, nous retournerions à ce jeune croisé des temps modernes, défenseur acharné d'une littérature à hauteur d'homme (nous y reviendrons) le compliment qu'il adresse à notre époque et à ses outres toutes gonflées de vent : le vide enté, si je puis dire, sur un discours proliférant, soit le byzantinisme décortiqué par l'impeccable et redoutable Julien Benda qui, ici, porte un autre nom, celui de romantisme de bazar, la phrase échevelée gonflée à l'hélium, la tension de faux biceps et l'inspiration d'une cage thoracique de crieur de boudoir, voilà qui nous donne ce genre de truisme dévitalisé : «Désormais l'usurpation éclate effrontément dans la nuit de la démission générale» (p. 16) ou bien tel autre propos, concernant la pourtant si commune et commerciale musique d'Arvo Pärt, laquelle semble néanmoins aux oreilles de Romaric Sangars, «osciller sans cesse entre l'écho du glas et quelque harmonique augurale» (p. 58). Et que dire des toutes dernières phrases du manifeste pressé de l'auteur, qui ressemble à l'un des éditoriaux de Jacques de Guillebon, à l'époque où il dirigeait feu la revue Immédiatement : «Gifle ou non, quoi qu'il en soit, puisse donc un tel bourdon retentir au plus intime de nos âmes infectées, puisse son écho se répercuter au cœur du disque. Que se répande en mille cercles la pédagogie du gong, que les vibrations ravivent au moins quelques astres. Véhiculés par des soleils derviches. Ainsi poursuivrons-nous. Au-delà des lignées brisées» (p. 59). Je précise que, dans le texte de notre livre, ces trois dernières phrases sont détachées du reste du paragraphe, preuve s'il en est que Romaric Sangars est un grand écrivain qui maîtrise les effets stylistiques les plus subtils et artistes. Cet homme-là, décidément, malgré quelques coupables barbarismes (4) qui ont dû faire s'étrangler le pauvre Renaud Camus d'ailleurs cité comme exemple de bon écrivain, a tous les dons et nul besoin, Sarah Vajda, de convoquer les plus hautes figures tutélaires de votre panthéon personnel au-dessus du destin de Romaric Sangars, nouvel Achille, à vous lire, dont les myrmidons se recruteraient chez Barak !Le lyrisme échevelé de Romaric Sangars, qui a contaminé Sarah Vajda, à moins que ce ne soit l'inverse, serait amusant s'il ne laissait transparaître, quoique discrètement, la thématique du biologisme, comme dernière incarnation, mais celle-ci salvatrice, de la résistance. Page 57, l'auteur écrit ainsi que le «retournement» qu'il appelle de ses vœux «tient moins à une question cyclique qu'à l'élan des spirales, qu'à une conception de l'évolution paradoxale qui nous permettrait de poursuivre au-delà des lignes brisées». Je laisse à quelque pythie contemporaine, juchée sur son trépied, le soin de nous dévoiler, mais auparavant de nous traduire, les beautés cachées de cette phrase énigmatique, moins énigmatique toutefois que ridicule, et pointe une autre mention de l'obsession biologique (cf. p. 53) qui semble propre à nos jeunes auteurs décidément si pressés de s'incarner qu'ils en oublieraient presque de penser, qu'il s'agisse donc de Romaric Sangars ou bien, version darwinienne de notre jeune Metzengerstein monté sur son coursier de feu, et éminemment sujette à caution cela va sans dire, Laurent Obertone. C'est d'ailleurs la mention du biologique, de l'incarnation, qui va nous permettre d'évoquer plaisamment la
Défense et illustration de la (vraie) littérature française ?
Quelle est l'obsession qui, du moins dans ce texte, travaille la prose ampoulée et creuse de Romaric Sangars ? L'incarnation, le milieu, non au sens sociologique mais au au sens biologique du terme (cf. p. 36). Il est dès lors plus que curieux, pour ne pas dire aberrant, de prétendre qu'un W. G. Sebald, dont nous avons évoqué dans la Zone tous les textes traduits en français, appartiendrait à quelque fantomatique communauté «limbique» dont les productions se caractériseraient par l'abstraction, la récapitulation et la hantise (cf. ibid.). Ne soyons point trop moqueurs en rappelant que Sebald n'est pas un auteur français et que, quelles que soient les contorsions herméneutiques auxquelles nous puissions nous livrer, il serait pour le moins fort difficile de le rapprocher d'auteurs, d'intérêt franchement divers, tels que Deville, Vuillard, Volodine ou encore Michon (cf. p. 44), et que dire encore de demi-soldes de la réaction comme Richard Millet ou Renaud Camus (cf. pp. 45 et 52), et même le pauvre Maurice G. Dantec, qualifié d'«ultraréactionnaire» et d'«hyper-futuriste» (cf. p. 48), sans compter Michel Houellebecq, dont j'ai été je crois à peu près le seul critique à lire correctement le dernier roman, Soumission. J'ai évoqué ces auteurs, parfois assez longuement comme Dantec, le cacographe martial Millet ou le néo-barrésien maladivement solipsiste Camus, à l'exception de Volodine et de Deville et, j'ai beau chercher, je ne comprends pas comment Romaric Sangars peut les faire entrer, fût-ce à la diable, dans une phase ou un état limbique (cf. pp. 42-3) d'une littérature non seulement française mais européenne, puisqu'il mentionne, d'ailleurs non sans justesse quoique de façon journalistique, donc superficielle, Sebald. Romaric Sangars, qui déteste la prose de Jean d'O qu'il s'est d'ailleurs probablement contenté de parcourir (comment le lui reprocher !), a les héros littéraires qui s'accommodent le mieux à ses aspirations biologiques d'incarnation expresse. Ce n'est donc pas sans raison que, dans un billet insignifiant mais non dénué d'ironie, le très sollersien Michel Crépu (5) affirme que Romaric Sangars, qualifié d'angelot gardien, ne plaisante pas avec les hiérarchies même si, en guise de hiérarchies, nous sommes bien davantage confrontés, avec les exemples d'auteurs qu'il a mentionnés, à un rhizome. Peu importe, Romaric Sangars a répondu avec beaucoup d'ironie à son tour à notre critique quatre étoiles qui finira bien, comme le prétendait Georges Bernanos, à penser avec son cul une fois qu'il l'aura déposé sur l'un des sièges molletonnés de l'Académie française, en lui faisant remarquer, en somme, qu'il occupait à la NRF une place qui était celle d'un vague aiguilleur point trop regardant sur la qualité, alors qu'il devrait être, excusez du peu, un critique impartial. C'est gentiment traiter l'ancien patron de La Revue des Deux Mondes d'imposteur et, ma foi, je doute que l'offensé se prenne à vouloir gifler l'impertinent angelot, ou même à lui adresser autre chose qu'un clin d’œil, le geste qu'il maîtrise le mieux depuis son plus jeune âge, à force d'heures d'un entraînement spartiate devant son miroir. Après tout, Gallimard vaut bien quelques crachats, même s'ils n'ont qu'un goût de sucre candi ou de chewing-gum, pas vrai Michel ?
Je me permets de résumer les hauts noms censés incarner une recherche littéraire profonde, dans la France de François Hollande et indique, bien sûr à part, W. G. Sebald. Je ne puis répéter tout ce que j'ai écrit sur leurs livres, ni passer trop de temps à détailler les banalités que Romaric Sangars égrène sur ceux-ci.
 Maurice G. Dantec donc.
Maurice G. Dantec donc. Michel Houellebecq.
Michel Houellebecq. Renaud Camus.
Renaud Camus. Richard Millet.
Richard Millet. Éric Vuillard.
Éric Vuillard. Pierre Michon.
Pierre Michon. Et, donc, le très grand W. G. Sebald.
Et, donc, le très grand W. G. Sebald.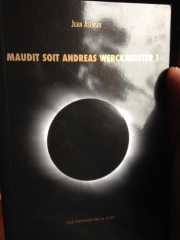 Je ne désespère pas, un jour, de lire d'autres auteurs évoqués par Romaric Sangars, comme Valère Novarina, François Taillandier et Jean Ristat mais enfin, nul ne m'en voudra je crois d'avoir bien d'autres priorités de lecture, quelques minutes de déambulation dans la Zone labyrinthique me semblant plus éloquentes que de longs paragraphes, où je pourrais d'ailleurs, moi aussi, rappeler que j'ai écrit une défense et illustration de la littérature, opposant la médiocrité de la production contemporaine (tiens, je l'ai justement évoquée en citant les livres Richard Millet) à ce qu'est un grand livre : un trou noir. Cette idée, parfaitement saugrenue mais fascinante d'un point de vue symbolique, constitue le soubassement, le centre ou le cratère de mon petit livre, qui n'est plus du tout disponible je crois par la faute de son lamentable éditeur. C'est peut-être l'absence d'exposition d'une telle figure qui rend le livre de Romaric Sangars si creux, alors même qu'il eût dû, sans doute, exploiter le détail qu'il pointe à la page 18, faisant remarquer, mais sans rien en tirer d'autre que la mention d'un «nouvel abaissement d'une souveraineté», que l'un des ancêtres de Jean d'Ormesson vota la mort de Louis XVI, et aussi une mignonne assertion si joliment poétique dont un Pierre Boutang aurait cependant tiré toutes les conséquences métaphysiques : «Et ce pays qui ne se dressa qu'en fonction de rites politiques et littéraires, dont le feu central est la parole et l'éclat, se retrouve avec au cœur comme une braise âcre» (p. 55).
Je ne désespère pas, un jour, de lire d'autres auteurs évoqués par Romaric Sangars, comme Valère Novarina, François Taillandier et Jean Ristat mais enfin, nul ne m'en voudra je crois d'avoir bien d'autres priorités de lecture, quelques minutes de déambulation dans la Zone labyrinthique me semblant plus éloquentes que de longs paragraphes, où je pourrais d'ailleurs, moi aussi, rappeler que j'ai écrit une défense et illustration de la littérature, opposant la médiocrité de la production contemporaine (tiens, je l'ai justement évoquée en citant les livres Richard Millet) à ce qu'est un grand livre : un trou noir. Cette idée, parfaitement saugrenue mais fascinante d'un point de vue symbolique, constitue le soubassement, le centre ou le cratère de mon petit livre, qui n'est plus du tout disponible je crois par la faute de son lamentable éditeur. C'est peut-être l'absence d'exposition d'une telle figure qui rend le livre de Romaric Sangars si creux, alors même qu'il eût dû, sans doute, exploiter le détail qu'il pointe à la page 18, faisant remarquer, mais sans rien en tirer d'autre que la mention d'un «nouvel abaissement d'une souveraineté», que l'un des ancêtres de Jean d'Ormesson vota la mort de Louis XVI, et aussi une mignonne assertion si joliment poétique dont un Pierre Boutang aurait cependant tiré toutes les conséquences métaphysiques : «Et ce pays qui ne se dressa qu'en fonction de rites politiques et littéraires, dont le feu central est la parole et l'éclat, se retrouve avec au cœur comme une braise âcre» (p. 55). Mais, comme tous les poseurs, Romaric Sangars ne sait faire qu'une seule chose : poser, et encore, malgré quelque facilité naturelle dans l'exercice point si aisé du poseur, comme c'est peu ! Quelle occasion manquée, tout de même, que celle de pouvoir évoquer la prose de Jean d'Ormesson, alors que Romaric Sangars se contente de la moquer superficiellement sans jamais véritablement la décortiquer, car disséquer une écriture, fût-elle celle d'un eunuque (je file la métaphore sangarsienne de la capote vide), n'est pas une tâche à la portée du premier journaliste venu, pas vrai ? De sorte que le petit exercice sangarsien, faisant le malin autour de deux ou trois citations de textes de Jean d'Ormesson provoque l'inverse de l'effet escompté : celui d'un dilettantisme qui, en guise d'analyse, a péniblement compilé quelques lignes d'un de ces dictionnaires des insultes littéraires où fleurissent les amabilités corrosives et réjouissantes : «Monsieur Lapalissade et pousse-clichés» ou bien encore «archange des tièdes», voire «DJ de l'anecdote historique» (p. 21), comme c'est peu tout de même, comme la volonté juvénile du bon mot méchant est tout de même d'une courte portée si nous la comparons à une analyse d'un tout autre acabit, comme par exemple celle de Jean Brenner (in Histoire de la Littérature française : de 1940 à nos jours, Fayard, 1978, pp. 416-417), qui fut pourtant assez favorable au chroniqueur (comme Brenner a pu prétendre de Cau, de Dutourd ou de Nourrissier qu'ils étaient des chroniqueurs) aujourd'hui pléiadisé : «Les œuvres n'ont pas manqué, dans le passé, où des auteurs racontaient l'histoire et les mœurs de pays imaginaires. De Rabelais à Michaux, de Swift à Butler, l'invention était poétique ou satirique ou les deux à la fois, mais très franchement. L'originalité de Jean d'Ormesson est de s'être inspiré de doctes ouvrages et d'en avoir imité le style neutre». Ces mots ont été écrits à propos de La Gloire de l'Empire et ne sauraient bien évidemment prétendre au rang de critique en bonne et due forme, Jean d'Ormesson n'étant qu'un écrivain subalterne qui a toutefois eu le bon goût de naître dans une très belle famille, comme aurait persiflé Peyrefitte mais enfin, je préfère, aux chlorotiques jérémiades de n'importe quel journaliste, fût-il inspiré par le très Saint Pneuma, sur l'état de la littérature française contemporaine, pour ne rien dire des remèdes proposés (Camus, Millet, Novarina !) une référence assassine aux textes évoqués.
Un pneuma qui n'est qu'une bouée (bien lire : bouée) de piscine gonflable
 Ce n'est certainement pas un hasard si le second texte, intitulé Pneuma, qui compose notre livre n'est guère évoqué, si ce n'est pas l'entremise de quelques généralités grandiloquentes sous la plume furieusement centrifuge (en ceci que, s'éloignant toujours du centre par mille digressions, elle ne cesse de nous le rappeler) de Sarah Vajda. Mon intuition était bien évidemment la bonne, que confirme ce second texte prétentieux, dont les anacoluthes sont assez mal maîtrisées (cf. p. 97), et qui brode sur les expériences hospitalières de l'auteur un canevas pour le moins éthéré : la littérature contemporaine est limbique puisque l'auteur a éprouvé la réalité de cet état cauchemardesque : «Le milieu de somnolence, d'indistinction, de circularité, d'impotence et de délire où allait me projeter la forte fièvre initiale pouvait être typiquement associé au lieu mythique en question» (p. 71). Les limbes sont donc caractérisables comme l'état d'une «hébétude en flux permanent» (p. 73), et les auteurs contemporains, que Romaric Sangars a évoqués dans son précédent texte, s'adressent à des lecteurs qui ne peuvent représenter que «l'homme des limbes», «l'homme sans rite actif et aux bornes éteintes, privé des chocs et des contre-chocs fondamentaux, de dieux comme de glaise et qui, fatalement, traité selon un tel régime, finit par en perdre son souffle» (p. 78). Je n'aimerais pas avoir à éprouver, comme Romaric Sangars, assez mystérieusement, pour Jacques Attali (cf. p. 84) une «très brève empathie» pour un auteur qui, non content de désirer s'incarner, via l'évocation du mystère de l'incarnation du Christ, est capable d'assigner aux lettres un tel programme fumeux, aussi fumeux qu'une ritournelle de chansonnette pour adolescent érubescent (6) : un rêve «de révolution intérieure et collective et sans frein possible; et qui fût fondée sur l'Esprit, la diffraction poétique des êtres et du monde ainsi que de toutes leurs interactions, voilà, j'ose le dire, l'ambition la plus canoniquement sainte» (pp. 96-7).
Ce n'est certainement pas un hasard si le second texte, intitulé Pneuma, qui compose notre livre n'est guère évoqué, si ce n'est pas l'entremise de quelques généralités grandiloquentes sous la plume furieusement centrifuge (en ceci que, s'éloignant toujours du centre par mille digressions, elle ne cesse de nous le rappeler) de Sarah Vajda. Mon intuition était bien évidemment la bonne, que confirme ce second texte prétentieux, dont les anacoluthes sont assez mal maîtrisées (cf. p. 97), et qui brode sur les expériences hospitalières de l'auteur un canevas pour le moins éthéré : la littérature contemporaine est limbique puisque l'auteur a éprouvé la réalité de cet état cauchemardesque : «Le milieu de somnolence, d'indistinction, de circularité, d'impotence et de délire où allait me projeter la forte fièvre initiale pouvait être typiquement associé au lieu mythique en question» (p. 71). Les limbes sont donc caractérisables comme l'état d'une «hébétude en flux permanent» (p. 73), et les auteurs contemporains, que Romaric Sangars a évoqués dans son précédent texte, s'adressent à des lecteurs qui ne peuvent représenter que «l'homme des limbes», «l'homme sans rite actif et aux bornes éteintes, privé des chocs et des contre-chocs fondamentaux, de dieux comme de glaise et qui, fatalement, traité selon un tel régime, finit par en perdre son souffle» (p. 78). Je n'aimerais pas avoir à éprouver, comme Romaric Sangars, assez mystérieusement, pour Jacques Attali (cf. p. 84) une «très brève empathie» pour un auteur qui, non content de désirer s'incarner, via l'évocation du mystère de l'incarnation du Christ, est capable d'assigner aux lettres un tel programme fumeux, aussi fumeux qu'une ritournelle de chansonnette pour adolescent érubescent (6) : un rêve «de révolution intérieure et collective et sans frein possible; et qui fût fondée sur l'Esprit, la diffraction poétique des êtres et du monde ainsi que de toutes leurs interactions, voilà, j'ose le dire, l'ambition la plus canoniquement sainte» (pp. 96-7).Se lançant ainsi sur les brisées des surréalistes, nous attendons de Romaric Sangars qu'il crève «l'imposture généralisée où se perdait notre civilisation», et dont la pléiadisation de Jan d'Ormesson n'est que l'un des innombrables signes, «notre civilisation qui éternisait les limbes où elle se dissolvait sans cesse pour avoir tout oublié depuis longtemps de son souffle initial». Du coup, notre moderne Lazare, notre Romaric redivivus ne nous déçoit pas qui, disposant tout de même de son portable et d'une connexion Internet (cf. p. 104) lors de son dernier séjour à l'hôpital se propose de «camper à nouveau sur l'essentiel» (p. 99), luttant sans relâche contre «l'entreprise symétrique et parodique» contemporaine consistant «à rendre à l'abstraction tous les corps» (p. 101), cette tâche surhumaine, après tout bien digne de la figure mythologique que l'auteur convoque pompeusement au début de son texte, ne pouvant se traduire que par «une modalité évolutive efficiente» consistant à «partir dans le choc permanent des opposés, dérouler la chaîne ignée des morts-renaissances», afin que cette dernière «se déploie selon son grand élan en spirale, chacune des courbes enlaçant le triangle que tracent Verbe, Esprit et Providence» (pp. 106-7). En résumé, la littérature doit ou devrait de nouveau se soumettre «aux mêmes exigences d'incarnation que quand la vie était pleine» (p. 36)
Relisant de telles phrases fumeuses, qui à vrai dire collent parfaitement à une mission prétendûment littéraire elle-même parfaitement fumeuse et ectoplasmique dont les figures tutélaires ne sont tout de même pas très encourageantes à suivre, hormis celle de Sebald (car enfin : Taillandier, Novarina, Ristat, Millet, Camus, Houellebecq, Dantec, Vuillard...!), nous comprenons que Romaric Sangars apparaisse tout obsédé par l'idée de s'incarner, et nous l'invitons à quelque modestie, car, ma foi, cruel retournement des critiques (7), il est encore plus facile d'aller gifler un vieillard, fût-il Jean d'Ormesson, qu'un ballon de foire. Car enfin, stigmatisant à juste titre une époque vide, fatiguée («Nous, Français, nous, peuples d'Europe, notre âme est minée», p. 41), l'unique antidote que le bon docteur Sangars veut nous administrer consiste à nous proposer le brouet insapide de quelques hongres littéraires à posture guerrière, je songe bien sûr à Richard Millet qui selon l'auteur «renoue avec la phrase longue, avec la scansion hypnotique proustienne, la phrase comme un filet jeté aux ténèbres et dont la syntaxe assure le déploiement» (p. 45).
En fin de compte, le soufflet prophylactique, qui n'est qu'un soufflé lyrique, que Romaric Sangars se défendait d'appliquer sur la face perpétuellement bronzée de Jean d'O est terriblement peu aérien, crâne, bravache, si peu adolescent mais pesamment travaillé qu'il en devient comique et rate sa cible perpétuellement mouvante, car c'est par un canular, La Gloire de l'Empire, paru en 1971, que Jean d'Ormesson a gagné ses galons d'écrivain sérieux, alors que c'est par un double pensum empesé et fat, tout simplement faussement libre, que Romaric Sangars, lui, est enfin parvenu à s'accrocher, en tirant la langue, sa médaille en aluminium de hussard poussif. Je crains que nous n'ayons, comme les écrivains, les journalistes que nous méritons.
Notes
(1) C'est à la suite de ma note sur un de ses romans, Contamination, plutôt passable voire médiocre (et qui en fait, me confia son éditeur, ne fut publié qu'après le relatif succès du premier, alors qu'il avait été écrit avant lui), que Sarah Vajda cessa du jour au lendemain de m'adresser la parole, alors qu'elle avait plusieurs fois contribué à nourrir la Zone, une fois tout de même ses textes relus avec la plus grande attention, afin d'en supprimer les innombrables erreurs. Si nous avions beaucoup de temps à perdre, et en utilisant le patron qu'Acrimed a taillé pour l'incorruptible Michel Crépu, nous prendrions la peine de noter les innombrables petits renvois d'ascenseurs qui constituent le quotidien de nos Cosaques et apparentés. Ainsi, c'est en passant que nous remarquerions que Romaric Sangars a dit tout le bien qu'il pensait de l'ouvrage, à peu près nul, plus haut mentionné de Jacques de Guillebon dans un papier initialement paru sur Chronic'art et repris sur le blog de ce dernier, tout comme nous constaterions que Rémi Lélian, autre habitué du Cercle Cosaque, avec sa casquette de professeur de philosophie, n'a pas craint d'affirmer apodictiquement la très haute portée intellectuelle, voire métaphysique faut pas se gêner, de ce même livre, et où cela, sinon dans Causeur qui, remarquons-le tout aussi discrètement, emploie non seulement Rémi Lélian (qui ne manque jamais de saluer un livre de son amie Sarah Vajda) mais aussi l'inénarrable disais-je Jacques de Guillebon et bien sûr le post (voire carrément anti)-limbique Romaric Sangars. Sans nous aventurer dans les profondeurs insoupçonnables de cette mare consanguine où nous verrions également, plein de surprise, barboter une Solange Bied-Charreton avec aux bras ses bouées gonflables griffées Philippe Muray, vais-je médire en anticipant le fait, possible voire probable, que Jacques de Guillebon dise tout le bien qu'il pense, ici ou là mais pourquoi pas sur Causeur, du livre de son ami cosaque Romaric, qui l'en remerciera n'en doutons pas et finira lui-même bien, non sans s'en être entretenu avec son ami Jacques, par inviter Sarah Vajda en tant qu'intervenante dudit Cercle, puisque, après tout, cette dernière a déjà collaboré au sommaire pléthorique d'un ouvrage intitulé Le Livre noir de la Révolution française paru au Cerf voici quelques années et que, après tout encore, on n'est jamais mieux salué, dans le miroir vaguement réfléchissant où tous ces bavards reconnaissent leur trogne interchangeable, que par soi-même ? Pardonnez la longueur de cette note mais enfin, Romaric Sangars lui-même affirme qu'il est «terriblement chic et baroque» de «laisser enfler de la sorte les notes de bas de page» (p. 75), ce qui ne peut que me conférer des ailes liberticides. Oh tout de même, mais comment diable allais-je oublier le fait qu'Éric Naulleau a bien évidemment invité Romaric Sangars, sur le plateau de son émission diffusée sur Paris Première, pour évoquer son livre, sans doute pour le remercier d'avoir dit tout le bien qu'il pensait de lui (à l'époque toutefois où Naulleau n'était que patron de «l'excellente maison L'Esprit des Péninsule», cf. p. 35). Une revue de presse est, en règle générale, un arbre généalogique où chaque branche communique avec une autre, plus basse ou plus élevée, par un système plus ou moins discret de poulies et de câbles.
(2) Ajoutons, pour faire bonne figure, que des ouvrages analogues, voire tout bonnement les mêmes titres, ont été édités en version de poche : par Pocket dans la collection Agora, par Hachette dans la collection Pluriel, mais aussi par La Table Ronde, pour certains titres de la collection Petite Vermillon, sans compter les éditions Complexe de Bruxelles (avec des ouvrages de Renan, Maistre ou encore Les Chaînes de l'Esclavage de Marat). Enfin, mêlant une partie des titres (ou de l'esprit) de la collection Libertés chez Pauvert avec la collection d'histoire de l'art dont le même Revel s'était fait l'animateur chez Julliard, signalons la collection intitulée Le Regard Littéraire, toujours aux éditions Complexe.
(3) «Surtout, cette littérature-tapisserie [de Jean d'Ormesson bien sûr] dont les motifs se trouvent si mal à propos se tisse à partir des pelotes les plus tièdes» (p. 17) ou encore : «[...] les gâteux de l'Oulipo m'ont toujours paru ressasser à l'infini une harassante partie de Scrabble dans un outre-monde où se perpétueraient sans plus la moindre interruption les occupations de l'hospice [...]» (p. 21).
(4) «[...] ce qui frappe en premier lieu, c'est comment [...]» (p. 31). L'usage, fort laid, de «comment» est un péché mignon de l'auteur (cf. p. 75).
(5) Patience Michel, patience, je suis en train de lire ton dernier livre, paru comme il se doit chez Gallimard, chez lequel tu as fini par entrer. Les efforts, y compris ceux que nous pourrions qualifier comme une suite discrète et perpétuellement joyeuse de minuscules compromissions, paient toujours, n'est-ce pas ? Te voici récompensé, et ce n'est pas fini, car j'attends ta coupolisation ou ta pléiadisation (les deux me dis-tu ?) je l'espère avant de quitter cette terre, ce qui me permettra, à 80 ans passés, d'écrire mon petit brûlot poussif contre tout ce que tu incarnes à mes yeux et qui est, tu t'en doutes, parfaitement giflable.
(6) Rappelons que Romaric Sangars, ou Romaric d'Arvycendres, a participé à des groupes tels que Forbidden Site, Projet Mercure ou Khôl, dont une des chansons, intitulée Rien ne respire, nous donne quelque idée de son talent d'écriture : «Qu'as-tu à remuer les cendres ! / Rien ne respire / Quand tout s'acharne à nous descendre / Aspire au pire / Qu'as-tu à ruminer les ruines ? / Rien ne respire / Le rimmel des martyrs a coulé sous la bruine». Ce grand morceau de poésie est bien sûr du goût de Maurice G. Dantec, qui le cite (sur un site pour l'heure indisponible).
(7) «Je me vante d'avoir fait dans ma vie au moins une prédiction exacte. C'était à propos de Jean d'Ormesson (né en 1925), en un temps où il n'était encore que «le neveu de Wladimir [d'Ormesson]» et où il hésitait entre Claude Chabrol et Françoise Sagan. Il finira, disais-je, par où il aurait dû commencer : par un beau mariage, le Figaro et l'Académie» : cet excellent jugement sur Jean d'Ormesson est signé Pierre de Boisdeffre, dans son Histoire vivante de la littérature, t. 1, nouvelle édition entièrement refondue de 1985 chez Perrin, p. 606. Si nous étions cruel, ce qu'à Dieu ne plaise, nous appliquerions tel autre jugement de Boisdeffre (cf. op. cit., p. 212) sur la spiritualité de Jean d'O à Romaric S : «Dans Le Vagabond Jean d'Ormesson nous confie : «Je suis chrétien.» Depuis vingt ans que je le connais, je ne m'en étais pas douté. Je l'aurais plutôt cru théosophe, amant des Lumières, que catholique à la manière de l'oncle Wlad. Il est vrai que Mai 1968. est passé par là. Le Dieu de Jean d'Ormesson n'est plus «en rien seigneur, hiérarchie, autorité, providence, technocrate qui aurait fait un plan». Le Dieu de Jean est un «copain», qu'il tutoie et dont il n'hésite pas à raconter la vie, en attendant de jouer au trictrac avec le Père Éternel.» Le Dieu de Romaric Sangars, lui, est baudruche de foire gonflée à l'hélium (ou bien préservatif mué en quelque immense édredon sans la moindre gouttelette de foutre ?, cf. p. 23) qui se prend pour vaisseau interstellaire.






























































 Imprimer
Imprimer