Les visages pâles de Solange Bied-Charreton ou Martine s'essaie à l'écriture (19/08/2019)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
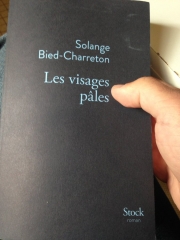 Mon article va finir mal, mais je crains qu'il ne commence assez difficilement. En effet, Les visages pâles m'a d'emblée fait penser aux Renards pâles de Yannick Haenel, et tout ce qui me fait penser à Yannick Haenel me donne la nausée, puis de franches envies vomitives. Avant même d'avoir ouvert ce laborieux roman qui rendrait ceux de Michel Houellebecq fins comme une phrase de Marcel Proust, roman dont je ne dirai rien car la presse réactive l'a amplement résumé et encensé, mon hypothétique plaisir de lecture s'envolait donc plus sûrement qu'une belle phrase devant la petite langue tirée de Christine Angot sur son clavier poisseux. Lire Solange Bied-Charreton est un exercice certes particulièrement pénible, à peine atténué par le petit plaisir que voici : en matière de critique littéraire, c'est-à-dire de jugement, la bonté est peut-être ce qui ressemble le plus au mystérieux péché de l'esprit. C'est parce que je suis encore bien trop plein de bonté que je n'ai pas évoqué Enjoy, premier roman de Solange Bied-Charreton, à peu près nul si ce n'est, ici ou là, un grumeau métaphorique s'extrayant malaisément d'une glu d'insignifiances, d'un plâtra de petites phrases que l'on dirait avoir été écrites, produites plutôt, par un logiciel que l'on n'aurait nourri que des textes paraissant sur Causeur ou L'Incorrect.
Mon article va finir mal, mais je crains qu'il ne commence assez difficilement. En effet, Les visages pâles m'a d'emblée fait penser aux Renards pâles de Yannick Haenel, et tout ce qui me fait penser à Yannick Haenel me donne la nausée, puis de franches envies vomitives. Avant même d'avoir ouvert ce laborieux roman qui rendrait ceux de Michel Houellebecq fins comme une phrase de Marcel Proust, roman dont je ne dirai rien car la presse réactive l'a amplement résumé et encensé, mon hypothétique plaisir de lecture s'envolait donc plus sûrement qu'une belle phrase devant la petite langue tirée de Christine Angot sur son clavier poisseux. Lire Solange Bied-Charreton est un exercice certes particulièrement pénible, à peine atténué par le petit plaisir que voici : en matière de critique littéraire, c'est-à-dire de jugement, la bonté est peut-être ce qui ressemble le plus au mystérieux péché de l'esprit. C'est parce que je suis encore bien trop plein de bonté que je n'ai pas évoqué Enjoy, premier roman de Solange Bied-Charreton, à peu près nul si ce n'est, ici ou là, un grumeau métaphorique s'extrayant malaisément d'une glu d'insignifiances, d'un plâtra de petites phrases que l'on dirait avoir été écrites, produites plutôt, par un logiciel que l'on n'aurait nourri que des textes paraissant sur Causeur ou L'Incorrect. Tout vieux briscard journalistique vous le dira : il ne faut jamais dire du mal d'un premier roman paraît-il, et l'inobservance de cette règle absolue du journalisme inculte peut valoir au critique envieux, ce raté notoire, une lourde peine d’excommunication. Depuis longtemps écarté du journalisme à fort tirage et petite pensée, j'ai donc critiqué tel premier roman, 111 d'Olivier Demangel par exemple, moins oubliable toutefois que les textes de Solange Bied-Charreton par l'originalité de son sujet. J'ai également qualifié de prétentieuse bouse le premier mais, hélas, sans doute pas le dernier, roman de Clémentine Haenel, et je serais bien évidemment tout disposé à en faire de même pour le second, voire le deuxième, hélas encore. C'est aussi parce que je suis trop plein de bonté, en dépit cette fois-ci de tout interdit tacite, que je n'ai pas évoqué Nous sommes jeunes et fiers, le deuxième roman, lui franchement mauvais, de Solange Bied-Charreton qui est quelque chose, je m'en avise en souriant, comme le pendant féminin, plus drôle cependant et quand même moins prétentieux que son altier modèle portant testicules en bakélite et lavallière en soie, du très dandy, vertical et même priapistique Romaric Sangars, cultivateur gothique de navets dont le troisième du genre, pourtant poussé au coin d'un jardin de curé, ne semble pas avoir bénéficié de quelque engrais certifié d'origine rigoureusement naturelle. D'ici peu, notre cultivateur de navets en herbe offrira en circuit court comme il se doit un cageot entier de ses dolentes cultures, dont quelques bécasses et pas mal d'ânes feront un usage résolument écologique en les transformant en engrais naturel, qui permettra d'enrichir la rapide poussée de nouvelles courges : hélas, les plantations de serre ne trompent jamais que les ignorants, et jamais une production de boudoir ne pourra être confondue avec une plante sauvage, soumise aux éléments, tirant d'eux sa force.
C'est cependant pour corriger cette coupable abondance de ridicule bonté suintant de la moindre de mes phrases comme les platitudes tombent d'un article d'Eugénie Bastié, laquelle (la bonté, pas la Bastié) me perdra assurément, que j'ai non seulement décidé de lire le troisième roman de Solange Bied-Charreton, Les visages pâles, ce qui n'est pas un mince exploit je vous prie de le croire, mais de l'évoquer sans tomber dans le tressage consanguin, sans fard et sans vergogne, de couronnes de laurier, ce qui tient non pas du prodige, mais de la plus élémentaire honnêteté intellectuelle et, sinon de la bonté, du moins de l'amour du travail bien fait. Avant de commencer ma séance de résipiscence publique, je me dois tout de même de ne point trop prendre mon lecteur pour un naïf, en précisant que Les visages pâles, roman non point pâle mais littéralement transparent (oui, pas même translucide), non point à peu près nul ou franchement mauvais mais franchement nul, a reçu l'accueil heureusement dithyrambique et bien sûr très largement mérité accordé aux livres des amis, selon la bonne vieille habitude des médias français, surtout ceux avec laquelle l'intéressée a l'habitude de travailler, qu'il s'agisse de Causeur, d'Éléments ou du Figaro. Une telle unanimité critique ferait presque passer Solange Bied-Charreton pour ce qu'elle n'est absolument pas : un écrivain digne de ce nom voire, tout bonnement, une romancière honnête à défaut d'être douée, comme l'est par exemple, avec une discrétion bienvenue par ces temps de surexposition, un Matthieu Jung qui a publié lui aussi chez Stock, et dans la même collection (La Bleue) que Martine, pardon, Solange.
C'est un problème de vue qui frappe tout d'abord le lecteur des Visages pâles : on relit telle ou telle phrase, pratiquement n'importe laquelle puisqu'elles sont toutes aussi mal fichues, et on se dit qu'on a mal lu. On relit la phrase en question, n'importe quelle autre puisqu'elles sont toutes capables de provoquer cette sidération de la vue, et on finit par se convaincre, ahuri, que Solange Bied-Charreton est moins une écrivassière rabat-joie, et même, une rabat-joie méticuleuse selon ses propres termes colligés par le cueilleur de truismes qu'est Devecchio, qu'une écrivante qui ne sait tout bonnement pas écrire, ni même respecter quelques règles élémentaires de concordance des temps. Sans doute est-ce le fait que l'intéressée soit née au début des années 80 qui lui a permis de bénéficier d'un enseignement de la grammaire et de la conjugaison aussi catastrophique que décomplexé, mais on se demande dans ce cas si la ou les personnes chargées de relire le manuscrit des Visages pâles (à moins, bien sûr, que l'éditeur Stock ne fasse point correctement son travail, hypothèse parfaitement envisageable quand on sait qu'il a osé publier du Christine Angot) souffrent du même déficit. Peut-être même faut-il parier que l'auteur et son ou ses relecteurs ne se sont même pas rendus compte que le livre qu'ils lisaient ou relisaient n'était tout simplement pas écrit en français, sinon celui d'un article pour Causeur je l'ai dit ou, bien pire, pour le Figaro Vox, Alexandre Devecchio, ce jeune prince du journalisme consanguin qui finira par prendre la place de l'insignifiant Étienne de Montety, qui possède, à défaut de cerveau, une langue (non certes pour écrire), réécrivant l'article et y ajoutant son lot de fautes.
On me dira que j'exagère, comme toujours, en me concédant toutefois que cette étrange tournure est bel et bien imprimée à la page 49 de notre roman : «La semaine précédente, l'enfant avait enchaîné les examens médicaux et psychologiques, et ils avaient enfin obtenu une explication rationnelle à propos de sur son comportement». Défaut de relecture assurément, qui en aucun cas ne doit me permettre d'affirmer que c'est tout le reste du roman qui présenterait les mêmes défauts, bien qu'il compte beaucoup de fautes (1). Pourtant, ce n'est pas tant cette faute évidente, imputable je le veux bien à une erreur d'inattention, qui me gêne, que des dizaines d'autres phrases qui, elles, j'en suis sûr, ont été conservées telles quelles. J'en donne un exemple, qui à vrai dire pourrait valoir pour tous les autres puisqu'il s'agit toujours du même patron étique : «Raoul avait conté à ses petits-enfants ce qui se trouvait derrière chaque fenêtre, combien d'hommes travaillaient, à quoi, à quel endroit, dans quel but. Ce qu'ils faisaient de leurs mains chaque jour» (p. 29). Deux phrases sont de la sorte artificiellement séparées par un point, la seconde étant du coup réduite à sa plus simple substance, comme le montre cet autre exemple : «Des rangements dégageaient ingénieusement l'espace. Autorisaient le vide» (p. 129). Parfois, le verbe est purement et simplement rayé de la deuxième voire de la troisième phrase suivant, toujours sur le même canevas, la première phrase qui les aura fait naître. Ainsi : «L'un des traits les plus édifiants de cette époque, c'était le défaut d'engagement, l'incertitude constante. Siècle d'êtres liquides, fébriles, titubants. Raison sans fondement. Revirements, fortune acquise mais perdue d'un cillement, d'un souffle» (p. 94).
Que voulez-vous, une seule phrase mal construite sur ce modèle, qui suffirait à faire passer la prose de Michel Houellebecq pour un modèle de nervosité stylistique, suffit à me faire jeter à la cheminée un livre (pardon Solange, mais c'est encore le meilleur moyen de spiritualiser ton texte que de le livrer aux flammes et aux courants chauds, donc ascendants, qu'elles provoquent), mais alors deux ou trois, à chaque page faiblarde, traînarde, poussive et soporifique de ce roman si long qui eût pourtant pu tenir en une ligne : Jules-Édouard est triste de ne pas savoir pourquoi il est triste et cela suffit à faire de lui un inadapté social et même un franc réactionnaire, voilà qui me donne des envies de bûchers géants, alimentés pourquoi pas par tout le petit bois débité menu par Solange, ses cousins, nombreux, et ses amis, pléthoriques voire journalistiques. Nous avons lu mille fois ces invertébrations d'écriture qui, par paresse ou plutôt, dans le cas qui nous occupe, par insuffisance, lorgnent systématiquement vers le camée sociologique et ont moins de profondeur qu'une platitude d'Eugénie Bastié et multiplier les exemples de cette indigence stylistique n'aurait d'autre but que de nous faire perdre un temps précieux que nous pourrions consacrer à de vrais écrivains.
J'ai avoué d'entrée de jeu un péché en affirmant qu'il ne m'avait jamais gêné de dire tout le mal que je pensais d'un premier roman, surtout s'il était mauvais. Je dois à présent confesser une seconde faute, plus grave encore que ne l'est la première : ce n'est pas au feu que j'ai jeté Les visages pâles de Solange Bied-Charreton, mais à la poubelle. Je crains même de ne pas m'être vraiment préoccupé de la couleur de son couvercle.
Note
(1) Solange Bied-Charreton, Les visages pâles (Stock, 2016). Voir ainsi, à la page 87 : «Cela ne servait à rien de présenter correctement, ou bien même d'utiliser d'expressions branchées». Page 66 : «L’œuvre en grand, étalé», etc. Ajoutons un assez comique : «La question immobilière avait pourtant glacé l'insistance» (p. 161) en lieu et place d'assistance bien sûr. Finalement, Solange Bied-Charreton écrit tellement mal que nous finissons assez vite par ne même plus voir les fautes et incorrections manifestes déparant sa non-prose, cette dernière étant tout entière une aberration de la langue française.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, solange bied-charreton, les visages pâles, romaric sangars, eugénie bastié, caueur, l'incorrect, éditions stock |  |
|  Imprimer
Imprimer
