Journal du voleur de Jean Genet, pour en finir avec Édouard Louis (13/09/2021)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
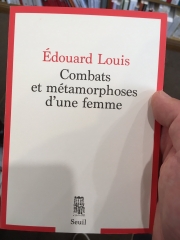 Comme Émile Louis dont il partage la si naturelle couleur de cheveux, Édouard Louis est un monstre. Je ne dirai bien évidemment pas qu'il est un tueur en série, même si je note que, avec son homonyme peroxydé, il partage la méthodique régularité avec laquelle il barbouille, massacre, éventre, viole : barbouille un paragraphe, massacre une phrase, éventre un livre, viole toute idée de beauté et de style, commet des hideurs arythmiques en série, autant de forfaits que nous pourrions bien considérer, sinon comme un meurtre du langage (car alors, Édouard le saccageur risquerait la prison à vie, enfermé dans une étroite cellule où il retrouverait la bavarde multitude de ses congénères, subissant constamment leur présence sordide, suffocante, outrageusement phallocratique), du moins comme un attentat envers toute forme de littérature digne de ce nom. Hélas, nous le savons tous : le laxisme règne, pas seulement lorsqu'il s'agit de condamner à de très lourdes peines des salopards de tous genres, comme Émile Louis, mais aussi en matière de critique littéraire voire, plus simplement, de bon goût, et le méticuleux sabordeur de littérature, l'épandeur de navets cacologaux, le compilateur de truismes bourdieusards qu'est Édouard Louis, non seulement ne sera jamais condamné, fût-ce à un unique jour-amende, mais sera au contraire célébré et, si cela continue, reconnu comme le nouveau Jean Genet qu'il n'a jamais été, n'est pas et jamais ne sera, même par la grâce de tous les journalistes pullulant comme une nuée de criquets destructeurs.
Comme Émile Louis dont il partage la si naturelle couleur de cheveux, Édouard Louis est un monstre. Je ne dirai bien évidemment pas qu'il est un tueur en série, même si je note que, avec son homonyme peroxydé, il partage la méthodique régularité avec laquelle il barbouille, massacre, éventre, viole : barbouille un paragraphe, massacre une phrase, éventre un livre, viole toute idée de beauté et de style, commet des hideurs arythmiques en série, autant de forfaits que nous pourrions bien considérer, sinon comme un meurtre du langage (car alors, Édouard le saccageur risquerait la prison à vie, enfermé dans une étroite cellule où il retrouverait la bavarde multitude de ses congénères, subissant constamment leur présence sordide, suffocante, outrageusement phallocratique), du moins comme un attentat envers toute forme de littérature digne de ce nom. Hélas, nous le savons tous : le laxisme règne, pas seulement lorsqu'il s'agit de condamner à de très lourdes peines des salopards de tous genres, comme Émile Louis, mais aussi en matière de critique littéraire voire, plus simplement, de bon goût, et le méticuleux sabordeur de littérature, l'épandeur de navets cacologaux, le compilateur de truismes bourdieusards qu'est Édouard Louis, non seulement ne sera jamais condamné, fût-ce à un unique jour-amende, mais sera au contraire célébré et, si cela continue, reconnu comme le nouveau Jean Genet qu'il n'a jamais été, n'est pas et jamais ne sera, même par la grâce de tous les journalistes pullulant comme une nuée de criquets destructeurs.Plus bas, figure l'une de ses premières pages, absolument indigente, dont la prose liquide se répand comme une flaque nauséabonde débordant d'un urinoir mousseux d'aire d'autoroute moldavo-croate, et que de vagues animalcules de flache éditorialo-publicitaire n'ont pas honte d'appeler : témoignage bouleversant, cri de révolte absolue, remarquable déconstruction du carcan familial, magistrale conquête de la liberté, et même (oui, et même) vraie leçon d'écriture et tant d'autres lombrics aveugles avec lesquels ces monotones parasites du langage que sont les journalistes et les rédacteurs de tout élytre rongent méthodiquement les fondations de l'intelligence, de la littérature, du langage, de l'être donc.
Lorsque je ne m'avise pas de le plaindre, je n'ai que du mépris pour Édouard Louis; j'ai, en revanche, une haine réelle pour tous ceux (éditeurs et leurs sbires, dont les journalistes et les libraires) qui entretiennent la fumisterie consistant à le faire passer pour un écrivain. Il en est tellement peu un qu'il n'y a littéralement rien à dire sur son non-style résolu; comme le prodigieux Karl Kraus face à Hitler, je n'ai strictement rien à dire, encore moins à écrire, sur un roman d’Édouard Louis, si ce n'est, mais c'est l'essentiel, qu'il ne s'agit pas de littérature. Non pas que les moyens d'analyse me manqueraient subitement face à la surrection de cette bouche vide, comme ils ne manquèrent bien évidemment pas à Kraus l'intraitable, comme ils ne manquent pas à quelque crétin universitaire lorsqu'il s'agit de vanter la richesse sémantique d'une phrase d'Amélie Nothomb, mais parce que, écrire sur un roman d’Édouard Louis consisterait à donner chair à ce qui n'en a pas, prêter langue à ce qui n'en a pas.
Qu'est-ce qu'un monstre ? Une créature qui ose : se montrer d'abord (étymologiquement, le monstre se montre), choquer, épouvanter, tuer même, écrire dans le cas d’Édouard Louis : tératologiquement parlant comme diraient les ânes s'ils savaient parler, il se pose là le Louis, il est vraiment monstrueux, notre spécimen, car il ose non seulement se prendre pour un écrivain, mais vouloir nous convaincre, une main sur son cœur et l'autre sur notre épaule qu'il pétrit fraternellement, de sa placide bonté, de son geignard génie, de ses perpétuels cris d'orfraie effrayée. Je ne marche pas dans l'odieuse combine voulant me faire prendre une baudruche criarde pour la Lune argentée irradiant son éclat fantomatique sur le paysage nocturne et j'ai punaisé, dans ma galerie des horreurs que j'ai appelée, délicieusement, Nains et mégères, tout un tas de représentants hideux, tous plus contrefaits les uns que les autres de ces créatures qui, sans bouche, sans mains et bien souvent sans cerveau, se piquent néanmoins de vouloir écrire. Dans une société qui n'ose plus rien couper, comment les langues ne se reproduiraient-elles pas, comme les mouches à merde dans l'ancien temps, par génération spontanée ? Hélas, mes bons offices ne m'auront jamais permis de réellement couper, arracher une langue et, ainsi, certes minusculement, aider à l'extension du domaine du silence, toute proche d'être la dernière lutte qu'il nous soit laissé de tenter, je dis bien tenter, d'accomplir.
J'ai d'ailleurs hésité à intituler cet article, référence aux déclarations louisiques, Édouard Louis, l'écrivant qui fait honte à la littérature, titre qui conviendrait sans doute davantage à une note évoquant, plutôt que tel ou tel de ses livres, tous nuls de toute façon, tous interchangeables non seulement entre eux, mais avec le reste de ce qui passe pour littérature contemporaine, le phénomène pontifiant de foire, tout entier sorti, d'emblée paré d'une rangée de dents impeccables lui permettant de sourire aux caméras, de la cuisse de Narcisse. Édouard Louis se dit et est présenté, ce qui est beaucoup plus grave on en conviendra, comme un écrivain alors qu'il n'est, dans le meilleur des cas, qu'un très piètre écrivant, un de ces éphémères de flache étale, une luciole visiblement complexée de si peu briller, dont la prétention seule, que nous pourrions trouver adaptée à la triste condition de la dernière licorne vivante, acculée à périr de façon certaine, lui permet toutefois de se croire puissant phare perçant les ténèbres s'étendant entre la Voie Lactée et la galaxie d'Andromède.
Laissons ces périphrases, car notre contradicteur n'y verra que rhétorique et non, comme il s'en prétend capable, capacité d'appréhender le réel dans sa plus plate médiocrité. Édouard Louis, comme Carlo Michelstaedter dont il ne sait très probablement rien (car, sinon, il en aurait parlé et l'aurait sali), ne jure que par l'expérience véritable, se méfie des mots qui du reste le lui rendent bien. J'avoue m'être fendu d'un rictus méchant en imaginant notre frêle blondinet dégingandé en bleu de travail, accomplissant quelque besogne durement éprouvante, à de solides années-lumière de toute prétention littéraire. Laissons ces enfantillages pour affirmer qu'Édouard Louis est un imposteur, qu'il se prétende écrivain ou qu'il tire parti d'une situation, devenue commune en France, où on le présente comme tel. J'appelle imposteur celui qui, affirmant maîtriser une technique ou un art, ici littéraire, est incapable d'en donner ne serait-ce qu'une approximation. La maison construite par un imposteur se disant architecte s'écroulera avant même que d'atteindre le premier étage; le vin produit par un imposteur se parant de la qualité de vigneron sera immédiatement recraché par le malheureux qui s'avisera d'en goûter une gorgée; prenez le métier de votre choix, le passe-temps même, la passion qu'il vous conviendra, peu importe : seul l'imposteur se recouvrant de la toge prétexte (prétexte à lèchements de pieds) sera reçu, avec la pompe médiatique requise, par une foule de journalistes imbéciles qui se pâmeront devant le déchet produit par ledit imposteur, le considérant comme une maison alors que quelques briques bancales témoignent de sa dégringolade immédiate, comme un vin alors qu'une murène ne survivrait pas plus d'une minute dans cette infecte saumure, comme un livre alors que sa seule utilité consisterait à être immédiatement recyclé avant que d'être imprimé de ces mots creux, vindicatifs et idiots, ces phrases stupides, convenues, qui auraient pu être écrites par Marie (Darrieussecq), Laurent (Gaudé), Mathias (Enard), Chloé (Delaume), Lydie (Salvayre), Jean-Claude (D... ?), ces verbes de sémantisme vide, ces comparaisons indigentes, ces métaphores vérolées d'avoir tant écarté leurs cuisses colonisées par les antennes vénériennes de toute une faune. En littérature, dans les arts plus généralement comme celui du contemporain, ainsi que le surnomme Jean-Philippe Domecq, l'imposteur est célébré, alors qu'il serait immédiatement moqué puis congédié d'un coup de pied au séant dans tout autre domaine où il aurait prétendu exercer ses fallacieuses compétences. Vous aurez raison de me faire remarquer que la presque totalité de ce qui passe en France pour de la critique littéraire, fût-elle journalistique, est exercée par des imposteurs refusant de juger (couper, donc, des langues et des têtes !) les textes produits par des imposteurs, les borgnes étant comme on le sait rois au pays des aveugles, ce mutuel réseau d'incompétences et d'impostures formant ce qu'il est convenu d'appeler le monde éditorialo-journalistique français, soit, plus directement, un lupanar à ciel ouvert. J'ai dessillé mon regard depuis longtemps; j'ai même été vacciné (mais oui !) contre la médiocrité littéraire, avec une seule dose par-dessus le marché, même si l'épidémie de livres bêtas a lancé, comme autant de gluants tentacules, des centaines d'attaques contre mon immunité désormais hermétiquement efficace contre toute forme d'intrusion de fausse littérature; je puis donc tout lire sans dépérir, oui, tout, même du Lydie Salvayre, du Yannick Haenel ou du Philippe Sollers, mais jamais on ne me fera prendre une imposture pour une œuvre d'art, et Édouard Louis pour ce qu'il n'est pas et qu'il ne sera jamais, autrement dit l'un des mots les plus prostitués de la création, certes après celui de journaliste : un écrivain.
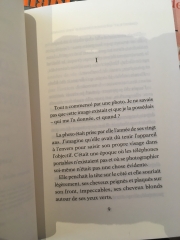 Je ne m'aventurerai pas davantage à gloser sur l'étrange complexion qui pousse ce Jean-Sol Partre de bac à sable et débarrassé de sa hargne dialectique confinant au génie, cet histrionique Bourdieu n'ayant pas dépassé le stade de l'apprentissage d'un vague pré-langage de supplétif sociologisant à nous donner son avis sur tout, y compris sur l’eidétique phénoménalo-existentielle de Properce de Varanges, ce grand philosophe oublié du 17e siècle moldavo-helvète luttant à ses heures pour la reconnaissance du caractère hermaphrodite de l'escargot de Bourgogne (Helix Pomatia).
Je ne m'aventurerai pas davantage à gloser sur l'étrange complexion qui pousse ce Jean-Sol Partre de bac à sable et débarrassé de sa hargne dialectique confinant au génie, cet histrionique Bourdieu n'ayant pas dépassé le stade de l'apprentissage d'un vague pré-langage de supplétif sociologisant à nous donner son avis sur tout, y compris sur l’eidétique phénoménalo-existentielle de Properce de Varanges, ce grand philosophe oublié du 17e siècle moldavo-helvète luttant à ses heures pour la reconnaissance du caractère hermaphrodite de l'escargot de Bourgogne (Helix Pomatia). Je ne craindrai pas en revanche d'affirmer qu'Émile, pardon, Édouard Louis est un monstre tout entier inventé par son éditeur et, cela va de soi, par des journalistes qui, eux-mêmes et avec une monotonie de vache à hublot ruminant de l'herbe synthétique, crient au chef-d’œuvre toutes les fois que ladite chimère médiatique, leur petit monstre de foire qu'ils exhibent à plaisir, fait un livre, qu'ils qualifient avec un merveilleux empressement d'idiot dodelinant du chef de chef-d’œuvre insurpassable, que ledit génie surpasse pourtant toutes les fois qu'un de ses nouveaux livres, crotte sur crotte donc jusqu'à former de petites tours malodorantes à la Foire du Livre, s'ajoute à sa production qui, comble de malchance, risque d'être abondante.
Il est vrai que le diligent Geoffroy de Lagasgnerie, dès que tombe sur l'herbe chaude la livresque bouse, s'empresse de la recueillir dans ses mains tremblantes, puis la fait sécher et la découpe savamment en petits pavés presque parfaits, comme s'il s'agissait d'un beurre de qualité supérieure : il paraît qu'il conserve dans sa cave, avec les champignons qu'il extrait méthodiquement de sa bibliothèque de combat en relative décomposition, ces blanchâtres crottins pas même odorants, ces maniables daubes saponifiées, ces délicates rinçures affinées pendant des mois, se réservant parfois le plaisir rare d'en offrir un minuscule morceau à tel de ses invités, ce qui ne peut manquer de provoquer, sur les faces de nos conspirateurs perpétuels et implacables conjurés de salon germanopratin, des convulsions de tique en train de pomper une outre remplie du sang du Minotaure.
Édouard Louis n'existe pas à vrai dire, au sens que la philosophie accorde à ce verbe point si transparent que cela, car il a été cultivé, je crois que c'est le terme exact que l'on réserve aux potirons et aux souches mutantes, par Télérama, par Le Monde des Livres, par Les Inrocks, par L'Obs, par Libération, et ses nourrices ou mauvaises fées ont pour nom Nelly Kaprièllan, Fabienne Pascaud, Claire Devarrieux ou encore Élisabeth Philippe, Aude Lancelin, cette journaliste d'une intégrité insoupçonnable, et Raphaëlle Leyris, autant de géni.e.sses (prononcez : génisses, je crois que c'est la façon dont les apôtres perclus de l'écriture inclusive désignent les génies de sexe féminin) de salles de rédaction officiant dans ce qui, naguère, portait le nom de critique littéraire, fût-elle journalistique je le répète ce qui ne peut que paraître suspect, et qui n'est plus, aujourd'hui, qu'un marigot saumâtre où ces animalcules et tant d'autres se sucent les antennes, se pourlèchent les élytres et s'épongent les émonctoires. Pierre Bourdieu, encore lui, aurait parlé de champ, ce qui ne saurait dépayser nos ruminants, un champ pour le contrôle duquel nos sommités critiques seraient capables d'exercer une terrible violence symbolique, voire de tuer, d'un bon mot uniquement, cela va de soi. Lorsque Fabienne salue le génie d’Édouard, Aude, qui aime Édouard et le montre au moyen d'un cœur tout rouge, se sent tenue, par un pacte tacite consistant à saluer non pas ledit génie, inexistant, mais bien davantage la rapidité de sa collègue pour flairer, entre mille ânes, le plus fameux, de relayer son chant d'amour en se contentant d'en changer quelques virgules, avant même que Claire ne reprenne pour son propre torchon l'antienne indigente, qui sera conclue en apothéose par le hululement de fin des temps poussé par Raphaëlle. Toutes sont unanimes, dans leur sottise : celui qui joue au paon, fût-il privé de ses organes de reproduction les plus identifiables et tirant gloire de cette éviction démocratique de toute forme de virilité, fût-elle bien visiblement jetée dans les pages d'un livre, fait toujours glousser les bécasses.
Je viens de vérifier, pris d'un doute bien compréhensible, quel est le verbe qui désigne le cri de la bécasse, car c'est la perdrix, la gélinotte ou la poule qui gloussent : la bécasse ne glousse pas mais croule. J'aime bien ce verbe, crouler, surtout lorsqu'il est accolé à Édouard Louis et à ses décaties, croulantes bécasses : tous, ils croulent d'envie, de bêtise et de jalousie (il n'y a rien de plus méchant que deux bécasses jalouses, si ce n'est deux poules et deux dindons rivaux), ils croulent sous les litres de salive, j'ai failli écrire, significativement, les livres de salive, qu'ils échangent en se congratulant, alors que nous aimerions, tout simplement, qu'ils soient croulés, pardon, coulés dans un bassin profond rempli de ciment liquide, pour qu'on tente d'oublier ce cirque où jamais un fauve ne croque de gladiateurs, faute de félins certes mais surtout de combattants.
Édouard Louis, à défaut de posséder une langue, sait gueuler, en plus de crouler, donc, des messages dont je ne voudrais pas réduire la haute portée littéraire comme : tout le monde déteste les gendarmes, ainsi que le montre cette vidéo où nous le voyons, en tête de cortège, affublé du distingué Geoffroy de Lagasnerie qui, m'a-t-on précisé depuis que j'ai commencé à écrire cette philippique inutile, est un sociologue de stature parisienne, défendre l'honneur bafoué du grand poète Adama Traoré, merveilleux auteur qui s'est naturellement inscrit dans les pas de l'immense Arthur Rimbaud en ayant écrit un pastiche d'une pièce célèbre du maître, l'ironie et le talent en moins cependant, intitulée Sonnet du trou du cul extravasé publié aux jeunes et prometteuses Éditions de la Matraque déjà encensées par le plus mauvais lecteur journalistique de France, Bernard Lehut en personne, sauf si l'on tient compte de la position de perpétuel outsider d'Augustin Trapenard, indéboulonnable Sphinx tout rempli des plus consternants truismes qu'il nous lâche avec la mine d'un perpétuel ravi de la crèche médiatique.
Vous aurez remarqué que mentionner la plus petite ligne d’Édouard Louis et même, sans le faire, évoquer sa personne, le moindre de ses propos, nous contraint à ratisser les écrits du plus nanométrique sous-pigiste d'arrière-latrine rédactionnelle, preuve supplémentaire, s'il en fallait encore une, que la mauvaise littérature prospère à proportion de la mauvaise critique, de la critique qui a baissé les bras et tendu ses fesses depuis longtemps dilatées, elles, même si, par généreuse célérité et non-respect du droit d'aînesse, elle aurait désormais tendance à en devancer systématiquement la profonde nullité. Je pourrais ainsi montrer qu’Édouard Louis est ce que Bernard Blier a appelé une synthèse (et Dieu sait que j'en ai vus, des écrivants !) de la pire littérature, celle qui s'abaisse au niveau d'une copie d'étudiant en première année de sociologie.
 Je ne sais pas qui a tué le père d’Édouard Louis, je crois bien que je m'en fiche princièrement, même si, à la réflexion, j'espère qu'il est mort avant d'avoir vu paraître au monde la tête de sa progéniture stochastique, mais je sais en revanche quel écrivain, par avance, et sans strictement rien savoir, heureusement, de cette affligeante créature médiatique qu'est l'auteur de Pour en finir avec Eddy Bellegueule, a tué non seulement les prétentions littéraires de notre cacographe émérite, mais toutes celles de son engeance fourmillante, femmes et hommes confondus, hommes puis femmes ou l'inverse, trans et autres bizarreries acronymiques genrées, LGBTRQZAFYK+&!?, fruits tavelés d'une modernité devenue folle, je crois n'avoir oublié aucun de ces têtards de laboratoire post-humaniste.
Je ne sais pas qui a tué le père d’Édouard Louis, je crois bien que je m'en fiche princièrement, même si, à la réflexion, j'espère qu'il est mort avant d'avoir vu paraître au monde la tête de sa progéniture stochastique, mais je sais en revanche quel écrivain, par avance, et sans strictement rien savoir, heureusement, de cette affligeante créature médiatique qu'est l'auteur de Pour en finir avec Eddy Bellegueule, a tué non seulement les prétentions littéraires de notre cacographe émérite, mais toutes celles de son engeance fourmillante, femmes et hommes confondus, hommes puis femmes ou l'inverse, trans et autres bizarreries acronymiques genrées, LGBTRQZAFYK+&!?, fruits tavelés d'une modernité devenue folle, je crois n'avoir oublié aucun de ces têtards de laboratoire post-humaniste. C'est bien simple : Journal du voleur peut être interprété comme quelque imaginaire Journal de l'imposteur que n'aurait pas eu le cran (car il en faut) ni le talent (car il en faut aussi) d'écrire Édouard Louis mais qui, pas moins imposteur littéraire, s'amuse à narrer mollement une vie passée sous la férule réactionnaire d'un ordre profondément phallocratique, donc fasciste et même exterminateur à ses yeux, quelque chose comme le déchirement du septième sceau apocalyptique entre son frigidaire et le bocal de son poisson rouge, qui tourne en rond et le fixe d'un air bizarre, presque fascistoïde ma parole. Se donnant le beau rôle (Édouard, pas Bubulle, contaminé depuis sa naissance on l'aura compris par la parasitose brune), il lutte sans relâche contre toutes les formes rampantes et souterraines, ou alors outrageusement dressées sous nos yeux, de la domination la plus inqualifiablement bourgeoise et honteusement machiste.
Terminons-en avec Édouard Louis car, si je m'écoutais, je déverserais des trombes de boue, des torrents d'injures bloyennes, des sacs de compost composé du moût des mots les plus rares sur ce soi-disant homme du verbe et qui n'est qu'un verbeux de l'espèce la plus ridicule, la fière et qui s'exhibe, et m'exposerais alors aux probables bien que redoutables foudres procédurières, comme ce fut le cas lorsque je ferraillai voici quelques années contre le pseudo-éditeur Léo Scheer dont il était alors le conseil, du paraît-il très ouvertement gay Emmanuel Pierrat, comme Têtu le claironne, saluant comme s'il s'agissait du débarquement du premier Lapon sur la Lune une orientation sexuelle dont nous nous contrefichons supérieurement, et qui ne saurait nous dire, dans tous les cas de figure, absolument rien de son éventuel talent, ou tout simplement de ses compétences professionnelles qu'il me faudrait alors, de nouveau, redouter ! Mais je crois que, pour l'heure, notre homme risquant d'être pour quelques mois voire années emberlificoté dans de beaux draps céliniens, nous devons le laisser tranquille, n'est-ce pas ?
Jean Genet, solitaire et intraitable, féroce comme la hampe de fer au sommet d'un glacier
 Après les oubliettes, la cave et les lieux d'aisance, les plus belles salles du château, largement ouvertes sur la grande lumière du jour. Après le faux, le vrai. Après le verbiage sociologisant pour phocomèle journalistique, la littérature. Je viens de terminer de relire le magnifique Journal du voleur (1), lu une première fois au sortir d'une adolescence que j'eus visiblement beaucoup moins âpre que celle de l'écrivain, ou même celle d’Édouard Louis si nous acceptons de lui prêter le plus mince crédit, texte célèbre qui m'avait frappé et laissé, au fil des années, une sensation déplaisante, de plus en plus vague, pas assez toutefois pour me faire ignorer qu'il me faudrait revenir à ce livre somptueusement écrit, aussi profond qu'est étale le reflux gastro-œsophagien qu’Édouard Louis veut à tout prix nous faire prendre pour un livre, avec il est vrai le concours de nombreux spécialistes des troubles de la digestion.
Après les oubliettes, la cave et les lieux d'aisance, les plus belles salles du château, largement ouvertes sur la grande lumière du jour. Après le faux, le vrai. Après le verbiage sociologisant pour phocomèle journalistique, la littérature. Je viens de terminer de relire le magnifique Journal du voleur (1), lu une première fois au sortir d'une adolescence que j'eus visiblement beaucoup moins âpre que celle de l'écrivain, ou même celle d’Édouard Louis si nous acceptons de lui prêter le plus mince crédit, texte célèbre qui m'avait frappé et laissé, au fil des années, une sensation déplaisante, de plus en plus vague, pas assez toutefois pour me faire ignorer qu'il me faudrait revenir à ce livre somptueusement écrit, aussi profond qu'est étale le reflux gastro-œsophagien qu’Édouard Louis veut à tout prix nous faire prendre pour un livre, avec il est vrai le concours de nombreux spécialistes des troubles de la digestion. En tout cas, avançant dans ma relecture, je me suis publiquement demandé comment on pouvait décemment posséder une paire d’yeux, voire un cerveau point trop journalistiquement contrefait, et préférer la lecture du livre d'un très vague para-écrivain inclusif sans autre talent que celui que lui prêtent des journalistes à celle du sulfureux (et véritable écrivain, lui) Jean Genet. L'un est un être dont on aurait à bon droit toutes les peines du monde à prétendre qu'il est un homme, un homme, vous savez, cet étrange assemblage de muscles, d'os et de tendons, d'organes plus ou moins nécessaires, de volonté aussi ajointant le tout dans un assemblage plus ou moins brinquebalant, qui est censé ne pas geindre à longueur de journée, pleurant des livres liquides lorsqu'il s'avise d'en exsuder, alors que l'autre est un homme au carré, qui cumule toutes les forces et toutes les faiblesses masculines et qui les exacerbe au contact de la pointe, mortelle, des mendiants et des voleurs, et qui par-dessus tout ose relater son histoire, réelle ou imaginaire, imaginaire donc réelle, dans une langue incandescente chargée d'en garder la trace scintillante mais aussi servir d'offertoire, au centre duquel insérer le joyau verbal conquis de si haute lutte.
Comme est logique à cette aune, en fin de compte, la déclaration d’Édouard Louis, affirmant qu'il a écrit contre Jean Genet (celui du Miracle de la rose, mais peu importe), alors que c'est évidemment Jean Genet qui a écrit, altièrement, sans jamais supposer qu’apparaîtrait un jour un aussi verbeusement nul enfileur de grands mots vides, contre Édouard Louis et ses petits semblables, comme tout écrivain digne de ce nom écrit finalement contre la multitude nullarde et agitée de spasmes lorsque l'un des siens, d'un coup de projecteur médiatique, est isolé, une minute ou 10 années, de la masse informe que composent ses grouillants congénères ! Ses déclarations pour le torchon Télérama prouvent en tout cas le fait que notre Eddy Bellegueule national est non seulement un écrivain à peu près infâme mais un très pauvre lecteur et, d'abord, de Jean Genet qu'il a peut-être (peut-être) sérieusement lu, en écartant quelques chromos criards que l'écrivain lui-même ne fut certes pas le dernier à brandir.
Je me demande alors si Jean-Paul Sartre n'aura pas été, pour Jean Genet, le tueur intellectuel, pas forcément involontaire si l'on connaît la ruse du bonhomme, et ce qu'il faut bien appeler sa méchanceté, que ce dernier a été par avance pour Édouard Louis, et cela en toute connaissance de cause, puisque son verbe puissant, sa volonté inébranlable ne peuvent qu'annihiler non seulement ledit Louis mais tous les moucherons de pissotière, qui s'enivrent des miasmes (lutte des classes, domination, classements dominants, espace d'identification, etc.) d'un urinoir qui aurait été ironiquement construit au pied d'un grandiose Himalaya, celui de la littérature, pour lequel ils n'auraient aucun désir et, même, dont ils se passeraient fort bien durant leur vie heureusement éphémère. En tout cas, l'analyse du philosophe est bonne lorsque, à propos du Journal du voleur, il remarque que «n'est pas Narcisse qui veut. Combien se penchent sur l'eau qui n'y voient qu'une vague apparence d'homme» alors que «Genet se voit partout; les surfaces les plus mates lui renvoient son image; même chez les autres, il s'aperçoit et met au jour du même coup leur plus profond secret». Il est par ailleurs tout à fait juste de constater que, dans le Journal du voleur, «le mythe du double a pris sa forme la plus rassurante, la plus commune, la plus naturelle : Genet y parle de Genet sans intermédiaire», mais il ne faudrait toutefois point trop suivre cette piste du double, si paresseusement scolaire, sauf à oublier de remarquer, et Sartre ne s'y trompe heureusement pas, que Genet «fait l'histoire de ses pensées», et qu'on pourrait même «croire qu'il a, comme Montaigne, le projet bonhomme et familier de se peindre». C'est bien sûr ce qu'il fait, se peindre, et cette peinture, plus terrible peut-être que le fameux portrait de Dorian Gray révélant la hideur cachée du personnage de Wilde, n'a pas d'autre but que celui d'être exposée, et donc remise sous les yeux du premier venu. Si édification il y a, et volonté de s'offrir au regard, le chemin qui y mène est assez peu semblable à la paisible allée de fins gravillons où le penseur promène ses pensées et les aligne dans un ordre impeccable, composant quelque jardin à la française que Genet eût moqué voire saccagé, avant d'y soupçonner le témoignage d'une grandeur ancienne.
Peinture solitaire, secrète, à respiration rentrée, hermétique même, absolument pas bonhomme c'est certain, mais qui doit pourtant sa puissance de trait d'être exposée à tous les regards, livrée au public, offerte ou plutôt, putanisée : c'est que Jean Genet, dans son Journal du voleur, veut ériger son infamie en grandeur, faire de sa pouilleuse misère une insigne réussite. La dialectique de cette exposition, du moyen plutôt qui y aboutit, est déclinée de multiples façons mais elle obéit systématiquement à cette trame : c'est à la mesure de la répulsion qu'elle leur inspire que les hommes s'éloignent d'une œuvre d'art «profonde», et profonde seulement «si elle est le cri d'un homme enlisé monstrueusement en soi-même» (p. 235). Notons encore cette confidence de Genet écrivant que c'est «à la gravité des moyens que j'exige pour vous écarter de moi [qu'il faut mesurer] la tendresse que je vous porte», l'écrivain d'ajouter que «créer n'est pas un jeu quelque peu frivole», car «on ne peut supposer une création n'ayant l'amour à l'origine» (pp. 235-6) : nous voici donc confrontés à une impossibilité, une aporie, puisque c'est dans le même mouvement que Jean Genet crée et se crée, mais que le mouvement même de cette création suppose de descendre en soi-même, jusqu'à éprouver l'éblouissement de «Hitler seul, dans les caves de son palais, aux dernières minutes de la défaite de l'Allemagne», Hitler qui sûrement connut «cet instant de pure lumière» qui n'est autre que «la conscience de sa chute» (pp. 236-7), mouvement de descente, de fermeture sur sa propre déchéance, voluptueux plaisir de sa chute donc qui ne peuvent être éprouvés que dans un tête-à-tête infernal. C'est l'ensemble du Journal du voleur qui pourrait être lu, bien davantage que comme l'exposition des jeux de miroir et de doubles où Sartre a cru saisir le reflet le plus pur (ou bien le moins déformé) de Jean Genet, ainsi que l'évocation de «la solitude satanique» (p. 241) à laquelle s'efforce de parvenir l'écrivain par «une ascèse entre toutes délicates» (p. 243).
La réussite de ce largage des amarres en somme, ne peut qu'être celle du langage par laquelle l'écrivain va fixer, non point tant ses traits, ou ceux de ses amants en lesquels il se mire selon Sartre, que la rigueur inhumaine, l'ascèse monstrueuse qui les façonneront bien davantage que les errances au travers d'innombrables pays. Portrait en creux, paradoxal encore, puisque chacun de ceux qui pourrait le contempler doit être rejeté, annihilé en tant que regard par essence imparfait. Il faut se demander, non pas si Jean Genet s'est peint pour quelque impossible spectateur idéal ou absolu, mais pour celle ou celui qui, par définition, ne peut exister.
Contrairement à sa fanfaronne affirmation, ce n'est pas pour le crime qu'il bande (1), ni même parce qu'il joue la putain «qui accompagne en Sibérie son amant ou celle qui lui survit afin, non de le venger mais de le pleurer et de magnifier sa mémoire» (p. 97), et il est faux de prétendre que «la trahison, le vol et l'homosexualité sont les sujets essentiels de ce livre» (p. 193); ce n'est même pas pour son moi plus narcissique que barrésien (cf. p. 106) qu'il en pince sérieusement, mais pour le style qui dira ce crime, du moins son voisinage attracteur et fascinant. Jean Genet se décrit mieux que tout autre commentateur, fût-il bien intentionné, lorsqu'il indique qu'il a surtout recherché à être «la conscience du vol dont [il écrit] le poème» (p. 105). Ainsi, bien que l'écrivain utilise des mots «non afin qu'ils dépeignent mieux un événement ou son héros mais qu'ils vous instruisent sur [lui]-même» (p. 17), cette prétention n'a pas d'autre sens que celle de chanter la geste du Mal dans une langue nouvelle : «L'acte est beau s'il provoque, et dans notre gorge fait découvrir, le chant. Quelquefois la conscience avec laquelle nous aurons pensé un acte réputé vil, la puissance d'expression qui doit le signifier, nous forcent au chant» (p. 24), l'invocation (plus ou moins directe quoique constante) à Rimbaud (2), obligeant Genet «à considérer [sa] vie misérable comme une nécessité voulue» (p. 20) devant s'entendre non seulement comme la volonté monstrueuse de cultiver sur soi-même quelques répugnantes verrues, mais de «retrouver les mots les plus neufs de la langue française» (p. 23), voire, tout bonnement, les inventer s'il s'avérait qu'ils étaient décidément trop démonétisés ou, pour reprendre la métaphore mallarméenne, démotivés.
Il ne s'agit donc pas, il ne s'agira d'ailleurs jamais, pour Jean Genet, de jouer les durs, les arsouilles, les rejetés du rivage petit-bourgeois que l'on s'efforce de toute sa volonté, avec de comiques moulinets de bras, de rejoindre pour, comme on dit, gagner sa place au soleil et étendre sa serviette sur la plage bondée, puis y acheter un paquet de grasses chips en songeant aux nombreuses invitations où des journalistes aussi serviles qu'ignares vous poseront de vaseuses questions auxquelles vous répondrez avec une morgue affectée, l'air presque absent. De tels amusements, laissons-les au révolté de pacotille qu'est Édouard Louis et à ses commis de plateau, pitoyables Sancho Panza prévenant le moindre désir du palefrenier à si triste figure, qui, comme son illustre ancêtre, combat des moulins disposant de tout le confort bourgeois nécessaire, ne rêvant cependant pas de grandeur épique, d'un temps où les chevaliers, avec le souvenir des belles dames, promenaient leur chance de servir une noble cause sur les routes dangereuses du monde, mais de cracher dans l'écuelle que lui tendent si complaisamment tant d'imbéciles, dont nous sommes bien loin d'avoir épuisé l'interminable liste consanguine. Car il est bien évident que celle ou celui (cela, pour mes amis atteints d'inclusivite aiguë) qui déroulent le tapis rouge sous les pieds de Louis et de ses semblables méritent l'estrapade, et doublement : ils ne savent pas lire, mais ils affirment haut et fort que les nullités interchangeables qu'ils louent quotidiennement, sur les ondes de France et de Navarre, sont des chefs-d’œuvre.
Revenons à notre écrivain. Il s'agira donc pour lui de réhabiliter une époque de sa vie «en l'écrivant avec les noms des choses les plus nobles», puisque la victoire de Jean Genet est verbale et qu'il la doit «à la somptuosité des termes» (p. 65), puisqu'il a aussi le culot insurpassable de croire qu'il ne reste de ses innombrables amants que tel de leurs attribut qu'il a chanté (cf. p. 122), lui qui refuse «d'être prisonnier d'un automatisme verbal» lui faisant par exemple comparer un postérieur à un reposoir (cf. p. 67), lui qui définit le talent comme «la politesse à l'égard de la matière», qui «consiste à donner un chant à ce qui était muet» (p. 123), Jean Genet encore qui confesse qu'il n'a peut-être cherché, dans ce livre plus que dans d'autres, qu'à s'accuser dans sa langue (cf. p. 128), la France étant à ses yeux, de manière assez remarquable il faut le noter, «une émotion qui se poursuit d'artistes en artistes», lui-même n'étant jusqu'à la fin qu'un «chapelet d'émois» (p. 132) dont il ignore les premiers, mais qu'il accepte après tout sans trop y réfléchir, comme tout écrivain de race, humblement, accepte de charger ses épaules de tel ou tel ancien dont la carcasse ne pèse pratiquement plus rien, mais qu'il faut pourtant sauver des eaux, du déluge de mots morts qui finira bien par recouvrir le dernier îlot point encore pollué par l'ondée du sous-langage.
La vie de Jean Genet, comme celle du Quichotte, doit être une légende, «c'est-à-dire lisible», héraldique aussi, renvoyant à un sens supérieur, un ordre de beauté caché, dont la «lecture [doit] donner naissance à quelque émotion nouvelle [qu'il] nomme poésie», lui-même n'étant alors «plus rien, qu'un prétexte» (p. 133). L'intention paradoxale, du moins en apparence, éclate lorsque l'écrivain avoue que, comme tant d'autres, il sait parfaitement que «notre langage est incapable de rappeler même le reflet de ces états défunts, étrangers», et qu'il en serait donc de même de son journal s'il devait être la notation de qui il a été. Il précise donc «qu'il doit renseigner sur qui [il est), aujourd'hui» qu'il l'écrit, et qu'il n'est donc pas «une recherche du temps passé, mais une œuvre d'art dont la matière-prétexte est [sa] vie d'autrefois» : il est donc, conclut Genet, «un présent fixé à l'aide du passé, non l'inverse» (p. 80), autrement dit : une parabole parfaitement valable même si elle ne livre point facilement sa clé, son chiffre secret, donnée à des fins d'édification, l'hermétisme dans lequel, volontairement, Genet déclare s'enfermer n'étant à ses yeux que le moyen le plus sûr de parvenir à son but.
Jean Genet, solaire et droit, ayant atteint une solitude qui lui confère la souveraineté (cf. p. 197), se tient, mais sa lumière présente la particularité de rayonner dans une longueur d'onde peu commune, comme une espèce de rouge dont la profondeur réelle est à peine perceptible par les yeux, ne serait que devinée comme un au-delà du spectre. Qu'est-ce qui le tient si crânement droit ? Rien d'autre que sa folle tentative de «réhabilitation de l'ignoble» (p. 26), lorsque les poux sont «le seul signe de notre prospérité, de l'envers même de la prospérité, mais il était logique qu'en faisant à notre état opérer un rétablissement qui le justifiât, nous justifiions du même coup le signe de cet état» (p. 28). C'est la misère qui relève (qui l'érige, dit-il) Jean Genet et ses compagnons, bien souvent ses amants, et il faut à toutes forces tenter de devenir «de plus en plus ignoble, de plus en plus un objet de dégoût, jusqu'au point final qui est je ne sais quoi encore mais qui doit être commandé par une recherche esthétique autant que morale» (p. 29).
On se sent vivre c'est certain, comme le montre ce passage extraordinaire, placé entre crochets et qui interrompent subrepticement la narration, qui semble être une réminiscence du Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, mettant en scène quelque aventurier «traversant la forêt vierge» et qui, «s'il trouve un placer que gardent d'anciennes tribus [...] sera tué par elles ou sauvé» (p. 33) : «découvrant de l'or il me semble l'avoir déterré : j'ai fouillé des continents, des îles océaniennes; les nègres m'entourent, de leurs piques empoisonnées ils menacent mon corps sans défense, mais, la vertu de l'or agissant, une grande vigueur me terrasse ou m'exalte, les piques s'abaissent, les nègres me reconnaissent et je suis de la tribu» (p. 32). Comme Kurtz l'aventurier, Jean Genet s'enfonce «de plus en plus profondément, dans les régions de [soi]-même les plus reculées» (p. 34), ce qui est tout de même d'une tout autre envergure que les explorations de l'autre moutard, retenant difficilement le hurlement qui ne va pas manquer de nous déchirer les oreilles à la moindre contrariété.
Autant de souvenirs, autant d'images et de métaphores qui convoquent un double registre : celui d'une exaltation de la souillure, du vol, du crime, de la trahison (3), de l'homosexualité, pour les retourner et en faire des signes de gloire, la vie misérable dans laquelle, à corps perdu écrit-il, Jean Genet s'est jeté, n'étant que «la réelle apparence de palais détruits, de jardins saccagés, de splendeurs mortes» (p. 99), et il faut alors briser «les liens les plus solides du monde : les liens de l'amour» (p. 51) mais, surtout, les ordonner pour en faire, tout à la fois, un chant digne de ce nom et une ascension qui est, retournement infernal, une descente. Ainsi, le Journal du voleur, de l'aveu de celui qui l'écrit, ne saurait être compris comme un «délassement littéraire» car, à mesure qu'il y progresse, «ordonnant ce que [sa] vie [lui] propose, à mesure [qu'il s']obstine dans la rigueur de la composition», il se sent s'affermir «dans la volonté d'utiliser, à des fins de vertus, [ses] misères d'autrefois» (p. 69). Nous pourrions analyser pratiquement chacune des pages de ce grand texte comme une illustration plus ou moins fine, ambiguë voire retorse, de la dialectique consistant à descendre dans le caniveau pour exalter ce que l'on y trouve et, même, que l'on n'hésitera pas à s'inoculer, afin d'exalter la monstruosité. Non pas pleurnicher sur une risible différence (version pédante, derridienne : différance), introuvable sauf peut-être dans les livres du père de la déconstruction, mais bien au contraire faire germer la graine d'aconit, en dévorer ensuite la fleur dangereuse, racines incluses : «Enfin plus ma culpabilité serait grande, à vos yeux, entière, totalement assumée, plus grande sera ma liberté. Plus parfaite ma solitude et mon unicité. Par ma culpabilité encore je gagnais le droit à l'intelligence. Trop de gens me disais-je pensent et qui n'en ont pas le droit. Ils ne l'ont pas payé d'une entreprise telle que penser devient indispensable à votre salut» (p. 94, l'auteur souligne).
Voyez comme Jean Genet érige tous ses vices en qualités, voyez, même, comme il ne craint pas d'écrire qu'il est «une exception monstrueuse», allant même jusqu'à crier de toute la force de ses poumons que son goût et son activité de voleur sont en relation avec son homosexualité, «sortaient d'elle qui déjà [le] gardait dans une solitude inhabituelle» (p. 277), confession de nos jours inimaginable car elle serait jugée stigmatisante, alors qu'un Édouard Louis, s'il exhibe ses ridicules pudenda, c'est pour qu'on le plaigne, qu'on se mette, avec lui, à déverser des bassines de pleurs compassionnelles et qu'on se range, toujours avec lui (de préférence derrière, car, dans la déploration lacrymale aussi, il lui faut tenir la vedette), pour accuser le père, la mère, les tantes et les oncles, le chien, le poisson rouge, la Terre entière puisque ce rageux jamais n'arrêtera d'écrire qu'il n'estimera avoir suffisamment craché sur la création tout entière pour tenter de la dissoudre et paraître, lui, Louis, blanc comme un linge.
Édouard Louis, comme une molle créature n'en finissant pas de secréter un opercule de bave pour se claquemurer dans sa coquille, ressortit de l'immonde aigreur nihiliste que Dostoïevski a analysée de manière insurpassable dans ses Carnets du sous-sol alors que Genet, lui, «s'enferme dans sa honte par l'orgueil, mot qui désigne la plus ancienne manifestation de la plus audacieuse liberté» et, «à l'intérieur de sa honte, dans sa propre bave, il s'enveloppe, il tisse une soie qui est son orgueil». Voyez comme l'un aspire à parader sur les plateaux télévisés, à être interrogé, soumis à la question pourvu qu'elle soit journalistique, donc complaisante; voyez comme l'autre, a contrario, tel «Lucifer ferraillant avec Dieu», par «la culpabilité suscite la singularité» et, si le coupable a le cœur dur poursuit Genet, «le hisse sur un socle de solitude» (p. 276).
La solitude n'est pas donnée, ose Genet qui prétend même la gagner, au rebours des innombrables courbures d'échine que l'autre aura dû accepter pour être intronisé par ses pairs, non pas tant les écrivains bien sûr, qui ne peuvent le regarder qu'avec une commisération amusée, que les journalistes, dont il exsude la nullité verbeuse, la complaisance satisfaite. Nous y venons doucement, au thème suivant, mais voyez encore comment l'un se veut «l'exception monstrueuse que s'accorde un monstre, délégué de Dieu, et qui satisfait [son] orgueil avec [son goût] de la solitude morale» (p. 266), alors que l'autre érige sa monstruosité chétive pour, à tout prix et hurlements de gamin perdu dans les bois et appelant son père espérons-le encore vivant, nous le prenions sous notre aile, nous l'aimions. Imaginez de quelle colère se fût animé le visage de Jean Genet si quelque journaliste, la mine faussement contrite, se fût avisé de le plaindre, de l'aimer ! Imaginez, l'espace d'un battement de cil, Édouard Louis écrivant, comme son modèle qu'il n'a probablement jamais lu sérieusement, sans ses lunettes à quintuple foyer idéologique (il serait amusant, s'il l'avait lu, de penser qu'il l'aurait trahi !), imaginez-le donc écrivant : «Je me reconnais le lâche, le traître, le voleur, le pédé qu'on voyait en moi» (p. 198), selon ce masochisme qu'un Roger Stéphane, dans son Portrait de l'aventurier, distingua comme l'un des traits les plus essentiels de la personnalité du grand Lawrence d'Arabie, et tremblez à la seule évocation, littéralement impossible de nos jours, sauf à ce que celui qui s'en serait rendu coupable ait les moyens de faire face aux innombrables procès qui lui seraient intentés, supposez tout de même que quelque Gauvain désespéré jette à la face de Louis ce jugement que Genet adressa à l'un de ses amants, réel ou magnifié, Stilitano, dans lequel il lui plaît de voir «un pédé qui se hait» (p. 60) ! Il ne me viendrait pas à l'esprit de reprocher à Édouard Louis sa sexualité, encore moins de la moquer; je méprise en revanche l'écrivain de peu de poids qu'il est, incapable d'oser, de nous étonner, de nous dérouter, de nous enthousiasmer, autant de sentiments que Jean Genet lève par brassées à chacune de ses pages. Édouard Louis, le conformiste absolu : la voilà, ma façon de l'insulter, qui s'attache à montrer que c'est le trognon pourri ou, pour faire mon universitaire, l'axe logocentrique faussé sur lequel cet alpiniste d'opérette exécute son petit tour, à 20 centimètres du sol préalablement recouvert d'un épais matelas gonflable.
Dans le texte de Genet, cette littérale inversion de toutes les valeurs n'a d'autre but que d'exemplarité et même, d'une paradoxale sainteté («la sainteté c'est de faire servir la douleur. C'est forcer le diable à être Dieu», p. 232) puisqu'elle est dépouillée de Dieu («Je nomme sainteté, non un état, mais la démarche qui m'y conduit. C'est le point idéal d'une morale dont je ne puis parler car je ne l'aperçois pas», p. 244), point de contact ou d'entrée, irruption fracassante dans la sphère du sacré : ainsi, la vie misérable que Genet a choisi d'épouser peut à bon droit être considérée, je l'ai dit, comme les ruines d'un monde autrefois solide, assuré, ferme mais, «plus ces ruines étaient mutilées, et ce dont elles devaient être le signe visible me paraissait lointain, plus enfoui dans un passé sacré», de sorte qu'il ne sait plus s'il habite «de somptueuses misères ou si [son] abjection était magnifique» (pp. 99-100).
Monter est descendre, nous l'avons vu, même si nous ne saurions tout de même tenir Jean Genet pour le plus direct continuateur de Léon Bloy, qui affirmait dans chacun de ses livres torrentiels que la réalité était inversée depuis la Chute; voyez toutefois : «C'est alors peut-être que rencontrant ma mère, et qu'elle fût plus humble que moi, avec elle nous eussions poursuivi l'ascension», encore que «le langage, précise Genet, semble vouloir le mot déchéance ou tout autre indiquant un mouvement vers le bas», l'ascension donc, «difficile, douloureuse, qui conduit à l'humiliation» (p. 102). Plus directement encore, ce passage étonnant que n'eût probablement point renié l'auteur des Histoires désobligeantes : «L'armée, les locaux de la police et leurs hôtes, les prisons, un appartement cambriolé [...] et, de plus en plus, chaque événement auquel j'assisterai, établissent en moi la même sensation de dégoût et de crainte qui me font penser que l'idée de Dieu je la nourris dans mes boyaux» (p. 195).
Un autre possible rapprochement avec la vision coruscante de Bloy, je le trouve dans la faculté de Genet à soupçonner, derrière la plus basse, sordide ou au contraire haute réalité, une réalité seconde, invisible, qui tout autant surplombe et approfondit la première d'une dimension mystérieuse, comme le montre cet exemple : «Si l'étendard du roi porté par un cavalier au galop apparaît seul, nous pouvons être émus, nous découvrir, si le roi l'apportait lui-même nous serions terrassés. Le raccourci que propose le symbole porté par ce qu'il doit signifier donne et détruit la signification et la chose signifiée», à moins, bien sûr, que cette double destruction ne soit elle-même l'objet d'un chant, chargé «d'embellir» les aventures révolues de Genet, «c'est-à-dire d'obtenir d'elles la beauté, découvrir en elles ce qui aujourd'hui suscitera le chant, seule preuve de cette beauté» (p. 230), comme l'explique l'auteur entre parenthèses.
Finalement, nous pourrions rapprocher l'inversion des valeurs que nous avons décrite comme une forme de réversibilité des mérites («Sans rougir, pourrais-je encore admirer les beaux criminels, si je n'avais pas connu leur nature ?», p. 242), selon l'approche de Massignon inspiré, justement, par Bloy et Huysmans, mais il n'en reste pas moins que le but de Jean Genet, dans notre texte, est de parvenir à rejoindre la terrifiante solitude de Rimbaud, non seulement pour tenter de forger un langage capable de raconter l'inouï et fixer des vertiges, mais pour se revêtir de la gloire d'un saint ne croyant à rien d'autre qu'à l'inflexible morale qui l'a mené si bas, donc si haut dans le système de l'auteur : «Je ne veux pas savoir si c'est pour expier un crime ignoré de moi que je désire le bagne, ma nostalgie est si grande qu'il faudra bien qu'on m'y conduise. J'ai la certitude que là seulement je pourrai continuer une vie qui fut tranchée quand j'y entrai. Débarrassé des préoccupations de gloire et de richesse, avec une lente, minutieuse patience j'accomplirai les gestes pénibles des punis. Je ferai tous les jours un travail commandé par une règle qui n'a d'autre autorité qu'émaner d'un ordre qui soumet le pénitencier et le crée. Je m'userai. Ceux que j'y retrouverai m'aideront. Je deviendrai poli comme eux, poncé» (p. 292). Comment ne pas rapprocher ces déclarations, bien d'autres encore, du programme poétique du Sieur Rimbaud se disant négociant ?
C'est «en crevant l'abcès de honte» que Jean Genet prétend «accéder à la lumière» (p. 75), s'il est vrai que l'écrivain a décidé «de vivre tête baissée, et de poursuivre [son] destin dans le sens de la nuit, à l'inverse de vous-même, et d'explorer l'envers de votre beauté» (p. 110) en embrassant le Mal, qu'il définit comme «un acharnement dans le contraire de votre morale» (p. 111). Nous avons vu quelle était la part importante, à vrai dire essentielle, du langage dans cette quête et, puisqu'il s'agit de magnifier l'abjection pour trouver du nouveau, parvenir à une sorte de sainteté qui n'est pour Genet que «le plus beau mot du langage humain» (p. 243), nous ne pourrions imaginer un Genet des ténèbres, un Genet muet, en somme, un Genet définitivement refermé sur lui-même, un Genet sans livre (celui que nous commentons, tous ceux qui l'ont suivi), ou bien qui eut échoué dans sa rimbaldienne tentative de fixer des vertiges et de forger une langue nouvelle. Cette intention est plusieurs fois répétée, et ce sont, systématiquement, des envolées qui nous font songer à l'exemple de l'homme aux semelles de vent : «J'irai vite ou lentement, mais j'oserai ce qu'il faut oser. Je détruirai les apparences, les bâches tomberont brûlées et j'apparaîtrai là, un soir, sur la paume de votre main, tranquille et pur comme une statuette de verre. Vous me verrez. Autour de moi, il n'y aura plus rien» (p. 234). Plus rien que l’œuvre, raison pour laquelle j'ai dit que cette intention était pour le moins paradoxale, monstrueuse même, s'il s'agit de constater que c'est à partir du ton même du Journal du voleur, plus que par les faits qu'il relate et dont nous ne connaissons guère une véracité qui au demeurant nous importe peu, que Jean Genet se fait un devoir de poursuivre son aventure (cf. p. 305), ses «séjours dans la mendicité et dans la prostitution» lui étant une discipline où il a appris à «utiliser les éléments ignobles», à se servir d'eux, à se complaire enfin dans son «choix pour eux» (pp. 80-1) et, de la sorte, à détruire une fois pour toute «les chers liens de la fraternité» (p. 91).
D'un côté, un écrivain, celui pour qui le verbe écrire est intransitif, qui recherche, sciemment, l'abjection et façonne une langue pour la dire. De l'autre, un écrivant, tout au mieux, celui pour lequel écrire n'est qu'un moyen pour obtenir quelque chose qu'il recherche ou convoite. Que recherche Édouard Louis ? Qu'on l'écoute plus qu'on ne le lise, qu'on le plaigne, qu'on le désigne comme celui qui a subi tant d'injures et de moqueries, qu'il n'a évidemment pas recherchées. D'un côté celui qui ne craint rien, cherche, volontairement, la trahison, la prostitution, le vol, le Mal, dût-il y laisser sa peau, son honneur et sa gloire (cf. p. 235) surtout, à vrai dire, pour se dépouiller de ces défroques, se débarrasser de ces anciennes peaux et muer. De l'autre celui qui ne cherche que cela, honneurs (le pluriel est important) et gloire, du moins réussite, et le fait en pleurnichant, en geignant, en se vengeant, en haïssant finalement, celui qui ne recherche qu'un vague honneur fantasmatique et corrompu, qu'il n'a probablement jamais perdu, car comment, dans pareil cas, imaginer qu'un homme puisse perdre un honneur aussi facilement si, pour le reconquérir, il doit se contenter de minauder sur les plateaux ?, honneur qu'il aura en tous les cas perdu en paradant devant les médias, et qui convoite une gloire chimérique, présente, actuelle, médiatique encore, et qui disparaîtra, fort heureusement, avant même que nous n'ayons définitivement oublié Édouard Louis qui, de fait, jamais ne parviendra à faire croire qu'il est ce qu'il prétend être : un écrivain, puisqu'un écrivain digne de ce nom se moque de tout ce après quoi un écrivant court, n'en finit pas de courir, et mourra sans jamais l'atteindre.
Cruel sort que celui d'Édouard Louis, plus cruel encore que celui de ses lecteurs, s'il en a de réels, lui qui est condamné à sans cesse faire et refaire le même texte dolent et nul pour atteindre un but qu'il a d'ores et déjà définitivement perdu et que Jean Genet, lui, a conquis, en ayant renoncé aux hommages, aux honneurs, au putanat médiatique, au verbe au rabais de l'éternel étudiant en sociologie qu'est et restera Édouard Louis.
Notes
(1) Jean Genet, Journal du voleur (Gallimard, coll. Folio, 2020), p. 13. Quelques fautes dans le corps du texte comme : absence d'un tilde («senorita», p. 64), absence d'un point final («le lecteur ne sera pas plus dupe que moi», p. 79 ou : «Après, me dit-il, j'ai vu un cul», p. 284, et : «Quand il sera sorti je monterai dans sa piaule», p. 297), absence de ponctuation après «Je tentai de sauver Armand et je dis encore» (p. 298).
(2) C'est une note complète qui mériterait d'être écrite sur la présence de Rimbaud dans la folle tentative de Genet dont le courage, écrit-il, consista «à détruire toutes les habituelles raisons de vivre et à [s'] en découvrir d'autres» (p. 197), certains passages du Journal du voleur pouvant même prétendre atteindre la fulgurance de l'auteur de la Saison en Enfer : «Quand pourrai-je enfin bondir au cœur de l'image, être moi-même la lumière qui la porte jusqu'à vos yeux ? Quand serai-je au cœur de la poésie ?» (p. 245). Remarquons aussi avec quelle infernale conscience, lui qui n'hésite pas à écrire qu'il se pense «du talon à la nuque» (p. 174), Genet cherche à briser les liens d'amour qui l'unissent aux hommes : «indispensable pour obtenir la beauté : l'amour. Et la cruauté le brisant» (p. 276) ou encore : «Si je ne puis avoir le plus brillant, je veux le destin le plus misérable, non pour une solitude stérile, mais afin d'obtenir d'une si rare matière, une œuvre nouvelle» (p. 278). Comme Rimbaud dont le «but rigide», écrit Genet, pourrait après tout être décrit «comme la hampe de fer au sommet d'un glacier» (p. 265), Genet, perpétuellement lancé «sur la route de ces régions infernales» (p. 266), et qui a multiplié les «interminables voyages à travers l'Europe poursuivis dans les haillons, dans la faim, dans le mépris, la fatigue et les amours viciées» (p. 188).
(3) C'est sans doute l'un des mots qui revient le plus systématiquement dans le texte de Genet, la trahison ou plutôt, son idée possédant un pouvoir réel sur l'écrivain. Selon ses dires, c'est sans doute elle qui est, à la différence de l'assassinat, «le moyen le plus efficace de rejoindre le monde souterrain de l'abjection» (p. 119). Innombrables sont les mentions accordant à la trahison de l'élégance ou de la beauté, voir la force permettant à l'inflexible Genet de poursuivre son but.
Lien permanent | Tags : littérature, critique llittéraire, émile louis, édouard louis, éditions du seuil, arthur rimbaud, léon bloy |  |
|  Imprimer
Imprimer
