« Le Grand d'Espagne de Roger Nimier | Page d'accueil | Les Verticaux de Romaric Sangars »
10/09/2016
Pas pleurer de Lydie Salvayre, le Goncourt de la vulgarité

Crédits photographiques : Daniel Ochoa de Olza (AP Photo).
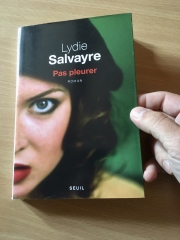 À propos de Lydie Salvayre, Pas pleurer (Éditions du Seuil, 2014).
À propos de Lydie Salvayre, Pas pleurer (Éditions du Seuil, 2014).LRSP (livre reçu en service de presse).
Acheter Pas pleurer sur Amazon.
Voici la copie d'une note initialement publiée en 2014, à l'occasion de la parution de cet ignoble roman qu'est Pas pleurer de Lydie Salvayre. Pour une raison incompréhensible, cette note, qui avait été notablement partagée sur les réseaux sociaux, avait tout bonnement disparu de la Toile lorsque je me suis avisé de la rechercher.
Pauvre France qui naguère se voulut le phare intellectuel et littéraire du monde, que dis-je, de l'univers, se prit à croire à ce miracle et, finalement, parvint à le réaliser durant quelques siècles tout de même ! Aujourd'hui, elle n'en finit plus, comme un dernier de la classe obstiné dans sa nullité crasseuse, de prouver qu'elle mérite sa dernière place, sa place de cancre, la place qu'il est au moins aussi difficile de conquérir, puis de garder, que la première place, la dernière place avant la sortie hors de la classe, du classement, pour cause de nullité non rédimable, malgré tous les redoublements possibles, et les aides de la République des lettres si vigilante pour son mioche au nez morveux.
Tentons d'affoler nos journalistes en utilisant l'une de ces formules qu'ils goûtent tant et qui constituent, à vrai dire, le ban et l'arrière-ban de leur pensée, et que certains m'envieront, car il constitue un excellent titre d'article pour sûr, qui bien sûr jamais ne pourra être publié dans les colonnes d'un de nos valeureux suppléments journalistiques spécialisés en littérature, ni même dans celles d'une de ces si peu intéressantes revues évoquant des livres confondus avec des saucisses : Pas pleurer est le Goncourt de la vulgarité. Le Goncourt de trop ? Mon Dieu, non, même pas, car il y a quelques années tout de même que ce prix n'est plus qu'un entreléchage éhonté, une promotion à l'insignifiance, la récompense de la platitude, tares communes dont la particularité est d'être joyeusement célébrée, ce qui n'est pas rien dans la Ville des lumières, sous l’œil las des journalistes et d'un public de badauds qui jamais n'ont établi de grande différence entre un livre, celui que les critiques journalistiques leur recommandent chaudement, et un chapelet de saucisses, dis-je pour filer ma métaphore charcutière, tripale ou tripière. Pauvres lecteurs tout de même, bien informés de la traçabilité qui, désormais, est devenue le maître-mot de notre délire hygiéniste, ils risqueront de vomir et de cagarse (se chier) dessus bien davantage en lisant Pas pleurer, dont le seul avantage notable est qu'il facilitera le travail de la personne qui le traduira en espagnol, qu'en consommant la très saine cochonnaille.
C'est l'un des petits-fils de Georges Bernanos qui m'a demandé si j'avais lu ce roman qui évoque l'épisode de la terrifiante Guerre d'Espagne telle que son grand-père l'avait vue de ses propres yeux, puis dénoncée dans l'un des plus admirables livres du siècle passé, Les Grands cimetières sous la lune.
Non, cher ami, je n'ai pas lu ce roman, lui ai-je alors répondu et, pour l'heure, n'en pense à peu près rien, si ce n'est que d'autres personnes m'ont indiqué son existence, en effet, voire me conseillent de le lire, non pas tant qu'ils aient estimé la qualité de ce roman, mais parce qu'ils me savent passionné par Georges Bernanos, que Lydie Salvayre met en scène. Je me suis méfié, et je crois que j'ai bien fait de me méfier, car nous ne sommes jamais trop prudents en matière de consommation de carne, ou de piquette, ou de mauvais livre, c'est là tout un, surtout lorsque l'adresse qui vend cette carne, cette piquette ou ce mauvais livre vous est plaisamment recommandée. Quel sens aigu et insoupçonnable, comme l'odorat d'un malheureux qui serait tombé dans une fosse à purin, mit en alerte mon impeccable et redoutée capacité de décortiquer un livre salué comme il se doit par tous les crétins exerçant ce qui est décidément devenu, devant un autre plus moral, le plus vieux métier du monde ?
La réponse réside en deux mots : Pas pleurer, le titre du roman de Lydie Salvayre, que l'on croirait tout droit sorti, après des heures de cogitation mentale exténuante, d'une conversation par SMS entre deux pré-adolescents, ou bien du dialogue qui aurait été mitonné après des années de page désespérément blanche par Christophe Ono-dit-Biot, auteur d'un titre encore plus court que celui de Lydie Salvayre il fallait le faire, Plonger, un jour de propitiatoire et miraculeuse inspiration littéraire.
De l'inspiration littéraire, et peut-être même, tout simplement, du travail, Lydie Salvayre semble en avoir été privée, cette double absence étant fort heureusement compensée, pour le plus grand plaisir des imbéciles qui ont récompensé son roman, par une dose massive et pourtant non létale de vulgarité.
Nous trouvons en effet un concentré de vulgarité, douce fragrance annonçant la puanteur à venir, dès le titre du roman de Lydie Salvayre, ce minimalisme linguistique étant finalement le plus honnête indice de l'indigence littéraire du roman tout entier, sur laquelle nous reviendrons amplement, proposant ainsi la première véritable critique littéraire surnageant sans peine au milieu d'un océan de résumés de quatrième de couverture, d'éléments de langage publicitaires et de condensés de sottise.
 La vulgarité du roman de Lydie Salvayre, comme l’Être selon les métaphysiciens, est présente à tous les niveaux de conception de son roman, et englobe tout : cette vulgarité est donc formelle, dans l'emploi de termes et de formules vulgaires, grossiers, orduriers, et cette vulgarité constitue aussi comme un soubassement, puisqu'elle enrobe l'intention ayant présidé à la naissance de l’œuvre : la critique du catholicisme, du moins, d'un certain catholicisme rigoriste et tartuffe, traîné dans la boue et la merde, la critique du nationalisme, de tous les nationalismes, la critique de la guerre civile, la critique des fanatismes. Avouons que Lydie Salvayre s'est donné le beau rôle, n'est-ce pas ? Cerise sur le flan pas même correctement moulé, cette intention critique prétend s'inscrire sur les brisées de Georges Bernanos pour servir de miroir, disent les publicistes, aux dérives de notre franchouillarde société française, n'aimant pas le révolutionnaire, portant hauts ses légendaires cojones comme des ergots reposant sur le fumier et droite sa peur de la nouveauté et de la différence, les nouvelles mamelles de la Modernité.
La vulgarité du roman de Lydie Salvayre, comme l’Être selon les métaphysiciens, est présente à tous les niveaux de conception de son roman, et englobe tout : cette vulgarité est donc formelle, dans l'emploi de termes et de formules vulgaires, grossiers, orduriers, et cette vulgarité constitue aussi comme un soubassement, puisqu'elle enrobe l'intention ayant présidé à la naissance de l’œuvre : la critique du catholicisme, du moins, d'un certain catholicisme rigoriste et tartuffe, traîné dans la boue et la merde, la critique du nationalisme, de tous les nationalismes, la critique de la guerre civile, la critique des fanatismes. Avouons que Lydie Salvayre s'est donné le beau rôle, n'est-ce pas ? Cerise sur le flan pas même correctement moulé, cette intention critique prétend s'inscrire sur les brisées de Georges Bernanos pour servir de miroir, disent les publicistes, aux dérives de notre franchouillarde société française, n'aimant pas le révolutionnaire, portant hauts ses légendaires cojones comme des ergots reposant sur le fumier et droite sa peur de la nouveauté et de la différence, les nouvelles mamelles de la Modernité.Les grands lecteurs qui ont salué ce roman tout au plus lisible affirmeront que je commets un contresens majeur, puisque, après tout, Lydie Salvayre a pu ne vouloir que mettre en scène le vocabulaire grossier des campesinos, plus sûrement des catetos dont elle peint la soudaine révolte aiguillonnée par les idées communistes et anarchistes, ainsi que leur haine de la hiérarchie catholique espagnole, du curé jusqu'au Bon Dieu en passant par les bonnes sœurs, violées avec une charité toute particulière, inspirée dirons-nous.
Cette vulgarité, de fait, est incarnée dans sa bassesse blasphématoire par ce Notre Père ordurier : «Puto Nuestro que estás en el cielo, Cornudo sea tu nombre, Venga a nosotros tu follón, Danos nuestra puta cada día, y déjanos caer en tentación...» (p. 42). Cette vulgarité est le jus dans lequel semblent infuser presque toutes les phrases, par ailleurs si pauvres d'un point de vue stylistique, de Pas pleurer : «crucifix enfoncé dans le cul» (p. 44), dont l'antithétique version, espagnole et conservatrice, nous est aimablement offerte par «Yo la revolución me la pongo en el culo» (p. 46), le reste étant du même tonneau ou tube avec «entuber» (p. 55), l'attendu et de fait présent «Que le den por culo !» (p. 74), Lydie Salvayre parvenant fort heureusement à nous faire entrevoir l'envers du décor, le gland après le cul grâce «aux bons offices d'un âne pour se faire sucer la bite» (p. 77), appelée, ailleurs (p. 85), une fois qu'une bouche féminine aura avantageusement remplacé une gueule animale, «grosse queue», sans oublier la présence logique, au milieu de cette orgie festive, des «cabrones» (p. 56), la joie nihiliste s'étendant à tout le continent, «l'Europe [faisant] dans son froc à l'idée d'une révolution» (p. 59), «toute l'Europe catholique ferm[ant] sa gueule» (p. 70), tout cet étalage d'attributs féminins ou virils ne pouvant que faire se dresser la seule question valable, qui apparaît dans le roman comme les lettres de feu sous les yeux de Nabuchodonosor : «il se la touche ou quoi» (p. 60), ou bien encore «Qui est assez con pour croire qu'on puisse se passer d'un chef à grosses couilles» (p. 63), et, dans sa version castillane qui épargnera une fois de plus un sérieux travail au futur traducteur, l'«hombre con huevos» (p. 64 : littéralement, les œufs), d'aimables et martiaux «putain, je vais lui péter la gueule» (p. 65), l'un des personnages principaux, un peu trop roux pour les paysans du village, étant fort logiquement, au milieu de tant de soucis politiques et phalliques, un «enculé» (p. 73), la morne litanie de l'ordure graveleuse s'étendant sur le reste des pages de notre roman, mais l'acmé de l'insignifiance pas même vulgaire mais ordinaire (como se dice de una mujer que es ordinaria, Lydie) résidant peut-être, tout de même, à la page 118, où Lydie Salvayre évoque par le menu, si je puis dire, les différences subtiles entre les odeurs et mélodies des pets féminins et des pets masculins provoqués par les fameux garbanzos consommés à haute dose dans cette contrée reculée, arriérée, bien évidemment profondément phallocrate, qu'est l'Espagne de 1936 dont l'atmosphère qui plus est, on le suppose du moins, devait sentir fort mauvais à cause de tous ces dégazages intestinaux faisant une tranquille concurrence aux pourrissantes carcasses humaines jetées dans des fosses.
Les lecteurs rigoureux, dont l'ami Sébastien Lapaque, pourtant fin connaisseur de l’œuvre de Bernanos, ayant salué comme tant d'autres pigistes et sous-pigistes les hautes qualités littéraires du roman de Lydie Salvayre, affirmeront que je me scandalise de bien peu et que j'adopte, après tout, la position pour le moins louche qui est celle de l'un des personnages féminins du roman, doña Pura (au patronyme transparent), dans laquelle, bien évidemment, comme nous y autorise la ridicule quatrième de couverture du roman affirmant que la vision de Lydie Salvayre résonne «étrangement avec notre présent», nous ne pouvons que voir le portrait se voulant assassin et qui n'est que ridicule, d'une catholique engoncée dans sa macération et secrètement travaillée par l'unique envie paraît-il interdite par l’Église, le sexe bien sûr. Ainsi, il est clair aux yeux perçants de Lydie Salvayre que la charité de doña Pura ne peut qu'être éminemment trouble : «Car doña Pura aimait à soulager la misère des pauvres, activité qui constituait une excellent diversion, je dirais même un dérivatif puissant à ses perfides autant qu'innombrables indispositions, innombrables (1) tant dans leur expression que dans la nature des organes affectés, avec une prédominance nette des organes sis dans la sphère génito-urinaire» (pp. 87-8), Lydie Salvayre, qui cite tout de même Georges Bernanos, ayant dû lire une ou deux lignes de Léon Bloy et utilisant l'un de ses mots préférés quelques lignes plus loin : «autant de missions qui servaient d'émonctoire à ses prurits intimes et à ses ardeurs libidinales douloureusement rabrouées» (p. 88). C'est d'ailleurs à propos de cette caricature honteuse de catholique mal baisée que Lydie Salvayre nous fait part de sa science gynécologique en écrivant : «mais la pauvrette avait bien des excuses : elle n'avait jamais baisé y su chocho estaba sequito como una nuez» (p. 90; cette même délicatesse est répétée à la page 205). A croire que la pauvre Lydie Salvayre, en matière de sexualité féminine, s'y connaît aussi lamentablement qu'en écriture, puisque ce sont les plus impavides ogresses sexuelles qui, presque toujours et pour la raison que jamais leur appétit n'est rassasié, éprouvent les irritations d'une sécheresse passagère frappant leur outil de travail, qui du coup, malchance, se grippe, le plus intime. Passons, car je redeviens vulgaire et je ne dois pas oublier que je suis lu par de belles âmes ayant été touchées par la pureté d'âme dont Lydie Salvayre, incontestablement, fait montre dans son roman goncourisable et goncourisé.
Ce qui nous irrite n'est pas franchement la sécheresse stylistique de Lydie Salvayre qui, tout du moins en matière d'écriture, ni blanche comme des pertes ni rose mais d'une couleur limoneuse bien plus suspecte, répand quelques hectolitres d'ordures et de fadaises consensuelles.
Entendons-nous bien. La vulgarité, y compris en matière sexuelle, ne me choque ni ne m'émeut, je ne l'attends pas ni ne demande à la sentir comme l'absente de tout bouquet et, absente justement, je ne me désole pas de sa disparition. Lorsqu'elle est évoquée dans une écriture digne de ce nom, elle me fait bien davantage rire, comme c'est le cas dans La Chair de Serge Rivron. Me gêne davantage, m'incommode même franchement le fait que, dans le roman de Lydie Salvayre, cette vulgarité phagocyte absolument tout, les rares parties saines de l'organisme, disons les deux dernières parties du roman, comme un cancer pressé de dévorer la chair pour la transformer en matière noire, morte, pourrie, puante. En somme, et pour le dire vulgairement, d'une vulgarité qui ne pourra que réjouir notre auteuse (pardonnez-moi cette horreur, je deviens vulgaire à mon tour), Chie pas juste qui veut, comme l'écrivait le grand Céline, dont la vulgarité, du moins incarnée dans ses livres, est proverbiale et ravageuse, et irrésistiblement drôle, non parce qu'elle atteindrait à une fosse d'aisance plus profonde que toutes celles qui ont été creusées avant ou après lui (par exemple par Rabelais, Pierre Guyotat ou, en Espagne, Francisco Quevedo), mais parce que, tout simplement, elle était portée, servie, achalandée si je puis dire par une écriture digne de ce nom et même, une écriture géniale, une invention linguistique et stylistique prodigieuse. En lieu et place de génie ou même, simplement, de talent, Lydie Salvayre tente d'expliquer (de justifier ?) cette vulgarité qu'elle nous a fait renifler malgré notre sinusite surinfectée en évoquant les troubles mentaux de sa mère (cf. p. 82)...
Ainsi abordons-nous le deuxième reproche, bien plus essentiel que le premier, que tout lecteur est en droit d'adresser au lamentable roman de Lydie Salvayre : la pauvreté absolue de son écriture. La merde étalée à toutes les pages ou presque finit non seulement par sentir mauvais mais par dégoûter le plus coprophile des lecteurs, alors que la merde, transcendée par une écriture jubilatoire, accède à la ferveur mystique tant de fois évoquée par un Léon Bloy.
Nous pourrions illustrer de bien des façons l'absolue platitude de l'écriture de Lydie Salvayre, mais nous nous bornerons à évoquer deux de ses aspects : la pauvreté de son invention verbale, lorsqu'il s'agit de créer une langue, ou plutôt, un idiome à cheval entre le français et l'espagnol, puis la pauvreté réellement étique de deux ou trois procédés stylistiques déparant certains de ses dialogues au style indirect, censés, du moins je le suppose, conforter la langue «joyeusement malmenée» qu'évoque, ridiculement, la quatrième de couverture.
Me permettra-t-on une anecdote ? Ma mère a commencé à apprendre le français lorsqu'elle est arrivée en France, après avoir suivi celui qui allait devenir son mari quelques années plus tard, mon père. Elle n'avait alors que 18 ou 19 ans. Je connais donc par cœur, m'en agace tout autant que j'y suis attaché depuis mon enfance, l'espèce d'idiome dans lequel elle s'exprime, surtout lorsqu'elle se montre agacée ou émue, étrange mélange de mots français ressemblant à l'espagnol et de mots espagnols littéralement traduits en français, de phrases commencées dans une langue et finies dans une autre. Je précise que cet idiome a été lissé si je puis dire, au fil des années, et que ma mère s'exprime depuis longtemps tout de même dans un français digne d'être salué par Pierre Assouline, qui n'a pas craint de récompenser celui de Lydie Salvayre. Lisant donc le pidgin (pardon ! le frañol) faussement savant dans lequel notre romancière sans talent fait s'exprimer sa mère, je n'y ai absolument pas reconnu celui de ma mère, preuve que son invention est artificielle et pas même crédible, preuve que son invention ne parvient pas à transcender des contingences purement particulières. Voulant sans doute faire sourire, voire rire son lecteur, Lydie Salvayre atteint un grotesque involontaire qui se retourne contre elle. Prenons un exemple qui vaudra mieux que bien des explications : «Alors quand on se retrouve en la rue, je me mets à griter (moi : à crier), à crier» (p. 13) ou bien «Tu l'as comprendi ma chérie, me dit ma mère» (p. 86). L'invention verbale est ici proche du degré zéro qui parvient à congeler même le plus bienveillant des lecteurs, puisqu'il ne s'agit dans ces deux cas, déclinés tout au long du roman («hablent», p. 116, pour parler, provenant de l'espagnol «hablar», «romper» à la même page pour rompre), que d'adapter un verbe espagnol (gritar pour crier, comprender pour comprendre, ou encore, p. 79, permitir pour permettre) en le francisant grossièrement. Cet effet, comme une escopette antédiluvienne, ne peut tirer qu'un seul coup, là où Lydie Salvayre nous troue de rafales, sans compter le fait que ce procédé grossier de calque fait de sa mère une imbécile bien davantage qu'une pauvre immigrée éprouvant des difficultés à s'exprimer dans une langue qui n'est si visiblement pas la sienne et ne le sera jamais. Pour ne pas être accusés de ne citer qu'un seul procédé stylistique et ainsi d'appauvrir volontairement la richesse de l'écriture de notre romanceuse (la vulgarité, derechef), accordons à Lydie Salvayre qu'elle procède à ce type de calque expéditif et convenu en l'adaptant à des noms, ce qui donne «riquesses» (p. 114) pour richesses, de l'espagnol «riquezas», ou bien «siègle» (p. 120) pour siècle, de l'espagnol «siglo», «mezclée» (p. 136) pour mélangée, de l'espagnol «mesclada», etc. En un mot, ce procédé est non seulement simpliste mais ridicule, et il parvient en outre à ridiculiser le personnage que Lydie Salvayre prétend nous rendre le plus proche et intime, la moins ridicule donc, la mère de sa narratrice. Je ne donne qu'un seul exemple du ridicule que provoque le débraillé lexical de l'héroïne : «cet été où tous les principes se renversent, où tous les comportements se renversent, où tous les sentiments se renversent, faisant basculer les cœurs vers le haut vers le ciel, ma chérie, c'est ce que je voudrais que tu comprends et qui est incompressible» (pp. 125-6). Là, les pseudo-trouvailles grammaticales et orthographiques, qu'il faudrait avoir le temps de comparer avec l'invention étincelante du langage d'Orange mécanique par Anthony Burgess, ne se fondent sur aucune racine espagnole.
Par cette très habile transition, nous passons au deuxième ingrédient stylistique dont Lydie Salvayre farce son écriture comme une piètre cuisinière sa dinde mal décongelée : l'anaphore de l'adverbe (le plus souvent) ou bien de l'adjectif au sein d'une même phrase : «Bernanos ne peut observer sans nausée ces meurtres perpétrés au nom de la Sainte Nation et de la Sainte Religion par une petite troupe de fous fanatiques enfermés dans la folie fanatique de leurs dogmes» (pp. 91-2) ou bien encore : «ils retroussent patriotiquement leurs manches et affûtent patriotiquement leurs armes afin d'éliminer la racaille qui ne pense pas comme il faut» (p. 99). Il est sans doute inutile de préciser que ces termes visent les nationalistes, catholiques purs et durs, franquistes et fascistes contre lesquels, nous y reviendrons, Lydie Salvayre déploie sa terrifiante et anaphorique colère. Ailleurs, nous avons même droit à la triple répétition d'un adverbe («insidieusement», pp. 105-6), voire à la quintuple répétition d'un verbe («imprégnait», p. 159), signe sans doute que Lydie Salvayre est franchement très énervée contre l'inadmissible carcan que la tradition, le dogme et la rigoureuse stratification sociale de l'Espagne de l'époque font peser sur sa mère, alors jeune, la belle Montse (diminutif de Montserrat), qualifiée de tête de linotte pardon, de «litotte» (sic, p. 135) par cette même héroïne devenue âgée et amatrice de «français bancal» (p. 111) que sa fille s'efforce, nous dit-elle, de redresser.
Nous aurons fait le tour de la puissance stylistique de Lydie Salvayre en évoquant son troisième et dernier ingrédient, bien incapable, comme les deux autres, de relever le caractère insapide ou insipide comme on voudra de son cochifrito, je veux parler de la rupture de construction, en langage spécialisé l'anacoluthe. Cet usage est probablement censé traduire le bouillonnement de la parole tel que le figure le dialogue indirect et, je le suppose du moins, nous montrer que Lydie Salvayre sait parfaitement créer un rythme et qu'elle n'ignore rien des tourments ultra-profonds dans lesquels ses personnages absolument pas caricaturaux sont plongés. Je me contente de donner un seul exemple de ce procédé, en respectant la mise en page : «Du reste, ils disent que le confort américain, ils s'en tamponnent le
Mais ce n'est pas du tout ce qu'on leur propose ! s'indigne Josep, et il se met soudain à marcher plus vite tandis que la colère aiguillonne son esprit» (p. 73).
La deuxième partie du livre nous offre un répit, il était temps ! : les piètres procédés stylistiques de Lydie Salvayre se font plus discrets (2), pets, rots, queues, couilles et trous du cul s'espacent quelque peu, la description de la nouvelle vie de Montse n'est pas désagréable même si les psychologies et les fonctions symboliques des personnages sont sommaires voire caricaturales (cf. p. 192), nous pouvons donc à peu près respirer. Mais c'est alors qu'une nouvelle odeur en profite pour venir chatouiller nos délicates narines et, une fois de plus, nous incommoder. Il n'aura échappé à personne, même à Pierre Assouline, inventeur du plus mauvais jeu de mots sur l'auteuse, Salvayre Regina, ce qui supposerait que le Goncourt est encore capable de couronner qui que ce soit, et même una peona écrivante, et à Arnaud Viviant, respectivement prince et bouffon cacographiques, que Lydie Salvayre évoque l'exemple du Grand d'Espagne, Georges Bernanos dont il est d'abondance traité sur ce blog, l'auteuse n'en finissant pas de louer le courage du grand écrivain lorsque, n'écoutant que son cœur, il écrivit l'un de ses plus grands livres en prenant la défense des pauvres et des opprimés massacrés par les troupes de Franco. C'est là sans aucun doute le seul intérêt du roman poussif de Lydie Salvayre, mais je m'empresse de relativiser cette affirmation par une nouvelle critique, en constatant que notre écrivain au rabais, dont le bradage vient d'être consacré par les marchands de tapis du Prix Goncourt, ne parvient jamais qu'à aligner une suite pour le moins consternante de banalités pieuses (si je puis dire, car notre romancière ne goûte guère les agenouillements devant le crucifix, nous l'avons vu).
M'apprêtant à citer deux exemples de ces truismes, je songe aux mots aussi justes et durs que l'ami Pierre Mari a écrit pour saluer, ironiquement, un autre phénomène de foire à tout qui se prend, excusez du peu, pour un écrivain, Emmanuel Carrère. Dans les deux cas, un bon sujet littéraire (bien qu'il n'y en ait pas de mauvais) est gâché par d'ignobles faiseurs qui, dénués de toute forme de profondeur ou même d'intelligence, et que dire de leur aptitude à l'écriture, ne tirent, des plus grands thèmes, que de vagues considérations où brille la phosphorescence de leur manque de talent, de souffle, de cerveau, d'âme sans doute mais je ne suis pas curé : «Je m'avise du reste, chaque jour davantage, que mon intérêt passionné pour les récits de ma mère et celui de Bernanos tient pour l'essentiel aux échos qu'ils éveillent dans ma vie d'aujourd'hui» (p. 169). Bravo, quelle admirable méditation, dites-moi, n'est-ce pas ? Permettez-moi de vous citer une fois encore la haute prose de Laurence Boccolini, pardon, d’Évelyne Thomas, non, décidément, de Lydie Salvayre, goncourisée et fière et émue de l'être, sans douter un seul instant de la sincérité de l'écrivaine, qui prend ici le relai de sa mère et nous délivre ses plus profondes pensées sur la nature du franquisme, soit, le Mal, ni plus ni moins ! : «As-tu comprendi (sic) qui étaient les nationaux ? me demande ma mère à brûle-pourpoint, tandis que je l'aide à s'asseoir dans le gros fauteuil en ratine verte installé près de la fenêtre. Il me semble que je commence à le savoir. Il me semble que je commence à savoir ce que le mot national porte en lui de malheur. Il me semble que je commence à savoir que, chaque fois qu'il fut brandi (sic ?) par le passé, et quelle que fût la cause défendue (Rassemblement national, Ligue de la nation française, Révolution nationale, Rassemblement national populaire, Parti national fasciste...), il escorta inéluctablement un enchaînement de violences, en France comme ailleurs» (pp. 94-5), la suite de ces lacrymales considérations s'étendant jusqu'à la page 96 et, en sourdine, dans tout le reste du roman. Je ne conteste pas, entendons-nous bien, la justesse, certes sommaire voire tout simplement irrécupérablement banale, de ces affirmations. Contester cela, ce serait moquer l'attitude, véritablement héroïque et digne, qui fut celle de Georges Bernanos face aux colonnes d'épuration du Caudillo. J'en conteste en revanche la très faible portée littéraire, car enfin, messieurs les jurés du Goncourt, il s'agit de juger la qualité littéraire d'un roman, n'est-ce pas ?, portée et qualité à peu près nulles, parce que ces considérations sont soutenues à bout de béquille par une écriture dénuée de vie, de grâce, de souffle, d'intelligence et que dire de son talent. Nous avons bien compris, la quatrième de couverture ayant du reste insisté discrètement, c'est-à-dire lourdement en langage publicitaire, sur ce point au cas où il aurait trompé notre vigilance, nous avons bien compris que la leçon de Lydie Salvayre concernait, avant tout, l'horrible retour à l'ordre moral qui semble gagner la France de 2014, même si une lecture plus subtile, après tout autorisée par notre roman, pourrait résider dans une critique générale portant sur le fanatisme des deux camps, révolutionnaires et conservateurs mélangés, tous fanatiques et meurtriers, tous capables de broyer les hommes, Josep et son beau-frère, Diego. Cette lecture, plus juste que la première et qu'autorise une fois encore la désillusion puis la mort du frère de Montse, Josep revenu de ses agapes anarchistes brutalement annihilées par la folie stalinienne portée jusqu'en la plus reculée des bourgades espagnoles, ou encore la déchéance de celui qui, en épousant sa sœur, deviendra son beau-frère haï, Diego, cette lecture ne parvient toutefois pas à effacer nos critiques, ni même l'impression d'avoir subi un texte bâclé, non pas tant qu'il serait mal fichu d'un strict point de vue technique (3), mais grossier, impression que nous laisse la lecture, faut-il le préciser rapide mais non point pressée (4), de Pas pleurer. Ainsi, c'est à bon droit que je pourrais reprendre la remarque cruelle que Pierre Mari a adressée à Emmanuel Carrère et, me servant à mon tour de Diderot, dire à Lydie Salvayre que non seulement son roman est assez quelconque, malgré la présence de quelques grandes figures comme celles de Bernanos et Bergamín ou Péguy (5), mais qu'il m’est démontré qu'elle n'en fera jamais de grands et qu'elle n'en a probablement jamais fait de grands, et ce n'est certes pas l'onction du cénacle cacochyme du Prix Goncourt qui parviendra jamais à me convaincre du contraire.
Notes
(1) Nous verrons que cette répétition de l'adverbe, au sein d'une même phrase, est l'un des rares marqueurs stylistiques de l'écriture, si l'on peut appeler ainsi l'art sommaire déployé dans ce roman, de l'auteur.
(2) Tempérons notre enthousiasme tout de même, car le langage que Lydie Salvayre prête à sa mère est toujours aussi ridicule : «Je n'arrivais pas réellement à l'embéléquer, si j'ose dire, me dit ma mère. A lui assurer que ses gâteaux étaient les meilleurs de la terre, et à lui faire ces déclarations maravilleuses que les enfants font à leur mère lorsqu'ils les sentent tristes et en manque d'arrosage» (p. 205). Les constats que l'auteur tire de l'expérience que fit Bernanos («Sale temps pour Bernanos», p. 215) de la Guerre d'Espagne sont toujours aussi plats, consternants : «Bernanos découvrait, le cœur défait, que lorsque la peur gouverne, lorsque les mots sont épouvantés, lorsque les émotions sont sous surveillance, un calme, hurlant, immobile s'installe, dont les maîtres du moment se félicitent» (p. 183). La vulgarité et même l'insulte ne sont jamais très loin, par exemple lorsque Lydie Salvayre traite Paul Claudel de «fil de pute» (p. 212) tout en se cachant derrière, allez savoir pourquoi, le prestige et l'autorité de Shakespeare, oppose, avec raison, sa lamentable attitude à celle de Georges Bernanos (cf. p. 248), et appelle Pétain «le maréchal Putain» (p. 176).
(3) Et encore car, dans ce seul domaine, Vingt ans et un jour de Jorge Semprún lui est bien supérieur.
(4) Rapide, bien évidemment, parce que tout est fait pour que ce livre puisse se lire en quelques heures à peine, ces quelques heures que les jurés du Goncourt ne possèdent que fort chichement, tout occupés qu'ils sont à lire d'autres grands romans également goncourisables.
(5) Moins curieusement qu'il n'y paraît, l'un des seuls beaux passages du livre de Lydie Salvayre évoque Péguy : «elle [Montse] retrouva son air de bonté, son air de bonté renseignée comme l'écrivait Péguy à propos de Lazare, c'est-à-dire non pas cette bonté des innocents et des simplets, non pas la bonté des anges ni des saintes nitouches, mais la bonté désabusée, la bonté clairvoyante, la bonté qui sait la nuit des hommes et la surmonte, qui tente à tout le moins de la surmonter» (p. 216).




























































 Imprimer
Imprimer