Karl Kraus. Phare et brûlot de la modernité viennoise de Jacques Le Rider (04/09/2019)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Karl Kraus dans la Zone
Karl Kraus dans la Zone«La misère peut faire de tout homme un journaliste, mais pas de toute femme une prostituée.»
Karl Kraus
 Marc Crépon, dans un ouvrage intitulé Les promesses du langage, évoque finement Karl Kraus (1) en plaçant son combat acharné sous une lumière de fin des temps. En effet, «aussi divers que soient les exemples, les anecdotes, les événements qui nourrissent cette «vision apocalyptique», un fil conducteur en relie l'analyse : la mise au jour de la perversion du langage dont ils témoignent. L'apocalypse, pour Karl Kraus, c'est moins directement le déchaînement de la violence, le déluge de fer et de feu et la perpétuation des massacres que l'usage dégradé du langage qui les prépare de longue date, qui nous habitue à supporter l'inacceptable, qui légitime le pire à l'avance; ce sont toutes les compromissions du discours», poursuit l'auteur, «qui font entrer la fin des des temps et la fin du monde dans l'ordre de la langue et dans celui des choses, sans même qu'on s'en aperçoive». Il n'y a plus d'Apocalypse car celle-ci est quotidiennement rejouée sur un mode mineur, une basse plutôt, ténue mais constante, sur laquelle tous nos faits et gestes se détachent, mais aussi nos paroles, puis, selon Kraus, les actions de celles et ceux qui auront été imperceptiblement contaminés par l'usage banal, devenu mécanique, d'un langage lui-même inhumain, prêt à servir pour les massacres qui, d'ailleurs, ne porteront même pas ce nom. Et Marc Crépon de poursuivre en affirmant que «ce qui est apocalyptique, c'est d'abord le fait qu'on ait su faire des phrases suffisamment efficaces pour rendre crédible la nécessité d'un tel sacrifice», celui des millions d'hommes envoyés à une mort certaine pendant les deux guerres mondiales par exemple et, de nos jours, par les guerres dites de basse intensité mais aussi dans chacun de ces faits divers quasi quotidiens : des agressions, des meurtres, que les médias, si tant est qu'ils daignent les évoquer, les caractérisent rarement pour ce qu'ils sont réellement. Cette apocalypse entretenue par le mésusage du langage est aussi une parodie, autrement dit une inversion, car, dans le monde de Karl Kraus et encore plus dans le nôtre, «ce ne sont plus les journaux qui sont le reflet de la vie, mais la vie elle-même qui ne fait rien d'autre que se conformer à l'image qu'en donne la presse». Dès lors, le «travail du critique de la langue» qu'est Karl Kraus consistera à, simultanément, dénoncer l'apocalypse ridicule qu'alimente la presse et présenter, de façon prophétique, «une voie pour en sortir». Il s'agit là d'un «double dévoilement en vérité : désigner ce qui a été perdu (la nature et le langage, et l'un en même temps que l'autre) et indiquer l'unique moyen de le retrouver (la nature par le langage, la première grâce à la correction, l'épuration du second)». Travail vain sans doute, ridicule peut-être, même, comme ne manqueront pas de le faire remarquer nombre des ennemis de Karl Kraus, qui, on s'en doute, eut le génie de s'en faire beaucoup : dans un monde courant à sa perte, par exemple au moment où les Nazis commencent à épurer la société allemande de ses parasites, quel est l'intérêt d'accorder une attention maniaque, réellement fanatique, à la correction de la langue allemande ? Marc Crépon note justement, à ce propos, que «personne plus que Kraus n'eut conscience de ce que pouvait avoir de dérisoire le fait d'opposer au déchaînement de la violence et des persécutions le jugement de la langue et l'espoir d'un autre rapport au langage» puisque, en somme, tout se passe comme si «la seule chose qui pouvait être faite était de prendre la violence à la racine, pour qu'au moins elle ne trouve plus dans le langage la moindre caution». Faisant cela, Karl Kraus montrait toute la perversion du langage, tordu jusqu'à ce qu'il puisse justifier une violence qui, en détruisant les hommes, finirait immanquablement par le détruire lui-même.
Marc Crépon, dans un ouvrage intitulé Les promesses du langage, évoque finement Karl Kraus (1) en plaçant son combat acharné sous une lumière de fin des temps. En effet, «aussi divers que soient les exemples, les anecdotes, les événements qui nourrissent cette «vision apocalyptique», un fil conducteur en relie l'analyse : la mise au jour de la perversion du langage dont ils témoignent. L'apocalypse, pour Karl Kraus, c'est moins directement le déchaînement de la violence, le déluge de fer et de feu et la perpétuation des massacres que l'usage dégradé du langage qui les prépare de longue date, qui nous habitue à supporter l'inacceptable, qui légitime le pire à l'avance; ce sont toutes les compromissions du discours», poursuit l'auteur, «qui font entrer la fin des des temps et la fin du monde dans l'ordre de la langue et dans celui des choses, sans même qu'on s'en aperçoive». Il n'y a plus d'Apocalypse car celle-ci est quotidiennement rejouée sur un mode mineur, une basse plutôt, ténue mais constante, sur laquelle tous nos faits et gestes se détachent, mais aussi nos paroles, puis, selon Kraus, les actions de celles et ceux qui auront été imperceptiblement contaminés par l'usage banal, devenu mécanique, d'un langage lui-même inhumain, prêt à servir pour les massacres qui, d'ailleurs, ne porteront même pas ce nom. Et Marc Crépon de poursuivre en affirmant que «ce qui est apocalyptique, c'est d'abord le fait qu'on ait su faire des phrases suffisamment efficaces pour rendre crédible la nécessité d'un tel sacrifice», celui des millions d'hommes envoyés à une mort certaine pendant les deux guerres mondiales par exemple et, de nos jours, par les guerres dites de basse intensité mais aussi dans chacun de ces faits divers quasi quotidiens : des agressions, des meurtres, que les médias, si tant est qu'ils daignent les évoquer, les caractérisent rarement pour ce qu'ils sont réellement. Cette apocalypse entretenue par le mésusage du langage est aussi une parodie, autrement dit une inversion, car, dans le monde de Karl Kraus et encore plus dans le nôtre, «ce ne sont plus les journaux qui sont le reflet de la vie, mais la vie elle-même qui ne fait rien d'autre que se conformer à l'image qu'en donne la presse». Dès lors, le «travail du critique de la langue» qu'est Karl Kraus consistera à, simultanément, dénoncer l'apocalypse ridicule qu'alimente la presse et présenter, de façon prophétique, «une voie pour en sortir». Il s'agit là d'un «double dévoilement en vérité : désigner ce qui a été perdu (la nature et le langage, et l'un en même temps que l'autre) et indiquer l'unique moyen de le retrouver (la nature par le langage, la première grâce à la correction, l'épuration du second)». Travail vain sans doute, ridicule peut-être, même, comme ne manqueront pas de le faire remarquer nombre des ennemis de Karl Kraus, qui, on s'en doute, eut le génie de s'en faire beaucoup : dans un monde courant à sa perte, par exemple au moment où les Nazis commencent à épurer la société allemande de ses parasites, quel est l'intérêt d'accorder une attention maniaque, réellement fanatique, à la correction de la langue allemande ? Marc Crépon note justement, à ce propos, que «personne plus que Kraus n'eut conscience de ce que pouvait avoir de dérisoire le fait d'opposer au déchaînement de la violence et des persécutions le jugement de la langue et l'espoir d'un autre rapport au langage» puisque, en somme, tout se passe comme si «la seule chose qui pouvait être faite était de prendre la violence à la racine, pour qu'au moins elle ne trouve plus dans le langage la moindre caution». Faisant cela, Karl Kraus montrait toute la perversion du langage, tordu jusqu'à ce qu'il puisse justifier une violence qui, en détruisant les hommes, finirait immanquablement par le détruire lui-même.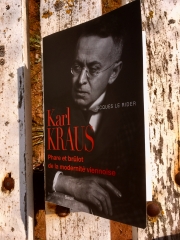 Sans accorder une importance déterminante à la problématique apocalyptique du travail de défense et d'illustration acharné de la langue allemande accompli par Karl Kraus, la biographie de Jacques Le Rider (2), la première du genre en France, honte à ce pays de faux intellectuels et de penseurs qui ne sont que des poseurs, explore assez méticuleusement les différentes facettes du diamant langagier que tailla, sa vie durant, le râleur autrichien, à l'école de résistance duquel un autre ciseleur de mots, Elias Canetti, assista, non sans émettre beaucoup de réserves sur la fascination, la réelle emprise que Kraus exerça sur les esprits de son époque. Il ne fut certes pas le seul à décrire, jusqu'au dégoût et à une rage pour le coup réellement apocalyptique, le dépotoir de phrases qu'était devenu le monde moderne puisque le premier modèle littéraire de Kraus, Maximilian Harden (qu'il honnira par la suite), avait pu consacrer en 1890 une satire entière, intitulée Phrasien (La Phrasie), à ce problème qui retint l'attention de l'incorruptible gardeur du troupeau des mots, plus d'une fois rapproché d'un autre féroce contempteur de la modernité bavarde, Léon Bloy (cf. pp. 63, 291-2). Comme Bloy d'ailleurs, l'auteur de La Littérature démolie conteste, «avec de bons arguments, les valeurs que ses contemporains considèrent comme les plus incontournables» (p. 66), une tâche aussi colossale qu'éreintante, qui exige de camper «dans une position d'extériorité au champ journalistique», tout en misant, car il s'agit véritablement d'un pari, «sur une marginalité qu'il a délibérément choisie pour affirmer sa distinction et pour fonder une légitimité» (p. 76) qu'il lui faudra défendre coûte que coûte jusqu'à son dernier souffle. La résistance, encore une fois, mais cette fois-ci à la lassitude que bien des fois Karl Kraus dut éprouver face à la montagne (de mots pourris) qu'il lui fallait gravir chaque jour, avant de devoir recommencer le jour suivant.
Sans accorder une importance déterminante à la problématique apocalyptique du travail de défense et d'illustration acharné de la langue allemande accompli par Karl Kraus, la biographie de Jacques Le Rider (2), la première du genre en France, honte à ce pays de faux intellectuels et de penseurs qui ne sont que des poseurs, explore assez méticuleusement les différentes facettes du diamant langagier que tailla, sa vie durant, le râleur autrichien, à l'école de résistance duquel un autre ciseleur de mots, Elias Canetti, assista, non sans émettre beaucoup de réserves sur la fascination, la réelle emprise que Kraus exerça sur les esprits de son époque. Il ne fut certes pas le seul à décrire, jusqu'au dégoût et à une rage pour le coup réellement apocalyptique, le dépotoir de phrases qu'était devenu le monde moderne puisque le premier modèle littéraire de Kraus, Maximilian Harden (qu'il honnira par la suite), avait pu consacrer en 1890 une satire entière, intitulée Phrasien (La Phrasie), à ce problème qui retint l'attention de l'incorruptible gardeur du troupeau des mots, plus d'une fois rapproché d'un autre féroce contempteur de la modernité bavarde, Léon Bloy (cf. pp. 63, 291-2). Comme Bloy d'ailleurs, l'auteur de La Littérature démolie conteste, «avec de bons arguments, les valeurs que ses contemporains considèrent comme les plus incontournables» (p. 66), une tâche aussi colossale qu'éreintante, qui exige de camper «dans une position d'extériorité au champ journalistique», tout en misant, car il s'agit véritablement d'un pari, «sur une marginalité qu'il a délibérément choisie pour affirmer sa distinction et pour fonder une légitimité» (p. 76) qu'il lui faudra défendre coûte que coûte jusqu'à son dernier souffle. La résistance, encore une fois, mais cette fois-ci à la lassitude que bien des fois Karl Kraus dut éprouver face à la montagne (de mots pourris) qu'il lui fallait gravir chaque jour, avant de devoir recommencer le jour suivant.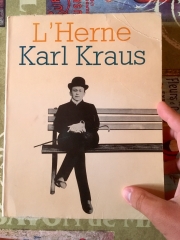 Prenant ses distances (paradoxales, comme l'indique, un peu ridiculement d'ailleurs (3), la conclusion de l'ouvrage) avec la presse, Karl Kraus ne pouvait logiquement tolérer que la littérature se journalise. C'est ainsi qu'il fut antifreyfusard, ne supportant guère Émile Zola en qui il voyait le parangon (français) d'un écrivain ne craignant pas de descendre dans la bauge journalistique et renonçant ainsi à «l'autonomie esthétique de l'œuvre» (cf. p. 113). Selon Jacques Le Rider, la position de Karl Kraus s'explique par le fait qu'à ses yeux la presse «est l'ennemie naturelle des intellectuels, non leur alliée, car, selon lui, elle ne cherche pas à faire connaître la vérité, ni à promouvoir la littérature, mais seulement à augmenter ses tirages et le tarif de ses annonces publicitaires» (p. 114). C'est tout le sens des critiques constantes que Karl Kraus adressera à des écrivains contemporains aussi considérables qu'Arthur Schnitzler mais surtout Heine (voir le texte intitulé Heine ou les conséquences, traduit en français dans le Cahier de l'Herne consacré à Kraus), en dépit d'une évidente admiration pour son style, ou encore Stefan George, tous accusés de se servir de la langue à des fins décoratives, ornementales ou, pour le dire en un seul mot, feuilletonistes.
Prenant ses distances (paradoxales, comme l'indique, un peu ridiculement d'ailleurs (3), la conclusion de l'ouvrage) avec la presse, Karl Kraus ne pouvait logiquement tolérer que la littérature se journalise. C'est ainsi qu'il fut antifreyfusard, ne supportant guère Émile Zola en qui il voyait le parangon (français) d'un écrivain ne craignant pas de descendre dans la bauge journalistique et renonçant ainsi à «l'autonomie esthétique de l'œuvre» (cf. p. 113). Selon Jacques Le Rider, la position de Karl Kraus s'explique par le fait qu'à ses yeux la presse «est l'ennemie naturelle des intellectuels, non leur alliée, car, selon lui, elle ne cherche pas à faire connaître la vérité, ni à promouvoir la littérature, mais seulement à augmenter ses tirages et le tarif de ses annonces publicitaires» (p. 114). C'est tout le sens des critiques constantes que Karl Kraus adressera à des écrivains contemporains aussi considérables qu'Arthur Schnitzler mais surtout Heine (voir le texte intitulé Heine ou les conséquences, traduit en français dans le Cahier de l'Herne consacré à Kraus), en dépit d'une évidente admiration pour son style, ou encore Stefan George, tous accusés de se servir de la langue à des fins décoratives, ornementales ou, pour le dire en un seul mot, feuilletonistes.En fait, ce que Kraus reproche à ces écrivains, c'est de se réfugier dans une certaine forme de facilité ou bien (pour George) dans un faux hermétisme qui n'a strictement rien à voir avec la difficulté véritable de la langue d'un Georg Trakl qu'il aida comme il le put ou d'une Else Lasker-Schüler, les créations littéraires les plus marquantes paraissant, de prime abord, incompréhensibles et ne pouvant être comprises qu'après une deuxième ou une troisième lecture, selon les dires de Friedrich Schlegel, auteur d'un texte justement intitulé Sur l'incompréhensible paru en 1800. En fait, affirme Jacques Le Rider, c'est une opposition quasi manichéenne entre l'écriture littéraire et les discours journalistiques qui «structure la pensée critique et la sensibilité de Karl Kraus» (p. 210), la littérature, lorsqu'elle est contaminée par la phraséologie journalistique, n'étant plus que de l'utilittérature, comme l'écrit Kraus dans le texte précédemment cité. Dans tous les cas, c'est le règne de la facticité que fait advenir le journalisme : «le journal n'informe pas, affirme Karl Kraus, mais donne forme à une réalité factice et produit des images du monde qui cachent la réalité que les lecteurs du journal n'imaginent même pas, tant l'autorité de la presse paralyse leur faculté d'imagination et leur sens critique» (p. 251), les journalistes étant du reste parfaitement capables, ajoutera le polémiste auquel nous aurons toujours beau jeu de reprocher de telles affirmations, de lancer une guerre comme ils lancent une opérette !
Si les rapports, ô combien complexes et même paradoxaux entre Karl Kraus et le journalisme sont méthodiquement évoqués par Jacques Le Rider, celui-ci n'oublie pas de mentionner les non moins étonnants liens qui unissent l'auteur à sa judéité, ce dernier rapprochant ainsi, dans ses Derniers jours de l'humanité, les deux peuples élus que sont les Juifs et les Allemands, lui qui ira même jusqu'à écrire dans sa Troisième nuit de Walpurgis que bien de troublants rapports existent entre «le présent pangermanisme et une partie de l'Ancien Testament remplie d'horreurs» et que si, «dans les programmes scolaires allemands, l'histoire du sacrifice d'Isaac est gommée parce que non allemande, le livre de Josué devrait, de ce point de vue, être maintenu tel quel», un propos que Jacques Le Rider reprochera à l'auteur sans trop de ménagements : «On a du mal à croire que Karl Kraus ait pu écrire ces lignes en 1933» (p. 300).
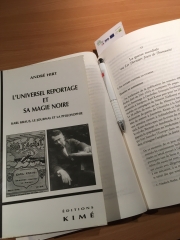 Plus d'une fois en effet, Jacques Le Rider a du mal à croire que Karl Kraus a pu écrire certaines des lignes qu'il a pourtant écrites, notamment sur son rapport pour le moins complexe avec les Juifs (4), voire dans ses querelles, souvent sordides, avec tel ou tel journaliste ou en constatant l'évolution de ses relations avec les tenants de la psychanalyse (5), dont Freud, mais, toujours, il en revient à l'extraordinaire fascination et au respect inégalé que Karl Kraus développa pour le langage, à sa haine, a contrario, contre «le dictionnaire de la phraséologie qui gouverne le monde en guerre» (p. 323). André Hirt, dans un bel ouvrage intitulé L'universel reportage et sa magie noire, a pu parler, avec justesse, de la «relation très spéciale qu'on ne peut penser qu'en termes d'élection ou d'identification incarnée, ou encore de responsabilité absolue» (6) entre Karl Kraus et la langue allemande.
Plus d'une fois en effet, Jacques Le Rider a du mal à croire que Karl Kraus a pu écrire certaines des lignes qu'il a pourtant écrites, notamment sur son rapport pour le moins complexe avec les Juifs (4), voire dans ses querelles, souvent sordides, avec tel ou tel journaliste ou en constatant l'évolution de ses relations avec les tenants de la psychanalyse (5), dont Freud, mais, toujours, il en revient à l'extraordinaire fascination et au respect inégalé que Karl Kraus développa pour le langage, à sa haine, a contrario, contre «le dictionnaire de la phraséologie qui gouverne le monde en guerre» (p. 323). André Hirt, dans un bel ouvrage intitulé L'universel reportage et sa magie noire, a pu parler, avec justesse, de la «relation très spéciale qu'on ne peut penser qu'en termes d'élection ou d'identification incarnée, ou encore de responsabilité absolue» (6) entre Karl Kraus et la langue allemande. C'est le rapport passionnel de Karl Kraus à la langue allemande qui nous permet de comprendre comment il fut à la fois révolutionnaire et conservateur, voire franc réactionnaire : il est à la fois «ennemi du progrès et conservateur de la tradition, mais aussi destructeur révolutionnaire d'un humanisme réduit dans le monde contemporain à la façade encore debout d'un immeuble démoli» (p. 453) ou, comme le dira Walter Benjamin dans son inimitable style fulgurant : «Dans la citation qui sauve et qui châtie, le langage apparaît comme matrice de la justice. La citation appelle le mot par son nom, l'arrache à son contexte en le détruisant, mais par là même le rappelle aussi à son origine» (cité par Jacques Le Rider, p. 454). La révolution selon Kraus est celle, totale, finale, que fera tonner dans les cieux l'Apocalypse ou, autrement dit : «La révolution apparaît alors comme un mouvement en courbe fermée, le point de retour est le point de départ, et finit dès lors par se confondre avec la réaction entendue comme le retour à un état antérieur de la société» (pp. 383-4), cette opération nulle pour ainsi dire ne pouvant être accomplie, contre «la magie noire de la langue dégradée en phraséologie», que par «la magie blanche des mots» évoquée dans Heine et les conséquences, un texte où ce véritable Timon d'Athènes viennois que fut Kraus affirmait du reste éprouver la «volupté de l'aventure avec le langage [qui] consume le poète». Nous avons pourtant vu que cette consomption ne devait rien avoir d'une épouvantable conflagration, parce qu'elle s'opérait en fait jour après jour, dans le moindre entrefilet fautif ou bien carrément mensonger de la Presse aux mille goitres, aux milles petites apocalypses quotidiennes, aux milliers de meurtres symboliques ou bien carrément réels, la corruption constante des mots facilitant la tombée de l'homme dans une espèce d'atonie, d'indifférence à tout ce qui peut lui arriver, à tout ce qu'on peut lui demander, comme le fait par exemple de devoir tuer un autre homme, déclaré ennemi de la patrie par de grands mots ronflants.
C'est le rapport passionnel de Karl Kraus à la langue allemande qui nous permet de comprendre comment il fut à la fois révolutionnaire et conservateur, voire franc réactionnaire : il est à la fois «ennemi du progrès et conservateur de la tradition, mais aussi destructeur révolutionnaire d'un humanisme réduit dans le monde contemporain à la façade encore debout d'un immeuble démoli» (p. 453) ou, comme le dira Walter Benjamin dans son inimitable style fulgurant : «Dans la citation qui sauve et qui châtie, le langage apparaît comme matrice de la justice. La citation appelle le mot par son nom, l'arrache à son contexte en le détruisant, mais par là même le rappelle aussi à son origine» (cité par Jacques Le Rider, p. 454). La révolution selon Kraus est celle, totale, finale, que fera tonner dans les cieux l'Apocalypse ou, autrement dit : «La révolution apparaît alors comme un mouvement en courbe fermée, le point de retour est le point de départ, et finit dès lors par se confondre avec la réaction entendue comme le retour à un état antérieur de la société» (pp. 383-4), cette opération nulle pour ainsi dire ne pouvant être accomplie, contre «la magie noire de la langue dégradée en phraséologie», que par «la magie blanche des mots» évoquée dans Heine et les conséquences, un texte où ce véritable Timon d'Athènes viennois que fut Kraus affirmait du reste éprouver la «volupté de l'aventure avec le langage [qui] consume le poète». Nous avons pourtant vu que cette consomption ne devait rien avoir d'une épouvantable conflagration, parce qu'elle s'opérait en fait jour après jour, dans le moindre entrefilet fautif ou bien carrément mensonger de la Presse aux mille goitres, aux milles petites apocalypses quotidiennes, aux milliers de meurtres symboliques ou bien carrément réels, la corruption constante des mots facilitant la tombée de l'homme dans une espèce d'atonie, d'indifférence à tout ce qui peut lui arriver, à tout ce qu'on peut lui demander, comme le fait par exemple de devoir tuer un autre homme, déclaré ennemi de la patrie par de grands mots ronflants.Mais Karl Kraus n'était absolument pas un naïf ni un doux rêveur et, combattant la presse qu'il se représente selon Jacques Le Rider «comme le principe méphistophélique logé au cœur de la civilisation contemporaine, comme une force du mal qui se réclame de la liberté pour préserver son impunité» (p. 471), il savait que sa mission, certes immense et même dépassant les efforts d'un seul homme, fût-il un enragé comme l'Autrichien, à savoir : lutter sans relâche contre «le journalisme [qui] est la colonie pénitentiaire de la langue où celle-ci est réduite à un usage communicationnel et informatif et se dégrade en bavardage, en verbiage, en phraséologie au point que le mésusage journalistique des mots finit par menacer la vie même de la langue» (p. 449), il savait donc parfaitement que cette mission était vouée à l'échec : «il est pleinement conscient de la fragilité de son utopie», écrit ainsi Jacques Le Rider qui poursuit en affirmant qu'il voulait «réconcilier l'homme avec lui-même, avec la nature et avec la société sous l'effet de la magie blanche de la langue», un «idéal culturel» (p. 423) qu'il fallait défendre plus que tout autre et, sans doute plus qu'un idéal culturel, bien que notre commentateur n'évoque finalement qu'assez peu cette dimension si bien perçue par Walter Benjamin, un idéal métaphysique et religieux.
La conclusion de Jacques Le Rider est, comme le reste de son ouvrage, assez nuancée, même si nous pouvons ne pas partager le choix qu'il établit entre deux Karl Kraus qui est «à la fois l'exorciste en lutte contre le mauvais démiurge qui s'empare de la parole et des discours dès que les individus font un mauvais usage de leur langue et le fidèle adorateur de la langue conçue comme le reflet du Verbe divin, comme une bienfaisante force d'orientation de l'existence humaine et parée de toutes les vertus : créatrice, inspiratrice et véridique». Or, comme je le disais plus haut, Jacques Le Rider, ici, est sceptique, lui qui écrit que ce «n'est sans doute pas le Karl Kraus fondateur d'un nouveau culte du langage qui conserve aujourd'hui la présence la plus vivante. En revanche, l'impitoyable satiriste d'une humanité en perdition parce qu'elle a perdu le sens des mots qu'elle croit maîtriser alors qu'ils la tiennent entièrement en son pouvoir, ce Karl Kraus-là est plus fascinant que jamais» (p. 510). Pour ma part, je ne vois pas en quoi le Karl Kraus adorateur de la langue «conçue comme le reflet du Verbe divin» serait moins fascinant que l'autre, le pourfendeur intraitable d'un quatrième pouvoir qui est en fait le premier, puisque «la presse tend à supplanter le pouvoir politique, dans la mesure où celui-ci craint beaucoup plus les journaux que les assemblées parlementaires, et même le pouvoir judiciaire car les juges craignent désormais eux-mêmes le jugement des journalistes» (p. 512). Dans les deux cas, la lecture de Karl Kraus nous semble plus que jamais nécessaire, tant les maux contre lesquels il a lutté sa vie d'intellectuel intraitable durant jusqu'à sembler à beaucoup de ceux qui le lurent et l'écoutèrent, fascinés, un héraut du Verbe, se sont aggravés depuis son époque.
Notes
(1) Dans un texte intitulé La grammaire de l'Apocalypse (in Les promesses du langage, Librairie philosophique J. Vrin, 2001), pp. 81-100. Remarquons que ce texte, qui d'ailleurs mentionne l'attention maniaque que Karl Kraus portait à la correction de la langue, comporte un grand nombre de fautes ! Les références citées renvoient respectivement aux pages 82, 85, 88, 97, 99 et enfin 100.
(2) Jacques Le Rider, Karl Kraus. Phare et brûlot de la modernité viennoise (Seuil, 2019). Quelques fautes sont à signaler : p. 74 (aborbés), p. 157 (recommandaient et non recommandait), p. 241 (les libéraux juif), p. 299 (les peuples qui leur faisait), p. 309 (les abominations la guerre), p. 385 (les deux tiers à nécessaires), p. 419 (son cerle pragois), etc. Pénible aussi est la répétition de l'expression «brigue amoureuse».
(3) «Lui qui clamait sa haine de la presse ne pouvait pas se passer de journaux. Il accusait la magie noire de la presse de préparer la fin du monde, mais il n'aurait certainement pas du tout aimé vivre dans un monde sans journaux» (p. 516).
(4) Jacques Le Rider écrit que «Kraus donne l'impression, quand il s'explique sur son propre «antisémitisme culturel», de marcher sur une corde raide» (p. 368), peut-être parce qu'il considère que la Presse qu'il déteste tant est en grande partie détenue par des Juifs, qu'il tient pour responsables de la propagation d'un «feuilletonisme ornemental» et d'une «phraséologie mensongère» (p. 383).
(5) Parfois, assez rarement heureusement, Jacques Le Rider psychanalyse sur le compte de Karl Kraus : «Si Kraus imite si bien et cite si habilement son adversaire pour démasquer sa bêtise et sa vilenie, si sa haine détecte avec tant de précision les procédés du journalisme, c'est parce que cette haine porte sur des éléments qu'il combat en lui-même, le journaliste en particulier, et parce que son procédé de satiriste consiste à intérioriser la violence de son époque, à se transformer en caisse de résonance des voix de ses contemporains, pour mieux les exorciser de lui-même» (p. 329).
(6) André Hirt, L'universel reportage et sa magie noire. Karl Kraus, le journal et la philosophie (Kimé, 2002), p. 149.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, journalisme, biographie, karl kraus, jacques le rider, éditions du seuil, andré hirt |  |
|  Imprimer
Imprimer
