Au-delà de l'effondrement, 64 : Dissipatio de Guido Morselli (12/12/2019)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Tous les effondrements
Tous les effondrements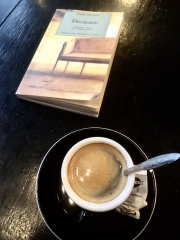 Acheter Dissipatio sur Amazon.
Acheter Dissipatio sur Amazon.Traduit de l'italien par Philippe Guilhon, Dissipatio (1) de Guido Morselli a paru en 1977 aux éditions Adelphi avant d'être publié en France en 1986 par Denoël. Le texte de ce magnifique écrivain sans pourtant aucun livre publié de son vivant, à l'instar de John Kennedy Toole, a été terminé en 1973, l'année même où il s'est suicidé, le 31 juillet exactement (soit quatre années après Toole), en se tirant une balle avec son Browning 7.65 qu'il avait l'habitude de surnommer, y compris dans ce qui serait son dernier texte écrit, «la fille à l'œil noir» ou encore son «amie à l’œil noir» (p. 26). Ce geste, en dehors de toute fumeuse considération psychologisante portant sur la légèreté avec laquelle, parfois, souvent même, des éditeurs rejettent de grands manuscrits, voire des manuscrits appelés à être d'incontestables monstres romanesques, porte une nécessité, une pesanteur que nous pourrions rapprocher de celles des principaux textes d'un autre suicidé célèbre, Carlo Michelstaedter, et est du reste rappelé ou peut-être même mis en scène, comme une intuition fulgurante de l'avenir qui attendait Morselli, dans le roman lui-même puisque le narrateur de Dissipatio a tenté de se suicider durant la nuit du 2 juin mais a raté visiblement son affaire puis, après une nuit passée dans la grotte où il a voulu mettre fin à son existence, se retrouve dans un monde totalement débarrassé non pas de toute présence de vie, mais de toute forme de vie humaine.
Bien des situations romanesques nous font nous souvenir que, retour d'une exploration de gouffre, en altitude ou dans les profondeurs, la face du monde a pu être dramatiquement changée. Je crois ainsi me souvenir que le personnage principal de La Terre demeure a été préservé de l'extinction de masse touchant ses congénères après avoir passé quelques jours dans une chaîne montagneuse particulièrement peu accessible, ce qui l'a sauvé de l'extinction de masse qui a frappé ses semblables. Nous pourrions encore songer, filant ainsi le motif traditionnel du dernier homme, au Travail de la nuit de Thomas Glavinic, un texte à l'atmosphère particulièrement suffocante que j'avais également évoqué dans ces colonnes virtuelles.
Les expressions censées rendre compte de cet événement littéralement extraordinaire, aussi étrange que celui que Jean-Philippe Domecq met en scène dans l'un de ses romans, sont nombreuses, comme s'il s'agissait pour le narrateur de comprendre ce qu'il lui arrive. En voici quelques-unes : «suspension nocturne de la vie collective» (p. 10), «retrait» ou encore «évanouissement» (p. 11) de la vie, «mystérieuse annihilation», «dissolution dans le néant» (p. 21) ou encore, tout simplement, «l’Événement» (p. 55) qualifié métaphoriquement de sortie de l’Égypte (cf. p. 69), sans parler bien sûr de l'expression proprement dite ayant donné son titre original au livre, la «Dissipatio Humani Generis» qualifiée par le narrateur de «sublimation» (p. 86).
Il est frappant que le narrateur de Dissipatio, s'il cherche plusieurs explications possibles à cette évaporation du genre humain, ne l'accepte pas moins sans beaucoup de tracas psychologiques, au final, même s'il peut être passablement affecté par le silence monstrueux d'après l'humanité, qui est un silence qui ne passe pas mais «s'accumule» (p. 34). De la même manière, le temps semble lui aussi immobilisé, «parce que c'est l'homme qui fait le temps des choses» (p. 36) et que, si le temps a cessé d'exister dans le monde vidé d'humains, alors le narrateur lui-même n'existe pas (cf. p. 144), du moins le laisse-t-il supposer. Nulle explication digne d'un récit d'anticipation n'est donnée et, comme dans La Route de Cormac McCarthy, nous nous retrouvons in medias res, sans que l'auteur n'éprouve le moindre besoin (il s'en moquerait même (2)) de donner une explication purement rationnelle à une aussi soudaine évaporation du genre humain, même si nous apprenons que cette dernière n'est en somme que la figuration brutale, la pétrification d'une tendance propre au narrateur, que ce dernier a du reste parfaitement identifiée avec sa lucidité coutumière en matière d'introspection psychologique puisqu'il sait qu'il pâtit d'une «absence totale de rapports interpersonnels» (p. 70), l'homme ne cessant de répéter qu'il éprouve une véritable «détestation du monde» (p. 9) qui, bien avant que la réalité ne rejoigne ses désirs, lui a fait imaginer «un pays abandonné, brusquement nettoyé de tous» (p. 33), comme si la dissipation de ses semblables lui permettait, enfin, de pouvoir se considérer à bon droit comme «l'Humanité» et même «la Société (H et S majuscules)», lui qui peut désormais sans emphase «parler à la troisième personne» en affirmant que l'Homme «a dit ceci, a fait cela...» (p. 32) et se payer le luxe de moquer Hegel, puisqu'il a plus d'une fois imaginé qu'il était «le seul être pensant d'une création entièrement déserte. Déserte en hommes», veut-il dire étant donné que, «dans des cas de ce genre, [son] discours intérieur peut s'accompagner de pédanterie : Hegel a rêvé une réalité en soi et pour soi», tandis que lui a rêvé «une réalité avec [lui] et pour [lui]», dans «laquelle les autres n'ont pas lieu, parce qu'ils n'existent pas» (p. 51). Dissipatio est ainsi le roman absolu, moins parce qu'il figure le cas du dernier homme que parce que celui-ci, alors même qu'il vivait entouré d'autres hommes et d'autres femmes, était seul ou plutôt, se voulait seul. D'une certaine façon, c'est le propos qu'illustrera, certes avec une intensité autrement dramatique, The Divide de Xavier Gans : à quoi sert-il de survivre dans un monde d'où l'humanité a été chassée si, alors même que nous étions vivants parmi d'autres êtres, nous avons oublié notre humanité ?
De telles pensées pour le moins pessimistes (3) sont-elles justement de celles qui sont non seulement interdites mais pourraient à bon droit être considérées comme un véritable «péché pour lequel il n'existe pas de pardon» (p. 52) ? Nous pouvons en douter, tant la perspective de se retrouver seul homme vivant au monde semble finalement réjouir le narrateur puisque ce qui, pour tout autre, «serait l'océan de la négation» et «une horreur totale», il y navigue, lui, «sur une petite barque de papier» (p. 61), vers un horizon absurde que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est ce même narrateur (unique, nous l'aurons compris !) qui du reste jamais ne manque de rappeler que cette subite et inexplicable dissolution du genre humain ne peut qu'avoir des conséquences bénéfiques sur la nature et les animaux sauvages, mais aussi qu'avec cette évaporation, c'est tout le système capitalistique (voir la critique constante et virulente de l'Argent dans ce roman) qui n'a plus de raison d'être : en somme, si, à «l'âge de la technologie», le monde civilisé, croulant sous les moyens de transport et envahi par les réseaux de communication, se tait, «cela veut dire que la société prétendument associée est suspendue, pour ne pas dire périmée, que l'organisation cryptomane et funeste déployée sur les cinq continents s'est dissoute, que la pieuvre de l'Économie n'allonge plus la myriade de ses immondes tentacules» (p. 54). Pour le dire d'une autre façon encore plus abrupte, ce n'est qu'avec la disparition de l'homme que son propre esclavage, consenti sinon souhaité, a pu disparaître ! L'évaporation du genre humain est peut-être une forme insurpassable d'escamotage (cf. p. 68) et d'élégante ironie adressée, non pas aux hommes dont il ne reste plus la moindre trace même si les draps de lit sur lesquels reposaient leur corps ont conservé sa forme, mais au dernier homme, comme si «un monde tout entier corporel et qui ne croit qu'en ce qui est tangible [avait été] vidé de son corps» (p. 62).
La nature, elle aussi, a tiré profit de la suppression inopinée de son implacable colonisateur, le narrateur n'étant jamais plus clair que lorsqu'il affirme que la prétendue fin du monde est «une des blagues de l'anthropocentrisme» puisque le fait de «décrire la fin de l'espèce comme impliquant la mort de la nature végétale et animale, la fin de la Terre» ou encore «la chute du ciel» est ridicule : il est évident qu'il «n'existe pas d'eschatologie qui ne considère la permanence de l'homme comme essentielle pour la permanence des choses» (pp. 56-7), ce propos radicalement écologiste, au sens propre du terme, ne pouvant que nous rappeler la thématique d'un texte saisissant d'Arthur Machen intitulé La Terreur.
Une fois l'humanité évaporée, reste le narrateur seul dans une ville complètement vide que la nature et les bêtes sauvages commencent ou recommencent à envahir, demeure donc le dernier homme mais aussi son langage teinté de psychologie et des disciplines qui lui sont associées, comme si «la rabelaisienne abondance en locutions» propre à ces domaines en faisait avant tout «une dense concrétion linguistico-littéraire, un édifice de tropes et de métaphores» qui ne serait pas grand-chose d'autre que l'ultime surgeon plutôt qu'un «des héritiers légitimes de la rhétorique» (p. 71) : en fait, le dernier homme ne peut se taire et est lui aussi la victime de l'idolâtrie de la communication, considérée comme «un vice récent» (p. 76), peu lui importe finalement que, comme dans le fameux texte de Philip K. Dick, Ubik, nous ne puissions véritablement trop nous avancer sur les différences séparant la vie de la mort, la vie quotidienne elle-même, selon un certain Mylius dont le narrateur rapporte l'étrange théorie, ressemblant par bien de ses aspects à son contraire. Ainsi, nous sommes morts bien que vivants, non seulement parce que nous méprisons la nature qui, elle n'a, «sans aucun doute, ni regret ni chagrins» (p. 91) face à la disparition des hommes, mais aussi parce que «nous ne savons plus écouter le temps organique, tandis que le temps psychologique se confond pour nous avec l'embrouillamini de sensations/impulsions dans lequel nous avons gauchi», autrement dit subjectivé, «le monde extérieur», «ses qualités, ses dimensions» (p. 96).
Bien plus encore, les hommes ont produit une culture de la mort, orientée entièrement vers la mort (cf. p. 102), si tant est qu'il faille accorder quelque sérieux à cette dernière et ne point la délaisser pour lui préférer la catégorie de l'inconsistance (voire de l'inconstance propre au démoniaque) comme l'indique cet étonnant passage que l'on dirait être une espèce de sociologie de l'ectoplasme, de la vie diminuée, la vie dissipée au sens de Morselli (et de Jamblique, donc) : «La culture porte en elle le dissolvant pour ce qui la fait vivre comme pour ce qui la nie. Elle n'a pas de constance si elle ne trouve pas quelque chose qui permette d'augmenter sa production, mais, du fait de son inconsistance, quoi qu'il puisse arriver de catastrophique, elle résiste» et, non seulement elle résiste mais elle «se relève», car c'est un phénix, «un phénix bavard et déplumé [et] de préférence en cage» pour lequel «il n'y a pas de fin du monde» car, s'il y en avait une, elle «lui offrirait de quoi s'alimenter et s'exercer» (pp. 95-6). Dès lors, face à cette apocalypse inversée ou grotesque ou plutôt : face à cette impossibilité de toute apocalypse, il n'y a rien à espérer de la dissolution des hommes, et le narrateur peut se persuader sans trop de mal qu'il les reverra tôt ou tard (cf. p. 96).
Notre narrateur n'a jamais aimé les autres hommes; il a même cultivé avec opiniâtreté le «vice rare du solipsisme» (p. 114) et, pourtant, c'est lui que quelque dieu grotesque et farceur a choisi pour être le témoin de leur disparition et incarner le dernier homme. C'est un autre marginal, un autre modeste, un autre inadapté au système qui a pu comprendre que le règne de l'homme touchait à sa fin, comme le narrateur le découvre en lisant par hasard une «page de journal, ou une lettre-testament» (p. 98) rédigée par un étranger travaillant dans la ville de notre dernier témoin : il annonce la fin de l'homme et le personnage principal n'en paraît pas stupéfait, peut-être parce que, comme lui, ce devin «se tenait bien à l'écart de l'intelligentsia» (p. 99), comme si les marginaux (et notre narrateur est un marginal à sa façon) étaient seuls capables de critiquer notre société ou d'éprouver quelque peu de «la respectueuse terreur que la vaste et pure nature inspirait jadis aux hommes» et dont la perte représente «l'une des infirmités vitales dont souffrait notre époque» (p. 104), comme si eux seuls pouvaient avoir perçu les signes de l'apocalypse cotonneuse, pour ne pas dire franchement éthérée, qu'est cette dissipation qui non seulement ravit les vivants mais fait disparaître les squelettes exposés dans une cellule bordant une église et exposée aux yeux des passants, dans une des scènes les plus étonnantes du roman, laquelle (et elle seule), semble plonger le narrateur dans la plus grande perplexité et même un effroi dévastateur, qui n'est pas la vie singeant la mort, la mort singeant la vie, qui n'est pas la vie-dans-la-mort ou l'inverse, mais quelque chose qui se tient derrière, «qui n'est pas douceur, et même pas repos», quelque chose digne d'un conte d'Arthur Machen ou de Lovecraft : «quelque chose qui ressemble à un précipice» et à une «expérience profonde, extrêmement profonde», mais «vers le bas, pas vers le haut» (p. 112).
Plus d'une fois, le livre de Guido Morselli, avec une remarquable économie de moyens, bascule dans le fantastique, car nous ne savons (lui-même ne le sait pas, du moins il s'interroge) si le personnage principal est bel et bien encore vivant vu que, comme le tout premier homme, le tout dernier est une impossibilité logique et métaphysique : «Il n'y a pas eu de premier de la race. L'hominien ou l'homme originel n'est qu'une supposition théorique. De même, au bas de la pyramide renversée (4), l'individu-sommet, mon individu, ne peut que se réduire à une hypostase mentale» (p. 118) et, ainsi, le livre que nous lisons et que le narrateur évoque comme étant la bouteille à la mer qu'il ne sait à quelles eaux confier (cf. p. 134) ne serait rien d'autre que «la funèbre trouvaille d'un solipsiste féroce, mais par ailleurs lâche et poltron, qui repousse obstinément l'idée de mourir» (p. 137) et qui, pourtant, mais nous ne le saurons jamais, est déjà mort, comme s'il nous tendait le miroir funeste dans lequel nous aurions quelque mal à distinguer les traits de Guido Morselli, un grand écrivain qui, alors qu'il était encore vivant, semblait être déjà mort, et d'abord à ses propres yeux.
Notes
(1) Un titre qui en français a perdu deux de ses lettres, H. G. pour humani generis, lointain souvenir de Jamblique. Comme toujours dans l'édition française, de poche ou pas, ce texte n'est hélas point dépourvu de fautes, dont je donne une liste sommaire: le Providence, p. 28; en une surprise désagréable au lieu de eu, p. 77; d'un société chorale à la même page, etc.
(2) Il parle ainsi d'une «bombe D (Dépeuplement, subit et radical)» ou encore d'une «bombe R (Raréfaction)» (p. 42). Plus loin, il affirme ne pas penser «à un génocide accompli au moyen de rayons de la mort, à des épidémies répandues sur la Terre par de méchants Vénusiens ou à des nuages nucléaires dus à de lointaines explosions» car, poursuit-il, il a immédiatement compris que «l'Événement ne pouvait pas se réduire aux mesures habituelles» (p. 60).
(3) «Seuls les optimistes entretenaient l'illusion que le réel fût rationnel, et je n'ai jamais été optimiste» (p. 59).
(4) Voir le schéma reproduit à la page 88 de notre roman.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, au-delà de l'effondrement, post-apocalyptisme, guido morselli, dissipatio, éditions rivages, cormac mccarthy, carlo michestadter, thomas glavinic |  |
|  Imprimer
Imprimer
