Le hussard bleu de Roger Nimier (08/06/2021)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Mâles lectures.
Mâles lectures. Le Grand d'Espagne.
Le Grand d'Espagne.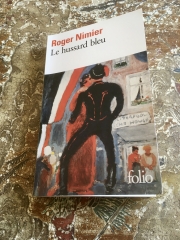
Acheter Le hussard bleu sur Amazon.
Le hussard bleu aura figé le visage de Roger Nimier dans une jeunesse perpétuelle, qui n'est qu'en partie celle, insolente, de son principal héros, François Sanders, que le ciel a fait de «cette race des hommes, puissante, assurée, maîtresse de la terre, des animaux et des femmes» (1). Un tel style qui ne s'embarrasse point de joliesses a de quoi heurter les vieux et les vieillards avant l'heure, qui sont de toute engeance, professeurs, diaristes, fonctionnaires du verbe et subventionnés de l'imaginaire, petit goitreux du journalisme phocomèle, sans bras ni jambes mais encore, hélas, pourvus d'une bouche jamais fatiguée ou figée par une crampe que l'on espérerait définitive, la crampe hideuse du dernier souffle. La jeunesse est un scandale, comme ne manquera d'ailleurs pas de le relever Nimier en reconnaissant à Georges Bernanos, qu'il surnomma le Grand d'Espagne et dont Sanders, dès la première page du roman, mais aussi à sa toute fin, reproduira l'un des plus fameux tics de langage (imbéciles !), un magistère indépassable sur les cœurs et les reins qui n'ont pas encore eu le temps de se saponifier, où de faire penser leur paire de fesses en les posant sur un fauteuil académique. C'est aussi deux années seulement après 1950, date de publication du texte le plus connu de l'auteur, que Paul Gadenne écrira La plage de Scheveningen où il s'agira, là encore, moins de tenter de comprendre l'homme qui a pactisé avec le diable, Hersent ou Besse donc, que de saluer la cohérence de leur destin, peu importe que, une fois de plus, la conscience minuscule des prudes en soit marrie.
C'est Sanders qui évoque celui de son ami et double même, qui se fera lui-même justice en se pendant à un arbre, après avoir fait sauter un train transportant des enfants (qui, miraculeusement, s'en échapperont apparemment, du moins en partie, mais lui n'en saura rien) : «Un ami, c'est beaucoup; mais un double, une ombre qui vous a suivi longtemps, chargée des mêmes espoirs, tournée dans les mêmes crimes, c'est beaucoup plus précis : un conseil, un ordre. Ce qu'il avait fait de lui, je devais le faire. Sur un théâtre silencieux les personnages de l'histoire défilent : celui qui a duré quand les autres sont morts, celui-là passe en baissant la tête; il jette un regard de mépris sur toutes les années qu'il a volées. Qu'en a-t-il fait ? Des fonctions éminentes dans le gouvernement de l’État, le commandement d'une place forte, une ambassade, la gloire, ou simplement le bonheur, tout cela se résumerait beaucoup mieux dans une minute fatale. On part avec les autres, on ne les lâche pas : voilà une fameuse ambassade, une vraie place forte. Depuis je me le suis répété sans arrêt», poursuit Sanders, concluant cette exaltation du don de soi consumé en un coup de tête ou de force par ces deux phrases dures comme une seule sentence de marbre : «Certaines vérités n'ont de force que dans l'ombre et piétinées. Au grand jour, elles s'envolent, regagnent leur ciel impérissable» (pp. 379-80), ce qui ne l'empêchera toutefois pas, revenu à Paris, de reprendre une vie que l'on devine être rien de moins qu'aventureuse : convenue, éditorialisante à ses heures perdues, à moins que ces dernières ne soient consacrées à la poursuite d'un idéal de force et de bravoure dans quelque recoin de brousse où la France fermera les yeux sur ces supplétifs que l'on qualifie parfois, avec un haussement d'épaules, d'irréguliers.
Un tel propos, surtout appliqué à un milicien (2), choquera, et nous nous imaginons Nimier adresser un sourire carnassier à tous les imbéciles ayant, justement, préféré conforter leur place forte sociale, qu'ils auront conquise sans verser une goutte de sang mais en écrasant quelques importuns sur leur passage victorieusement laid. Peu importe, car ce n'est pas tant la jeunesse de ses héros que Roger Nimier magnifie, ni même la trace de pure violence que les partisans de la Germanie éternelle veulent laisser dans l'Histoire, plaçant même l'âme maudite du Reich millénaire «sous le signe d'une gorge tranchée qui saignera jusqu'à la venue des temps» (p. 340) (3), mais bien plutôt la vieillesse de l'Occident, singulièrement de la France (qui vit ses dernières années, selon Sanders, pays fini malgré quelques soubresauts faisant illusion et qui retombera dans l'ignoble apaisement de la paix, qui ne tardera pas à voter et se mettre «le timbre à trois francs», p. 268), qu'il moque cruellement car «si les Français, autrefois, entendaient vanter avec plaisir leur littérature, leur monarchie et leurs armées, ceux du XXe siècle bouillonnent de joie dès qu'on fait la moindre allusion à leur coutumes et à leurs parfumeurs» (p. 371). Une époque de mauviettes; à la lettre, de phraseurs («On ne se tuerait pas si on n'écoutait pas les autres», p. 414), des lettrés en somme, Sanders éprouvant par exemple le besoin de tremper les romans de sa maîtresse, dont tout le corps réclame «une vie personnelle et non plus l'existence passagère prêtée par les créatures de roman» (p. 361), dans l'alcool car, ainsi, ils prendraient ces couleurs qui leur manquaient et l'on pourrait espérer qu'«ils se décideraient à finir plus vite» (p. 368). Sanders lui-même ne se décrit-il pas comme «un garçon à qui il n'arrivait pas d'aventures» mais seulement «des événements» (p. 359), comme s'il refermait sur sa constante ironie l'orbe du projectile que d'autres, avant lui et dans la vraie vie comme l'illustrera Roger Stéphane en dressant le portrait de l'aventurier, ont eu toutes les peines du monde à charger dans la gueule d'un canon passablement rouillé ? Les miliciens, eux-mêmes, «Frantz, Darmun, Laudenbach» et ces Français «dont la frivolité n'enlevait rien au dénuement de leur sort», devinent «les impatientes nécessités qui armaient leur bras malgré eux» (p. 337), et ne semblent plus vraiment croire qu'à l'élan qui les a menés là où ils se trouvent, face à un mur, contre lequel toutefois il leur est possible de se jeter plutôt que, minablement, se faire fusiller en y plaquant un dos trempé de la sueur de sang de la mauvaise conscience ou, plus acide encore, du bon droit injustement bafoué.
Sanders qui n'hésite pas à déclarer que «nos moindres gestes [poursuivent] des signes venus de loin» (p. 17), comme Macbeth, est hanté par ce que nous pourrions appeler l'onde concentrique surnaturelle de l'acte, son ombre portée sur un sol invisible, sa résonance dans la vie future, songeant tout à coup que «personne sur la terre n'a jamais fait une chose dont il ait seulement eu envie pour l'éternité», imaginant alors qu'après la mort, «chacun de nous se verrait multiplié mille fois et ces êtres nouveaux et semblables, enfermés dans la même pièce, répèteraient sans fin les gestes que nous avons accomplis de notre vivant» (p. 351). C'est ainsi que les femmes, selon Nimier, du moins les plus conséquentes, les plus invinciblement attachées au génie irascible et instinctif de leur sexe, osent tout, dépucèlent par exemple les mâles sans vergogne, puisqu'elles veulent bien se damner, par exemple sous la férule d'un Sanders, à condition de ne pas passer leur vie «dans les vestibules» (p. 326), à condition aussi de presser entièrement le jus du fruit éphémère, leur fût-il fatal. En cela sont-elles, à leur façon, les doubles de Sanders, pas gêné de dire, crânement, qu'il a aimé passionnément une femme «pendant une après-midi» et que c'est, si on l'envisage sous le bon angle, une performance pas moins digne qu'une autre : certes, «on dira qu'une après-midi, ce n'est pas très long. C'est une affaire de nature», rétorque-t-il aux prudents, aux vieux, car lui pense «au contraire qu'il faut plus de passion pour penser à un être, minute par minute, avec extase, ravissement, colère, inquiétude, pendant un seul jour, que n'en réclame une liaison durable, qui se contente souvent d'un vif regard de temps à autre et nourrit sa flamme au contact des objets quotidiens» (pp. 275-6).
Jouer sa vie est l'attitude la plus respectable, puisqu'il s'agit de parier, de risquer de perdre ce que l'on a misé mais enfin, c'est encore là être fidèle à sa monstrueuse façon à l'esprit d'enfance, si «la guerre est une enfance prolongée», alors même que la civilisation, «qui est presque tout entière dans les ambitions de l'adolescence», ne tire désormais plus «ses valeurs de l'amour, mais du meurtre» (p. 271), ce changement ne manquant pas d'agréments, vers la dix-huitième année, conclut Sanders (cf. p. 272), même si l'on devine quel genre d'enfants monstrueux enfantera un tel monde de fer.
Qui, dès lors, pourra feindre de s'étonner si, pour un des personnages (De Forjac), le Christ a été «un coupable jeune homme» qui «avait donné aux hommes l'envie de ressembler à des torches» (p. 382), une remarque que l'on peut bien sûr prendre au pied de la lettre néronienne mais aussi de façon plus spirituelle, comme lui-même d'ailleurs semble l'entendre, puisqu'il ne peut que constater que, à notre époque, les torches se sont transformées en «boîtes d'allumettes», puisque nous ne savons plus que brûler «un petit sentiment pour une femme, un autre pour un tableau, ainsi en avait-on pour un long temps et, d'ailleurs, c'étaient de mauvaises allumettes», étant donné encore que «la plupart ne prenaient pas feu» (p. 383) ?
Nous retrouvons Sanders dans les dernières pages du roman, de nouveau aux prises avec sa maîtresse vicieuse et cruelle et qui, elle aussi à sa façon, parie tout sur un seul coup de dés; Sanders, ce type qui se sait parfaitement «détraqué» car «trop d'alcool, trop de sang, trop de XXe siècle dans le sang, trop de mépris» (p. 403) ne peuvent que vous vicier les sentiments, Sanders qui plus que jamais sait que les hommes, tous les hommes, «sont les ennemis du temps» (p. 404), Sanders qui espère, pour ses cadets, l'heureuse fortune qui aura été refusée à sa génération (cf. p. 415), se traitant durement car, d'une certaine façon, il a abandonné Besse à son sort en saturant sa cervelle de grands mots, ces grands mots qui l'auront peut-être conduit à suivre la voie qui a été la sienne : se pendre à un arbre et, ainsi, donner tout son sens à cette très belle et mystérieuse phrase, qui pourrait servir de titre, pourquoi pas, à l'impossible odyssée des enfants de la si républicaine (donc cocue) France (4) que Nimier aura finalement écrite dans chacun de ses livres : «Mais un autre sommeil se nomme l'avenir» (p. 256).
Mais de cet avenir de Sanders nous ne savons rien, et le sang versé qui réclame «les terres promises» finira bien par tourner, comme le lait, et empoisonner le corps tout entier de celui qui, rendu à la vie civile, ne sait non seulement plus qui il est, mais se déclare, parodiant le vers fameux de Térence, étranger à tout ce qui est humain (p. 434 et dernière), comme si la guerre elle-même avait changé de visage et ne laissait plus, en lieu et place des survivants plus ou moins traumatisés, habituels cortèges des anciens conflits, que des ombres malades, exclusivement occupées à poursuivre leur but solitaire, tromper l'ennui dans les bras d'une femme ou dans une cause perdue.
Il doit bien en rester quelques-unes dans ce monde uniformément aseptisé, où François Sanders finira de brûler sa destinée maudite et ridicule.
Notes
(1) Roger Nimier, Le hussard bleu (Gallimard, coll. Folio, 2019), p. 373. Je n'ai relevé qu'une erreur d'orthographe, sur le nom de Reichshoffen, incorrectement écrit Reischoffen (p. 372), ainsi qu'une majuscule fautive à «plutôt» (cf. p. 228).
(2) Bon an mal an, il nous semble que Roger Nimier considère le milicien, celui, donc, qui s'est trompé plus ou moins volontairement, comme l'enfant humilié, voire le pauvre, selon Bernanos. Voici ainsi comment Sanders voit Besse, auquel il vient de sauver la vie en évitant de le viser au moment où il est parvenu à s'échapper : «Dans la fumée de la ferme, je l'avais mal reconnu et pourtant c'était lui, car le drame avait toujours servi son visage. Maintenant, je considérais avec tristesse son allure misérable, ses épaules étroites : il appartenait bien à cette immémoriale race des pauvres qui fournit éternellement les bourreaux et les victimes tandis que les pharisiens, en se frottant les mains, en pinçant les lèvres, déclarent fièrement qu'ils n'ont rien à voir avec ces choses-là et que c'est bien fait» (p. 350).
(3) Ainsi comprenons-nous la différence existentielle entre le milicien et le réprouvé selon Ernst von Salomon lequel jamais ne s'arrêtera de lutter, puisque, par définition, il n'admettra pas qu'un quelconque nouvel État, une improbable société construite selon ses plus profonds désirs, puissent advenir dans ce monde.
(4) De Forjac, à propos de de Gaulle : «le fait d'avoir rétabli la République ne prouvait rien, sinon qu'il tenait une douloureuse promesse et que cette promesse-là n'avait pas de quoi beaucoup le chagriner, puisque aussi bien, rétablir une République en France, c'est toujours marier une femme coquette avec un vieillard : elle le trompera» (p. 190). Notons que nous pourrions dresser un portrait, assez peu flatteur, de la France et des Français en relevant plus d'une allusion à la fin de partie qu'est en fin de compte Le hussard bleu. Cette image vaut bien de pesantes thèses : «J'ai mangé [c'est Sanders qui parle] une cinquantaine d'abricots et, en jetant les noyaux à dix mètres de moi, je me suis amusé à écrire sur le sol des mots sans suite, c'est-à-dire : Vive la France» (p. 116).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, roger nimier, le hussard bleu, paul gadenne, la plage de scheveningen |  |
|  Imprimer
Imprimer
