« L’insécurité culturelle de Laurent Bouvet, par Gregory Mion | Page d'accueil | Pas pleurer de Lydie Salvayre, le Goncourt de la vulgarité »
04/09/2016
Le Grand d'Espagne de Roger Nimier
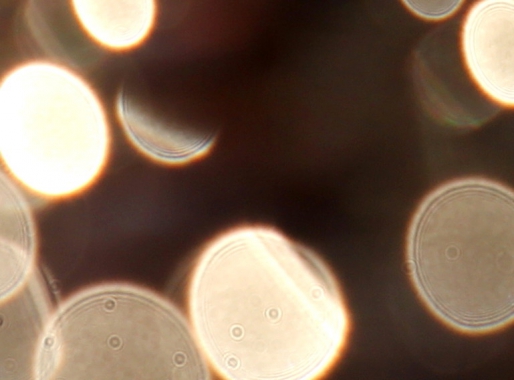
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Mâles lectures
Mâles lectures Georges Bernanos dans la Zone
Georges Bernanos dans la Zone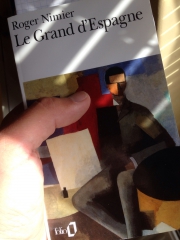 Tout grand livre naît du désespoir, mais du désespoir qui a été surmonté. S'il ne fallait citer qu'un seul roman qui me vient immédiatement à l'esprit, j'avancerais le labyrinthique et faustien Sous le volcan de Malcolm Lowry, ce livre dans le cratère duquel il est difficile de ne pas tomber, une fois qu'on s'est approché, imprudemment, de ses rebords. S'adressant, à 25 ans seulement, à celui qui, du désespoir, a offert l'une des explorations littéraires les plus profondes et fascinantes, Georges Bernanos, Roger Nimier ne pouvait que prétendre qu'il «faut savoir désespérer jusqu'au bout» (1) avant d'écrire comme un homme se jette dans un dernier sursaut de courage sur l'ennemi en surnombre qui l'encercle. Il mourra bien sûr, mais il se sera battu. Nous, nous mourrons, nous sommes en fait déjà morts. Mais contre qui nous sommes-nous battus, si ce n'est, dans ce pays vidé de sa substance, écouillé par des décennies de socialisme, de gauchisme, de féminisme, de véganisme, de structuralisme, d'humanisme intégral et autres fariboles devant tout au soi-disant modernisme, contre des pleutres, des Homais cramponnés à leurs places comme une sangsue à la peau qu'elle suce ? Parler d'humanisme intégral et de monde privé de sa force me fait penser à cette méchanceté de Georges Bernanos contre Maritain, dans une lettre à l'abbé Sudre datant du mois d'août 1927 : «Admirable parmi les abstractions, sitôt qu'il rencontre l'homme, on le voit plier ses reins. Pourquoi diable rêve-t-il d'une influence directe et personnelle ? Sa prise sur les consciences est nulle. Aucun sens de l'honneur» (in Correspondance inédite 1904 - 1934 Combat pour la vérité, Plon, 1971, p. 310). Aucun sens de l'honneur, voici la phrase qui caractérise le mieux notre époque devenue flache, et le comportement de tous les têtards qui y barbotent. Puis désespérer suppose de posséder encore un idéal, et je crains que le Français, de nos jours, non seulement n'en possède plus, si ce n'est de ne point se retrouver relégués dans une banlieue malfamée ou de rater leur soirée de match de football, mais ne soupçonne aussi de commettre quelque faute de goût en employant ce mot.
Tout grand livre naît du désespoir, mais du désespoir qui a été surmonté. S'il ne fallait citer qu'un seul roman qui me vient immédiatement à l'esprit, j'avancerais le labyrinthique et faustien Sous le volcan de Malcolm Lowry, ce livre dans le cratère duquel il est difficile de ne pas tomber, une fois qu'on s'est approché, imprudemment, de ses rebords. S'adressant, à 25 ans seulement, à celui qui, du désespoir, a offert l'une des explorations littéraires les plus profondes et fascinantes, Georges Bernanos, Roger Nimier ne pouvait que prétendre qu'il «faut savoir désespérer jusqu'au bout» (1) avant d'écrire comme un homme se jette dans un dernier sursaut de courage sur l'ennemi en surnombre qui l'encercle. Il mourra bien sûr, mais il se sera battu. Nous, nous mourrons, nous sommes en fait déjà morts. Mais contre qui nous sommes-nous battus, si ce n'est, dans ce pays vidé de sa substance, écouillé par des décennies de socialisme, de gauchisme, de féminisme, de véganisme, de structuralisme, d'humanisme intégral et autres fariboles devant tout au soi-disant modernisme, contre des pleutres, des Homais cramponnés à leurs places comme une sangsue à la peau qu'elle suce ? Parler d'humanisme intégral et de monde privé de sa force me fait penser à cette méchanceté de Georges Bernanos contre Maritain, dans une lettre à l'abbé Sudre datant du mois d'août 1927 : «Admirable parmi les abstractions, sitôt qu'il rencontre l'homme, on le voit plier ses reins. Pourquoi diable rêve-t-il d'une influence directe et personnelle ? Sa prise sur les consciences est nulle. Aucun sens de l'honneur» (in Correspondance inédite 1904 - 1934 Combat pour la vérité, Plon, 1971, p. 310). Aucun sens de l'honneur, voici la phrase qui caractérise le mieux notre époque devenue flache, et le comportement de tous les têtards qui y barbotent. Puis désespérer suppose de posséder encore un idéal, et je crains que le Français, de nos jours, non seulement n'en possède plus, si ce n'est de ne point se retrouver relégués dans une banlieue malfamée ou de rater leur soirée de match de football, mais ne soupçonne aussi de commettre quelque faute de goût en employant ce mot.Et puis, pour le dire simplement : il est impossible, du moins en littérature, de parvenir à se figurer ce que pourrait signifier une passation de pouvoirs, pour ainsi dire, entre représentants de différentes générations. Il n'y a plus de générations, le jeune crache sur le vieux, le gifle (du moins, prétend le gifler) et, de toute manière, le népotisme qui caractérise la vie intellectuelle parisienne (donc française, hélas) est un universalisme de la médiocrité : pas de différences établies sur des normes aussi ringardes que l'identité sexuelle, l'histoire personnelle, l'intelligence, le talent, l'âge même, le pays dans lequel nous vivons, fidèle à sa tradition d'avance sur le reste du monde, a inventé l'infernal remugle, la partouse pour le coup intégrale que Dalibor Frioux a cauchemardés dans son terrifiant Incident voyageurs.
C'est donc de plus d'une façon qu'un livre comme Le Grand d'Espagne est tout bonnement inconcevable de nos jours : par manque de talent, par absence de hardiesse, par intumescence prodigieuse d'inculture, de vulgarité, de bassesse, de médiocrité, et puis parce que tout le monde se contrefiche de saluer ce qui nous a précédés et qui, pour le dire point trop désobligeamment, est presque toujours plus grand que nous ne sommes.
Imaginons, de nos jours, un jeune premier, une jeune première refaisant le beau geste, après tout simple, point trop inouï ni même surhumain, d'Arthur Rimbaud saluant le prince Charles Baudelaire, ou de Roger Nimier envers son aîné, et s'adressant à... S'adressant à qui, au fait ? S'adressant aux guerriers de papier que sont Renaud Camus ou Richard Millet, ces Charles Martel en guimauve ? S'adressant au pédophile revendiqué, à coloration vaguement réactionnaire plaisant aux vieilles carnes, qu'est Gabriel Matzneff ? Certains de ces moitrinaires, pour reprendre le mot génial que Léon Daudet réserva pour une caste bien particulière d'impuissants, les impuissants à miroir, peuvent en tout cas revendiquer le rôle d'inspirateur de la jeunesse au vu de leur âge plus que respectable, un rôle que Gab la Rafale prend, lui, au pied de la lettre, même si, au passage, il aura quelque peu défiguré le début du mot inspirateur. Même Nabe, paraît-il, ne dédaigne pas de recevoir son lot d'enveloppes cachetées à la cyprine de bécasse antisémite, où il flaire paraît-il les fragrances vite éventées de son talent de polémiste gentiment bloyen. Nous avons donc nos muses, assurément, des muses à la hauteur de notre horizontalité sous-littéraire, même si elles sont parfaitement ridicules et saponifiées dans une comique suffisance, ou bien bronzées, comme le presque centenaire Jean d'Ormesson, au néon de la gloriole, qui ne provoque hélas pas d'expéditif cancer de la peau. Nos muses, quelque peu replâtrées pour l'exposition dans les librairies et sur les plateaux d'émissions télévisées sont nombreuses, bien que peu originales. Mais que pourrions-nous leur dire qui, sans être inoubliable, s'élève quelque peu au-dessus de l'exercice où une bouche de peu de talent mais pourvue d'une langue longue et admirablement souple prononce quelques mots à des pavillons auriculaires cimentés par le cérumen de la prétention et de l'insignifiance ?
J'ai lu le premier état du manuscrit de Georges Bernanos encore une fois où Sébastien Lapaque, crânement, avait imaginé une série de lettres qu'il eût pu adresser au romancier du mal et de la grâce, mais cet artifice, volonté de l'auteur ou de son éditeur Olivier Véron je ne sais, ne tint pas le choc ni même debout, et fut donc abandonné. Comme si, en fait, nous n'avions plus le courage, assurément simple, d'oser nous adresser à un homme qui, aussi imparfait et faillible qu'on le voudra, n'en demeure pas moins un modèle, ou encore, comme si ce geste, que la littérature des siècles passés a illustré de bien des remarquables manières, ne pouvait plus, de nos jours, qu'être une plaisanterie de potache qui, dans le meilleur des cas, sera jugée par ses professeurs d'un trait rageur au stylo rouge, en marge de la copie naïve mais sincère : Quel orgueil ! L'orgueil d'un gamin génial, admiratif à sa façon, ironique et cruelle, de ses aînés, Rimbaud saluant Hugo et Baudelaire, Huguenin Bernanos et Valéry, voilà un métal rarissime que la tête de pioche de tous les imbéciles du monde prétendra épuiser en quelques coups savamment frappés.
Nous sommes confrontés à une double impossibilité, tragique ou bien comique selon les humeurs, lorsque nous imaginons un jeune écrivain français s'adresser à celle ou celui qui le précéda et l'inspira : d'abord, il n'y a pas, en France, de jeune écrivain susceptible de posséder l'once de talent d'un Roger Nimier qui eut 20 ans en 1945, ce à quoi il ne pouvait évidemment rien mais qui, cinq ans plus tard, n'eut pas peur de clamer son admiration à l'égard de Georges Bernanos venant de mourir, ce qu'il eût pu avoir la peur de faire; ensuite, s'adresser à un écrivain suppose, je le crois du moins, de l'avoir lu et, ainsi, d'être capable de jauger et juger ce qu'il a pu vous apporter mais, surtout, ce qu'il a pu apporter à ce qui vous-même vous dépasse, et qui a pour nom la littérature. Or, et je fais ce constat à peu près chaque jour que je lis des livres, quel jeune écrivain français pourrait témoigner, à une ou deux exceptions près sans doute, qu'il s'agisse de Marien Defalvard ou encore de Julien Capron, en plus de quelques lignes mal écrites, de l'admiration qu'il porte à un autre écrivain, à condition même que nous puissions prétendre de ce dernier qu'il est, bel et bien, un écrivain, et pas un plaisantin un peu plus âgé que son jeune admirateur ? L'exercice de l'éloge véritable, qui peut s'enrober autant qu'il le voudra de la carapace de l'ironie, à condition qu'elle ne soit jamais moqueuse, vile, suppose intelligence, finesse, humilité et orgueil tout à la fois, piété, une notion presque tombée dans le plus méprisable des oublis, sens de la transmission et, bien sûr, talent, autant de conditions que je ne trouve nulle part réunies dans leur ensemble, ni même, trop souvent, réduites à leur portion congrue, parmi nos très nombreux écrivants, et même chez nos très rares écrivains.
Imaginons, avant de revenir au beau livre lucide et noir de Roger Nimier, Édouard Louis clamer son comique attachement et sa très minable admiration à un vieux mandarin expert en farces et attrapes sociologiques, pour le plus grand bonheur des idiots journalistiques qui ne pourront s'empêcher de saluer, comme ils l'écrivent avec emphase, une nouvelle conscience de gauche !
Imaginons, au centre du désert de l'écriture jeune et jolie, hélas aussi peu sexuée que vertébrée, une Cécile Coulon, saluée un peu partout, y compris dans les librairies et les salles de rédaction, comme une jeune prodige cousine, pardonnez du peu, de Rimbaud, s'adresser à telle figure féminine, Simone de Beauvoir ou Marguerite Yourcenar pourquoi pas, et tentons d'apprécier ce que pourrait signifier le fait de sonder la profonde inanité des mots qu'elle leur adresserait, dans des phrases offrant avec les flans à la courge une similarité d'aspect et de saveur qui n'aurait rien de métaphorique.
Ce n'est pas tout, car il serait injuste de ne distribuer nos coups que sur certaines faces aussi molles qu'interchangeables, Édouard Louis n'étant finalement qu'une Cécile Coulon en pantalon plutôt qu'en jupe, à moins, diraient les mauvaises langues, que ce ne soit l'inverse.
Imaginons, à droite cette fois-ci et même : à droite de la droite moins buissonnière que putassière, Solange Bied-Charreton, que tel ami ô combien drôle et cruel dans ses fulgurances point toutes littéraires ne peut s'imaginer autrement que comme un insecte, un papillon plutôt commun, voletant dans la mondanité de droite selon ses termes, imaginons cette jeune femme au talent littéraire aussi développé qu'une antenne de charançon, et qui vient de témoigner d'un bel entêtement en faisant publier un troisième roman encore plus mauvais que les deux qui l'ont précédé, imaginons-la clamer son admiration vers quelque anti-modèle absolu, c'est-à-dire une femme belle, intelligente et talentueuse, Cristina Campo par exemple, et retenons-nous de rire aux éclats. D'abord, Solange Bied-Charreton ne sait rien de Cristina Campo car, si elle avait lu avec exigence une seule des pages coruscantes et magnifiques de l'auteur des Impardonnables, elle saurait, d'une évidence intime n'ayant point besoin d'être démontrée, qu'elle n'a strictement pas la force d'écrire, et encore moins le droit, et que dire du péché consistant à lui écrire, à elle, la magnifique Cristina Campo qui évoqua mieux que nulle autre la sprezattura, cette incandescence sereine à la jointure entre la chair et l'esprit, et que dire de cette énormité existentielle quand on s'appelle Solange Bied-Charreton, et que le moindre de vos propos est repris par tous les bécasseaux droituriers qui se contorsionnent pour comprendre les oracles que la pythie de foire lâche sur la vie politique française et, comme ils disent encore, les grands enjeux sociétaux ? Que lui dirait-elle, d'ailleurs, Solange, à Cristina, je vous le demande ? Que dirait Solange Bied-Charreton à Cristina Campo (ou bien, si vous la voulez laide mais tout aussi intelligente, à Simone Weil), que lui écrirait-elle qui dépasse la construction, pour le moins sommaire, qui caractérise la presque totalité de ses phrases, très originalement alignées en sujets-mouflons, verbes-chèvres et compléments aussi domestiqués qu'un mouton d'alpage helvétique ?
Je m'éloigne de mon sujet et me livre à des attaques bassement misogynes ? Notons que ces gentes demoiselles (Édouard Louis ne m'en voudra pas que je l'inclue dans ce charmant groupe) exigent d'être traitées comme les hommes, montrant d'ailleurs, il faut le préciser, un peu plus de courage que nombre d'entre eux. Ensuite, cette petite digression s'intègre parfaitement dans notre problématique d'ensemble : la disparition de tout jugement critique, l'amenuisement drastique de la qualité des romans imprimés en France, la réduction jusqu'à peau de chagrin du prestige, autrefois immense, de la littérature, l'annihilation possible sinon de moins en moins improbable de la France, le refus de s'appuyer sur le passé pour guetter, la main en visière, les dangers qui grondent, et nous permettre, d'ores et déjà, de déjouer ce qui se trame jour après jour sous nos yeux. Je n'en ai donc pas fini avec ces animalcules bavards, qui bien mieux que d'autres, qui jamais n'ont prétendu incarner le renouveau intellectuel d'une nation moribonde, illustrent mon propos !
Parler de Solange Bied-Charreton ou de sa version journalistique officielle, donc à quotient intellectuel minimal exigible, la très vaguement télégénique Eugénie Bastié, c'est presque aussitôt voir émerger à l'horizon de la fulminance apprivoisée la haute figure marmoréenne du Melmoth des sacristies et des confessionnaux, sorte d'Urbain Grandier portatif à effet garanti sur les dortoirs de filles bien sages, j'ai nommé, pardon : invoqué le trois fois consacré au saint-chrême, quoique coupé au Picon, Jacques de Guillebon, sorte de Gauvain de prétention donquichottesquement monté sur son coursier apocalyptique gonflable, bien évidemment réutilisable en cas de harangue improvisée dans une Fête à Neuneu(s) catholique(s). Celui-là, sans doute touché par le don de bilocation qui lui permet de chanter les vertus de deux ou trois poules et coqs de basse-édition en même temps, a la langue suffisamment déliée pour raconter n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce que l'on voudra et sur commande apostolique, sur n'importe qui, qu'il s'agisse du Christ ou de Marion Maréchal-Le Pen, de Gandhi ou de son ami Romaric Sangars, dont le prénom est aussi crânement francique que l'écriture est melliflue, fémininement douce, évasivement profonde, stochastiquement méchante, y compris lorsqu'elle feint de mordre. Il est vrai que, tout occupé à faire publier (pardon : «apporter», sic) la rinçure journalistique d'Eugénie Bastié au Cerf, sous le regard noir de Jean-François Colosimo qui a décidément beaucoup perdu de son acuité, le preux Jacques de Guillebon n'en est pas moins capable de saluer la daube surnuméraire de son ami à la coiffure plus savamment destructurée que la phrase, daube modestement intitulée Les Verticaux et publiée chez l'inénarrable (ne narrons point trop, son avocat veille) Léo Scheer, et qu'il sera n'en doutons point tout autant capable de chanter les mérites surnuméraires du dernier navet lacrymalo-guerrier de son ami Richard Millet qui, lui, a autant d'amis que peut en accueillir La Revue littéraire de son (nouvel) ami Léo Scheer, c'est-à-dire fort peu, mais à l'échine merveilleusement souple et au large cul adorateur de coups de pied. Inutile de préciser que Richard Millet, lui aussi, publie chez Léo Scheer, un éditeur dont nous pourrions presque deviner, j'y songe tout à coup, quel sera l'un des futurs auteurs. D'ici peu, Jacques de Guillebon va se prendre pour Claudel, lui qui se prend déjà pour Bernanos, et tenter de convertir aux vertus de la pauvreté christique celui qui, flairant le bon coup catéchétique, voudra le publier sans pour autant risquer d'être baptisé !
Imaginons encore un Marin de Viry qui fort heureusement n'a publié aucun livre depuis 2012, ou encore un Alexandre de Vitry, une ombre impossible à confondre avec la précédente et qui, lassée de son cinquantième colloque sur Philippe Muray, lui adresserait une dernière lettre, en forme d'hommage forcément (mais nous pouvons alors nous demander quelle sera cette forme), où ce percolateur de truismes relèvera l'inventivité lexicale de l'obsession anale développée par son mentor dans l'indigeste et sollersien Ultima Necat.
Imaginons une dernière fois, car le temps se fait long et surtout que je ne voudrais pas davantage m'égarer dans les sous-pentes du népotisme germano-sacristain à tropisme rebelle, cette théorie cliquetante et bavarde de fantômes sans talent, à laquelle nous pourrions joindre celle d'auteurs plus âgés, nullités à mouvement perpétuel (François Haenel et Yannick Meyronnis ou l'inverse, Antoni Casas Ros, Mathias Enard, etc.), pousser son refrain niais vers quelque grand écrivain (mais lequel qui soit encore vivant ?) qu'elle réduira à de mornes fadaises et sophismes confondants, pieusement repris par les journalistes du tout-Paris à prétentions littéraires, nous valant par exemple de grotesques comparaisons avec, nous avons vu cette obscénité, Balzac !
Gardons en mémoire, dans quelque recoin de notre cerveau dévolu aux distractions féroces, cette scène du plus haut comique, partons d'un grand rire qui suffira à dissoudre ces moucherons et revenons au Grand d'Espagne, le livre d'un gamin de 25 ans que nous savons d'ores et déjà condamné au désespoir, qu'importe qu'il le surmonte grâce à un livre écrit pour l'édification de personnes qui le liront avant même, qui sait, d'avoir atteint le sot et bel âge de 25 ans, puisqu'il sait, intimement, comme s'il s'agissait d'une image de notre époque qui se fût matérialisée devant ses yeux, qu'il était déjà presque impossible d'écrire comme cela à son époque, en 1945, et qu'il serait tout bonnement inconcevable de prétendre écrire comme cela à la nôtre, plus d'un demi-siècle plus tard, une paille temporelle, quoi, dans un pays qui, comme il l'écrivait, ne profite plus depuis longtemps déjà «de cette avenue que lui ouvre l'Histoire», car il «se passe une chose grave» voyez-vous, ne cesse de nous répéter ce gamin moins désespéré qu'en colère, il se passe que notre pays «ne croit plus en elle», et qu'il est donc pour le moins «assez vain d'invoquer l'union si l'on ne sait autour de quoi s'unir» : «Ici, chacun déborde d'une excellente volonté. Le désir d'être une grande nation, seul, fait défaut. En son absence tranche Nimier, il ne se fera rien» (p. 44). Il ne se fait plus rien de grand en France, nos hommes politiques, mais aussi notre lâcheté, ont en effet tranché.
Comment s'étonner que ce soit un texte consacré à Georges Bernanos qui, nous assure Roger Nimier, nous aura enseigné «l'autre chemin, celui de la perdition», qui pleure la disparition de la France en tant que grande nation ? Comment s'étonner que ce soit, dans cette situation-là qui est encore un peu plus la nôtre, vers Georges Bernanos, que nous tournions «nos visages» (p. 45) ? Comment ne pas comprendre que Roger Nimier, du haut de ses 25 ans, avait vu ce qui est désormais notre passé, notre présent et, n'en doutons pas, notre très pitoyable avenir ? Lisez-le, lisez l'outrecuidant Roger Nimier qui n'avait pas besoin de se targuer d'une chaire en futurologie, comme Alvin Toffler : «Il est plaisant de réclamer l'Europe à grands cris. Elle ne naîtra pas sans un centre, une volonté. Aujourd'hui, c'est le rôle de la France. Mais par un sentiment de modestie ou d'impuissance qui perd nos Européens, ils refusent à l'avance cette place magnifique et proposent de se fédérer autour du Grand-Duché de Luxembourg. Leur idée n'est pas que l'Europe sera plus forte, plus riche, plus menaçante au besoin. Ils veulent qu'elle soit faible et vaste, si vaste et si faible qu'elle attendrisse les nations de proie. Ils rêvent d'une immense Suisse, d'une bergerie universelle» (p. 44), alors que les hommes comme Roger Nimier, eux, n'ont toujours voulu à la France que «des victoires comme un jeune homme qui rêve de sortir au bras d'une maîtresse chargée de bijoux» (p. 43).
Si le «signe royal» de Georges Bernanos est «l'Intelligence» que Nimier prend le soin de distinguer du génie, «notion bien commode» qui «permet au moindre cuistre de dominer les grands hommes» (p. 37), c'est qu'il aura su, bien mieux que tout autre, dire «les vérités nécessaires» et casser «les vitres», un «air nouveau ven[ant] insulter les impurs», sans doute ces «quarante millions de Français» qui, «après avoir suivi aveuglément le Maréchal, se trouvaient avoir passionnément résisté» (p. 19). C'est aussi qu'il aura su, contre celui qui fut un temps son propre maître, Charles Maurras, être de «plain-pied dans le siècle et parmi les êtres». Si «l'univers de Maurras, privé de Dieu, exige néanmoins une transcendance d'idées qui maintienne la forme des choses», au contraire, «avec Dieu, Bernanos» sait que «la véritable transcendance est beaucoup plus haut et si elle veut bousculer l'Histoire, il lui suffit de changer les cœurs» (p. 24).
Changer les cœurs ! Admirable naïveté de Roger Nimier, qui fut aussi celle de Georges Bernanos, qui est celle de tout écrivain ne désirant pas écrire pour rire, comme le font tous nos contemporains, mais qui écrivent, comme le Grand d'Espagne, pour insuffler une vigueur nouvelle à «ces mots un peu décolorés : la sainteté, le génie» (p. 14), l'honneur et le courage aussi et, contre Maurras encore, afin de nous assurer de l'évidence selon laquelle «les hommes sont toute la qualité et le secret de l'Histoire» (p. 24) !
Si, au moment où Roger Nimier a vingt ans, la France a «tout perdu dans une bataille» et si, aujourd'hui, ce n'est même plus le déshonneur mais le ridicule qui nous annonce dans la vie, puisque les nains qui pullulent jamais ne préféreront «s'enfoncer dans l'oubli, remonter les marches du passé» (p. 13) comme l'écrit bellement Roger Nimier en parlant de ces éternels vieillards dont «un rire lent et fatal» est «le signe de la bouillie retrouvée» (p. 14), elle semble, aujourd'hui, avoir perdu davantage si c'est encore possible, bien que, hélas, Georges Bernanos, comme Charles Péguy, sont tripotés comme de vieux oncles à héritage par ceux que Roger Nimier nomme les «mainteneurs de l'esprit» et qui ne sont que des habiles et des agioteurs, petits professeurs d'université et petits intellectuels bouffis de suffisance, qu'un simple frémissement du cadavre dont ils pillent chaque atome suffirait à faire s'évanouir.
C'est encore contre les habiles et les agioteurs que Roger Nimier écrira d'autres textes recueillis dans ce livre, comme celui intitulé Le 7 février à l'aube qui lâche utilement des salves destructrices d'ironie, évoquant ainsi la ligne Maginot qui «avait cette propriété miraculeuse, qu'elle partageait avec les gaines élastiques, de vous donner une silhouette jeune et moderne, longtemps après l'âge». Mais jamais le ton ne sombrera dans la trivialité, puisqu'il reprendra vite une hauteur douloureuse, depuis laquelle Nimier se lamentera, comme seuls savent se lamenter celles et ceux qui jamais n'oublient l'enfant qu'ils ont été : «C'est une terrible pitié que de voir un peuple qui a besoin d'aimer et ne trouve rien pour satisfaire son amour» (p. 55), puisqu'il a perdu son idéal, nous assure l'écrivain, alors que nos ancêtres, eux, ne se torturaient pas pour le trouver puisqu'«ils l'avaient dans le sang ou, si l'on veut, à portée de la main, en chair et en os, ou en bois sculpté». La suite de cette page est superbe : «Sans doute, les hommes de l'ancienne France connaissaient-ils un grand nombre de lois; mais ils n'étaient pas perdus dans ces textes comme un écureuil dans sa cage, qui court, affolé, en croyant au progrès parce que le sol bouge sous ses pieds» (p. 56).
C'est au fond contre une Histoire privée de sa substance, envahie par les nains dont nous sommes loin d'avoir punaisé tous les représentants, contre un monde sans Dieu dans lequel «les foules modernes n'auront pas d'autres processions que les files devant les portes des cinémas» (p. 173) et, aujourd'hui encore plus qu'hier, devant les devantures de librairies où se pressent quelques imbéciles prodigues en dédicaces que Roger Nimier s'insurge, moquant les communistes qui ont remplacé le mystère par le secret du cachot et de la geôle sibériens. Ainsi, si les communistes ont le «sens du mystère», à la différence des socialistes, c'est parce qu'ils «l'arrosent de sang; par ce moyen délicat, ils gardent les fidèles en éveil» (p. 62), Nimier ajoutant qu'avec eux, «on en revient aux principes du despotisme éclairé. S'il n'est plus de Dieu pour châtier les méchants et suspendre au-dessus de leur tête sa Justice», alors il ne faut point hésiter à utiliser «la justice immanente qu'impose la terreur : toute faute est immédiatement punie et un bon communiste, après une erreur, préfère sans doute une balle dans la nuque aux embarras du repentir. Après tout, une balle dans la nuque, c'est une certitude, tandis que le pardon divin n'est qu'une promesse. Comme on le sait, les hommes détestent l'hésitation» (p. 63). Après tout, le communisme n'est-il pas lui aussi un «tonnant mélange d'enthousiasme et de police qui est le secret de tous les fascismes» (p. 88) ?
Dès lors, si Roger Nimier peut prétendre, sans point trop sourire, qu'il aime bien la morale, c'est parce qu'il réclame «un bon Dieu pour y croire» puisque, en effet, «fidélité ou blasphème, seul il permet de jurer» (p. 69) et surtout parce qu'il s'entête «à proclamer qu'une Justice humaine qui ne s'appuie pas sur une Justice divine (c'est-à-dire universelle) est une fameuse plaisanterie» (p. 70). Finalement, si les grandes actions sont désormais impossibles, il reste en revanche parfaitement possible, raille Nimier, «de lancer un mot historique avant de s'écrouler» (p. 71).
Les pages qui suivent ce texte, intitulée Les Girondins sont bernanosiennes à souhait, qui évoquent le fait «qu'un enfant ne laisse jamais humilier ses parents sans en tirer vengeance» (pp. 80-1) ou encore parlent de la honte, qui «ne sait rien sinon son visage et elle sait encore le reconnaître chez autrui» (p. 81) et se lamentent d'un passé devenu tout entier muséal, car il n'est plus considéré que comme «une histoire désinfectée et il est reconnu qu'on ne se bat plus pour venger la mort de Charlotte Corday» (p. 90).
Comment se battre pour des fantômes de fantômes qui ne soulèvent même plus les discours vils et fades des hommes politiques ? Nimier nous avertit, retrouvant une fois de plus un ton, et même une image typiquement bernanosiens : «Oh ! Il s'agit bien peu des personnes. Les personnes, dans la politique française d'aujourd'hui, voilà un mot qui ne s'emploie qu'au singulier et à l'indéfini. On pense plutôt à je ne sais quel marécage où l'eau affleure, avec des bulles, suivant certains courants obscurs» (p. 91).
Je parlais de désespoir surmonté : comment ne le serait-il pas, qui permet d'écrire de telles phrases ? : «La suite fut désagréable. Nous n'étions pas le Christ des Nations, mais un peuple occupé, qui pleurnichait sur ses malheurs. Il est très ennuyeux, très pénible, très humiliant, quand on s'est cru le nombril du monde, de n'être plus soudain que ses glandes lacrymales» (p. 95), comme si nos «raisons pour marcher sur Berlin n'avaient pas la force et l'ardeur juvénile que donne une place retenue dans l'avion de New York» (p. 97), comme si Sartre et Breton encore ne pouvaient que singer les hommes de parole et d'action que jamais ils ne furent (cf. pp. 100-102), Roger Nimier moquant la stupidité de l'une des phrases surréalistes les plus fameuses, la mettant en parallèle avec la sordide réalité des assassins : «Nous relisions, avant la guerre, ses Commandements : «L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule.» Eh bien ! oui. Les Allemands se sont livrés à toutes sortes d'exercices de ce genre et le hasard n'y manquait pas non plus» (p. 102).
«Il se prépare en Europe un trouble beaucoup plus considérable» que «l'infortune des nègres américains» : «c'est la fin de la France» (p. 105), écrivait Roger Nimier à une époque où l'emploie du mot «nègre» n'était pas susceptible de vous conduire devant un juge, car ce «monde podagre» (p. 123) n'est qu'un simulacre de vitalité, de bonheur et de progrès : «Nos amis sont morts. Nos espoirs vite reniés. Ceux qui rêvaient à l'ordre nouveau connaissent la fraternité des ruines, le déchirement des nations pauvres et les seuls Européens du siècle dans la personne des cadavres sur les décombres» (p. 125), tandis que d'autres «supplient l'Histoire de les exaucer en raison de leurs bonne vie et mœurs, comme un impuissant qui réclamerait un enfant de sa femme parce qu'il a écrit des brochures sur la natalité» (pp. 125-6), et que bien de ceux qui ont commencé leur carrière littéraire par des «déclarations incendiaires», maudissant l'humanité, parlant «des charmes de la folie, du silence», insultant les patries («c'est le bon moyen pour qu'elles nous entretiennent un jour», ajoute malicieusement Nimier), n'en feront pas moins, et très vite, «le voyage de l'anarchie à l'ordre» (p. 133). Rien n'a changé, et nous attendons sereinement le jour où tous les Romaric Sangars et les Jacques de Guillebon, où toutes les Eugénie Bastié et les Solange Bied-Charreton écriront, mais pour Le Figaro ou Valeurs actuelles, des éditoriaux aussi creux que leurs reins et leur cervelle. Comme un monde faux pourrait-il enfanter autre chose que des lémures, des ersatz de force, des enfants morts-nés à la force et au verbe ?
La génération de celles et ceux qui ont vingt ans en 45 a ainsi hérité de «la fatigue des voyages, du désespoir après l'action, si l'action déjà n'était pas inventée pour sortir du désespoir» (p. 135), à présent que «la force a perdu la moitié de son prestige» et que la génération de Nimier, qui évoque par exemple «cet animal de Boutang» alors un peu plus âgé que l'écrivain (p. 139), en parle «surtout par politesse, pour faire enrager les amis du Droit et de l'Impuissance réunis» (p. 143), même si, acte de foi ou bien ironie glaciale à laquelle il ne croit même plus lorsqu'il évoque l'essor d'une «sorte de nouveau classicisme» (p. 145), «Nous sommes parmi quelques miroirs où la jeunesse d'aujourd'hui tente de se reconnaître, puis de se ressembler un peu mieux» (p. 144). Pour être tout à fait franc, il n'est plus du tout certain que, à «vingt ans», le monde soit désormais «un entrelacement de sources où chacun n'a qu'à puiser" (p. 179), comme nous le confirme la lecture du texte bouleversant qui clôt notre recueil, intitulé Lettre d'un fils à son père, où Roger Nimier évoque un «triste empire aux yeux creux, vieux rêve dont le fard empeste, ce pays, ce cadavre échoué sur une plage, attend et nous retient. Ses prestiges sont morts. Ses charmes fanés. Que reste-t-il ?» (p. 199), sinon appeler de nos vœux l'heure où nous saurons, comme la nature, «glorifier nos déchets», et d'entrer, sans trop nous révolter, dans le «règne minéral de l'esprit» (p. 201), puisque «l'insolente race française» qui pendant des siècles a imposé «sa logique, son langage, sa force», n'a désormais tout simplement plus «la force de supporter ses souvenirs» (p. 202) ? La dernière farce du démon est de donner l'occasion, aux cuistres grandiloquents qu'il taraude d'un rêve de grandeur avortée, l'occasion inespérée de se plaindre contre la médiocrité de l'époque : cela aboutit à peu de chose, un éjaculat trouble qui ne donnera au mieux naissance qu'à une moitié de créature contrefaite, un livre verbeux intitulé Nous sommes les enfants de personne que tout le monde, même son éditeur, semble avoir oublié.
Que nous reste-t-il ? Rien de plus qu'un plaisir hagard, plus solitaire qu'on ne le pense, picoré auprès d'une «petite merveille» «blonde, éméchée», «avec un visage d'ingénue bronzée et une cape de fourrure grise» (2), rien de plus que quelques mots à majuscule (3) qui seront employés par des «hommes de bronze», des «hommes de plâtre» faits de «la substance dont on fait les statues dans les jardins publics», fils et père réunis «dans un commun mépris», puisque «ceux-là n'étaient pas vos cadets», et qu'ils ne sont pas davantage les aînés de Nimier qui appartient, mais moins que nous, à une «génération fœtus, engendrée par mégarde, enflée de son propre hasard» (p. 207).
Que nous reste-t-il ? Rien sinon lire et relire les dernières phrases du livre de Roger Nimier, avant de rêver aux maigres possibilités d'une renaissance, puis les rejeter car elles supposeraient que soit défait tout le mal qui a été fait, en France, depuis quelques lustres à l'éducation, aux arts, aux esprits, aux âmes même : «Si nous ne trouvons pas cette civilisation, cet état de grandeur durable où chacun peut aller un peu plus loin parce que les autres ont déjà fait une partie du chemin à sa place - alors nous irons au plus pressé; pour sortir de cette angoisse, nous retournerons dans la guerre. Car les religions modernes, malgré leur emphase et leurs inquisiteurs nombreux, pèchent par un détail : elles ne sont pas révélées. Leur assurance ne les garde pas d'un doute obscur. Personne ne se fait tuer pour le cinéma, l'hygiène ou les élections cantonales. Voilà l'erreur. Sans martyrs, les religions clament leur peine et ne savent pas vivre. Leur hésitation les oppose. C'est un grand vacillement des vérités ivres mortes. Dans ce temps-là s'avance la jeune barbarie et la seule réponse à tant de questions se nomme la guerre. Dans la guerre, on se sacrifie tout à son aise. Une morale sévère, un ordre, un culte de tous les instants s'imposent aux hommes. Cette conviction est une chose d'importance, au cœur de chacun – et qui saigne pour un faux mouvement» (pp. 209-10).
Eh bien, nous y sommes, désormais, et ce ne sont pas les petits raouts où les médiocres que j'ai évoqués plus haut, ces enfants de personne, filtrent leur ennui apeuré, entrelèchent leurs petits népotismes et lampent de maigres gorgées d'héroïsme, de pensée et de force, qui pourront nous persuader du contraire.
Notes
(1) Roger Nimier, Le Grand d'Espagne (Éditions de la Table Ronde, 1950, puis Gallimard, coll. Folio, 1997), p. 46.
(2) Occasion de l'une des plus étonnantes définitions de la Collaboration que je connaisse : «quand elle a quitté l'autobus j'ai failli la suivre», ce qui n'aurait rien apporté à l'auteur qui conclut : «En tout cas, je n'ai pas supporté d'aller retrouver une femme beaucoup moins jolie, qui m'aimait. C'est en cela que je ne serai jamais vichyssois» (p. 205).
(3) «Quand la majuscule du mot liberté fut à son comble, alors commença l'oppression» (p. 205).





























































 Imprimer
Imprimer