« Histoire d'un Allemand de Sebastian Haffner | Page d'accueil | Henry Darger, juge des adultes et génie des enfants, par Gregory Mion »
07/01/2016
Les Réprouvés d'Ernst von Salomon

Photographie (détail) de Juan Asensio. Philippe-Auguste Jeanron, Décollation de Saint-Jean Baptiste, Musée de la vie romantique.
«[...] car seul un cadavre ne réagit plus contre les vers qui le rongent.»
Thomas Molnar, La contre-révolution (10/18, 1972), p. 193.
Citant Franz Schauwecker, Ernst von Salomon rappelle en exergue de son magnifique roman (1) que le sang et la connaissance doivent coïncider pour faire surgir l'esprit. Je ne sais de quel esprit il s'agit, même s'il me semble être assez visiblement hégélien, mais il est en tout cas évident que la littérature, elle, peut surgir de ce mélange, comme le prouve par exemple l’œuvre protéiforme d'Ernst Jünger.
Au départ, tout est confusion, car il n'y a alors (nous sommes en 1918) plus de «victoires, maintenant les drapeaux avaient perdu leur radieuse signification, maintenant, à cette heure trouble où tout s'écroulait, la voie à laquelle j'avais été destiné était devenue impraticable, maintenant je me trouvais, sans pouvoir m'en saisir, en face de choses nouvelles, en face de choses qui accouraient de toutes parts, de choses sans forme, où ne vibrait aucun appel clair, aucune certitude qui pénétrât irrésistiblement le cerveau, sauf une pourtant». Tout semble jeté à terre, détruit, et c'est sur la confusion, sur la destruction des anciennes certitudes que va souffler un vent nouveau. Voici la suite immédiate de notre extrait, rappelant qu'il demeure une seule certitude : «celle que ce monde où j'étais enraciné, que je n'avais eu ni à accepter ni à adopter nous dit le narrateur, et dont j'étais une parcelle, allait s'effondrer définitivement, irrévocablement, et qu'il ne ressusciterait pas, qu'il ne renaîtrait jamais» (pp. 16-7).

La confusion, immédiate, évidente, partout visible, ferment d'actions et de songes d'action, est la première des caractéristiques de l'époque que décrit Ernst von Salomon, comme en témoignent ces lignes : «Des croyants appartenant à toutes les classes de la société [se] réunissaient [dans des associations patriotiques]. Partout c'était le même tohu-bohu d'opinions et de gens. Tous les lambeaux et les débris des valeurs d'autrefois, des idéologies, des confessions et sentiments qui avaient été sauvés du naufrage s'entremêlaient aux mots d'ordre attrayants, aux demi-vérités du jour, aux aperçus imprécis, aux divinations exactes et tout cela formait une pelote, perpétuellement en rotation et d'où s'échappait un fil dont mille mains empressées s'emparaient pour tisser une tapisserie d'une diversité de couleurs déroutante» (p. 188).
Les cendres de l'ancien monde sont encore chaudes, que le héros de notre roman devient une espèce de loup, ivre de liberté, et à l'abri, dirait-on, de cette camaraderie des masses que Sebastian Haffner, dans son Histoire d'un Allemand, a rendu responsable des plus grands malheurs de l'Allemagne, la perte de toute conscience individuelle, la fusion dans la masse aveugle, prête à écouter les chants de guerre, à être éblouie par les spectacles grandioses orchestrés par les pyrotechniciens nazis : «La désagrégation de l'ancien ordre jointe au déchaînement des convoitises et des désirs les plus profonds, les plus secrets, et au relâchement de tous les liens, faisait que tous s'éloignaient les uns des autres et il ne semblait plus nécessaire à personne de dissimuler le véritable fond de son être. Chacun était subitement seul en face de lui-même et ne pouvait plus être apprécié que séparément; toute amitié devenait impossible» (p. 25). Il est vrai que, d'un bout à l'autre de ce long roman qu'est Les Réprouvés, et même si plus d'une fois le narrateur a des compagnons d'arme, il reste invinciblement seul, ne se laissant bercer par aucun discours lénifiant, n'appartenant à aucune coterie, allant faire le coup de force là où il sait que son courage sera nécessaire.
Il n'est pas étonnant que les premières pages du roman d'Ernst von Salomon paraissent vibrer d'une attente qui, pour imprécise qu'elle semble être, n'en est pas moins réelle et violente, puisqu'elle concerne, d'abord, le langage qui, après tout, Cormac McCarthy l'illustrera dans La Route, doit être, ne peut qu'être la première fondation sur laquelle bâtir, après l'effondrement : «Je voulus apprendre à aimer la révolution; ses énergies peut-être n'étaient pas encore éveillées. Peut-être les marins n'attendaient-ils que le Mot», attente qui ne peut qu'être le corollaire d'un dégoût à l'endroit d'autres mots, des mots qui ne sont que trop connus du narrateur, «des mots usés, remâchés et mille fois entendus» (p. 31), des mots tels que patrie, peuple, nation qui «sonnaient faux» (p. 42). D'où pourrait donc venir ce Mot, qui pourrait le prononcer (cf. p. 243), de quelle région où se joue, semble penser le narrateur, l'avenir de l'Allemagne et peut-être plus que cela, une certaine conception de l'homme ne servant ni Dieu ni maître, débarrassé comme un nouvel Adam de ses peaux mortes, tout entier plongé dans l'ivresse du sang qui coule ? Et de quel creuset sont donc revenus ces hommes au regard vide que contemple, sidéré, le héros du roman ? : «Encore de l'infanterie. Non, ils ne voulaient rien savoir de nous. Ou bien l'horreur était-elle toujours dans leurs yeux, serrait-elle toujours leurs gorges, la guerre ne les avait-elle pas encore rendus à eux-mêmes ? Ils venaient directement du front, ils venaient de régions que nous ne connaissions pas, desquelles nous ne savions rien; ils venaient d'une terre qui était brûlante comme un creuset dans lequel ils auraient été fondus, calcinés, purifiés, ils venaient d'un monde qui ne ressemblait à nul autre» (p. 40), le monde que ce même narrateur ira rejoindre, dont il rejouera le drame sur plusieurs théâtres d'opération.
Ce monde, c'est celui qu'Ernst von Salomon croira trouver dans les Freikorps, faisant le coup de feu en Baltique et en Haute-Silésie, en participant à l'assassinat de Walter Rathenau, considéré comme l'incarnation de l'humiliation allemande au sortir de la Première Guerre mondiale. Ce monde, nous ne savons si c'est celui qui a pu entendre ce fameux Mot évoqué plusieurs fois dans le roman et auquel l'action doit «préparer le chemin» (p. 196), mais c'est en tout cas celui qui ne supporte plus les vieux mots usés je l'ai dit, l'Allemagne pleine de «chants et de paroles, mais qui sonnaient faux» (p. 70), une fois de plus. Il est ainsi frappant de constater que la situation pour le moins chaotique de l'Allemagne de ces années-là s'explique en partie, selon l'auteur, par un verbe dévalué, par des slogans creux, une presse aux ordres ou bien mensongère, qui accentue le sentiment d'irréalité (cf. pp. 143, 215 et 402). Karl Kraus n'a jamais affirmé autre chose !
C'est contre cette irréalité ou plutôt ce sentiment d'irréalité bien davantage que de désordre lequel, au moins, peut faire naître la nouveauté, que va vouloir lutter le narrateur, qui croit «aux instants où toute vie se trouve ramassée» et «au bonheur d'une prompte décision», seule capable de couper «tous les liens qui nous attachaient, poursuit l'auteur, à un monde corrompu, un monde à la dérive, avec lequel le véritable guerrier ne pouvait plus rien avoir en commun» (p. 76). Mieux vaut encore la guerre et l'aventure, la «sédition et [la] destruction et dans tous les recoins de nos cœurs une pression inconnue, torturante qui nous poussait sans relâche !» (p. 79) que de suivre la masse prête au déshonneur, d'écouter les délibérations à Paris et les «bavardages de Weimar» (p. 95). Si la «résignation est l'ennemie de tout mouvement», c'est parce que le «chaos est plus favorable au devenir que l'ordre» et qu'il faut craindre dès lors de sauver «la patrie du chaos», puisque ce serait fermer «la porte au devenir» et ouvrir «les voies à la résignation» (pp. 106-7). C'est encore parce que «c'est bien du chaos» que surgit la nouveauté, «à ces moments où la misère rend la vie plus profonde, où, dans une atmosphère surchauffée, se consume ce qui ne peut pas subsister et se purifie ce qui doit vaincre» (p. 189). Le nihilisme évident (2) de ces déclarations dont la plupart sont très, voire trop lyriques (3) ne doit pas masquer le fait essentiel qu'illustrent Les Réprouvés : seul l'homme libre est vivant, qu'importe qu'il fasse le coup de feu si sa lutte lui permet à tout le moins de desserrer l'étau des mensonges, et de faire triompher non pas le règne de l'idée, mais, pour commencer, celui de la force, de l'élan vital qui le meut hors de l'inertie des sépulcres blanchis : «Un drapeau de fumée marquait notre chemin. Nous avions allumé un bûcher où il n'y avait pas que des objets inanimés qui brûlaient : nos espoirs, nos aspirations y brûlaient aussi, les lois de la bourgeoisie, les valeurs du monde civilisé, tout y brûlait, les derniers restes du vocabulaire et de la croyance aux choses et aux idées de ce temps, tout ce bric-à-brac poussiéreux qui traînait encore dans nos cœurs» (p. 127).
Il s'agit de trouver «une nouvelle réalité», hic et nunc, en bâtissant un pont qui pourrait y conduire ces hommes (cf. p. 132), même si l'époque de la reconstruction est encore une lointaine chimère, car «les matériaux ne valaient rien et le sol tremblait» (p. 136), même si les réprouvés auxquels Ernst von Salomon appartient ne sont pas capables de proférer, étonnante vérité que l'on dirait proférée par Georges Bernanos, autre chose que «le désespoir qui jamais ne s'exprime dans un langage articulé» (p. 137), même si encore, comme je l'ai dit, seule l'action recherchée pour elle-même, la «marche vers l'incertain» (p. 145) et l'abolition de la raison (4) ont du sens aux yeux de nos proscrits. Bien évidemment, un tel mouvement ne peut que mourir de sa fin, plus ou moins belle, car le plus farouche des nihilistes ne saurait toute sa vie n'être animé que par le pur mouvement de l'action recherchée pour elle-même. C'est d'ailleurs le sens des propos de l'auteur lorsqu'il évoque ce que devrait être une «révolution nationale», c'est-à-dire, stricto sensu, la «révolution pour la nation», laquelle présuppose, après «l'assaut des barricades» et le constat d'échec qui en découle, la «révolution de l'esprit» (p. 171) qui seule permettra de balayer les anciennes élites, point disparues, hélas, et toujours prêtes à s'emplir comme des outres gonflées de mots creux de nouveaux slogans qui attacheront un peu plus l'homme à son impuissance moderne : «Nous avons perdu la guerre sous l'ancienne élite. Puisque la nouvelle est la même que l'ancienne, qu'elle n'a fait en somme que jouer aux quatre coins, qu'elle emploie le même vocabulaire, qu'elle est soumise aux mêmes conditions et tenue aux mêmes engagements, cette élite, il me semble, ne peut pas non plus nous dédommager pour la perte de la guerre» (p. 169). Bernanos, encore une fois, le vieux lion revenu de tout et, en premier lieu, du front où les mots menteurs fusaient comme des balles traçantes.
Il est ainsi grand temps, puisqu'ils sont tout près de sombrer dans le marécage de l'action devenue folle, n'ayant d'autre but que d'amasser des images, des sensations, des ivresses proscrites, il est grand temps que les réprouvés se muent en conjurés, acceptent de se mêler des affaires de la société un peu plus profondément qu'en essayant d'en accroître le désordre et d'abord, à l'instar du narrateur estimant que cette voie est la seule possible à terme sinon souhaitable, qu'ils rebâtissent les conditions de l'émergence d'une nouvelle culture. Cette renaissance, bien plus que naissance ex nihilo, vieux rêve criminel des dictateurs, ne peut pourtant que s'appuyer sur les outils eux-mêmes de l'ancien monde, les livres bien sûr : «Il arriva donc que livré à la monotonie matérialiste de ce monde banal, seul en face du rythme inconnu et entraînant d'une vie en apparence complètement insensée et pourtant réglée par un mécanisme inexorable, je recourus d'abord à ce qui autrefois m'avait donné la première notion de l'existence, c'est-à-dire au livre» (p. 177). L'idéal tant de fois caressé d'un homme de guerre qui serait aussi un prince de l'esprit est souligné par le biais d'un des personnages, un certain Heinz, évoqué d'un trait stylistique au moins aussi précis que l'aptitude au tir dudit guerrier : «Il faisait des sonnets parfaits et mettait dans l'as de cœur à une distance de cinquante mètres» (p. 190). D'ailleurs, l'une des plus extraordinaires invitations à la lecture du Rouge et le noir nous est donnée par l'auteur lorsque, emprisonné, il tente de briser le cercle maléfique de sa solitude en tentant d'obtenir, à force de demandes, la permission (qu'il n'obtiendra pas) de lire le fameux roman de Stendhal (cf. le chapitre intitulé, ironiquement, Guérilla, pp. 375-85).
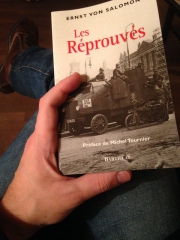 Cette renaissance, ne nous y trompons pas, ne saurait être seulement celle de quelque solitaire anarque ou bien d'un gouvernement de rois philosophes à la sagesse impénétrable, comme nous le voyons dans plusieurs romans de Jünger, dont Héliopolis. Cette renaissance, c'est encore et toujours la force qui va prétendre la faire advenir, et d'abord par la liquidation des vieux symboles des élites, comme Walter Rathenau, dont le livre enthousiasme pourtant l'auteur, lequel n'arrache à un des conjurés, Kern, que ce mot superbe : «Tant d'étincelles et si peu de dynamite» (p. 196). De sorte qu'il est assez difficile de comprendre quel est le sens politique profond de la lutte de nos conjurés qui, comme le dit le narrateur, sont «plus mûrs pour la mort que pour la vie» (p. 224), comme si décidément une époque (en apparence du moins) aussi statique que la nôtre ne pouvait comprendre ces «êtres dynamiques dans une époque dynamique et qui ne pouvaient être jaugés qu'avec des mesures dynamiques» (p. 239), comme si chacun des actes de nos réprouvés, gagnant «des victoires d'où la gloire est absente» (p. 269) et condamnés à ne jamais voir les fruits politiques de leur geste aventurière et sanglante, ne pouvaient finalement qu'ébranler «profondément les charpentes des systèmes», et miner «le nouvel édifice social laborieusement construit» (p. 267). La renaissance politique sera pour plus tard, puisque semble primer sur celle-ci le façonnage, physique, intellectuel et spirituel de l'homme, non point dans les geôles de quelque démocratie populaire toute pressée de faire naître du cloaque de ses camps de rééducation l'homme communiste intégral, mais par le feu d'une vie solitaire, dangereuse.
Cette renaissance, ne nous y trompons pas, ne saurait être seulement celle de quelque solitaire anarque ou bien d'un gouvernement de rois philosophes à la sagesse impénétrable, comme nous le voyons dans plusieurs romans de Jünger, dont Héliopolis. Cette renaissance, c'est encore et toujours la force qui va prétendre la faire advenir, et d'abord par la liquidation des vieux symboles des élites, comme Walter Rathenau, dont le livre enthousiasme pourtant l'auteur, lequel n'arrache à un des conjurés, Kern, que ce mot superbe : «Tant d'étincelles et si peu de dynamite» (p. 196). De sorte qu'il est assez difficile de comprendre quel est le sens politique profond de la lutte de nos conjurés qui, comme le dit le narrateur, sont «plus mûrs pour la mort que pour la vie» (p. 224), comme si décidément une époque (en apparence du moins) aussi statique que la nôtre ne pouvait comprendre ces «êtres dynamiques dans une époque dynamique et qui ne pouvaient être jaugés qu'avec des mesures dynamiques» (p. 239), comme si chacun des actes de nos réprouvés, gagnant «des victoires d'où la gloire est absente» (p. 269) et condamnés à ne jamais voir les fruits politiques de leur geste aventurière et sanglante, ne pouvaient finalement qu'ébranler «profondément les charpentes des systèmes», et miner «le nouvel édifice social laborieusement construit» (p. 267). La renaissance politique sera pour plus tard, puisque semble primer sur celle-ci le façonnage, physique, intellectuel et spirituel de l'homme, non point dans les geôles de quelque démocratie populaire toute pressée de faire naître du cloaque de ses camps de rééducation l'homme communiste intégral, mais par le feu d'une vie solitaire, dangereuse. Rien à faire, la race d'hommes à laquelle le narrateur appartient est condamnée à être toujours déçue et trahie, y compris par Dieu qu'elle craint de ne même pas reconnaître, si d'aventure Il daignait Se montrer : «Si tu le sais, dis-moi par quel bout nous devons saisir le manteau de Dieu, s'il vient à passer près de nous ?» (p. 271), parce qu'elle ne sert au fond qu'une seule idole : la force, car aucun «peuple qui veut se réaliser jusqu'à la limite de sa force ne renonce à la prétention de dominer aussi loin qu'il peut s'étendre» (ibid.), force qui n'est donc qu'un autre nom pour la volonté de puissance évoquée par Nietzsche (l'auteur parle, lui, de «volonté pressante de l'époque», pp. 407-8), qu'importe après tout que le narrateur pense y reconnaître «du socialisme dans sa forme la plus pure, dans la forme prussienne», à savoir un «socialisme sur tous les plans, non seulement un socialisme qui brisera la tyrannie des lois économiques par la plus intime des cohésions, par le sacrifice le plus complet à la totalité allemande, mais encore un socialisme par lequel nous retrouverons aussi la tenue intérieure, l'unité spirituelle, dont le XIXe nous a frustrés» (pp. 274-5) (5).
Rien de surprenant, dès lors, si les réprouvés se considèrent d'abord comme des révolutionnaires, qui ne connaissent pas «le fardeau des plans, des méthodes et des systèmes», puisqu'ils se contentent «de faire le premier pas, d'ouvrir la première brèche», et qu'ils devront donc «disparaître au moment où [leur] tâche sera accomplie», tâche qui ne consiste pas à gouverner mais à «donner l'impulsion» (p. 280), toujours et encore, en dépit des échecs, des errances, des trahisons, des emprisonnés, des tués. En somme, nos réprouvés sont des mercenaires et, en l'occurrence, des mercenaires qui semblent étrangement peu se préoccuper des menées d'Hitler, mentionné en une seule ligne dans notre roman (cf. p. 283).
Roulant à vide, entraînés dans une logique délétère qui peine à se pavaner sous des atours que l'auteur veut somptueux, les réprouvés, devenus conjurés, finiront criminels ne reculant «devant aucune conséquence de [leurs] actes et de [leurs] pensées» (p. 345) (6), criminels mais toujours insoumis, comme le rappelle l'exergue empruntée à Jünger de la troisième et dernière partie du roman d'Ernst von Salomon. C'est toujours le même lyrisme (7), qui ouvre ces pages (cf. p. 307), puisque l'auteur insiste sur la liberté absolue de nos personnages réprouvés assimilés à des opprimés mettant «toute chose, toute valeur au service de la lutte contre la servitude» (p. 318), liberté totale, à vide dirions-nous, qui ne peut que les amener à se heurter à une époque déclarée veule et soumise, enchaînée. Pourtant, ils se prétendent des «pionniers du renouvellement [qui] trouveront le champ libre et verront derrière eux les masses qui donneront à leur victoire sa pleine signification» (p. 328), alors même qu'ils n'hésitent pas à se dire désespérés : «Nous avons perdu la pudeur, nous sommes d'une insupportable arrogance, même envers ce qui jusqu'alors avait une valeur pour nous; nous avons perdu tout contact avec les choses, nous ne voyons plus aucune ligne droite et plus aucun fait tel qu'il est», le narrateur concluant ses propos par : «Ah ! mon vieux, si au moins nous savions prier !» (p. 366).
Mais il ne sait pas, visiblement, prier, mais ils ne savent pas prier, et il faut tout recommencer car le monde ancien honni «était toujours là qui vivait dans le dégoût de lui-même» et, comme l'admet le narrateur, même «si le monde des réprouvés avait disparu», «la Tâche restait», ce qui signifie que le réprouvé est un idéaliste, le dernier des idéalistes peut-être, qui doit continuellement se lever contre le pouvoir, toute forme de pouvoir, aussi peu contraignant en apparence fût-il, parce qu'il est qualifié «d'illégitime, car il s'appuyait sur une hiérarchie des valeurs dictée par les besoins des hommes et non pas sur cette force éternelle et plus profonde qui aurait dû primer tous les besoins des hommes» (p. 408).
Serviteur de la force, homme libre abhorrant les foules (cf. p. 416, le dégoût du narrateur au moment de sa libération de prison), le réprouvé est le dernier des naïfs, attentif aux tensions «qui ne pouvaient [lui] permettre d'échanger des chaînes contre d'autres et qui [le] poussaient à sortir de l'inertie pour [s]'élancer dans l'espace infini, dans la joie, dans la dureté, dans les choses qui sont au-dessus des mots» (p. 420). Mais, au moins, il n'a pas craint de risquer sa vie pour nous montrer quelle est la profondeur de cette naïveté, que jamais nous ne pourrons confondre avec l'ironie des nantis, des veules, des lâches.
Notes
(1) Ernst von Salomon, Les Réprouvés (Die Geächteten, 1931) (traduit de l'allemand par Andhrée Vaillant et Jean Kuckenburg, Bartillat, 2007), p. 13.
(2) Nihilisme et exaltation de la force pure, égale au désespoir (cf. p. 137) qui plus d'une fois m'a fait songer à l'atmosphère de fin du monde baignant Méridien de sang de Cormac McCarthy : «Car nous buvions ferme et le lieutenant Kay avait par nature une voix très perçante. «Nous sommes dressés contre le courant de l'époque, criait-il, et nous sommes une camarilla militaire assoiffée de sang qui suce le peuple jusqu'à la moelle des os et qui lui bourre le crâne.» Et il avalait précipitamment de larges cuillerées de grog. «Les générations futures nous demanderont : "Qu'est-ce que vous avez fait ?" Eh bien, nous répondrons que nous avons remué du sang. Car l'âme est la vapeur du sang et le sang bouillait et la vapeur montait et nous n'avons pas cessé de remuer. Alors les générations futures diront : "C'est très bien, vous aurez un bon point." Mais ces bourgeois qui sont assis là devant nous, gras et satisfaits [...] à eux aussi on posera la question et ils répondront : "Nous nous sommes servis du sang pour faire une bonne soupe épaisse et bien digestive et c'était rudement bon !"... Et les générations futures leur diront : "Zéro, asseyez-vous."» (p. 134).
(3) Ce genre de passage étant très commun dans le roman d'Ernst von Salomon, je me contenterai de n'en citer qu'un «Nous ne pouvons plus nous sentir engagés envers la patrie, parce que nous croyions ne plus pouvoir la respecter. Nous ne pouvons plus respecter la patrie parce que nous aimions la nation. Ce n'était plus un commandement qui maintenant nous réunissait, ce n'était plus la solde, le pain et la chaude haleine de la patrie qui nous liait. Une contrainte que nous ne sentions qu'obscurément nous poussait, une loi nous fouettait dont nous ne voyions que l'ombre. Maintenant nous étions dans le tourbillon fou du danger. Maintenant nous étions dans un nouveau champ de force, nous possédions d'autres espoirs, nous étions débarrassés du fardeau des misérables nécessités qui jour par jour, pas à pas allaient encercler des millions d'êtres affamés dans des mailles tissées par la malice la plus raffinée. Nous les dispersés, les réprouvés, les gueux sans patrie, nous portions haut nos flambeaux» (p. 111). Notons que l'auteur ne sépare jamais la condition de réprouvé d'une existence libre, quasiment celle d'un de ces adeptes du millénarisme qui n'hésitèrent pas à piller, violer et tuer au cours des âges, en tout cas essentiellement proche de celle d'hommes ayant comme lui choisi la lutte armée, même s'ils appartiennent à l'autre bord, bolchevique, avec lequel d'ailleurs les frontières sont très poreuses.
(4) Je me suis exprimé trop vite, car il ne s'agit pas d'une abolition de la raison, mais plutôt du soupçon que cette dernière ne sait pas grand-chose, et ne sert à pas grand-chose non plus, voire à rien du tout. Du coup, l'auteur affirme que sa démarche ne saurait en aucun cas être qualifiée de réactionnaire (cf. p. 146). Pourtant, force est de constater qu'une démarche refusant le progrès peut à bon droit être qualifiée comme une réaction. D'ailleurs : «Il y avait là quelque chose qui voulait vivre d'une vie plus résolue. Un grand nombre d'hommes étaient sans patrie, beaucoup se sentaient encore dépourvus d'une mesure d'évaluation, beaucoup étaient prêts à reconnaître que de nouvelles vertus avaient besoin pour croître d'un nouveau sol et que les désirs les plus profonds ne pouvaient plus se réaliser par le seul progrès» (p. 186).
(5) Le narrateur, plus d'une fois, rapprochera et opposera les luttes des corps francs et des communistes, les premiers thuriféraires de «la lutte des êtres solitaires, qui justement dans leur isolement ressentaient la joie d'une union plus entière et qui pouvaient, pour cette raison, faire une brèche plus profonde que tous les assauts des déshérités ne le pourraient jamais» (p. 324).
(6) Ernst von Salomon renverse d'ailleurs l'acception traditionnelle du criminel qu'il magnifie lorsqu'il écrit, visant les autres prisonniers enfermés dans sa prison, et qui ne sont que des «bourgeois jusqu'aux dernières conséquences [puisqu'ils] aimaient leur confort, ils étaient attachés à l'ordre, ils avaient une crainte mesquine devant chaque décision à prendre» (p. 345) : «Pourtant il me semblait que la marque même du crime consiste en ce qu'il vise la destruction de l'ordre existant, et non pas en ce qu'il est un essai de s'y faire une place par des moyens illicites» (p. 346). Finalement, aux yeux du narrateur, seul celui qui a accepté le risque de se faire tuer, qui s'est sacrifié, a le droit de se dire criminel, et non pas les hommes qui «ne courent aucun danger» et «ne portent aucune responsabilité» (p. 363).
(7) Ainsi les hommes avec lesquels le narrateur combat sont-ils rapprochés de l'exemple des réprouvés des sagas de l'Islande (cf. p. 396).






























































 Imprimer
Imprimer