Septembre éternel de Julien Sansonnens (10/01/2022)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
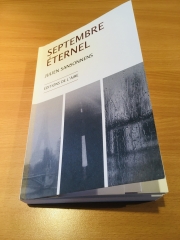 Il se pourrait bien que le véritable roman de Michel Houellebecq ne soit pas celui que l'on pense, Anéantir encensé jusqu'à l'orgasme libératoire par les habituels podagres faisant office de critiques littéraire qui continuent, bien des années tout de même après Extension du domaine de la lutte, à se demander gravement si le romancier français vivant le plus célèbre du monde a un style, une écriture digne de ce nom, lui qui n'en a guère ou même : pas du tout, et que, en lieu et place d'une énième variation chlorotique autour des thèmes habituels prisés par l'auteur de Sérotonine, il nous faille désigner Septembre éternel, le quatrième roman de Julien Sansonnens publié aux éditions de L'Aire (1), comme un roman assez convaincant de Michel Houellebecq, et même, comme un roman digne d'attention.
Il se pourrait bien que le véritable roman de Michel Houellebecq ne soit pas celui que l'on pense, Anéantir encensé jusqu'à l'orgasme libératoire par les habituels podagres faisant office de critiques littéraire qui continuent, bien des années tout de même après Extension du domaine de la lutte, à se demander gravement si le romancier français vivant le plus célèbre du monde a un style, une écriture digne de ce nom, lui qui n'en a guère ou même : pas du tout, et que, en lieu et place d'une énième variation chlorotique autour des thèmes habituels prisés par l'auteur de Sérotonine, il nous faille désigner Septembre éternel, le quatrième roman de Julien Sansonnens publié aux éditions de L'Aire (1), comme un roman assez convaincant de Michel Houellebecq, et même, comme un roman digne d'attention. Je m'amuse d'ailleurs de constater que, sans même avoir relu la note que j'avais consacrée, en 2016, aux Événements de Jean Rolin, j'en ai cité l'entame quasiment au mot près, comme si, hélas, Michel Houellebecq avait, plus ou moins consciemment, favorisé par capillarité médiatique la production de textes houellebecquiens : textes fatigués, minimalistes, railleurs, pornographiques mais à tropisme sociologique dans leur volonté d'analyser au plus près le grand désarroi du Français contemporain et, plus largement, de l'homme blanc hétérosexuel, et qui, comme semblent l'espérer les auteurs de ces pensums finalement assez convenus puisqu'ils remplissent un cahier des charges et surtout leurs éditeurs, doivent a priori bénéficier de l'aura du si tristement imitable auteur phare de la maison d'édition Flammarion.
Non pas que l'écriture de Septembre éternel soit bien sûr exceptionnelle alors qu'elle évite, pourtant, le relâchement et la vulgarité monotone des derniers romans de Houellebecq, car le fait même de s'inscrire dans le sillage de l'enfant terrible de la littérature française comme l'appellent, avec ce génie du lieu commun qui les caractérise, les journalistes, Houellebecq donc cité deux fois (2), et de s'y inscrire un peu trop facilement, à tel point que je n'ai pu totalement écarter le doute que l'auteur d'Anéantir n'ait une fois de plus cédé à l'un de ces plus vilains défauts (3), par le phrasé tout autant que le sujet et la peinture des personnages, non pas qu'une telle intention, voire ambition, ne peut tout de même pas conduire aux champs élyséens de la grande prose.
Peu importe alors que ce roman n'ait aucune prétention à la belle langue car, intelligemment construit, le narrateur évoquant de manière alternée son présent si communément sordide et son tout aussi banal apprentissage de la vie, occasion de radiographier la France des années 70 jusqu'à celles qui sont les nôtres, le sujet réel du texte est moins la méthodique déconstruction de tous les repères, réels ou symboliques, qui ont établi la puissance d'un pays qui autrefois fut une nation, que la lente mais inéluctable déliquescence d'un homme, d'une personne donc qui n'est plus rien d'autre qu'un individu qui «demeure comme retenu dans un mois de septembre éternel, dans ce peu que constitue désormais le présent, matériellement confortable et sans beaucoup d'intérêt» (p. 332), individu à tout autre semblable qui entend désormais se «laisser porter, puisque rien ne pouvait plus être entrepris» (p. 305). Nous aurions aimé, toutefois, pouvoir tracer de métaphoriques parallèles entre la très banale décomposition du personnage principal, Marc Calmet, et la remontée de la Loire à laquelle, avec une jeune femme rencontrée à Saint-Étienne, il se livre, mais, alors même qu'il évoque «la teinte verdâtre de la décomposition» que peut prendre le fleuve, quand il «coule parmi les immondices, non loin de zones industrielles déchues» (p. 85), Julien Sansonnens ne nous suggère rien de tel, comme s'il était finalement inutile et grossier, à l'ère de la platitude littéraire, de suggérer au lecteur de minuscules traces d'ordre et de beauté, dont la disparition afflige bien moins le narrateur que sa compagne de déambulation.
Cette impossibilité d'agir, malgré le fait que Marc Calmet traverse un pays en proie à des troubles plus ou moins violents causés par ceux qui se désignent eux-mêmes comme des enchaînés (qui ne peuvent évidemment que rappeler le mouvement des Gilets jaunes), est la résultante (ou bien la conséquence puisque les lois de la causalité historique sont bien moins rigides qu'on ne le croie) d'une impossibilité se nouant dans la sphère socio-politique : «une nouvelle révolution française n'aura pas lieu», le Gouvernement s'ingéniant à manipuler les foules par des «méthodes alliant punitions, récompenses et ingénierie sociale» (p. 283), Julien Sansonnens démentant finalement nombre de ces romanciers, penseurs et auteurs qui ont vanté la nécessité d'une révolution, y compris nationale, de Georges Darien avec la prodigieuse peinture de La Belle France jusqu'à Juan Branco rapproché du remarquable Ernst von Salomon, en passant par Georges Valois. Même «les émeutiers de 2005», en «incendiant leurs écoles et leurs voitures», «ont démontré que la banlieue ne constituerait pas la matrice d'une révolution» (p. 88), constat assez imparable même s'il n'est soufflé mot de l'existence, de plus en plus flagrante, d'un ferment théologico-politique bien capable d'opérer une véritable révolution, fût-elle réalisée en douceur, que Houellebecq a désigné comme étant l'Islam dans Soumission.
Pourtant, Julien Sansonnens, analysant «le mouvement des chaînes» qui, comme celui des Gilets jaunes, «était né hors des partis, des syndicats et des habituelles associations» (p. 219), affirme dans son roman que «le peuple français était sorti de l'invisibilité et s'était reconstitué en acteur politique» (p. 218), et clôt le neuvième chapitre de son livre sur un bel optimisme insurrectionnel (ou populiste, diront les imbéciles) par ces mots : «Personne, entendait-on, n'avait prévu le mouvement des enchaînés; l'insurrection est une taupe, elle creuse ses galeries, travaille le corps social à l'insu du pouvoir avant de ressurgir au jour, alors que s'effondre autour d'elle le terrain patiemment labouré» (p. 221). Une tension, on le voit, subsiste, l'auteur paraissant hésiter devant la violence populaire, une piste romanesque qu'il suit, un temps, avant de ne plus l'évoquer que par bribes, à la faveur des informations égrenées par les médias et d'une intrusion, assez brève, du narrateur en pleine manifestation. On mesurera alors ce qui sépare cette brève expérience, suivie d'aucun enseignement particulier, de la participation du Gilles de Drieu la Rochelle aux événements du 6 février 1934.
Cette impossibilité d'une révolte radicale, totale, l'auteur la figure pourtant dans les toutes dernières pages, assez décevantes tout de même, où l'on comprend que le narrateur, éconduit par la jeune femme, Myriam, avec laquelle il s'est rendu en voiture jusqu'à Paris, va sans doute commettre un meurtre, puis, pourquoi pas, se suicider. Après tout celle-ci le rejette, lui a vieilli, alors même que ses deux enfants se sont détournés assez sensiblement de lui, le tenant plus ou moins responsable de sa séparation avec leur mère.
Septembre éternel, titre antithétique puisqu'il résonne douloureusement d'un temps non seulement qui file mais qui est aboli contient de belles pages évoquant l'enfance, la relation entre un père et ses enfants, et l'impossibilité, pour notre narrateur, de pouvoir s'empêcher de détruire le bonheur tout simple de son couple; la vraie fluidité de l'écriture, que le manque de toute fioriture rend parfois émouvante, ne présente qu'une parenté somme toute assez lointaine avec l'indigence stylistique de Houellebecq vaguement relevée de termes crus et d'un humour grinçant qui ne semble plus faire ricaner que les journalistes. Cette qualité ne peut toutefois compenser à mon sens une déambulation qui demeure bien trop didactique dans une France ruinée, comme si Patrick Buisson, dans une voiture où se trouveraient Renaud Camus et Alain Finkielkraut, sans oublier Laurent Obertone, condensaient toutes les critiques, illustraient leurs analyses au sein d'un roman un peu trop pressé de montrer que la France est moins agonisante que morte.
Je ne demande pas à un roman de n'être qu'une compilation de vues sociologiques, peu importe du reste le fait qu'elles soient toutes assez justes à mes yeux, mais de me transporter dans un monde plus vrai que nature, même s'il a été totalement inventé. Or, il n'y a aucune invention dans Septembre éternel, et rien, même, ne s'y passe, au sens romanesque du terme (4), personnage et auteur y déplorent, l'un mollement, l'autre plus énergiquement, la lamentable fin de partie d'un pays qui semble n'avoir existé que par ses «images d’Épinal» (p. 181) ou bien qui vaille que vaille parvient à donner le change et à se maintenir «sur ses mythes» (p. 187). La fin du roman est du reste assez peu crédible comme je l'ai dit, laquelle ne vient même pas consacrer la lente déréalisation du personnage principal, son évaporation existentielle et ontologique, puisque, à l'instar du langage selon l'auteur (cf. p. 66), l'homme s'altère, perd tout sens, mais ne représente que la concrétisation elle-même paresseuse d'une forme d'épuisement : littéralement, Julien Sansonnens semble avoir voulu se débarrasser de son personnage, en même temps que de sa rencontre féminine, elle-même assez peu crédible.
Est-ce figurer, directement, par l'écriture (pourtant celle-ci ne semble absolument pas épuisée, comme celle de Houellebecq avec, comme je l'ai dit, quelques fort belles pages), le «renoncement au combat des idées au profit d'un égoïsme de bon aloi» (p. 187) tel que l'exprime Marc Calmet, l'homme ne se sentant finalement jamais plus heureux que lorsque, roulant seul la nuit, «de cet habitacle d'où on ne distingue que l'immédiate proximité, on croit évoluer dans un monde qui n'aurait pas conscience de nous» (p. 284) ? Est-ce montrer que le meurtre, du moins sa préparation moins méthodique que décidée en quelques secondes, n'est que l'aboutissement logique de la dissolution du christianisme, puisque, si «le soubassement de la civilisation occidentale» qu'aura constitué l'éthique chrétienne «était en passe d'être détruit», les limites, alors, ne pourraient que se dissoudre avec la fin du «système de valeurs qui permettait de différencier le bien du mal» (p. 215) ? Quelques pages avant la fin du roman, Myriam et Marc, dans une église, s'interrogeront pour savoir si le «cœur du problème» n'est pas «le vide laissé par la destruction du sentiment religieux» (p. 360), chaque époque, à l'exception de la nôtre, ayant «détruit les créations d'hier pour les remplacer par sa propre splendeur contemporaine» alors que, «pour quelque raison, ce mouvement s'est aujourd'hui interrompu», seule demeurant «l'abrogation, le remplacement perpétuel» (p. 358), la France, comme d'autres pays du vieil Occident mais, peut-être, bien davantage que tout autre pays si démocratiquement avancé, étant «en proie à une immense fatigue d'elle-même qui partout se perçoit, une nostalgie d'autant plus prégnante que le souvenir de ce qu'elle a été reste terriblement visible, enchâssé dans la pierre, dans les institutions, dans le génie populaire, dans la masse des expériences accumulées», dans «ces trésors de civilisation, de science et de culture qu'on ne parvient à refouler qu'au prix d'efforts inouïs et qui de partout expriment le drame de leur interminable agonie» (pp. 364-5) (5), comme si un meurtre, probable, qui ne fera guère plus d'une ligne dans la rubrique des faits divers, pouvait, en effet, conclure cette destruction.
Le terme est encore trop fort, car il faudrait plutôt parler d'une sorte d'évaporation, de dissipation, selon le terme de Guido Morselli, de la France et de ce qu'il reste de Français se souvenant de ce qu'elle fut, et qu'elle n'est plus, et ne sera sans aucun doute plus jamais.
Notes
(1) Des fautes, comme toujours : «des richesse» (p. 14); absence de point après «toujours plus dématérialisés» (p. 36); le titre du torchon Libération n'est pas en italiques (p. 100); signalons la curieuse manie d'écrire apparaitre au lieu d'apparaître (pp. 113; même chose p. 171 pour parait). Qu'est-ce que cela veut dire que : «Il faut que je fasse un téléphone à l'hôpital» (p. 130) ? Des boisons chaudes à emporter et non «à l'emporter» (p. 174). «Prépuce voilement rétracté», qui ressemble à du René Char inspiré, au lieu de violemment (p. 243); n'avaient pu et non pas «n'aient pu» (p. 249); le verbe décider employé deux fois dans la même phrase (p. 257)); me rendaient fier et non «fiers» (p. 263); un ou plusieurs mots semblent manquer entre les pages 263 et 264, dans la phrase «mais on cherchera surtout à les voir réunis en séries cohérentes, s'expriment le goût de la pièce rare»; de se trouver mutilé et non «de se trouvé» (p. 309). Rentrer chez em me semble plus logique que «renter chez toi» (p. 336); à la même page, le terme «perspective» est utilisé deux fois dans la même phrase; «faisait encore franchir le seuil de la librairie [à] une majorité de femmes» (p. 337); d'hommes et de femmes et non «des» (p. 364); Moyen Âge et non «Moyen-âge» (pp. 365 et 367); fine et non «fin couche» (p. 371).
(2) «Après quelques poèmes obscurs, Houellebecq publiait Extension du domaine de la lutte, un premier roman d'une rare intensité, cinglant, lucide et farci d'un humour remarquable, on pressentait que le livre marquerait son époque» (p. 232), ce qu'il fait, assurément. Houellebecq est de nouveau cité à la page 353.
(3) S'inspirer très largement, pour rester dans le prudent euphémisme, des livres d'auteurs beaucoup moins connus, comme il le pratiqua avec L'Oreille de Lacan de Patrice Trigano. Voir ma longue note présentant de troublantes coïncidences entre ce roman et Soumission.
(4) L'on m'objectera que rien ne peut se passer dans un roman qui figure un narrateur affirmant, d'entrée de jeu que, «comme beaucoup», il attendait «vaguement que quelque chose se passe» (p. 21).
(5) Je corrige une faute dans cette phrase en supprimant le pluriel d'au pris.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, roman, julien sansonnens, septembre éternel, éditions de l'aire, michel houellebecq |  |
|  Imprimer
Imprimer
