« Lancelot de Walker Percy | Page d'accueil | Montaigne de Stefan Zweig : histoire d’une lointaine fraternité, par Gregory Mion »
14/11/2016
Guerilla de Laurent Obertone

Photographie (détail) de Juan Asensio.
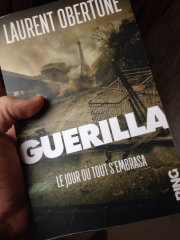 Acheter Guerilla sur Amazon.
Acheter Guerilla sur Amazon. Utøya.
Utøya. La France Orange mécanique.
La France Orange mécanique. Chroniques d'une dhimmitude annoncée.
Chroniques d'une dhimmitude annoncée.Nous considérerons comme un imbécile d'illustre lignage et, s'il se reproduisait hélas, de mirifique descendance, tout lecteur qui accordera la plus petite attention à la réclame que les éditions Ring, qui semblent confondre la promotion publicitaire la plus caractérisée avec le décachetage du septième sceau, ont organisée autour du dernier ouvrage de Laurent Obertone, qu'elles tentent de faire précéder, comme toujours ou presque, d'une réputation de chef-d’œuvre. Amusons-nous ainsi d'apprendre que «les événements décrits dans Guerilla reposent sur le travail d'écoute, de détection et les prévisions du renseignement français», alors que le visionnage de quelques scènes d'exécution commises par Daech, disponibles sur la Toile, aura suffi à Laurent Obertone pour servir d'utile support à telle ou telle de ses descriptions les plus macabres (1), ainsi que de probable bagage immersif auprès des discrets services de renseignements français.
Sans honte encore, puisqu'un représentant commercial ne connaît point la honte, notre vendeur de chefs-d’œuvre ne craint pas d'affirmer que c'est «après deux ans d'immersion au contact d'agents de services spéciaux et de spécialistes de la terreur et des catastrophes» que Laurent Obertone, que nous savons être «l'auteur du chef-d’œuvre» sur l'affaire Breivik et de «l'enquête phénomène» qu'est La France Orange Mécanique, nous livre enfin un «roman météore». Nous avons de la chance que le Dieu du Désert en personne ne vienne nous annoncer, dans un déchirement prodigieux des cieux, qu'il a Lui-même inspiré Laurent Obertone pour écrire, sous sa dictée, les Tables des Lois nécessaires à la rédaction de tout bon roman de gare.
Plusieurs questions se posent néanmoins en lisant cette réclame (et même, en la subissant visuellement, via des films publicitaires), sans tenir compte, notre intrépide VRP me remerciera pour cette douceur, de l'habituel et comique baratin grâce auquel les vendeurs emballent leurs poissons plus vraiment de première fraîcheur pour s'en débarrasser avant qu'ils ne sentent trop mauvais. Nous pourrions ainsi être en droit de nous demander pour quelle drôle de raison Laurent Obertone a, ou aurait eu apparemment besoin de s'immerger «au contact d'agents de services spéciaux et de spécialistes de la terreur et des catastrophes» (question subsidiaire : qu'est-ce donc qu'un spécialiste de la terreur et des catastrophes ? Laurent Obertone a-t-il déjeuné avec Paco Rabanne ?) quand la littérature la plus facilement dénichable, y compris Le Nouveau Détective, y compris tout de même celle de plus haute tenue, dont nous avons patiemment énuméré bien des exemples dans deux séries de notes, Chroniques d'une dhimmitude annoncée et Au-delà de l'effondrement, regorge de scénarios parfois infiniment plus élaborés que la trame ultra simpliste (bien davantage qu'ultra réaliste, comme l'affirme encore la réclame de notre livre) de Guerilla.
 Ces précautions prises, Guerilla, comme le reste de la production de Laurent Obertone, dont nous avons par deux fois rendu compte, est évidemment un texte qui se lit d'une traite, en quelques heures, tant il ne s'encombre pas de discours qui ralentiraient l'unique principe moteur, et même Dieu de Vengeance, devant lequel notre habile faiseur plie genoux : l'action et, plus précisément, le film de l'action, c'est-à-dire un scénario digne ou indigne c'est selon d'un uppercut (zut, j'écris comme l'éditeur d'Obertone !) bien davantage qu'un roman proprement dit. Guerilla, plus qu'un roman, titre auquel du reste il ne prétend même pas et nous saluons cette modestie, est tout entier conçu pour son adaptation cinématographique, que l'on imagine réalisable par quelque improbable clone d'un Luc Besson de droite, la réduction minimaliste du scénario et de toute forme d'intelligence alors mise au service d'un efficace déroulé (action resserrée en trois journées, chapitres et phrases courts, horaires et lieux de l'action précisés, exergues apportant une espèce de caution littéraire sinon humaniste, un ancrage de l'horreur dans la mémoire des lettres), de préférence ultra-violent, retournant les caricatures de personnages (des policiers par exemple, comme c'est une constante dans les films de Besson et de ses clones) contre ce petit milieu médiatique honni et tout aussi caricatural, quoique du bon côté de la barrière dégoulinante de moraline.
Ces précautions prises, Guerilla, comme le reste de la production de Laurent Obertone, dont nous avons par deux fois rendu compte, est évidemment un texte qui se lit d'une traite, en quelques heures, tant il ne s'encombre pas de discours qui ralentiraient l'unique principe moteur, et même Dieu de Vengeance, devant lequel notre habile faiseur plie genoux : l'action et, plus précisément, le film de l'action, c'est-à-dire un scénario digne ou indigne c'est selon d'un uppercut (zut, j'écris comme l'éditeur d'Obertone !) bien davantage qu'un roman proprement dit. Guerilla, plus qu'un roman, titre auquel du reste il ne prétend même pas et nous saluons cette modestie, est tout entier conçu pour son adaptation cinématographique, que l'on imagine réalisable par quelque improbable clone d'un Luc Besson de droite, la réduction minimaliste du scénario et de toute forme d'intelligence alors mise au service d'un efficace déroulé (action resserrée en trois journées, chapitres et phrases courts, horaires et lieux de l'action précisés, exergues apportant une espèce de caution littéraire sinon humaniste, un ancrage de l'horreur dans la mémoire des lettres), de préférence ultra-violent, retournant les caricatures de personnages (des policiers par exemple, comme c'est une constante dans les films de Besson et de ses clones) contre ce petit milieu médiatique honni et tout aussi caricatural, quoique du bon côté de la barrière dégoulinante de moraline.Cette efficacité ne me gêne absolument pas et même, tant qu'à faire, je la goûte davantage que la pseudo-intellectualité de mirliflore parisien servant de squelette mou à tant de navrants navets bavards qui, bien que ne possédant aucun organe de reproduction visible, ne cessent de se reproduire. Je préfère ainsi, et je le dis bien franchement, un livre de Laurent Obertone aux œuvres complètes, hélas à venir aux éditions du soudainement très milletien Léo Scheer, de l'impeccablement manucuré et déconstructivement coiffé Romaric Sangars. Du reste, il est frappant de constater que Guerilla donne finalement un corps testostéroné à la révolution d'eunuque minaudier, amateur de raouts où quelques bourgeois lassés de tout s'inventent des frissons en invoquant des Cosaques montés sur des poneys, que Romaric Sangars a figurée dans ses avachis et dolents Verticaux, ou bien que Jean Rolin a déroulée mollement dans ses euphémistiques et affligeants d'ennui Événements tout remplis de bruit et de fureur, mais surtout de descriptions de versicolores volatiles.
Cette efficacité, assez souvent tout de même, se dévalue en simplisme plutôt qu'en simplicité, même si Laurent Obertone semble avoir quelque peu, quelque peu seulement hélas (2), muselé son étrange compulsion au métaphorisme animalier, grossier, malgré quelques embardées que notre adepte de darwinisme social pour les nuls n'a visiblement pas pu maîtriser, faute peut-être d'une laisse suffisamment solide pour tenir son animal intime assis sagement plutôt qu'aboyant. Finalement, pour reprendre un des procédés qu'il figure dans son texte, c'est assez souvent que la (ou sa) bête intérieure s'empare de Laurent Obertone. C'est ainsi fort classiquement que la toute première scène du texte obertonien nous présente des policiers aux prises avec ce que les médias, AFP en tête logiquement puisque c'est le centre de commandement du novlangue français, continuent, pudiquement, mensongèrement, criminellement, d'appeler des jeunes et qui sont, nous dit Obertone, des salopards, des chiens, des monstres, des criminels en puissance sinon en acte(s) : «Ces gars-là n'étaient pas faits du même bois», car «Ils étaient animaux, blocs de pulsions et de haine, des chiens d'attaque prêts à rompre leurs laisses, et à broyer des visages» (p. 14). Cette bête réapparaîtra bien des fois, y compris dans ces quelques lignes qui suivent («La bête des entrailles préparait son putsch» puis «Alors la bête des entrailles avait parlé», p. 15), parfois de manière directe (avec la belle scène de l'éléphant errant dans les rues de Paris), mais elle possède un sens évident, quoi qu'il puisse assez équitablement être réparti entre criminels et représentants de l'ordre (s'il en reste) : l'intrusion de l'animalité est toujours, pour Laurent Obertone, retour à ce qu'un autre a appelé la verte primitivité, laquelle est probablement la dernière chance de réveiller le Français, sans doute l'Occidental, de sa prodigieuse léthargie. C'est toujours en fait le déclassé, celui qui trop longtemps a contenu sa rage, comme le policier abattant plusieurs jeunes, le psychopathe à la gâchette facile ou bien celui qui est un clochard (cf. p. 21), qui peut se laisser submerger par la bête : déchaînement de violence assuré mais, si j'ai bien lu Laurent Obertone, celui-ci vaut toujours mieux que la noria monotone des discours iréniques et l'inaction, dont vont périr bien des personnages du livre.
Une autre métaphore est goûtée par Laurent Obertone, et c'est à peu près la seule prise vaguement littéraire que cet expéditif scénariste a rapportée dans son filet à très amples mailles baleinières, métaphore qui évoque, pour le dénigrer, tel ou tel dieu auquel se réfèrent ses personnages. Lorsqu'il s'agit de la caricaturale Zoé, imbécile et même, ne craignons pas de l'écrire en nous faisant le souffleur de l'auteur, pauvre conne qui mourra d'aimer par-dessus tout les sauvages qui la détestent, Laurent Obertone raillera ainsi son dieu du «Lien Social» (p. 143) qui, curieusement, a abandonné son irénique ouaille. Le «Dieu du Lien Social» auquel croit, comme son amie Zoé, Noah, est tout bonnement déchu, ce pauvre Noah parlant «une langue morte et ses valeurs [n'étant] plus que les fables d'une époque disparue» (p. 279) Ailleurs, «les gens encerclant les commissariats donnaient l'impression de se recueillir, comme possédés par une révélation religieuse» (p. 212), remarque dont Laurent Obertone ne fait strictement rien, alors que tout idiot sur terre est capable de dégainer son petit précis de René Girard en moins d'une seconde.
Je pense que nous avons ramassé là tout ce que nous pouvions en guise de procédés métaphoriques, mais je crois que Laurent Obertone se contrefiche de savoir écrire lui qui, lorsqu'il se laisse aller à obéir à son propre «démon intérieur» (p. 60), qui est peut-être celui qui lui susurre qu'il est un écrivain, nous afflige de trouvailles pas mêmes dignes d'un volume de SAS, parlant par exemple des «yeux noirs de la zone grise» (p. 16) ou encore, envolée lyrique dont nous goûterons l'irrécusable profondeur, et qui eût il me semble parfaitement convenu à l'un des jeux de la série Assassin's Creed : «Les deux côtés de la rue semblaient donner sur la fin du monde. Il faisait noir comme chez les loups, et la nuit était pleine d'assassins» (p. 332).
Pourtant, en dépit même de ces facilités et enfantillages inouïs, sans même tenir compte des personnages qui, tous, sont des caricatures, qu'il s'agisse de militants qui, au moment même où ils vont mourir, continuent de saluer leurs meurtriers, d'un tueur psychopathe (Anders Breivik, sors de ce corps de papier !) éliminant les hommes qu'il tient directement pour responsables du chaos dans lequel la France a sombré, ou encore d'un vieux médecin réactionnaire flanqué d'une imbécile indécrottablement progressiste elle-même femme d'une irénique pourriture, Guerilla doit être considéré à sa juste valeur, qui n'est pas mince, et que nous pourrions définir comme étant la remise au goût du jour d'un roman assez médiocre, bien que supérieur à celui de Laurent Obertone, je veux bien évidemment parler du Camp des saints de Jean Raspail, chroniqué dans la Zone.
Cette remise au goût du jour, aussi vulgaire et grossière, simpliste disais-je, qu'on le voudra, nous permet néanmoins de comprendre quelle est la cible réelle et, du coup, l'intérêt, du roman de Laurent Obertone. Guerilla n'est pas vraiment un livre sur la guerre civile qui vient, nous disent les mauvais augures, sur l'ultra-violence qui, pour s'exprimer, n'a même plus besoin de la géniale invention verbale à laquelle Anthony Burgess avait eu recours dans son remarquable Orange mécanique. Guerilla pas davantage n'est un livre sur le Grand Remplacement cher à Renaud Camus, mais un roman sur une France qui, contre les apparences trompeuses, s'est en fait déjà effondrée et c'est à ce titre que nous pourrions réaffirmer ce que j'ai écrit sur le roman de Jean Raspail : «Le Camp des Saints est un roman pré-apocalyptique, au sens où il affirme et démontre, d'une façon assez convaincante, que l'effondrement de la France est moins la conséquence de l'afflux prodigieux de mendiants et de va-nu-pieds sur son sol, que le résultat d'une longue et méthodique propagande bien-pensante, «terrorisme verbal» et «vérole contemporaine galopante», «gaz délétères de la pensée contemporaine», ennemi intérieur en tous les cas, rats de la nuit sortant au moment idoine de leurs trous puants comme dans La Peste écarlate de Jack London, sous-langage de la propagande diffusé sur les ondes, dans les journaux, lors de simples conversations, propagande qui a sapé les dernières forces qu'il restait à notre pays, miné le moral de ses troupes, détourné la mission de ses prêtres, pollué la cervelle de ses habitants, surtout ceux de Marcel et Josiane : «[...] il faut une fois encore en conclure qu'au-delà du manichéisme d'élite, dans quelque sens qu'on le prenne, l'histoire du monde blanc n'était plus qu'affaire de millions de moutons», et c'est bien là l'unique évangile auquel Laurent Obertone semble souscrire sans réserve.
Comment s'étonner, dès lors, que nul de nos médias officiels, sauf erreur de ma part, n'ait évoqué ce roman, puisque c'est bel et bien contre eux qu'il a été écrit, offrant ainsi une version romancée de la thèse développée dans La France Big Brother ? C'est d'ailleurs lorsqu'il moque férocement tous les éléments de langage de nos édiles et de nos journalistes perpétuellement honteux et craignant, davantage que d'écraser malencontreusement un piéton, de commettre une bourde linguistique inexcusable (par exemple, donner du meurtrier en lieu et place du jeune ou du crétin profondément inculte au lieu du jeune issu de la diversité et cherchant à s'exprimer par ce nouvel art hautement figuratif qu'est le rap), que Laurent Obertone est le plus efficace et même, parfois, outrancièrement drôle : «On parla ensuite du bien vivre ensemble, de symboles forts, d'ascenseur social, de jeunes sans histoire, de dialogue qui passe mal, de quartiers déshérités, de cette honte à la française» (p. 47) ou encore, morceau de bravoure vivre-ensembliste prononcé par le Président de cette France plus vraie que nature, Jacques Chalarose, qui ma foi me semble n'être qu'un trait à peine forcé du baratin tiers-mondiste qui nous est servi sans rougir depuis quelques lustres, de ce «Grand Enrichissement» (p. 54) que constitue ce que le vieil hibou solipsiste du Gers, Renaud Camus, nomme «Grand Remplacement», ou encore de ces «stationnaires» que nous sommes en face des «itinérants» qui ne sont riches que d'un seul trésor, «leur mal-amusement» ou bien «leur mal-insertion», voire «leur mal-vivre» (p. 56), autant de termes monstrueux, d'une laideur de barre de quartier, qu'une Anne Hidalgo ou ses communicants décérébrés, trente fois par jour au moins mais toute leçon s'apprend par la répétition, répètent sur le compte Twitter de cette démagogue d'une prétention stratosphérique. Songeons encore, car nous n'en sommes peut-être plus très loin, à cette «loi d'incritiquabilité du très-bien-vivre-ensemble» à laquelle une Anastasia Colosimo consacrera peut-être l'un de ses prochains essais. C'est affirmer, certes grossièrement, que la France est devenue la patrie du novlangue (voir encore le chapitre 30) inventé par George Orwell et qu'il faudrait en somme parvenir à se sevrer de cette drogue, comme le montre le film Equilibrium pour enfin ouvrir les yeux et constater de quoi il en retourne vraiment, là, tout près de chez moi, sous mes yeux à vrai dire, dans ma propre rue et non pas à l'abri derrière un beau bureau républicain ou de direction de quotidien national. Comme il le peut, avec ses moyens qui ne sont tout de même pas bien grands, Laurent Obertone illustre ce que j'ai appelé les langages viciés. Bien sûr, il serait cruel de faire remarquer à l'auteur que son écriture elle-même, qui n'est pas franchement la plus haute manifestation du génie français, est à sa façon expéditive un langage vicié.
Du coup, c'est bien une espèce de conversion que décrit Laurent Obertone, mais une conversion paradoxale, comme entravée, car aucun de ses personnages, à l'exception de ceux que nous avons cités, de quelques militaires de la 1ère compagnie du 2e REP, d'un colonel atrabilaire et du Breivik français, Vincent Gite, ne semblent être en état, ni même désirer comprendre que la réalité façonnée par des décennies d'usage de mots trompeurs s'est tout simplement écroulée en quelques heures à peine : «Dans un monde à l'envers il est fou d'être à l'endroit» (p. 70), la «terreur citoyenne rempliss[ant] partout son saint-office, réduisant la majorité à son silence favori» (p. 80), les médias et les élites politiques de ce pays plus vrai que nature qu'évoque Laurent Obertone ayant appris aux Français «la politesse de se faire tuer» (p. 97), les islamistes, toute la sale engeance des sauvageons, il est vrai diablement épaulée par ce qui a été appelé l'anti-France détestant bien cordialement les Français de souche et ce pays de dhimmis.
Comme Jean Raspail montrant qu'il ne fallait que quelques heures pour assister à l'effondrement d'un pays, le nôtre, puisqu'il était déjà vermoulu de l'intérieur comme une poutre creuse que la vibration d'une aile de mouche suffit à faire exploser dans un nuage de sciure, Laurent Obertone estime lui aussi que les chiens égorgeurs «n'ont pas besoin de gagner», «puisque nous avons déjà perdu» (p. 103) et que nous ne nous souvenons même plus du moment où nous sommes devenus des agneaux (cf. p. 97) désireux de terminer en fines lamelles de viande à kebab. Laurent Obertone, fidèle à sa tactique, force le trait et, non content de montrer l'écroulement d'un «pays si avide de disparaître, que le vaincre en était presque insultant» (p. 109), se lance à la poursuite de ses personnages, dont il venge la forfaiture en les faisant disparaître de plus ou moins ignoble façon, y compris même cette tête de pont de l'invasion annoncée qu'est Quraych Al-Islam qui voit d'un mauvais œil le désordre, les incivilités ou, pour le dire en bon français, la guerre civile, car il pense que «la conquête gagnerait à s'imposer sans heurts, par les vannes ouvertes de l'immigration, avec la complicité active des infidèles, dont la morale délirante lui échappait, mais qu'il interprétait comme un signe du Ciel» (p. 111). Le suprême plaisir, pour notre auteur, semble résider dans le fait d'exterminer les crétins antifas jamais à court de slogans pacifistes et «la vermine écolo» (p. 293) au moyen des hordes de jeunes, comme le montrent plusieurs scènes, l'une des plus brutale étant celle où des anarchistes viennent saccager, piller Rungis, mais aussi tuer ceux qui y travaillent, un boucher finissant ainsi «pendu par la cuisse, parmi les porcs, au crochet de la file de carcasses» (p. 294), anarchistes qui seront eux-mêmes massacrés par les jeunes auxquels ils ont pourtant tenter de clamer leur amour des opprimés. Identiquement, un juge laxiste, revenant à Marseille livrée à de véritables scènes de guerre, finira écrasé sous un camion poubelle volé au dépôt par «Abderrahmane, seize ans, fonçant droit sur lui et venant le percuter à près de soixante-douze kilomètres heures. Sa boîte crânienne explosa sous la roue arrière du quinze tonnes, et son corps fut étalé sur une trentaine de mètres» (p. 305). Il est assez évident que, s'il se laissait aller et avait les moyens littéraires nécessaires à son ambition, Laurent Obertone réserverait de subtiles tortures pour ces personnages, afin de bien nous faire comprendre qu'il les hait, lui qui les extermine méthodiquement, son livre tout entier pouvant être lu comme une vengeance, de papier mais pas moins sincère, par anticipation, la description où ces traîtres finiront la tête au bout d'une pique ou bien pendus à un croc de boucher.
Ce n'est pas seulement le pays qui s'écroule, mais la République, qui paradoxalement, en mourant, lâche autant de sang que lorsqu'elle est née puisque «le pays n'avait pas connu pareille fête depuis la Terreur» (p. 197), et c'est paradoxalement encore par la bouche d'une des pires saloperies médiatiques du pays, Renaud Lorenzino, père de l'insupportable idiote bien-pensante Zoé, que la vérité inéluctable de l'écroulement du pays sera proclamée (pp. 237 et sq.), le menteur professionnel qu'est cette ordure, qui sera d'ailleurs torturée, pour le coup, par Vincent Gite, étant finalement aussi près de la vérité de la situation de la France que l'est le médecin atrabilaire qui affirme que cela fait peut-être «longtemps que nous sommes morts, mais qu'on n'a jamais su en voir le signe certain» (p. 255).
Tout n'est pas cependant désespéré dans ce livre d'une noirceur absolue, où ne vivent (quelques heures seulement pour la plupart après le début des événements) que «les êtres sans visage et sans nom du monde sans forme» (p. 342), car nous croisons, çà et là, deux ou trois personnages qui nous permettent d'espérer que la France et même toute trace d'humanité ne sont pas complètement mortes (voir l'histoire de Cédric et Alice, que le meurtrier Idriss aura pourtant aidée à accoucher), car «l'amour, première et dernière des dépendances humaines, les sauverait de toutes les autres» (p. 362). C'est encore l'attitude consistant à «réserver sa peau aux siens, aux parents, à la petite amie, aux enfants» (p. 401) qui semble à Laurent Obertone la plus respectable, et il a bien évidemment raison.
Plus finement, et c'est peut-être le seul indice qui nous permet de croire que Laurent Obertone ne s'identifie pas complètement à son vengeur implacable, Vincent Gite, l'auteur semble conscient du fait que l'histoire de bruit et de fureur qu'il a mise en scène de façon réaliste sinon vraisemblable ne saurait clairement donner la victoire aux assassins : «Les tueurs, si médiatisés en temps de paix, avaient basculé dans l'anonyme, et l'inutile, de quelque camp qu'ils furent. Pour ne pas y penser, ils n'avaient que la fuite en avant dans le crime. Il n'en resterait que quelques éclats de folie, dissous dans la catastrophe générale» (p. 395). Ainsi même Gite est qualifié de «chevalier maudit» lequel, dans «son délire obsidional», «voulait être la grâce dans le Mal, et ce Graal il le cherchait dans les égouts de sa folie» (p. 396).
L'espoir, aussi, subsiste d'une autre façon, le mot guerilla étant le prénom que la petite fille sauvée par le colonel se choisit, qui peut-être la conduira, qui sait, à briser un jour, devenue grande, «le règne de la peur», car c'est bel et bien la peur qui est «l'identité française, la peur qui parlait à l'oreille des hommes, qui gouvernait leur folie» (p. 402), et c'est peut-être encore cet espoir tenace qui donne raison à ceux qui «croyaient que tout au fond de la France, tout en bas, dans ses sous-sols, dans sa terre, dans ses racines il y avait une force, une force qui s'ignorait, et qui, soudain confrontée au danger, à l'effondrement de ce pays sur lui-même, se réveillerait, se déchaînerait, et ferait éclater la terre» (p. 407).
Cette force qui s'ignore, rassurons Laurent Obertone sur ce point, nous sommes tout de même quelques-uns, fous ou bien naïfs espérant contre tout et tous, à l'espérer sinon la sentir gronder sous terre, et il ne faut jamais craindre de la jeter à la face de tous les nantis, thuriféraires et putains de la Médiature perdus dans leur simulacre de France ouverte comme une charogne aux quatre vents du saccage mondialisé, qui liront en cachette ce livre sans profondeur mais si terriblement efficace, mais il n'en reste pas moins qu'il faut regretter qu'elle soit aussi pauvrement, aussi peu littérairement incarnée que dans Guerilla.
Notes
(1) C'est ainsi que la description d'un homme qui, «l'air détaché», prend son élan pour sauter sur la tête à pieds joints d'un homme à terre me rappelle les images, ultra-violentes et datant de quelques années, d'un Brésilien poursuivi par plusieurs hommes et se faisant lyncher sous une caméra de discothèque. Dans ces images, l'un des poursuivants s'acharnera à sauter à pieds joints sur la tête de l'homme à terre, depuis longtemps inconscient. Ces images, je m'en souviens encore, avaient fait le tour de la Toile et provoquaient, comme tant d'autres du même ressort morbide, un flot de commentaires de la part d'habitués du site Ogrish. Ailleurs, la description d'un petit blanc brûlé vif ne peut que nous rappeler les images atroces diffusées par l’État islamique et montrant ce pilote de chasse jordanien, qui, après avoir été capturé par les barbus de Daech puis badigeonné d'essence et enfermé dans une cage en fer, fut brûlé vif. Je me rappelle l'un des gros plans atroces de ce film parfaitement mis en scène, correspondant à ce qu'écrit Laurent Obertone : «Un des tueurs eut le réflexe de prendre la caméra et de filmer en gros plan, la peau se dilatant, les yeux se fondre, la chair se racornir, découvrant les dents, les tissus se figeant au crâne, et la graisse brûlée dégouttant du trou qui fut un nez" (pp. 204-5, je souligne).
(2) L'usage de la métaphore animalière, quoique réduit dans ce dernier texte de Laurent Obertone, n'en demeure pas moins prégnant, comme le montrent plusieurs exemples auxquels je me contente de renvoyer (cf. pp. 29, 39, 96, 119, 322, 337, etc.).






























































 Imprimer
Imprimer