Fusées, Mon cœur mis à nu, La Belgique déshabillée de Charles Baudelaire (17/01/2023)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
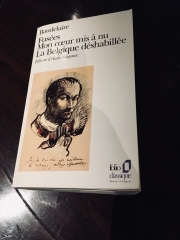 Acheter sur Amazon. Je signale que la réédition de cet ensemble de textes ne comporte pas, allez savoir pour quelle pathétique raison, La Belgique déshabillée.
Acheter sur Amazon. Je signale que la réédition de cet ensemble de textes ne comporte pas, allez savoir pour quelle pathétique raison, La Belgique déshabillée.Commençons par saluer l'édition impeccable qu'André Guyaux a donnée de plusieurs textes de Charles Baudelaire à l'alacrité pour le moins vive, Fusées, Mon cœur mis à nu ainsi que La Belgique déshabillée, regroupés dans un fort volume à l'apparat critique non seulement abondant mais très bien choisi et ma foi assez peu enclin à suivre les modes éditoriales actuelles, mélange de manque de rigueur, de prétention et de sottise bassement commerçante (1).
Je laisse le lecteur prendre connaissance de l'excellente préface de ce maitre d’œuvre à l'ancienne, pour ce qui concerne les détails et problématiques relevant de ce corpus qui a pu engendrer nombre d'incompréhensions ou de francs rejets chez les badauds mais aussi chez les connaisseurs de l’œuvre du poète, déroutés par la morne répétition, au mot près parfois, de simples notes de travail, parfois de titres ou de coupures de presse devant constituer l'ébauche d'un texte autrement construit, ou bien de notes plus développées qui, par leur teneur ont pu captiver, comme l'écrit André Guyaux, des esprits aussi forts et variés que «Nietzsche, Bloy, Claudel et Proust» (p. 12).
Il fallait bien évidemment que Jean-Paul Sartre, l'un de ces faux esprits forts par excellence qui auront étalé sur des milliers de pages leur désarroi de n'être point de véritables philosophes, obscurcisse ce qui était clair en déclarant que Baudelaire, «contre tous ceux qui ont souhaité de libérer les hommes, contre George Sand, contre Hugo» avait «pris le parti de ses bourreaux» (2); André Guyaux a alors raison de noter que «le danger, quand on mêle la morale à la littérature, et quand on veut corriger une conscience, c'est, tout en ayant l'air d'ajouter quelque chose qui manquerait, en l'occurrence la conscience progressiste, de soustraire au lieu d'ajouter» (p. 18), et de soustraire par exemple le poète «à la détestable influence de Joseph de Maistre, lui ôter ses mauvaises lectures d'Edgar Poe», pour «le reconduire en tête de la grande manifestation contre la tyrannie et lui faire écrire, sans doute, quelque chose comme des Fleurs du progrès». Si Sartre «veut, assurément, comprendre Baudelaire, saisir sa singularité», André Guyaux a raison de douter que le meilleur moyen, pour ce faire, soit de placer le grand poète «entre le pouvoir de Napoléon III et les idéologies progressistes» (p. 20).
C'est donc dans ces «disjecta membra de l'insoumission et de la vengeance» que l'on trouve, selon André Guyaux, la «plus belle expression» du blasphème, dont «notre époque a largement perdu le sens esthétique», mais aussi de «l'allégation morbide [et] de l'anathème», comme Camille Lemonnier ne manquera pas de le souligner en déclarant dans Baudelaire à Bruxelles ce dernier «devait être, avec Barbey d'Aurevilly et Félicien Rops, le dernier diabolisant d'une époque qui ne croyait plus au diable» (p. 546) : «Sur un plan littéraire, c'est très regrettable, poursuit Guyaux, car c'est la beauté terrible, la magnifique incantation de ces textes décomposés, dont les phrases, perdues de contexte, ont toujours quelque chose d'immédiat et de longuement mûri et reviennent, en variantes ou en variations thématiques, comme si la formulation n'était jamais suffisante, jamais assez aiguisée, comme si la pensée obsédait inlassablement son expression, ne trouvait jamais sa forme définitive» (p. 25).
Quel est l'ennemi principal, principiel, de Baudelaire le diabolisant, dégageant, toujours selon Lemonnier, bien davantage que Rops et Barbey, «l'impression physionomique du satanisme» (p. 547) ? Le Progrès bien sûr, voilà ce qui fit enrager Sartre contre celui qu'il prit pour centre d'une étude aussi célèbre que bornée et ridicule ! En effet, «s'il y a, en dehors des épigrammes contre Hugo et des attaques contre George Sand, qui ont finalement la même cible, un thème qui fait, d'un seul coup d'aile, virer Fusées et Mon cœur mis à nu de la fausse confession au véritable pamphlet, c'est le progrès», cette «doctrine de paresseux» selon Baudelaire, ou encore ce «paganisme des imbéciles», dont l'époque, affirme Guyaux, «est affligée comme d'une épidémie» (p. 29). Notre commentateur va plus loin, et nous ne pouvons qu'approuver chacun des mots qu'il écrit, après avoir noté qu'à l'exception de critiques comme Jacques Crépet, Georges Blin ou encore Daniel Vouga ayant consacré un ouvrage aux liens entre Joseph de Maistre et Baudelaire, l'influence maistrienne sur le poète, «sentie à chaque instant dans les fragments publiés ici, est l'objet d'une dénégation systématique», car «notre siècle, qui a largement illustré les désastres humains incombant aux différents processus révolutionnaires, accepte malaisément que le poète qui nous a légué l'idée de la modernité ait reproduit, pensé, magnifié la vulgate de cette chouannerie intellectuelle» (p. 30). Et Guyaux de poursuivre, avec panache : «L'enjeu idéologique est de taille qui fait l'économie d'un Baudelaire politique, réduit son importance, occulte la solidarité interne de son œuvre, soustrait le politique du poétique. Car si, avec l'alibi de l'apolitisme poétique, on décolle le Baudelaire maistrien de l'autre Baudelaire, comme le fait Sartre, non seulement on méconnaît la pensée de Baudelaire, sa structure réactive et ses ramifications polémiques, sa violence même, mais on ôte à la pensée maistrienne le prolongement qui l'illustre d'un destin poétique, qu'elle mérite, étant elle-même poétique» (pp. 30-1). Notons que l'excellent Pierre Glaudes, mentionnant lui aussi l'influence du grand penseur contre-révolutionnaire sur Charles Baudelaire dans le Dictionnaire clôturant le volume des Œuvres maistriennes chez Robert Laffont (coll. Bouquins, 2007, p. 1135), note qu'il manque à ce dernier «la confiance ontologique qu'avait Maistre : la création poétique est chez lui une tentative héroïque pour recomposer allégoriquement, mais sans garantie transcendantale, l'unité de l'accidentel et du fugitif», façon détournée de dire que Baudelaire ne croit plus vraiment en Dieu ou peut-être même que la croyance en Dieu, à son époque, a été plus que mise à mal.
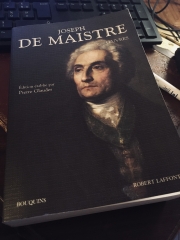 De fait, il faut s'interroger sur la dernière inspiration du grand poète par le biais «d'une écriture en saut de plume» (p. 43), dans «ces textes au flux saccadé» laquelle, pour André Guyaux, «est telle qu'une médecine où le patient force la dose du vaccin et se donne la maladie au lieu de s'en guérir», alors même que «le mal entretient le mal" et que «rien n'apaise la force intérieure du mal sans cesse renflouée par sa force extérieure», inspiration enfin qui va devenir, durant le séjour en Belgique, une «loi absurde» dévorant «les deux dernières années de relative santé» (p. 32) du poète.
De fait, il faut s'interroger sur la dernière inspiration du grand poète par le biais «d'une écriture en saut de plume» (p. 43), dans «ces textes au flux saccadé» laquelle, pour André Guyaux, «est telle qu'une médecine où le patient force la dose du vaccin et se donne la maladie au lieu de s'en guérir», alors même que «le mal entretient le mal" et que «rien n'apaise la force intérieure du mal sans cesse renflouée par sa force extérieure», inspiration enfin qui va devenir, durant le séjour en Belgique, une «loi absurde» dévorant «les deux dernières années de relative santé» (p. 32) du poète.Nous nous souvenons que l'auteur d'Anywhere out of the World assurait qu'il fallait fuir «les pays qui sont les analogies de la Mort», et que Léon Bloy, dans une lettre à un poète belge datée du 5 octobre 1900 reproduite dans son colossal Journal, assurait qu'une personne se disant à la fois poète et chrétien ne pouvait que décemment fuir la Belgique.
Les belles âmes ont durement jugé le mépris, la haine véritable que le poète crache un si grand nombre de fois contre la Belgique, le plus souvent dans des termes orduriers, sans paraître comprendre qu'il voyait en celle-ci «une miniature de l'horreur du monde, carrefour des sectes, des athéismes, de la bêtise qui veut sauver l'homme, lieu sans identité, voué à l'imitation et à la division» (p. 40).
Selon André Guyaux que je ne me gêne pas du tout de citer longuement tant sa présentation est claire et percutante, «démembré comme Osiris, le livre sur la Belgique fonde deux lignages importants de notre littérature moderne. Il est d'abord le père de tous les pamphlets qui prendront pour cible un objet collectif : on songe à Bloy, peut-être à Claudel ou à Péguy reprenant la flamme sacrée contre les positivismes; Céline est sans doute plus loin des «foudres catholiques», de Baudelaire, selon le mot de Verhaeren, mais non de ses violences. Il préfigure aussi le grotesque et le burlesque modernes, qui donneront Jarry» (p. 42). En tout cas, la Belgique, telle que la déplore et, surtout, la vomit Baudelaire, semble être le stade terminal de la société contemporaine, ainsi que l'aboutissement de ses marottes, comme une espèce de Barnum à l'échelle d'un pays tout entier, qui montrerait «aux hommes dégradés» des temps futurs «une belle femme des anciens âges artificiellement conservée» : «Eh ! quoi ! disent-ils, l'humanité a pu être aussi belle que cela ?» Je dis que cela n'est pas vrai. L'homme dégradé (3) s'admirerait et appellerait la beauté laideur. Voyez les déplorables Belges» (feuillet 39, p. 155). Les Belges n'ont aucune individualité notable puisqu'ils ne savent penser «qu'en bloc» (feuillet 82, p. 174), leur principale qualité étant leur aptitude au troupeau manifestant un «esprit d'obéissance et de conformité», un «esprit d'association» vu leur manie de créer d'«innombrables associations» (feuillet 96, p. 182) : ce sont des «Ruminants qui ne digèrent rien» (feuillet 86, p. 175, l'auteur souligne), vu qu'il «n'y a pas de peuple plus fait pour la conformité que le peuple belge» (feuillet 100, p. 184).
«N'être pas conforme, c'est le grand crime» (feuillet 112, p. 191, l'auteur souligne) et, en son stade terminal de régression, une telle société, si le terme est encore de mise, un pays qui n'est rien d'autre qu'un «arlequin diplomatique» (feuillet 321, p. 282) n'a nul besoin d'une quelconque littérature, se contentant de «deux ou trois chansonniers, singes flamands des polissonneries de Béranger» (feuillet 151, p. 210). Nous touchons ici une des principales caractéristiques, selon Baudelaire, du peuple belge, qui n'est pas digne d'être autre chose qu'une contrefaçon de la France, contrefaçon notable certes, puisqu'«élevée au cube» (feuillet 187, p. 221), un ridicule calque, mais exacerbé, de tous les maux affligeant notre propre pays; ainsi : «La Belgique est plus remplie que tout autre pays de gens qui croient que J. C. était un grand homme, que la nature n'enseigne rien que de bon, que la morale universelle a précédé les dogmes dans toutes les religions, que l'homme peut tout, même créer une langue et que la vapeur, le chemin de fer et l'éclairage au gaz prouvent l'éternel progrès de l'humanité». En somme, conclut le poète dans ce même feuillet 188, «ce que la Belgique, toujours simiesque, imite avec le plus de bonheur et de naturel, c'est la sottise française» (p. 221, l'auteur souligne). Et Baudelaire, inlassablement, comme pour se convaincre qu'il tient là une évidence qu'il s'agira ensuite de développer, de répéter que «la sottise belge est une énorme contrefaçon de la sottise française, c'est la sottise française élevée au cube» (feuillet 196, p. 225).
Qu'attendre d'un pays qui, comme le reste des autres pays occidentaux assurément me dira-t-on, autrement dit contaminés par la funeste idéologie du Progrès, cherche «la vérité dans le nombre», fait son miel, comme l'analysera Philippe Muray, du «suffrage universel et [des] tables tournantes», ce qui revient à dire que l'homme cherche «la vérité dans l'homme» (feuillet 204, p. 228) ?
Il est piquant de constater que Charles Baudelaire naît la même année, 1821, que meurt Joseph de Maistre et que sont publiées Les Soirées de Saint-Pétersbourg et que, bien des années plus tard, dès 1861, il aura pour projet de consacrer un essai intitulé Du Dandysme dans les lettres où Maistre, avec Chateaubriand ou Barbey d'Aurevilly, trouvera sa place naturelle. C'est en tout cas dans Mon cœur mis à nu, livre tant rêvé qui «sera autre chose que les fameuses Confessions de Jean-Jacques», qui sera «un livre de rancunes» où le poète voudra «faire sentir sans cesse [qu'il se sent] comme étranger au monde et à ses cultes», où il voudra tourner «contre la France entière [s]on réel talent d'impertinence» (4), que Baudelaire déverse sa raillerie contre ce qu'il a appelé «le Progrès indéfini dans une lettre à Alphonse Toussenel du 21 janvier 1856, précisant sa pensée en ces termes : «Qu'est-ce que le Progrès indéfini ! qu'est-ce qu'une société qui n'est pas aristocratique ! ce n'est pas une société, ce me semble. Qu'est-ce que c'est que l'homme naturellement bon ? où l'a-t-on connu ? L'homme naturellement bon serait un monstre, je veux dire un Dieu» (p. 527). C'est dans cette même lettre, assez étonnante on nous l'accordera, que Charles Baudelaire nous livre le fond de sa pensée que je crois pouvoir qualifier de théologique, et même, de mystique, nous allons le voir, dans une étonnante préfiguration d'une vue de Bernanos dans son dernier roman, Monsieur Ouine, de quoi, effectivement, horrifier jusqu'à l'apoplexie idéologique les vieilles badernes sartriennes et la ribambelle de ses petits surgeons progressistes : «Toutes les hérésies auxquelles je faisais allusion tout à l'heure ne sont, après tout, que la conséquence de la grande hérésie moderne, de la doctrine artificielle, substituée à la doctrine naturelle», à savoir, selon Baudelaire, «la suppression de l'idée du péché originel» et, ajoute le poète dans une étonnante percée vers une modernité devenue folle : «à propos de péché originel, et de forme moulée sur l'idée, j'ai pensé bien souvent que les bêtes malfaisantes et dégoûtantes n'étaient peut-être que la vivification, corporification, éclosion à la vie matérielle, des mauvaises pensées de l'homme», ce qui ne peut avoir que la signification abyssale suivante, que développa Arthur Machen dans l'une de ses nouvelles les plus admirables, La Terreur : «Aussi la nature entière participe du péché originel» (p. 528, l'auteur souligne), Baudelaire concluant sa lettre en demandant à son correspondant dont je ne connais pas la réponse de bien vouloir, on le comprend, ne pas lui tenir gré de son audace !
Ce passage m'a frappé et, si j'ignore les commentaires plus ou moins inspirés qu'il a peut-être suscités, je me permets, ici, de citer un long passage d'une note consacrée à ma dernière relecture de Monsieur Ouine de Georges Bernanos, qui est comme l'éclosion insoupçonnée à ce jour du bouquet de fleurs baudelairiennes à la fragrance suspecte et plus que trouble, parfaitement hérétique à vrai dire : «C'est à l'occasion d'une discussion impromptue avec le médecin du village de Fenouille que le prêtre, en délicatesse avec ses supérieurs depuis les lamentables événements qui semblent avoir réveillé les plus vieux démons dans l'esprit de paisibles villageois ni meilleurs ni plus mauvais que d'autres, expose ses étranges visions : si l'homme parvenait à se débarrasser de Dieu, nul doute à ses yeux qu'il ne deviendrait alors la victime d'étranges maux que les scientifiques auraient toutes les peines du monde à classer, et que dire de réussir à les endiguer.
 Ainsi, le prêtre commence par poser un paradoxe : «Pour reprendre l’expression qui vous a surpris tout à l’heure, on ne peut nier que Dieu se soit fait petit depuis longtemps, très petit. D’où l’on conclut qu’il se fera petit demain comme hier, plus petit, de plus en plus petit. Rien, cependant, ne nous oblige à le croire» (p. 1508) (5). Le pauvre, autant dire l'homme occidental dans son ensemble, n'a plus de mots pour nommer ce qui lui manque, et c'est dans ce silence ajoute Bernanos, ou plutôt, dans ce mutisme, que le Mal va finir de digérer sa proie, non sans que cette dernière, ne comprenant pas ce qui lui arrive, jette une toute dernière fois ses forces, sa colère et peut-être même sa haine dans l'assaut final. Dieu les aurait prises, cette colère et cette haine, car la révolte vaut toujours mieux que l'impassibilité, le désespoir, mais sait-on ce que l'Autre fera de tels aliments ? : «Oui, monsieur, l’heure vient (peut-être est-elle déjà venue ?) où le désir qu’on croit avoir muré au fond de la conscience et qui y a perdu jusqu’à son nom va faire éclater son sépulcre. Et, si toute autre issue lui est fermée, il en trouvera une dans la chair et le sang – oui, monsieur – vous le verrez paraître sous des formes inattendues et, j’ose le dire, hideuses, horribles. Il empoisonnera les intelligences, il pervertira les instincts et… qui sait ? pourquoi le corps, notre misérable corps sans défense ne paierait-il pas une fois de plus la rançon de l’â… de l’autre ? une nouvelle rançon ?» (pp. 1509-10). Le médecin de Fenouille résume le propos de celui qu'il n'hésite pas à traiter de confrère, sans doute par pure politesse : «C’est de la folie [...], de la folie pure. Les trois vertus théologales passant du monde invisible au monde visible, transformées en tumeurs malignes, je suppose ? Monsieur, il est permis de se demander ce qu’on penserait en haut lieu de ces extraordinaires divagations» (p. 1510). Quelques pages plus loin, il tentera, discutant avec le prêtre des obsessions du maire de Fenouille, qui reste visiblement «hanté par le fantôme de ses innocences perdues», de définir de nouveau les étonnantes idées du curé, en affirmant : «Si je vous entends bien, vous prétendez qu’une certaine déficience… du sentiment religieux… pourrait se traduire par… certains phénomènes pathologiques… qui iraient même… jusqu’à une transformation profonde de… de l’espèce ?…» (p. 1524). Le prêtre ne tarde pas à répondre au médecin, et je cite intégralement ce passage vraiment remarquable, qui sonde notre propre présent, mais aussi, surtout, ce qu'il nous sera peut-être donné de voir, avec une justesse véritablement remarquable, passage qui à lui seul nous permet de dire que le dernier roman de Georges Bernanos représente une plongée absolument inédite à ma connaissance dans des eaux pour le moins aussi profondes que dangereuses, qui plus est susceptibles de provoquer bien des remous et des grimaces de dégoût : quoi, un écrivain peut-il se prétendre, sans craindre le ridicule, se prendre pour un prophète ? Il semblerait que oui, et nul besoin pour ce faire de plaider l'existence, pour le moins suspecte, d'un quelconque don de seconde vue, car Georges Bernanos, dans son dernier roman, ne fait finalement que tirer des conséquences logiques, bien qu'extrêmes, des propositions (la poisse que d'écrire comme un universitaire, à coup de concaténations et de petites déductions !) qu'il a tenté d'illustrer dans chacun de ses écrits : l'homme sans Dieu est bien davantage qu'un loup pour l'homme, car il devient ou redevient alors un sauvage, un démon. Écoutons le prêtre de Fenouille annoncer un monde qui, s'étant débarrassé de Dieu, n'est toutefois pas parvenu à annihiler la si douloureuse nostalgie de la pureté : «N’importe ! dit le prêtre. Vous aurez un jour la preuve qu’on ne fait pas au surnaturel sa part. Oui, reprit-il après un silence, de cette voix qui contrastait chaque fois si étrangement avec son ton habituel qu’elle semblait appartenir à un autre, lorsque vous aurez tari chez les êtres non seulement le langage mais jusqu’au sentiment de la pureté, jusqu’à la faculté de discernement du pur et de l’impur, il restera l’instinct. L’instinct sera plus fort que vos lois, vos mœurs. Et si l’instinct même est détruit, la souffrance subsistera encore, une souffrance à laquelle personne ne saura plus donner de nom, une épine empoisonnée au cœur des hommes. Supposons qu’un jour soit consommée l’espèce de révolution qu’appellent de leurs vœux les ingénieurs et les biologistes, que soit abolie toute hiérarchie des besoins, que la luxure apparaisse ainsi qu’un appétit des entrailles analogue aux autres et dont une stricte hygiène règle seule l’assouvissement, vous verrez ! – oui, vous verrez ! – surgir de toutes parts des maires de Fenouille qui tourneront contre eux, contre leur propre chair, une haine désormais aveugle, car les causes en resteront enfouies au plus obscur, au plus profond de la mémoire héréditaire. Alors que vous vous flatterez d’avoir résolu cette contradiction fondamentale, assuré la paix intérieure de vos misérables esclaves, réconcilié notre espèce avec ce qui fait aujourd’hui son tourment et sa honte, je vous annonce une rage de suicides contre laquelle vous ne pourrez rien. Plus que l’obsession de l’impur, craignez donc la nostalgie de la pureté. Il vous plaît de reconnaître dans la sourde révolte contre le désir, la crainte entretenue depuis tant de siècles par les religions, servantes sournoises du législateur et du juge. Mais l’amour de la pureté, voilà le mystère ! L’amour chez les plus nobles, et chez les autres la tristesse, le regret, l’indéfinissable et poignante amertume plus chère au débauché que la souillure elle-même. Passe pour les lâches traqués par l’angoisse de la souffrance ou de la mort qui viennent implorer du médecin leur grâce, mais j’ai vu, – oui, j’ai vu – se lever vers moi d’autres regards ! Et d’ailleurs, il n’est plus temps de convaincre, le proche avenir se chargera de nous départager. Au train où va le monde, nous saurons bientôt si l’homme peut se réconcilier avec lui-même, au point d’oublier sans retour ce que nous appelons de son vrai nom l’antique Paradis sur la terre, la joie perdue, le Royaume perdu de la Joie» (pp. 1525-6). Nous pourrions longuement commenter ce passage extraordinaire, ajoutai-je dans cette même note, passage auquel je ne vois pas d'équivalent dans les romans de langue française, mais qui a peut-être constitué la matrice des textes d'un Walker Percy, dont les romans pourraient je crois être lus comme autant d'illustrations des conséquences, à même la vie pratique la plus commune, sans oublier la psychologie humaine, provoquées par l'irrécusable évidence que nous vivons désormais dans un monde qui sait admirablement, du moins en apparence, se passer de Dieu et même de toute véritable quête spirituelle.»
Ainsi, le prêtre commence par poser un paradoxe : «Pour reprendre l’expression qui vous a surpris tout à l’heure, on ne peut nier que Dieu se soit fait petit depuis longtemps, très petit. D’où l’on conclut qu’il se fera petit demain comme hier, plus petit, de plus en plus petit. Rien, cependant, ne nous oblige à le croire» (p. 1508) (5). Le pauvre, autant dire l'homme occidental dans son ensemble, n'a plus de mots pour nommer ce qui lui manque, et c'est dans ce silence ajoute Bernanos, ou plutôt, dans ce mutisme, que le Mal va finir de digérer sa proie, non sans que cette dernière, ne comprenant pas ce qui lui arrive, jette une toute dernière fois ses forces, sa colère et peut-être même sa haine dans l'assaut final. Dieu les aurait prises, cette colère et cette haine, car la révolte vaut toujours mieux que l'impassibilité, le désespoir, mais sait-on ce que l'Autre fera de tels aliments ? : «Oui, monsieur, l’heure vient (peut-être est-elle déjà venue ?) où le désir qu’on croit avoir muré au fond de la conscience et qui y a perdu jusqu’à son nom va faire éclater son sépulcre. Et, si toute autre issue lui est fermée, il en trouvera une dans la chair et le sang – oui, monsieur – vous le verrez paraître sous des formes inattendues et, j’ose le dire, hideuses, horribles. Il empoisonnera les intelligences, il pervertira les instincts et… qui sait ? pourquoi le corps, notre misérable corps sans défense ne paierait-il pas une fois de plus la rançon de l’â… de l’autre ? une nouvelle rançon ?» (pp. 1509-10). Le médecin de Fenouille résume le propos de celui qu'il n'hésite pas à traiter de confrère, sans doute par pure politesse : «C’est de la folie [...], de la folie pure. Les trois vertus théologales passant du monde invisible au monde visible, transformées en tumeurs malignes, je suppose ? Monsieur, il est permis de se demander ce qu’on penserait en haut lieu de ces extraordinaires divagations» (p. 1510). Quelques pages plus loin, il tentera, discutant avec le prêtre des obsessions du maire de Fenouille, qui reste visiblement «hanté par le fantôme de ses innocences perdues», de définir de nouveau les étonnantes idées du curé, en affirmant : «Si je vous entends bien, vous prétendez qu’une certaine déficience… du sentiment religieux… pourrait se traduire par… certains phénomènes pathologiques… qui iraient même… jusqu’à une transformation profonde de… de l’espèce ?…» (p. 1524). Le prêtre ne tarde pas à répondre au médecin, et je cite intégralement ce passage vraiment remarquable, qui sonde notre propre présent, mais aussi, surtout, ce qu'il nous sera peut-être donné de voir, avec une justesse véritablement remarquable, passage qui à lui seul nous permet de dire que le dernier roman de Georges Bernanos représente une plongée absolument inédite à ma connaissance dans des eaux pour le moins aussi profondes que dangereuses, qui plus est susceptibles de provoquer bien des remous et des grimaces de dégoût : quoi, un écrivain peut-il se prétendre, sans craindre le ridicule, se prendre pour un prophète ? Il semblerait que oui, et nul besoin pour ce faire de plaider l'existence, pour le moins suspecte, d'un quelconque don de seconde vue, car Georges Bernanos, dans son dernier roman, ne fait finalement que tirer des conséquences logiques, bien qu'extrêmes, des propositions (la poisse que d'écrire comme un universitaire, à coup de concaténations et de petites déductions !) qu'il a tenté d'illustrer dans chacun de ses écrits : l'homme sans Dieu est bien davantage qu'un loup pour l'homme, car il devient ou redevient alors un sauvage, un démon. Écoutons le prêtre de Fenouille annoncer un monde qui, s'étant débarrassé de Dieu, n'est toutefois pas parvenu à annihiler la si douloureuse nostalgie de la pureté : «N’importe ! dit le prêtre. Vous aurez un jour la preuve qu’on ne fait pas au surnaturel sa part. Oui, reprit-il après un silence, de cette voix qui contrastait chaque fois si étrangement avec son ton habituel qu’elle semblait appartenir à un autre, lorsque vous aurez tari chez les êtres non seulement le langage mais jusqu’au sentiment de la pureté, jusqu’à la faculté de discernement du pur et de l’impur, il restera l’instinct. L’instinct sera plus fort que vos lois, vos mœurs. Et si l’instinct même est détruit, la souffrance subsistera encore, une souffrance à laquelle personne ne saura plus donner de nom, une épine empoisonnée au cœur des hommes. Supposons qu’un jour soit consommée l’espèce de révolution qu’appellent de leurs vœux les ingénieurs et les biologistes, que soit abolie toute hiérarchie des besoins, que la luxure apparaisse ainsi qu’un appétit des entrailles analogue aux autres et dont une stricte hygiène règle seule l’assouvissement, vous verrez ! – oui, vous verrez ! – surgir de toutes parts des maires de Fenouille qui tourneront contre eux, contre leur propre chair, une haine désormais aveugle, car les causes en resteront enfouies au plus obscur, au plus profond de la mémoire héréditaire. Alors que vous vous flatterez d’avoir résolu cette contradiction fondamentale, assuré la paix intérieure de vos misérables esclaves, réconcilié notre espèce avec ce qui fait aujourd’hui son tourment et sa honte, je vous annonce une rage de suicides contre laquelle vous ne pourrez rien. Plus que l’obsession de l’impur, craignez donc la nostalgie de la pureté. Il vous plaît de reconnaître dans la sourde révolte contre le désir, la crainte entretenue depuis tant de siècles par les religions, servantes sournoises du législateur et du juge. Mais l’amour de la pureté, voilà le mystère ! L’amour chez les plus nobles, et chez les autres la tristesse, le regret, l’indéfinissable et poignante amertume plus chère au débauché que la souillure elle-même. Passe pour les lâches traqués par l’angoisse de la souffrance ou de la mort qui viennent implorer du médecin leur grâce, mais j’ai vu, – oui, j’ai vu – se lever vers moi d’autres regards ! Et d’ailleurs, il n’est plus temps de convaincre, le proche avenir se chargera de nous départager. Au train où va le monde, nous saurons bientôt si l’homme peut se réconcilier avec lui-même, au point d’oublier sans retour ce que nous appelons de son vrai nom l’antique Paradis sur la terre, la joie perdue, le Royaume perdu de la Joie» (pp. 1525-6). Nous pourrions longuement commenter ce passage extraordinaire, ajoutai-je dans cette même note, passage auquel je ne vois pas d'équivalent dans les romans de langue française, mais qui a peut-être constitué la matrice des textes d'un Walker Percy, dont les romans pourraient je crois être lus comme autant d'illustrations des conséquences, à même la vie pratique la plus commune, sans oublier la psychologie humaine, provoquées par l'irrécusable évidence que nous vivons désormais dans un monde qui sait admirablement, du moins en apparence, se passer de Dieu et même de toute véritable quête spirituelle.»Revenons, après cette brève plongée en eaux profondes, à Mon cœur mis à nu, où nous retrouvons des traces de la pensée maistrienne, non seulement pour ce qui concerne la doctrine du péché originel, à laquelle plus personne, surtout pas les catholiques je le crains, ne croit plus, mais aussi pour l'idée, paresseuse par excellence (6), du progrès, comme ici : «Théorie de la vraie civilisation. Elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes, elle est dans la diminution des traces du péché originel» (p. 111) ou encore, en quelques lignes plus développées évoquant la Belgique : «La croyance au progrès est une doctrine de paresseux, une doctrine de Belges. C'est l'individu qui compte sur ses voisins pour faire la besogne. Il ne peut y avoir de progrès (vrai, c'est-à-dire moral) que dans l'individu et par l'individu lui-même» (feuillet 15, p. 95, l'auteur souligne). Baudelaire, lui, décidément assez peu enclin à faire sien le mot, qui restera dit-il, de Saint-Marc Girardin, «Soyons médiocres» (feuillet 57, p. 110), semble croire au Jugement dernier, certes de manière pour le moins badine (7) et même à l'immortalité, non seulement de l'âme, mais de toute œuvre de l'esprit : «Toute idée est, par elle-même, douée d'une vie immortelle, comme une personne. Toute forme créée, même pour l'homme, est immortelle. Car la forme est indépendante de la matière, et ce ne sont pas les molécules qui constituent la forme» (feuillet 79, p. 119).
C'est dans ses Fusées que Baudelaire évoque directement son admiration pour Joseph de Maistre et Edgar Alan Poe qui lui ont appris à raisonner (cf. feuillet 89, p. 86) et critique la notion de Progrès, la déclarant absurde «puisque l'homme, comme cela est prouvé par le fait journalier, est toujours semblable et égal à l'homme, c'est-à-dire toujours à l'état sauvage» (feuillet 21, p. 79). Il prolonge à mon sens l'idée que nous avons longuement commentée plus haut, en la rapprochant de son étonnante efflorescence dans le dernier roman de Bernanos, lorsqu'il moque les «peuples civilisés», qui parlent «toujours sottement de sauvages et de barbares, et qui cependant bientôt, comme le dit d'Aurevilly selon le poète, ne vaudront «même plus assez pour être idolâtres» (feuillet 22, p. 80, l'auteur souligne). Dans ce même feuillet, le plus long des Fusées, Baudelaire affirme que «le monde va finir», ajoutant ce paradoxe selon lequel «la seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe», et peignant son avenir, c'est-à-dire notre présent, en ces termes : «Nous périrons par où nous avons cru vivre» car «la mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges, ou anti-naturelles des utopistes ne pourra être comparé à ses résultats positifs». Vient cette phrase, superbe de hauteur, épouvantable si l'on s'avise de songer qu'elle nous condamne : «Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie», le poète poursuivant en déclarant que «la ruine universelle» sera produite par «l'avilissement des cœurs» : «Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l'animalité générale, et que les gouvernants seront forcés, pour se maintenir et créer un fantôme d'ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie ?». Ce n'est pas tout car, alors, demain, aujourd'hui à vrai dire, «le fils fuira la famille, non pas à dix-huit ans, mais à douze, émancipé par sa précocité gloutonne; il la fuira, non pas pour chercher des aventures héroïques, non pas pour délivrer une beauté prisonnière dans une tour, non pas pour immortaliser un galetas par de sublimes pensées, mais pour fonder un commerce, pour s'enrichir, et pour faire concurrence à son infâme papa», lui-même «fondateur et actionnaire d'un journal qui répandra les lumières et qui ferait considérer Le Siècle d'alors comme un suppôt de la superstition» (pp. 82-3).
Nous en sommes là, et il faut bien évidemment remercier Charles Baudelaire pour sa lucide alacrité saluée par André Guyaux, lui qui, en décrivant la société française tout entière devenue belge après avoir contaminé celle-ci, donc peu ou prou universelle, ne cessa de nous avertir du danger extrême, moins à venir que d'ores et déjà présent, et de pointer notre lâcheté pour tenter de le réduire car, bien sûr, nous n'avons rien fait pour inverser la chute (la vapeur, allais-je écrire en reprenant la métaphore du progrès discontinu) et avons même, au contraire, accéléré le mouvement.
Notes
(1) Chez Gallimard, coll. Folio classique, 2002. Sans autre mention, la pagination indiquée renvoie à cette édition.
(2) Dans son hélas inusable Baudelaire cité en note 23 par André Guyaux qui ne manque pas d'étriller ce prodigieux sot.
(3) Parlant de dégénérescence, notons que Baudelaire classe, non sans éprouver quelque difficulté d'ailleurs, les Belges «entre le Singe et le Mollusque», ajoutant méchamment qu'«il y a de la place» (feuillet 75, p. 171).
(4) Dans une lettre du 5 juin 1863 à Mme Aupick citée dans le dossier de notre ouvrage, pp. 498-9.
(5) Je me sers de l'édition en un volume, dans la collection La Pléiade et datant de 1974, des romans de Georges Bernanos.
(6) Plusieurs fois, Baudelaire affirme que la croyance dans l'idée de progrès ne peut qu'être le fait de paresseux : «Voltaire, comme tous les paresseux, haïssait le mystère» (feuillet 30, p. 101) ou, parlant des «abolisseurs de la peine de mort» qui sont aussi des abolisseurs d'âme, puisqu'ils sont matérialistes, intéressés au fait d'abolir l'Enfer car «ce sont des gens qui ont peur de revivre», autrement dit, là encore, «des paresseux» (feuillet 23, p. 98).
(7) «J'ai oublié le nom de cette salope... ah ! bah ! je le retrouverai au jugement dernier» (feuillet 70, p. 116).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, charles baudelaine, mon cœur mis à nu, la belgique déshabillée, fusées, joseph de maistre, monsieur ouine, georges bernanos, arthur machen, poésie |  |
|  Imprimer
Imprimer
