Entretien autour de l’anthologie J’ai mis la main à la charrue : Gregory Mion et Henri Rosset aiguisent le soc afin de rendre la terre moins vaine, 3 (02/03/2023)

 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone. Entretien, 1.
Entretien, 1. Entretien, 2.
Entretien, 2.Henri Rosset
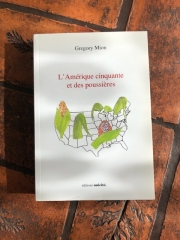 Cette évocation du Mexique – ce furieux «pays des pulques et des chinches» dont la beauté «fatale est purificatrice» comme le disait Malcolm Lowry – n'est pas sans nous rappeler votre roman L'Amérique cinquante et des poussières dont le premier chapitre s'enracine à Albuquerque, en plein cœur du Nouveau-Mexique américain. Nous apprenons que dans cette ville «vivait un grand-père mélancolique» qui disait du Mexique que ce «n'était plus un pays», mais plutôt une «dépossession» (p. 17 de L'Amérique cinquante et des poussières). Pour poursuivre cette évocation mythique du Mexique, citons encore Lowry et la somptueuse lettre qu'il envoya à son éditeur Jonathan Cape : «[Le Mexique] est une sorte de symbole intemporel du monde où l’on peut placer le Jardin d’Éden, la Tour de Babel et tout ce que l’on voudra. Le Mexique est paradisiaque; il est, sans conteste, infernal.» Par ces quelques extraits nous saisissons à quel point la fine pointe maniée par la littérature porte en sa sculpture même l'approfondissement du monde sensible. L'écrivain situerait alors son œuvre à rebours de ces compilations historiques qui se contentent bien souvent de plaquer une linéarité temporelle sur le chaos des évènements. Mettant la main à la charrue, dans le profond sillage labouré par Kierkegaard, l'écrivain est peut-être condamné à «enfoncer son doigt dans l'existence» pour en déterrer les pulsations enfouies.
Cette évocation du Mexique – ce furieux «pays des pulques et des chinches» dont la beauté «fatale est purificatrice» comme le disait Malcolm Lowry – n'est pas sans nous rappeler votre roman L'Amérique cinquante et des poussières dont le premier chapitre s'enracine à Albuquerque, en plein cœur du Nouveau-Mexique américain. Nous apprenons que dans cette ville «vivait un grand-père mélancolique» qui disait du Mexique que ce «n'était plus un pays», mais plutôt une «dépossession» (p. 17 de L'Amérique cinquante et des poussières). Pour poursuivre cette évocation mythique du Mexique, citons encore Lowry et la somptueuse lettre qu'il envoya à son éditeur Jonathan Cape : «[Le Mexique] est une sorte de symbole intemporel du monde où l’on peut placer le Jardin d’Éden, la Tour de Babel et tout ce que l’on voudra. Le Mexique est paradisiaque; il est, sans conteste, infernal.» Par ces quelques extraits nous saisissons à quel point la fine pointe maniée par la littérature porte en sa sculpture même l'approfondissement du monde sensible. L'écrivain situerait alors son œuvre à rebours de ces compilations historiques qui se contentent bien souvent de plaquer une linéarité temporelle sur le chaos des évènements. Mettant la main à la charrue, dans le profond sillage labouré par Kierkegaard, l'écrivain est peut-être condamné à «enfoncer son doigt dans l'existence» pour en déterrer les pulsations enfouies. C'est peut-être par cet enfouissement dans l'existence que la forme même de L'Amérique cinquante et des poussières est étonnante. On pressent à sa lecture que ce découpage des chapitres insuffle en chacun d'eux la pénétrante mission de saisir le souffle souterrain de chaque État américain. Bien loin du simple amas d'impressions, l'ensemble est relié par la trame d'un récit qui ne cesse d'enfoncer ses linéaments vers un abîme incertain – où le romanesque rejoint les rivages de la dramaturgie. Ce qui nous amène nécessairement à vous demander si vous estimez, à la suite de votre expérience du roman, que seule la forme romanesque vous semble à même de saisir la juste mesure de la pulsion dionysiaque de l'Amérique – là où l'essai ou le livre d'histoire ne saisirait que les contours visibles d'une réalité apollinienne ? (Nous ne doutons pas en outre que Shelby Foote démentirait sûrement cette affirmation, comme le prouve son immense The Civil War: A Narrative écrit après ses impardonnables romans).
Gregory Mion
 Tout d’abord, sur le Mexique enivrant qui jamais ne nous laisse de marbre, sur le Mexique, aussi, de la vermine entomologique qui rend fou, je le perçois, au regard de ce que vous en dites avec Malcolm Lowry, comme la terre superlative de l’Amérique où les paradis et les enfers vont plus haut et plus bas que partout ailleurs dans la galaxie. À la fois terre sainte et terre maudite, entrelacs de bénédictions et de malédictions, le Mexique concorde aussi bien avec l’heure de midi de Nietzche (24) – un précieux fuseau d’Appartenance où l’âme se repose indéfiniment dans les fonts baptismaux de la totalité vivante, immergée dans le Tout, contemplative d’une exhaustive et inestimable réalité photonique – qu’avec l’heure antinomique de minuit où l’ombre la plus dense pourrait se dissocier de la lumière et vaincre la vie. C’est la raison pour laquelle je serais plutôt enclin à croire qu’un écrivain tel que le voyant Lowry a sûrement vu au Mexique l’inquiétante silhouette de Pan, allongée, somnolente (25), émissaire palpable de l’impalpable totalité de l’éternelle fécondité, qu’il a vu cette divinité composite quelque part à l’angle d’une rue de Mexico ou alors dans ses prémonitions, dans ses visions d’une quelconque chambre magmatique à l’origine d’Under the volcano, qu’il s’en est inspiré, qu’il a pu intrépidement marcher sur ses plates-bandes, tout comme, évidemment, il doit avoir vu dans ce Mexique bâtard l’insurrection des ténèbres, la charge des gouffres à l’intérieur desquels macèrent les créatures hostiles au règne vivant – les dépeceuses rancunières de la plénitude. Ainsi, à un degré probablement supérieur par rapport aux autres pays de l’Amérique et même par rapport au reste du monde, le Mexique est capable périodiquement de nous faire vivre midi à minuit et minuit à midi, de nous submerger de vie ou de nous saturer de mort, les deux facettes étant indissociables de n’importe quelle expérience mexicaine ou de n’importe quelle œuvre qui prendrait le Mexique pour climat narratif. Tour à tour le Mexique promet la félicité mirobolante et cette espèce d’infelicità qui semble s’être déportée des chants de Giacomo Leopardi pour infester perfidement les nappes phréatiques de cette nation où coulent tantôt des eaux d’or, tantôt des eaux de plomb, tantôt la légèreté intimidante d’une étincelante éternité, tantôt la lourdeur écœurante d’une éternité de cendres. Quel bon roman du Mexique ne nous fait pas sentir cela ? Quelle incursion fictive – ou réelle – au Mexique ne s’expose pas à l’incommode éventail de ces deux éternités incessamment mises en péril ? Nulle part ailleurs qu’au Mexique ne se ressent avec autant de vigueur cette lutte cosmique, cette polémologie astronomique, cette gigantomachie où le divin ne dispose pas des atouts définitifs pour écraser le malin. J’aime à penser que c’est cela qui a fait peur aux deux compères de Sur la route au terminus de leur voyage, comme c’est cela, peut-être, qui a tué Neal Cassady à San Miguel de Allende, comme c’est cela encore qui fait certainement tituber le mémorable consul de Malcolm Lowry, toujours en équilibre précaire sur une corde suspendue au-dessus d’une barranca illuminée et d’une barranca enténébrée.
Tout d’abord, sur le Mexique enivrant qui jamais ne nous laisse de marbre, sur le Mexique, aussi, de la vermine entomologique qui rend fou, je le perçois, au regard de ce que vous en dites avec Malcolm Lowry, comme la terre superlative de l’Amérique où les paradis et les enfers vont plus haut et plus bas que partout ailleurs dans la galaxie. À la fois terre sainte et terre maudite, entrelacs de bénédictions et de malédictions, le Mexique concorde aussi bien avec l’heure de midi de Nietzche (24) – un précieux fuseau d’Appartenance où l’âme se repose indéfiniment dans les fonts baptismaux de la totalité vivante, immergée dans le Tout, contemplative d’une exhaustive et inestimable réalité photonique – qu’avec l’heure antinomique de minuit où l’ombre la plus dense pourrait se dissocier de la lumière et vaincre la vie. C’est la raison pour laquelle je serais plutôt enclin à croire qu’un écrivain tel que le voyant Lowry a sûrement vu au Mexique l’inquiétante silhouette de Pan, allongée, somnolente (25), émissaire palpable de l’impalpable totalité de l’éternelle fécondité, qu’il a vu cette divinité composite quelque part à l’angle d’une rue de Mexico ou alors dans ses prémonitions, dans ses visions d’une quelconque chambre magmatique à l’origine d’Under the volcano, qu’il s’en est inspiré, qu’il a pu intrépidement marcher sur ses plates-bandes, tout comme, évidemment, il doit avoir vu dans ce Mexique bâtard l’insurrection des ténèbres, la charge des gouffres à l’intérieur desquels macèrent les créatures hostiles au règne vivant – les dépeceuses rancunières de la plénitude. Ainsi, à un degré probablement supérieur par rapport aux autres pays de l’Amérique et même par rapport au reste du monde, le Mexique est capable périodiquement de nous faire vivre midi à minuit et minuit à midi, de nous submerger de vie ou de nous saturer de mort, les deux facettes étant indissociables de n’importe quelle expérience mexicaine ou de n’importe quelle œuvre qui prendrait le Mexique pour climat narratif. Tour à tour le Mexique promet la félicité mirobolante et cette espèce d’infelicità qui semble s’être déportée des chants de Giacomo Leopardi pour infester perfidement les nappes phréatiques de cette nation où coulent tantôt des eaux d’or, tantôt des eaux de plomb, tantôt la légèreté intimidante d’une étincelante éternité, tantôt la lourdeur écœurante d’une éternité de cendres. Quel bon roman du Mexique ne nous fait pas sentir cela ? Quelle incursion fictive – ou réelle – au Mexique ne s’expose pas à l’incommode éventail de ces deux éternités incessamment mises en péril ? Nulle part ailleurs qu’au Mexique ne se ressent avec autant de vigueur cette lutte cosmique, cette polémologie astronomique, cette gigantomachie où le divin ne dispose pas des atouts définitifs pour écraser le malin. J’aime à penser que c’est cela qui a fait peur aux deux compères de Sur la route au terminus de leur voyage, comme c’est cela, peut-être, qui a tué Neal Cassady à San Miguel de Allende, comme c’est cela encore qui fait certainement tituber le mémorable consul de Malcolm Lowry, toujours en équilibre précaire sur une corde suspendue au-dessus d’une barranca illuminée et d’une barranca enténébrée. Ce plasma mexicain procède d’une physiologie unique dont on peut retrouver quelques traits communs dans la Provence de Jean Giono, plus particulièrement dans la Trilogie de Pan, une série de textes qui transcrit le pourtour et le noyau d’une Occitanie synchroniquement matutinale et vespérale. En outre, pour aller plus loin dans la caractérisation du Mexique et pour compléter ce que j’évoquais avec l’excursion italienne de Max Picard, selon les mots de ce dernier, il y aurait sur cette tierra extraña, par analogie avec le territoire transalpin, une tendance du «passé [à être] toujours en plein dans le présent» (26), une insistance archaïsante, un accent duratif qui élargit le présent au volume de l’éternel, qui l’amplifie au diapason d’une symphonie où l’Ancien vibre fièrement dans le Moderne, là où ne se perdent pas ce que vous nommez si congrûment «les pulsations enfouies», là où l’engouffrement des mystères palpitants (peut-être identiques à ce cœur pour les dieux du Mexique tellement cher à Aiken (27)) s’éternise dans l’actuel déploiement de los Estados Unidos Mexicanos, là où le passé continuellement recomposé s’apparenterait à «l’immense rumeur de la mer qui se déverse dans la cataracte indéfinie du monde» (28). Une telle royauté du Présent Éternel ne peut que déborder de son épicentre et inonder comme une eau vive, pulsative, pulsionnelle et sotériologique l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, comme l’Italie incorruptible de Picard, supposons-le, a pu vasculariser ici ou là, pour les éveillés, une Europe en perdition, arythmique, épuisée par ses guerres et par son consécutif dogmatisme technocratique. Je veux alors imaginer que le Mexique serait la source indiscutable des grandes littératures américaines, l’amont de tous les fleuves romanesques du Nouveau Monde, et même, osons le présumer, le générateur d’un feu sacré qui déjoue encore les méchantes entreprises de la glaciation du devenir, ne serait-ce déjà qu’au niveau de ses frontières terrestres, sur les mythiques rebords de la Californie, de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas, sans oublier le Guatemala et le Belize. Il est indéniable que des résistances émergent aux confins de ces zones géographiques, que des tressaillements s’emparent de ceux qui s’y aventurent, que des dionysies d’un ordre indicible s’adjugent les volontés de ces aventuriers et qu’elles les préservent des empires de la frigidité capitalistique. C’est un phénomène prégnant dans les livres hantés par le Mexique et par ses frontières poreuses, mais c’est quelque chose, aussi, que l’on peut observer par exemple dans le magistral et préoccupant Sicario de Denis Villeneuve (29). On y reconnaît le Mexique en tant que pourvoyeur de vie et de mort intenses, en tant que rectification d’une ère annoncée ou actualisée de l’androïde, de l’individu vidé de toute organicité, en tant que rappel à l’ordre du désordre occidental des hommes frigorifiés, des hommes adeptes de la cryogénisation tous azimuts.
Ce Mexique-là n’est vraiment pas soluble dans les infusions de la logique ou de la théorie. Il ne peut être que littéraire, cinématographique, esthétique en un mot, exempté d’une approche apollinienne d’autant plus regrettable, d’autant plus aride qu’elle illustre désormais un changement de paradigme largement redouté par Nietzsche, c’est-à-dire ce moment où la science devient un problème (30) parce qu’elle est recrutée pour fournir une élucidation algébrique et bientôt algorithmique du monde. C’est une étape critique où la référence apollinienne se déprend de sa contrepartie dionysiaque et profère une compréhension rigide de la vie en nous et autour de nous. Le mode causal – ou exagérément discursif – l’emporte ici sur le mode intuitif et réduit l’infinité fluente de la réalité à la dictature de la limite atrophiée. Sans surprise, ce défaut de vitalité intellectuelle touche la plupart des essais universitaires et confirme tout au long du XXe siècle progressivement désensibilisé l’apothéose de l’homme théorique vilipendé par Nietzsche au détriment de l’homme de chair et de sang. L’exception de Shelby Foote se justifie toutefois en ce sens que son histoire de la guerre civile américaine n’est pas tributaire d’un carcan académique : il écrit son narrative à l’instar d’un romancier et il agrandit encore le sujet de la guerre, tandis que les universitaires, eux, rapetissent même les plus vastes sujets. À partir de là, je soutiens le principe que l’essai, l’article, la recension (ou tout ce que vous voudrez de codifié) doit faire affleurer au sein même du tracé théorique un genre d’immensité romanesque pour éviter de sombrer laborieusement dans les minuscules formats institutionnels. J’assume ainsi la tentation du style dans tous mes textes formels, l’imperfection décomplexée, l’éventuel superflu de la digression, la violente sortie de route, et, faisant cela, je ne pouvais décidément pas écrire une centaine de pages sur le Mexique de Roberto Bolaño à l’image de ces universitaires qu’il brocarde dans la première partie de 2666. Malheureusement, on en est arrivé à un point de décadence tel que presque tous les universitaires, les professeurs et les intellectuels assermentés ne sont plus compétents pour honorer leurs sujets de prédilection putatifs : ce sont les êtres les plus malingres, les plus vils, les plus ignoblement démocratiques qui sont en charge d’étudier et de faire étudier les êtres les plus forts, les plus complexes et les plus parfaitement aristocratiques. N’est-ce pas cela que Bolaño dénonce avec une jubilante cravache verbale, fouettant la cuisse du hongre pédantesque que serait l’Université européenne ? Le souci, bien entendu, c’est que ce système des faibles pleins de rancune a passablement contaminé la littérature et tend dorénavant à instituer des romans d’une absolue stérilité, des romans rédigés et donc non écrits, des livres pour l’économie de marché à destination du robot occidental qui ne sait plus lire, sentir, contempler et même aimer. Tout cela est forcément concomitant d’une dégradation du langage et par conséquent d’une dégradation humaine, d’un accès au monde et à soi-même monstrueusement simplifié, ce qui présage le pire des naufrages pour autant que nous demeurions encore à la surface : un monde où ce n’est pas l’animal qui serait pauvre en monde comme l’a prétendu Heidegger, mais un monde où l’homme lui-même aurait déjà dépassé ce déficit existentiel en tant qu’il s’efforcerait maintenant d’être sans monde, inexpressif, intransitif, tel un minéral (31) sur lequel ne pourrait même pas perler la poétique rosée du matin.
Ce monde-là, ce monde catastrophique, ce n’est pas le monde du Mexique invulnérable. Au sein de ses citadelles imprenables, le Mexique abrite encore des hommes et des femmes dont les visages – et les esprits – ne sont pas détruits par l’inhumanité rampante, des hommes et des femmes qui ont des visages «intacts» eût dit Max Picard, à ceci près que «semblables visages [sont] isolés, [ils ne peuvent] plus se mettre en route vers d’autres, [ils ont] l’immobilité pleine de noblesse des statues romanes de pierre, mais [ce n’est pas] la rigidité de la pierre, [ils sont] quelque chose de vivant» (32). J’insiste sur la configuration sensible de ces visages étant donné que je la vois comme un radical démenti de la configuration insensible du visage préconisé par le Capital – photogénique, télégénique, moralement tératogénique en fin de compte. Aussi ce n’est pas un hasard si dans L’Amérique cinquante et des poussières l’un des personnages les plus marginalisés, les plus déconsidérés par la société nord-américaine, se trouve être un jeune homme d’origine mexicaine. Je décris péjorativement et à dessein son visage comme si c’était les États-Unis qui en établissaient le portrait offensant. Les guichets de la réussite sont plus étroits et beaucoup moins nombreux pour ce représentant de la minorité hispanique, mais à l’inverse de tant d’Américains de son âge, il n’est pas étranger à la vie et à la prise de risque. Peu à peu, à l’encontre des injustices qu’il a subies et que les États-Unis sécrètent
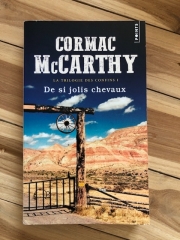 abondamment, il s’affirme comme un visage de la justice, comme un redéfinition également de la désobéissance, et, surtout, comme un foyer d’ivresse dionysiaque. C’est par son intermédiaire que l’aventure amoureuse prend tout son sens pour une jeune fille d’Amérique. Auprès de lui, elle va réveiller la meilleure part d’elle-même, et, d’ailleurs, ce réveil fait transparaître la meilleure part du visage princeps de l’Amérique : un visage derrière lequel l’âme du Nathanaël de la Bible se devine, une âme où aucune espèce de fraude ne pourrait se détecter – un visage antérieur à la défiguration apollinienne où sévit la plus trompeuse des beautés, à savoir la beauté du Capital, la beauté du calcul, la beauté de la proportion sanitaire, la beauté absente des univers de Cormac McCarthy mais omniprésente dans les univers de Don DeLillo.
abondamment, il s’affirme comme un visage de la justice, comme un redéfinition également de la désobéissance, et, surtout, comme un foyer d’ivresse dionysiaque. C’est par son intermédiaire que l’aventure amoureuse prend tout son sens pour une jeune fille d’Amérique. Auprès de lui, elle va réveiller la meilleure part d’elle-même, et, d’ailleurs, ce réveil fait transparaître la meilleure part du visage princeps de l’Amérique : un visage derrière lequel l’âme du Nathanaël de la Bible se devine, une âme où aucune espèce de fraude ne pourrait se détecter – un visage antérieur à la défiguration apollinienne où sévit la plus trompeuse des beautés, à savoir la beauté du Capital, la beauté du calcul, la beauté de la proportion sanitaire, la beauté absente des univers de Cormac McCarthy mais omniprésente dans les univers de Don DeLillo. Solidaire de ce visage mexicain révolté, un autre personnage emblématique de L’Amérique cinquante et des poussières se détache par son vivant faciès en contradiction avec la momification généralisée des États-Unis : l’acnéique, le furonculeux, le pustuleux Xavier Mamoulian, immigré français dont le visage est ravagé de bubons versicolores, autant de perturbations glandulaires qui manifestent un excès de vitalité, une vive dérégulation au milieu d’un contrôle macabre et pas toujours visible des individus américains. Avec Mamoulian, la vie ne quitte jamais sa dimension naturelle, sa vérité excessive, à tel point que les données les plus fiables le concernant sont quasiment toutes rattachées aux divers écoulements des fluides corporels. Il y a chez Mamoulian un occulte génome du Mexique confondu aux chromosomes de la France, une hybridation de Pancho Villa et de Jean-François Varlet, un déroutant parallélisme monadologique avec Emilio Velasquez, le Mexicain dissident et bachique, somme toute une manière pour lui de refléter en chacune de ses motions intérieures tout le cosmos de ce rebelle qu’il ignore, au même titre que celui-ci, enragé de justice et de pasíon amorosa, fait miroiter en lui toute la nébuleuse spasmodique du Français constamment défié par ses dérèglements. Il est par conséquent inutile, me semble-t-il, de préciser en quoi le roman est ici le seul médium envisageable afin de traduire tout ce réseau hormonal, toute cette furie pulsionnelle, tout ce soubassement primitif de l’Amérique, toute cette profonde rémanence de l’authentique en contre-pied de l’inauthenticité qui pullule au niveau de l’écorce de la nation américaine. Des protagonistes comme Velasquez, Mamoulian et quelques autres érodent la carapace du Capital – malgré leurs valses-hésitations avec ce mode de vie – et libèrent discrètement le cœur de l’Amérique, la rapprochant d’une sainteté originelle qui lui permet de contester une satiété destructrice. Ils incarnent la plus printanière des possibilités divines, la possibilité de Dionysos parmi l’hégémonie d’Apollon, le fait qu’à Dieu rien n’est impossible – et qu’un chameau passera par le trou d’une aiguille bien avant qu’un riche ne devienne éligible au Royaume de Dieu (33). Et cela, en l’occurrence cet afflux de Dionysos, ce déluge d’impétuosité, je dirais qu’on le ressent nettement dans tous les États US limitrophes du Mexique de L’Amérique cinquante et des poussières, comme si, inconsciemment, chaque fois que j’avais abordé un chapitre pour ces régions distinctes, je n’avais pas pu faire autrement que de consentir à l’évidence de la vida máxima.
Henri Rosset
Pour revenir à ces injustices que «les États-Unis sécrètent abondamment», il en est une qui semble particulièrement retenir votre attention : la ségrégation. Le titre même de la première partie de J'ai mis la main à la charrue se nomme ainsi Ségrégation(s) – titre dont le (s) est évocatoire quant à la plurivocité de l'injustice. Plusieurs œuvres sont colligées dans ce chapitre où l'on entrevoit tour à tour les relents d'inhumanité qui n'ont cessé de destituer l'homme : la ségrégation sud-africaine chez André Brink et son Au plus noir de la nuit, l'antisémitisme dans L'esclave d’Isaac Bashevis Singer, l'enfance profanée chez Henry Darger, Charles Dickens et Carson McCullers, ou encore la pulsion criminelle dans Crime et châtiment de Dostoïevski, et même l’Algérie en guerre de Mouloud Mammeri. Toutes ces corolles douloureuses, filles d'une «matrice commune de la calamité» pour reprendre vos mots à propos du somptueux Louons maintenant les grands hommes de James Agee (p. 23 de J'ai mis la main à la charrue), résonnent particulièrement pour nous autres contemporains, enfants d'une modernité stérile – «Notre héritage n'est précédé d'aucun testament» comme le dirait René Char.
Ce thème du devenir gaste et ensablé du monde abonde chez certains auteurs contemporains : on pense tout naturellement à László Krasznahorkai, à Cormac McCarthy ou à W. G. Sebald, voire à l’œuvre picturale d’Anselm Kiefer. Ceux-ci semblent décocher leurs flèches depuis la désolation même – comme pour dénicher quelques «joyaux intacts sous le désastre» (Hamlet de Mallarmé). Ce mouvement paradoxal d'une aurore qui renaîtrait par la nuit est portée jusqu'à des altitudes insoupçonnés par le sublime La route de Cormac McCarthy – dont l'un des passages témoigne de toute l'incandescence –portée par ce texte : «Le froid et le silence. Les cendres du monde défunt emportées çà et là dans le vide sur les vents froids et profanes. Emportées au loin et dispersées et emportées encore plus loin. Toute chose coupée de son fondement. Sans support dans l'air chargé de cendre. Soutenue par un souffle, tremblante et brève.» Diriez-vous qu'en dernier ressort votre critique littéraire s'apparente à l'orpaillage toujours renouvelé et jamais achevé des dernières braises, qu’elle est «soutenue par un souffle, tremblante et brève» – et ce malgré l'inanité régnante dans ce siècle, où de toute évidence le temps des livres est passé ?
Gregory Mion
Dans sa définition élaborée, la ségrégation se rapporte à deux populations antagonistes (ou à de petits groupes d’individus séparés, voire à deux individualités concurrentes), l’une au sommet d’une société et l’autre enfermée dans les catacombes de la même société, la première disposant d’un maximum de possibilités d’exister et la seconde ayant été assignée à une quasi impossibilité d’exister, cela dans la mesure où les choix d’existence des uns, divers et variés, leurs opinions également, sèment une drastique impuissance de vivre pour les autres. Ainsi se détermine l’argument sociologique de tous les romans qui négocient frontalement ou obliquement avec la ségrégation. L’œuvre d’André Brink est un cas d’école de la critique romanesque de la calamité ségrégationniste, et, du reste, parce que le nom de Brink est moins connu que ceux de Nadine Gordimer ou de J. M. Coetzee en Afrique du Sud, j’ai voulu que mon livre s’ouvre avec lui, que ses pages liminaires soient d’emblée concernées par l’une des plus intolérables faillites de l’humanité, à savoir ici la transformation d’une différence biologique (la couleur de la peau) en illégalité caractérisée. Ce faisant j’ai associé le travail d’André Brink à celui d’un autre Sud-Africain tombé dans l’oubli : Alan Paton dont je recommande instamment la lecture de Pleure, ô pays bien-aimé. Dans la lignée de cette ségrégation et de toutes ses insupportables déclinaisons, je vous remercie de mentionner le fabuleux Isaac Bashevis Singer car tout prix Nobel qu’il puisse être, ses livres ne sont plus guère prisés, empruntés ou offerts, sauf par quelques lecteurs qui n’ont pas complètement abdiqué et qui connaissent la valeur de la littérature adossée à la véracité, je veux dire alignée sur une véracité supérieure qui fait apparaître la véracité inférieure d’un monde en crise, d’un monde injuste où les véridiques sont persécutés par les faussaires. Ces lecteurs connaissent la façon dont cette littérature épuratrice du mensonge nous amène à suffoquer devant «l’horreur sacrée d’un texte fondamental» (34), devant une suite de mots qui révèlent d’horribles contradictions temporelles tout en nous abreuvant de magnifiques corrélations spirituelles. De sorte que la dissonance physique de la ségrégation peut se résoudre parfois dans la promesse d’une consonance métaphysique. La littérature qui est en capacité de faire ce miracle, de le précipiter, c’est-à-dire en capacité d’invoquer une puissance invisible pour corriger une impuissance visible, cette littérature, évidemment, ne peut que demeurer absente des forteresses de l’imposture et des usines de l’inégalité. Cela commence par une absence à la télévision qui jamais ne défendra le moindre livre habité de justice puisque toute émission prétendument littéraire (télévision et littérature étant devenues antithétiques depuis au moins trente ans) n’est là que pour détruire la littérature. Cela se poursuit par une absence dans la presse qui n’est plus qu’une officine de la réclame et du renvoi d’ascenseur. Et en allant plus loin, hors de toute facilité polémique, en prolongation de ce que pouvait penser le désespéré Guy Debord, je serais prêt à soutenir qu’une littérature de la vérité, de la justice et de la profondeur du cœur humain est toujours une fête, une jubilation où s’extrapole une proclamation suprême, à l’opposé du mauvais spectacle qui anime les sociétés qui sont en guerre contre toute forme de suprématie éternelle. Par conséquent les livres qui ont le sens de la fête surnaturelle, le sens d’une abondance divine, ces livres-là sont rejetés par les non-livres qui sont les serviteurs du spectacle et par les sociétés qui ont chaviré dans l’entertainment perpétuel et la stigmatisation des indigents (que le spectacle essaie toutefois d’introduire dans sa putanisante narration). Or ce temps accru du spectacle, vous l’aurez déduit, est un catalyseur de la ségrégation sous toutes ses coutures car il voudrait nous faire croire que les livres qu’il défend – ou plutôt dont il organise effrontément la promotion – sont des solutions pour le monde, des voix sincères de l’égalité, des suffrages du Bien, alors même qu’ils en sont le problème majeur. De cette manière nous voyons se consolider à présent une épouvantable pseudo-littérature de dominants qui fait semblant de se préoccuper des dominés tout en s’adressant à un public de dominants. La France est à cet égard parmi la plus criminelle des nations : son total massacre de la littérature et des humanités a provoqué une grave confusion axiologique – cela en fait un pays déclassé où ce qui est en haut devrait être bas et ce qui est en bas devrait être en haut. La France de notre siècle aime tout ce qui est vil et infatué et il y a longtemps qu’elle n’a pas été en fête, tout comme il ne lui reste plus beaucoup de grands hommes à louer.
Par ailleurs la ségrégation inculpée par la littérature ne peut être qu’une sorte de traité de parasitologie plus ou moins revendiqué. Les responsables de la ségrégation, quels qu’ils soient, à quelque étage de leur degré de nuisance et de cabale, sont des parasites, des membres d’honneur d’un «inframonde de dévoration et d’autodestruction, loin du bien, de la vérité et du beau, de la lumière et de la Divinité» – ils entretiennent «un monde damné pour toujours» (35). Certains d’entre eux ne sont même pas conscients qu’ils sont des parasites car la corruption qu’ils répandent se situe à un niveau moins phénoménal que nouménal. Ils empoisonnent l’air que nous respirons et ils nous donnent la sensation qu’un poids énorme s’est impudemment couché sur notre poitrine. Les solitudes oppressées que raconte Carson McCullers dans Le cœur est un chasseur solitaire sont le résultat d’une intoxication de l’éther qui condamne chaque personnage à la survie, à la gêne respiratoire, les contraignant à végéter au sein d’un périmètre limité. L’échappatoire est inenvisageable dans de telles conditions et il me semble que c’est à partir des quartiers isolés décrits – ou plutôt esquissés tant ils sont enrobés d’une brume toxique – par Carson McCullers que l’on peut admettre avec Juan Asensio (et son ancêtre Léon Bloy) que le temps des livres est passé – passé sans retour. Je veux signifier par ce recoupement que tout écrivain digne de ce nom, aujourd’hui, n’est pas différent des séquestrés qui peuplent cette dramatique histoire de Carson McCullers où domine l’impression d’un internement carcéral plus draconien que si nous avions affaire à une véritable prison. Les prisons intangibles aiguisent la catastrophe des prisons tangibles – elles brisent les cœurs et elles incitent à répudier le Royaume. Elles sont légion dans l’atmosphère de l’Europe corrompue et elles sont la norme dans la France archi-corrompue. La prolifération des parasites littéraires est en train de remplacer ce qui est sain (et saint) par ce qui est impur et révoltant de bassesse. Les derniers grands écrivains sont en train de disparaître et ceux qui sont leurs homologues ne vont plus pouvoir apparaître car l’infection nouménale les cantonnera dans les districts de la séquestration existentielle – et pour être tout à fait exact : dans les goulags de l’inexistence, dans de nouveaux baraquements d’une Kolyma qui ne seront jamais dénoncés. L’existence croissante des parasites en littérature, la vilaine profusion de ces indésirables, induit l’inexistence des écrivains désirables, de même qu’elle induit la misère pour les particuliers qui n’ont pourtant rien à voir avec le champ de l’écriture. Je suis intimement convaincu que pour qu’un parasite de la littérature existe, il faut, symétriquement, que non seulement de grands écrivains cessent d’exister ou ne puissent pas du tout advenir à l’existence, et que, également, des hommes et des femmes soient misérables car les nombreuses possibilités du parasite ont des répercussions nuisibles à tous les échelons de l’ossature sociale. C’est pourquoi je traite ces agents corrupteurs comme des criminels, comme des assassins, comme des destructeurs de la santé nouménale et des accélérateurs scélérats de la réclusion phénoménale. C’est la pire engeance de notre monde car elle défile en complet-veston de moralité. Elle a presque substitué le réel avec sa propre reconstruction de la réalité, et, de ce point de vue, nous ne tarderons plus à regarder la réalité à l’instar d’une créature enfouie, antédiluvienne, irrécupérable, «[déambulant] comme une taupe aveugle, terrifiée par sa propre solitude» (36). Dirais-je alors que l’air est un peu moins irrespirable aux États-Unis qu’en Europe ? Que la réalité américaine est un peu moins compromise ? Au regard de ce que j’ai formulé dans les questions précédentes, je me dois de le dire, je me dois de dire que là-bas le temps des livres est peut-être un peu moins passé, que le temps du Livre aussi continue de subsister, le temps biblique, mais l’action des parasites n’y est pas moins enclenchée et elle a déjà gangrené une pléthore de jardins d’Éden.
Vous comprenez alors que l’enjeu de la critique littéraire devient de nos jours quelque chose de foncièrement justicier : au-delà de l’impitoyable jugement des textes, nous jugeons aussi des hommes, et, à ce titre, vous voyez se profiler une stricte concordance entre un texte immonde par sa nullité (et par son pacte avec la démonologie capitaliste) et un être immonde dont toute la puanteur humaine est à l’avenant de la puanteur de son livre. Toute cette engeance règne en France à des degrés qui ne possèdent pas leur équivalent dans le reste du monde. La disparition pure et nette de cette saloperie modifierait instantanément la qualité de l’air nouménal, mais, malheureusement, nous n’allons pas vers cela. En ce qui me concerne, eu égard à cette accablante courbe exponentielle de l’infamie, je suis proche de baisser le rideau, comme je crois que Juan Asensio l’est aussi. Je suis horrifié par la décomposition des esprits et je n’ai plus vraiment envie de forger le matériau de leur douteuse recomposition. Il n’y a plus que Dieu pour se charger d’une telle guérison ou d’une telle résurrection. Je garde malgré tout une infime espérance vis-à-vis du jeune public, c’est-à-dire du public des élèves que je redécouvre chaque année, et, parmi eux, il y en aura toujours une poignée dont la plasticité cérébrale (et l’âme inviolable) ne sera jamais la dupe des valeurs inversées. Alors oui, bien sûr, mon travail critique ne tient plus qu’à un souffle, il est tremblant et vulnérable, il est de plus en plus vain, il est sur la corde raide, comme l’est mon enseignement qui doit affronter d’autres monstruosités de notre époque inhumaine. Et si je suis un orpailleur ici et là, je ne le suis que dans la mesure où je recherche l’or de la vie sous les décombres de l’Occident écroulé, le métal précieux de la vitalité parmi les cimetières psychiques, l’opulence pneumatologique de la respiration cosmique ou divine, et, tel qu’a pu l’écrire William James pour spécifier le sentiment de la vie, ce qui m’intéresse par-dessus tout, c’est de faire sentir par-delà les textes littéraire ou philosophiques le Texte de la Vie, la Phrase de Dieu, en l’occurrence «the total push and pressure of the cosmos» (37) en dépit des actuelles tyrannies du chaos, en dépit de toute la souffrance humaine qui «[s’ouvre] comme une fleur carnivore» (38) et menace de nous faire périr de la laideur des jours qui sont devenus les nôtres. Aussi le mot d’ordre auquel nous devrions nous astreindre pour limiter la nocivité de nos sociétés déifuges, le mot d’ordre qui pourrait initier une conversion des mentalités en alliance des esprits satano-fuges, c’est de ne jamais rien faire en vue d’obtenir de la puissance sociale (par exemple ne jamais écrire pour vendre), mais de toujours agir par amour en toutes choses (donc toujours écrire par pur amour de l’écriture).
Notes de la troisième partie
(24) Cf. Nietzsche, Le Voyageur et son ombre (§ 308).
(25) Nietzsche, ibid.
(26) Max Picard le dit spécifiquement de l’Italie lorsqu’il se trouve à Modène (op. cit. ).
(27) Cf. Conrad Aiken, Un cœur pour les dieux du Mexique.
(28) Conrad Aiken, Au-dessus de l’abysse.
(29) S’agissant du Mexique au cinéma, deux films au moins me paraissent essentiels pour saisir ou ressaisir la charge vitale et fatale de ce pays : Post Tenebras Lux et Nuestro Tiempo de Carlos Reydagas.
(30) Cf. Nietzsche, La Naissance de la tragédie (Essai d’autocritique, § 2).
(31) Cf. Heidegger, Les Concepts fondamentaux de la métaphysique. Heidegger fait de l’homme un configurateur de monde, mais, au point où nous en sommes, cette qualité prêtée à l’homme devrait être sérieusement remise en question (Heidegger n’a du reste pas minimisé les effets croissants et délétères de la technique sur la vie en général).
(32) Max Picard, op. cit. (citation de son ouvrage Le Visage humain).
(33) Cf. Évangile de Matthieu.
(34) Mircea Cărtărescu, Solénoïde.
(35) Mircea Cărtărescu, ibid.
(36) Ibid.
(37) William James, Pragmatism.
(38) Mircea Cărtărescu, op. cit.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, gregory mion, henri rosset, j'ai mis la main à la charrue |  |
|  Imprimer
Imprimer
