« Entretien autour de l’anthologie J’ai mis la main à la charrue : Gregory Mion et Henri Rosset aiguisent le soc afin de rendre la terre moins vaine, 1 | Page d'accueil | Entretien autour de l’anthologie J’ai mis la main à la charrue : Gregory Mion et Henri Rosset aiguisent le soc afin de rendre la terre moins vaine, 3 »
18/02/2023
Entretien autour de l’anthologie J’ai mis la main à la charrue : Gregory Mion et Henri Rosset aiguisent le soc afin de rendre la terre moins vaine, 2

 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone. Entretien, 1.
Entretien, 1.Henri Rosset
Vous avez exposé votre conception pour le moins verticale de la littérature : «je ne m’intéresse qu’aux œuvres qui nous font passer par-dessus le parapet, par-delà le limes d’un monde gouverné par les châteaux de Dracula. Je me soucie de ces œuvres pour plonger dans les précipices». Et parmi ces gouffres mythiques, il en est un sur lequel vous vous appesantissez avec une attention soutenue : l’abîme américain. Entre votre roman L’Amérique cinquante et des poussières, la tentaculaire liste de notes L’Amérique en guerre sur Stalker et les diverses études sur les géants américain recensées dans J’ai mis la main à la charrue (Henry Darger, Don DeLillo, William Faulkner, Nathaniel Hawthorne, Ken Kesey, Harper Lee, Jack London, Vladimir Nabokov, Carson McCullers, Herman Melville, Robert Penn Warren, Thomas Wolfe), vous semblez sonder une crevasse plus enracinée et peut-être encore plus profonde que celle que vous avez mise en évidence jusqu’ici. Pays pour le moins monstrueux sous bien des regards, les États-Unis labourent pourtant encore une terre fertile et prodigue en fulgurances littéraires (à rebours de la vieille Europe qui se contente bien souvent de lamentations fiévreuses sur sa terre devenue gaste et irrémédiablement vaine, comme le dirait T. S. Eliot). Lançant ainsi des regards balbutiants et hagards à la face de l’Amérique, les Européens apparaissent comme tout à fait ignorants de la profondeur littéraire de l’Amérique, comme en témoigne la difficulté de publication en France pour les ouvrages de Thomas Wolfe et de Robert Penn Warren, pour ne citer que ces deux sommets.
Cette ignorance provient-elle d’une forme d’infatuation bourgeoise qui aurait corrompu l'Europe ou aurait-elle pour ressort, selon vous, une plaie plus profonde encore : la cécité volontaire d’un continent dévasté métaphysiquement ?
Gregory Mion
Il y a une image qui me vient spontanément à l’esprit en lisant votre intuitif et pertinent diagnostic dressant les pathologies de la sénescente et impardonnable Europe. Cette image est celle du Danube tel qu’il apparaît sous la plume foudroyante de László Krasznahorkai dans son recueil de nouvelles intitulé Sous le coup de la grâce (7). C’est une déclinaison du Danube qui se situe en phase terminale de son existence hydrographique et dont les aspects les plus écœurants
 traduisent d’une manière flagrante le crépuscule de l’Histoire européenne. Ce serait en quelque sorte le Danube de l’ombre, le fleuve le plus hanté du monde, un flux médusé, définitivement orphelin du devenir et qui tiendrait à jamais prisonnier dans l’une de ses poches de pétrification le cadavre affligé d’Héraclite. En cela ce n’est pas le Danube tel que l’a descendu Claudio Magris (8), même si ce dernier n’a pas fait l’économie des ténèbres historiques dont le fier et fascinant courant du Danube a été le témoin privilégié. On trouve d’ailleurs chez Magris un pari latent du devenir, une façon de dire, un peu comme Héraclite l’eût dit à ce sujet, que si l’Histoire n’a pas toujours été favorable aux hommes, il n’en reste pas moins que l’écoulement universel de toutes choses – symbolisé ici par la souveraineté du Danube – finira toujours par évacuer les sédiments les plus coriaces et les plus corrupteurs. Cette perspective justifie la possibilité d’une messianité même après une horreur aussi impensable que la systématique destruction des Juifs d’Europe.
traduisent d’une manière flagrante le crépuscule de l’Histoire européenne. Ce serait en quelque sorte le Danube de l’ombre, le fleuve le plus hanté du monde, un flux médusé, définitivement orphelin du devenir et qui tiendrait à jamais prisonnier dans l’une de ses poches de pétrification le cadavre affligé d’Héraclite. En cela ce n’est pas le Danube tel que l’a descendu Claudio Magris (8), même si ce dernier n’a pas fait l’économie des ténèbres historiques dont le fier et fascinant courant du Danube a été le témoin privilégié. On trouve d’ailleurs chez Magris un pari latent du devenir, une façon de dire, un peu comme Héraclite l’eût dit à ce sujet, que si l’Histoire n’a pas toujours été favorable aux hommes, il n’en reste pas moins que l’écoulement universel de toutes choses – symbolisé ici par la souveraineté du Danube – finira toujours par évacuer les sédiments les plus coriaces et les plus corrupteurs. Cette perspective justifie la possibilité d’une messianité même après une horreur aussi impensable que la systématique destruction des Juifs d’Europe.En revanche, avec Krasznahorkai, on ne peut pas se fier au pouvoir salutaire du fleuve parce que le fleuve lui-même est dorénavant privé de sa capacité à nous inspirer une issue de secours, ou, mieux encore, privé de son éclat qui pourrait nous laisser éprouver le sentiment que l’innocence du devenir permettra de vaincre tôt ou tard la culpabilité des noirs immobilismes. Que voit-on alors se profiler ? Qu’est-ce que les personnages de la monstrueuse nouvelle de Krasznahorkai vivent en parallèle de ce Danube de la mort ? Certains d’entre eux sont parvenus à monter sur un bateau censé leur apporter la délivrance, censé les éloigner au plus vite d’une Hongrie malade qui a de tout temps été pour Krasznahorkai le centre satanique de l’Europe, mais où qu’ils aillent, quelle que soit la destination qui les attend, ces hommes et ces femmes, ces fugitifs terrifiés, ces émigrants beaucoup plus appesantis dans leur psychisme que ceux de W. G. Sebald, tous autant qu’ils sont, sans le moindre atome d’exception, ils n’auront vraisemblablement pour point de chute qu’une Europe effondrée, un continent glacial, une terre inféconde où n’importe quelle flèche du destin ne pourrait plus être tirée depuis l’Arc Divin des Destinées. Ce Danube-là, ce Danube contemporain, précisément fatigué d’une Europe cacochyme et malsaine, n’a pour seule vocation, selon le romancier hongrois extralucide, que de transporter des cadavres ou des objets typiques d’une déchetterie, les uns et les autres confondus dans une masse figée de décadence
 ontologique, sujets objectivés dans la mort et objets subjectivés dans les formes révolues de la décharge, terribles empreintes d’une cosmologie négative où il serait illusoire de penser qu’un bateau flottant sur ces eaux maléfiques pourrait s’estimer séparé de ce désastre, comme une goutte d’huile possède l’avantage d’être immiscible à l’eau. Autrement dit le bateau qui semble – ou plutôt qui croit se diriger – à contre-courant du fleuve, à l’opposé de la Hongrie moribonde et empestée, n’est pas du tout un véhicule de secours, mais il n’est qu’un objet de plus parmi les ruines flottantes ici-bas, une embarcation d’emblée sinistrée, maudite, outragée, un radeau de la Méduse qui ne fait que prolonger la souffrance généralisée des quelques optimistes qui s’imagineraient fendre d’une proue glorieuse les monolithes d’un fleuve de glace.
ontologique, sujets objectivés dans la mort et objets subjectivés dans les formes révolues de la décharge, terribles empreintes d’une cosmologie négative où il serait illusoire de penser qu’un bateau flottant sur ces eaux maléfiques pourrait s’estimer séparé de ce désastre, comme une goutte d’huile possède l’avantage d’être immiscible à l’eau. Autrement dit le bateau qui semble – ou plutôt qui croit se diriger – à contre-courant du fleuve, à l’opposé de la Hongrie moribonde et empestée, n’est pas du tout un véhicule de secours, mais il n’est qu’un objet de plus parmi les ruines flottantes ici-bas, une embarcation d’emblée sinistrée, maudite, outragée, un radeau de la Méduse qui ne fait que prolonger la souffrance généralisée des quelques optimistes qui s’imagineraient fendre d’une proue glorieuse les monolithes d’un fleuve de glace.Par conséquent je crois que cette image du Danube embaumé de malheur illustre assez correctement votre idée d’une «cécité volontaire» en Europe, et peut-être, à cet égard, l’idée d’un aveuglement délibéré de tout le Mal qui nous étreint de ses tentacules hyperactifs, de même que cette image est le reflet de votre impression que tout recours à la métaphysique – au sens large d’un appel des puissances spirituelles – est devenu le motif d’une condamnation en hérésie sur les terres abominablement vaines, voire fraîchement super-matérialistes, du Vieux Continent aujourd’hui dénaturé.
Par souci de synthèse et de reprise, je défends donc la chose suivante s’agissant de l’Europe : c’est un continent qui s’est peu à peu cruellement fourvoyé, un continent de la désillusion qui s’est trop souvent et indûment cru à l’abri des périls – qui s’y croit d’ailleurs toujours et même davantage – au fur et à mesure de ses triomphes sur la scène internationale, un continent désormais anéanti de bureaucratie et de palabres, plus menacé psychiquement qu’il ne l’était autrefois réellement, se tenant pour le vainqueur de tous ses problèmes d’antan et n’acceptant pas la persévérance d’un certain ver dans le fruit. C’est en cela un continent hémiplégique avec un avant et un après de la folie technico-administrative, mais également un avant et un après du bon élève récurrent qui prétend avoir appris des leçons de l’Histoire, un continent où se regardent depuis au moins une vingtaine d’années deux temporalités duelles, irréconciliables (un rythme passé qui pouvait se régénérer dans la violence archaïque et une arythmie présente qui dégénère dans la modération ultramoderne), en somme un mélancolique segment de notre «ball of earth» (9) où les guerres de jadis étaient des fragments de mort à l’intérieur d’un monde encore vivant alors que de nos jours l’Europe n’est plus qu’un monde mort strié par de rarissimes fragments de vie (la bureaucratie étant la prohibition catégorique de tout élan vital). De là s’ensuit une espèce de crime graduel contre le devenir, une sorte de refus de plus en plus net du mouvement, non sans exploiter une rhétorique du progrès, un bavardage de la marche en avant, tout ceci alourdi par l’apologie d’une force politique tranquille. En d’autres termes, nous sommes à présent confrontés à une époque de l’Europe qui récuse à la fois la destruction et la création, ce qui a l’inconvénient d’attirer malgré tout la guerre d’une part, et, d’autre part, ce qui suscite un horizon accablant où la figure du créateur est submergée par la figure du producteur de stagnation morbide.
 Conformément à ce qui précède, je ne suis vraiment pas optimiste quant à ce déni de l’Europe sur les conditions actuelles de sa santé mentale. Du temps du bloc communiste, du temps de l’Europe en partie soviétiforme, on avait encore du remous sous la glace, de l’eau vive sous la banquise, et les profondeurs fluides, à force de durer, ont réussi à défaire les mauvais états solides qui s’étaient emparés de la vie en surface. Même les descriptions désespérées de Ričardas Gavelis dans son chef-d’œuvre Vilnius Poker peuvent être compensées par le souvenir consolateur de ce qu’il advint du Pacte de Varsovie au début des années 1990. Et je me réfère à Gavelis parce qu’il est aussi question d’une rivière allégoriquement statufiée dans Vilnius Poker : en l’occurrence la Néris dont l’écoulement s’est interrompu en raison de la soumission de l’homo lithuanicus aux dogmes soviétiques. On pourrait du reste me reprocher de constituer une différence arbitraire entre la Néris de Gavelis et le Danube de Krasznahorkai puisque la nouvelle que je ciblais dans Sous le coup de la grâce a été écrite durant la période communiste de la Hongrie. Ma conviction, cependant, c’est que Gavelis cherche à mettre en évidence un phénomène spécifiquement lituanien, très localisé, tandis que l’écriture de Krasznahorkai paraît contenir une dimension qui excède le cas particulier de la Hongrie pour embrasser dans son orbite littéraire le cas général d’une Europe où les malformations physico-mentales du territoire hongrois seraient partout. De sorte que Krasznahorkai, de livre en livre, a judicieusement anticipé la substitution d’un bloc (le communisme) par un autre (que j’appellerais le bloc du nihilisme intégral tant la fatigue de vivre et de faire vivre subjugue maintenant les individus). En outre, ce n’est pas l’auteur du Tango de Satan qui répugnerait à confirmer notre intuition d’un contrat social-européen perverti. Ce pacte social que nous conjecturons ne vise plus du tout à rendre le peuple d’Europe souverain, mais il s’est insidieusement transformé en un pacte avec le diable où ne peuvent se réaliser que les individualités les plus noires, les plus catastrophiques, au détriment des individualités les plus saintes. D’où, en France par exemple, la présomption que perdure un jacobinisme sordide qui coupe méthodiquement toutes les têtes qui dépassent, comme si des prédicateurs de la mort s’arrangeaient pour que les aristocrates de la vie ne puissent pas vivre et exalter la vie autour d’eux. C’est pourquoi, probablement, la France et par extension l’Europe n’ont plus beaucoup de très grands écrivains pour inverser cette tendance et couper once and for all les têtes vides des coupeurs de têtes bien faites. Il est quand même effrayant de se dire que les oasis n’existent quasiment plus sur le sol de l’Europe et que ce continent qui meurt philosophiquement de soif n’a pas l’air de souhaiter sa nécessaire désaltération.
Conformément à ce qui précède, je ne suis vraiment pas optimiste quant à ce déni de l’Europe sur les conditions actuelles de sa santé mentale. Du temps du bloc communiste, du temps de l’Europe en partie soviétiforme, on avait encore du remous sous la glace, de l’eau vive sous la banquise, et les profondeurs fluides, à force de durer, ont réussi à défaire les mauvais états solides qui s’étaient emparés de la vie en surface. Même les descriptions désespérées de Ričardas Gavelis dans son chef-d’œuvre Vilnius Poker peuvent être compensées par le souvenir consolateur de ce qu’il advint du Pacte de Varsovie au début des années 1990. Et je me réfère à Gavelis parce qu’il est aussi question d’une rivière allégoriquement statufiée dans Vilnius Poker : en l’occurrence la Néris dont l’écoulement s’est interrompu en raison de la soumission de l’homo lithuanicus aux dogmes soviétiques. On pourrait du reste me reprocher de constituer une différence arbitraire entre la Néris de Gavelis et le Danube de Krasznahorkai puisque la nouvelle que je ciblais dans Sous le coup de la grâce a été écrite durant la période communiste de la Hongrie. Ma conviction, cependant, c’est que Gavelis cherche à mettre en évidence un phénomène spécifiquement lituanien, très localisé, tandis que l’écriture de Krasznahorkai paraît contenir une dimension qui excède le cas particulier de la Hongrie pour embrasser dans son orbite littéraire le cas général d’une Europe où les malformations physico-mentales du territoire hongrois seraient partout. De sorte que Krasznahorkai, de livre en livre, a judicieusement anticipé la substitution d’un bloc (le communisme) par un autre (que j’appellerais le bloc du nihilisme intégral tant la fatigue de vivre et de faire vivre subjugue maintenant les individus). En outre, ce n’est pas l’auteur du Tango de Satan qui répugnerait à confirmer notre intuition d’un contrat social-européen perverti. Ce pacte social que nous conjecturons ne vise plus du tout à rendre le peuple d’Europe souverain, mais il s’est insidieusement transformé en un pacte avec le diable où ne peuvent se réaliser que les individualités les plus noires, les plus catastrophiques, au détriment des individualités les plus saintes. D’où, en France par exemple, la présomption que perdure un jacobinisme sordide qui coupe méthodiquement toutes les têtes qui dépassent, comme si des prédicateurs de la mort s’arrangeaient pour que les aristocrates de la vie ne puissent pas vivre et exalter la vie autour d’eux. C’est pourquoi, probablement, la France et par extension l’Europe n’ont plus beaucoup de très grands écrivains pour inverser cette tendance et couper once and for all les têtes vides des coupeurs de têtes bien faites. Il est quand même effrayant de se dire que les oasis n’existent quasiment plus sur le sol de l’Europe et que ce continent qui meurt philosophiquement de soif n’a pas l’air de souhaiter sa nécessaire désaltération.Ce serait d’ailleurs une banalité si je me limitais à cette vision désenchantée de l’Europe à dessein de lui opposer de la façon la plus frontale qui soit une vision idyllique des États-Unis. Mes années nord-américaines, assorties de nombreux périples supplétifs au sein du fameux Nouveau Monde, tout à rebours d’une partialité qui serait de fort mauvais goût, m’ont heureusement immunisé contre la fâcheuse propension à romantiser une vastitude proverbiale et la liberté qui lui serait consubstantielle (lors même que l’Europe aurait atteint le stade ultime de l’exiguïté et de la servitude). L’Amérique du Nord patauge aussi dans ses excréments idéologiques – elle le fait même ostensiblement – et elle appartient plus que jamais à la scélérate matrice occidentale qui met notre écosystème en danger, torpillant au passage les fondations intellectuelles qui ont stabilisé l’humanité. Vous l’avez justement rappelé au demeurant : j’ai consacré des dizaines d’articles au sang que les États-Unis ont versé – et versent toujours ici et là – au cours de telle ou telle guerre, qu’elle soit intérieurement civile, extérieurement restreinte ou pitoyablement mondiale. Je reconnais donc volontiers que l’Amérique, du moins dans son gouvernement, dans son arrogance tutélaire, est sans aucun doute une faillite pour le salut de l’humanité parce que sous ses airs de commandant néguentropique (elle incarnerait le gendarme de la planète) elle dissimule un potentiel entropique de moins en moins réprimé. La Guerre Froide l’a longuement
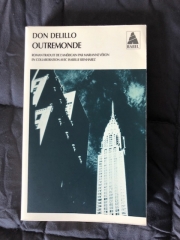 démontré et Don DeLillo n’a pas manqué de le saisir avec maestria dans son incomparable Outremonde. Plus grave : la fin de la Guerre Froide, comme le suggère également DeLillo, a été une aubaine pour les États-Unis puisque l’obtention d’un statut de vainqueur moral au cœur d’une paix artificielle a bâti une autoroute pour faire circuler l’idéologie décuplée du capitalisme. Avant cela, sur un modèle différent et précurseur, les spéculations financières tout de suite générées par la Première Guerre mondiale avaient d’ores et déjà prouvé l’amour inconditionnel du Capital pour la guerre (qu’elle soit directe ou indirecte), à tel point que le Capital redemande de la guerre, insatiable, capricieux, souffrant d’un genre inquiétant de satyriasis bellimorphique. Ainsi, que la guerre soit interne ou externe au territoire américain, peu importe, elle remplit son office de pornographie spéculative ou opérative, elle donne aux puissances de l’argent de quoi prendre leur pied, alternant parfois entre des campagnes mégalomanes à l’étranger (par le biais de quelque délire de l’état-major de Washington) et des prolongements aussi abjects que sournois de la guerre de Sécession (par le biais des relents persistants du racisme). Les guerres dites justes, au milieu de cela, ne sont que des hapax parmi les mots enténébrés d’un discours mensonger. Et toutes les guerres, au bout du compte, ne sont que des visas pour l’Argent, des passeports pour la Perdition.
démontré et Don DeLillo n’a pas manqué de le saisir avec maestria dans son incomparable Outremonde. Plus grave : la fin de la Guerre Froide, comme le suggère également DeLillo, a été une aubaine pour les États-Unis puisque l’obtention d’un statut de vainqueur moral au cœur d’une paix artificielle a bâti une autoroute pour faire circuler l’idéologie décuplée du capitalisme. Avant cela, sur un modèle différent et précurseur, les spéculations financières tout de suite générées par la Première Guerre mondiale avaient d’ores et déjà prouvé l’amour inconditionnel du Capital pour la guerre (qu’elle soit directe ou indirecte), à tel point que le Capital redemande de la guerre, insatiable, capricieux, souffrant d’un genre inquiétant de satyriasis bellimorphique. Ainsi, que la guerre soit interne ou externe au territoire américain, peu importe, elle remplit son office de pornographie spéculative ou opérative, elle donne aux puissances de l’argent de quoi prendre leur pied, alternant parfois entre des campagnes mégalomanes à l’étranger (par le biais de quelque délire de l’état-major de Washington) et des prolongements aussi abjects que sournois de la guerre de Sécession (par le biais des relents persistants du racisme). Les guerres dites justes, au milieu de cela, ne sont que des hapax parmi les mots enténébrés d’un discours mensonger. Et toutes les guerres, au bout du compte, ne sont que des visas pour l’Argent, des passeports pour la Perdition. Du reste, concernant la xénophobie diffuse qui est une guerre intestine en vol stationnaire et une insoluble fatuité d’un segment non négligeable de l’Amérique blanche, un écrivain comme Toni Morrison, par exemple, dans son bref et prodigieux roman Home, a rigoureusement établi que la guerre de Corée (son personnage en revient) n’était pas une situation aussi périlleuse à surmonter que le quotidien d’un homme noir au pays de la bannière étoilée. Quiconque a visité les États-Unis en faisant autre chose que les quartiers ripolinés de gentrification s’est rendu compte de cela. Et James Baldwin a brillamment montré la même chose dans La prochaine fois, le feu, ajoutant par ailleurs que ce qui détruit l’Amérique, ce n’est pas tant l’inqualifiable méchanceté de quelques-uns que la veulerie généralisée. Je me souviens pour ma part de la honte que j’ai ressentie en passant une journée à Gary, dans l’Indiana, un terrible jour d’hiver, côtoyant une population black abandonnée, perfusée aux suspectes vitamines des énormes usines métallurgiques défigurant le nord de la ville, sevrée de tout lieu de vie (la rue principale de la ville n’étant qu’une succession de bâtiment délabrés ou désaffectés), mais néanmoins vaillante, lucide aussi, s’amusant à tagguer sur les murs de cette Cité de l’Antichrist déchaîné les deux mots joueurs que sont «steel strong». Que le petit Michael Jackson ait pu naître là est un miracle et c’est peut-être cette possibilité du miracle, cette sorte d’occulte survivance du mystère dans l’horrible gueule du loup, dans l’infâme complément d’objet du malheur de l’Occident, qui donne aux États-Unis, bien plus que son folklorique gigantisme ou sa liberté cabotine, un intérêt tout à fait spécial et des raisons de postuler ne serait-ce qu’une aventure de plus en pleine croissance accélérée de la mésaventure. Le pouls du devenir, là-bas, fait encore réagir l’instrument de mesure d’une cardiologie métaphysique. Les gouffres par où les vivantes racines des destins fulgurants remontent au hasard à la surface et font jaillir les grands arbres humanoïdes qui oxygènent leur siècle, ces gouffres-là, en Amérique, ne sont pas totalement oblitérés comme ils le sont apparemment en Europe. Dans les termes de Kerouac, cela signifie éventuellement qu’en Amérique, «depuis le jour où des chariots bâchés roulèrent au ralenti, trois mois de suite, dans les déserts infinis» (10), l’aventure spirituelle qui avait visiblement béni l’Europe pendant des siècles s’était soudainement déplacée outre-Atlantique. C’est le paradoxe d’un pays où un certain coefficient d’archaïsme subsiste au milieu de l’ultra-modernisme tandis qu’en Europe, par hypothèse, le modernisme a irrévocablement sonné le glas d’un divin conservatisme. Moralité : si de nouvelles Simone Weil et Cristina Campo devaient renaître, elles auraient davantage de chances d’advenir dans un coin isolé de l’Iowa ou dans une bicoque du Nouveau-Mexique, sous l’œil spectral et protecteur de Georgia O’Keeffe.
J’ai essayé d’être à la hauteur de tout cela quand j’ai entrepris d’écrire L’Amérique cinquante et des poussières. Ce roman est d’abord la traduction d’un enjeu formel : il réunit cinquante chapitres et chacun de ces chapitres passe par un État des États-Unis (on démarre par la fête de la montgolfière d’Albuquerque et l’on termine dans une rue anonyme de San Francisco). Cette forme romanesque identifie autant que possible la structure archétypale des États-Unis, c’est-à-dire, au fond, quelque chose comme «un édifice immémorial» (11) de l’Amérique, un extraordinaire dessous des cartes, ou plutôt le territoire américain psychologique par-delà les frontières de la carte géographique. Ce ne sont donc pas tant les données historiques qui dominent l’argument de ce livre (on ne fait que les pressentir) que les données médiates d’un inconscient collectif. Puis le défi de la forme, la contrainte de l’intelligible, cède je crois assez rapidement la place à la matière sensible, à savoir au faisceau de personnages dont les destinées respectives sont imbriquées les unes dans les autres à une échelle explicite ou implicite. Certains de ces personnages ne dépassent pas le niveau de la plus anodine des confluences (mais toute rencontre, ne serait-ce que furtive, engendre par la simplicité de sa cause des effets complexes), d’autres, en revanche, appellent de plus significatives convergences et débrouillent pour quatre d’entre eux l’écheveau mystérieux de l’amour. Pour autant, ce n’est pas un roman d’amour, même si j’accepterais sans aucune difficulté l’opinion qui affirmerait que les deux histoires d’amour de ce livre en déterminent l’intrigue. Ce que je dirais au-delà du territoire mental et de la carte américaine où circulent des personnages accidentellement solitaires puis essentiellement reliés (il y a même un chat qui pourrait réclamer sa part du lion), c’est que ce livre espère participer au spectacle de la vie, aux ancrages dionysiaques qui nous sauvent des proportions apolliniennes du libéralisme, et, en fin de compte, au déferlement d’une pulsion vivante qui provient des abysses terrestres et qui remonte jusqu’aux abysses du ciel. Quelques-uns verront alors que la justice sociale qui se dessine en filigrane dans le roman ne peut aboutir que par l’intermédiaire de la justice plus sommitale de la vie. La vie doit l’emporter – en tant qu’elle est naturellement l’ordre juste – sur tous les avatars de la mort et par conséquent de l’inertie. Les hiérarchies vivantes et spirituelles ont le devoir de débouter les hiérarchies temporelles synonymes d’épuisement existentiel.
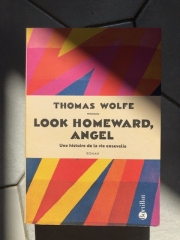 Or si je reviens maintenant à la thématique du fleuve – comme lieu par excellence du devenir – et que je veux aller plus loin que le Danube et la Néris, plus loin que la rigor mortis européenne, je peux commencer par convoquer, au risque de la facilité, le débit furieux de Thomas Wolfe, véritable cataracte littéraire où Héraclite se trouve comme un poisson dans l’eau, non seulement par le style héraclitéen de ce novelist in full mais aussi par le titre redoutablement évocateur de l’un de ses romans – Le Temps et le Fleuve. J’ajoute par ailleurs que la certification des gouffres de vie qui permettent à l’Amérique d’être encore debout constitue la préoccupation majeure de Wolfe dans son premier texte (Look Homeward, Angel) dont le sous-titre est d’une renversante beauté : Une histoire de la vie ensevelie. J’ai dû lire et relire ce roman des précipices vitaux avant de m’engager théoriquement sur ses parois descendantes qui sont en réalité autant de versants ascendants qui promettent le Royaume. Tout ce livre est inchoatif de l’œuvre géniale de Wolfe et du Royaume de Dieu : c’est une spéléologie apparente qui se convertit progressivement en authentique alpinisme céleste, ou, si vous préférez, une plongée dans l’opacité qui contient la lumière (comme l’aveugle de l’Évangile contemple en lui-même la lumière du Christ), une espérance qui voudrait nous formuler, à l’instar de Gilbert Cesbron, que toute prison tangible est un royaume intangible (12). Il semble alors que l’Amérique détienne pour l’heure cette discrète force de conversion ou de transfiguration qui empêche les gorgones de terminer leur pétrifiante besogne. Le Mississippi, par exemple, n’est pas encore astreint aux sommations qui ont réduit le Danube au givre ontologique de Parménide. Il y a dans le Mississippi une allure de triomphe, une fanfare de gloire, une physionomie invincible que Faulkner a perçue dans son roman L’invaincu. Une scène est particulièrement frappante à cet égard : le moment où des flots de nègres se confondent aux flots du Mississippi, le moment où la profonde poussée de la vie libère les nègres du joug mortel de la guerre civile et les amène jusqu’au fleuve pour y pratiquer symboliquement les ablutions, les gestes purificateurs qui exhaussent le nègre au culminant palier de l’humanité, le moment où, très clairement, nommément, Faulkner trace une équivalence entre le Mississippi et le Jourdain, comme si tous ces nègres recevaient simultanément le baptême suprême et que leur ferveur, enfin, autorisait à penser un point de suture christique au cœur d’une nation divisée par le diable. Le soulèvement – et le relèvement – de ces nègres par le truchement du Mississippi est a minima aussi puissant que la guérison du paralytique des Évangiles. Ils étaient paralysés mais ils avaient la volonté de se lever et de marcher, quelque chose de l’Amérique leur murmurait que c’était possible, alors qu’en Europe, nous n’avons pas – ou nous n’avons plus – de Faulkner qui puisse nous suggérer que la volonté de vivre est susceptible de contester l’ultime force gravitationnelle d’une paralysie maximale. En Europe, il nous faudrait donc un réveil surnaturel, une Pâque de la volonté, un Emerson, comme l’eût dit Kerouac, prêt à souffler tout le pneuma de l’univers dans la «trompette de l’aurore américaine» (13).
Or si je reviens maintenant à la thématique du fleuve – comme lieu par excellence du devenir – et que je veux aller plus loin que le Danube et la Néris, plus loin que la rigor mortis européenne, je peux commencer par convoquer, au risque de la facilité, le débit furieux de Thomas Wolfe, véritable cataracte littéraire où Héraclite se trouve comme un poisson dans l’eau, non seulement par le style héraclitéen de ce novelist in full mais aussi par le titre redoutablement évocateur de l’un de ses romans – Le Temps et le Fleuve. J’ajoute par ailleurs que la certification des gouffres de vie qui permettent à l’Amérique d’être encore debout constitue la préoccupation majeure de Wolfe dans son premier texte (Look Homeward, Angel) dont le sous-titre est d’une renversante beauté : Une histoire de la vie ensevelie. J’ai dû lire et relire ce roman des précipices vitaux avant de m’engager théoriquement sur ses parois descendantes qui sont en réalité autant de versants ascendants qui promettent le Royaume. Tout ce livre est inchoatif de l’œuvre géniale de Wolfe et du Royaume de Dieu : c’est une spéléologie apparente qui se convertit progressivement en authentique alpinisme céleste, ou, si vous préférez, une plongée dans l’opacité qui contient la lumière (comme l’aveugle de l’Évangile contemple en lui-même la lumière du Christ), une espérance qui voudrait nous formuler, à l’instar de Gilbert Cesbron, que toute prison tangible est un royaume intangible (12). Il semble alors que l’Amérique détienne pour l’heure cette discrète force de conversion ou de transfiguration qui empêche les gorgones de terminer leur pétrifiante besogne. Le Mississippi, par exemple, n’est pas encore astreint aux sommations qui ont réduit le Danube au givre ontologique de Parménide. Il y a dans le Mississippi une allure de triomphe, une fanfare de gloire, une physionomie invincible que Faulkner a perçue dans son roman L’invaincu. Une scène est particulièrement frappante à cet égard : le moment où des flots de nègres se confondent aux flots du Mississippi, le moment où la profonde poussée de la vie libère les nègres du joug mortel de la guerre civile et les amène jusqu’au fleuve pour y pratiquer symboliquement les ablutions, les gestes purificateurs qui exhaussent le nègre au culminant palier de l’humanité, le moment où, très clairement, nommément, Faulkner trace une équivalence entre le Mississippi et le Jourdain, comme si tous ces nègres recevaient simultanément le baptême suprême et que leur ferveur, enfin, autorisait à penser un point de suture christique au cœur d’une nation divisée par le diable. Le soulèvement – et le relèvement – de ces nègres par le truchement du Mississippi est a minima aussi puissant que la guérison du paralytique des Évangiles. Ils étaient paralysés mais ils avaient la volonté de se lever et de marcher, quelque chose de l’Amérique leur murmurait que c’était possible, alors qu’en Europe, nous n’avons pas – ou nous n’avons plus – de Faulkner qui puisse nous suggérer que la volonté de vivre est susceptible de contester l’ultime force gravitationnelle d’une paralysie maximale. En Europe, il nous faudrait donc un réveil surnaturel, une Pâque de la volonté, un Emerson, comme l’eût dit Kerouac, prêt à souffler tout le pneuma de l’univers dans la «trompette de l’aurore américaine» (13). Henri Rosset
Il n'est pas anodin que vous citiez la sublime Histoire de la vie ensevelie, écrite à tout juste trente ans par Thomas Wolfe, «façon de dire que l'Amérique des années 1920 contenait dans ses entrailles un embryon turbulent» selon votre commentaire (p. 471 de J'ai mis la main à la charrue). Comme pour mettre en garde la mirifique canopée à laquelle se mesurait le jeune Wolfe, il écrira, dans l’une des dernières lignes de ce prodigieux livre, qu'il ne
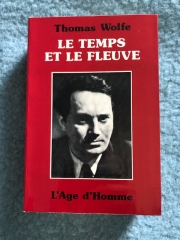 cessera de sonder «des mers plus étranges que celle que hante l'Albatros» — forme renouvelée de cette tauromachie héritée des plus hauts Mont Ventoux poétiques que Baudelaire a arpentés. Cette langue de l'épreuve et de la mise en joue du monde par l'écrivain nous apparaît aujourd'hui comme bien étrange (si ce n'est littéralement étrangère) pour nous autres Français. Hormis quelques «Sommets», pour reprendre le titre d'un des chapitres de J'ai mis la main à la charrue, ce qui surnage dans les étalages des librairies de notre pays, ce sont bien davantage les relents viciés d'un odieux bavardage égotiste (diagnostic d'ailleurs partagé par l'immense Krasznahorkai : «La bêtise bouffie d'autosatisfaction règne partout»).
cessera de sonder «des mers plus étranges que celle que hante l'Albatros» — forme renouvelée de cette tauromachie héritée des plus hauts Mont Ventoux poétiques que Baudelaire a arpentés. Cette langue de l'épreuve et de la mise en joue du monde par l'écrivain nous apparaît aujourd'hui comme bien étrange (si ce n'est littéralement étrangère) pour nous autres Français. Hormis quelques «Sommets», pour reprendre le titre d'un des chapitres de J'ai mis la main à la charrue, ce qui surnage dans les étalages des librairies de notre pays, ce sont bien davantage les relents viciés d'un odieux bavardage égotiste (diagnostic d'ailleurs partagé par l'immense Krasznahorkai : «La bêtise bouffie d'autosatisfaction règne partout»).En lisant vos écrits sur l'Amérique, on ne peut que conclure que ce jugement ne s'applique pas textuellement outre-Atlantique. Par-delà la Mer Océane, les catabases métaphysiques perdurent : la simple évocation d'un 2666 suffit à démontrer que l'orpaillage au sein de ces «mers étranges» évoquées par Wolfe ne s'est pas tari. D'ailleurs, on trouve à la fin de la deuxième partie de 2666 (La partie d'Amalfitano), ce «roman exceptionnel, immunisé contre le défaut de bavardage» (p. 99 de J'ai mis la main à la charrue), un brisant paragraphe où Bolaño fixe les vertiges inhérents à toute œuvre qui daignerait se présenter à l'autel de l'incandescence : «les grands maîtres luttent contre ça, ce ça qui nous terrifie tous, ce ça qui effraie et charge cornes baissées, et il y a du sang et des blessures mortelles et de la puanteur». Diriez-vous que la richesse métaphysique colportée par la littérature américaine (des livres comme Méridien de sang de McCarthy ou L'homme qui marchait sur la lune de McCord le laissent penser) provient d'une forme de persistance de ce souci du «ça» évoqué par Bolaño ?
Gregory Mion
Vis-à-vis de ce turbulent «ça» qui serait le commensal de tous les grands maîtres en écriture et qui aurait pour spécificité de transformer tous les repas en orgies ou en dérangeantes libations, je crois en effet que bon nombre des littératures de l’Amérique sont habitées par ce réjouissant vivificateur bachique. Il y a en Amérique un statement de la bacchanale intérieure ou extérieure et bien souvent des deux à la fois, en l’occurrence un appétit énorme pour les déluges excessifs d’une conscience et pour les sensations d’engloutissement issues des paysages illimités ou des skylines angoissantes, et, ce faisant, ces livres américains nous embarquent alternativement sur l’onde fiévreuse d’un psychisme accouchant de tout son réservoir pulsionnel (l’émérite Ça freudien), sur les vagues océaniques ou telluriques d’une envahissante nature, sur les tourbillonnantes vibrations du gigantisme de n’importe quelle architectonique urbaine.
Le paradigme de ces trois surabondances peut aisément se repérer dans l’œuvre de Thomas Wolfe qui ressemblait tant à ce qu’il était : un géant de quasiment deux mètres qui pouvait dompter littérairement aussi bien les surprenantes conformations de la nature omni-créatrice, les panaches arachnéens de la civilisation dévoratrice d’espace, que les coulées infinies d’une horloge mentale convulsive. En tant que tel Thomas Wolfe fut le paratonnerre des foudres du Moi et des foudres du Non-Moi, avec cette différence notable que sa conscience, comme celle de ses frères et sœurs d’Amérique, loin d’être le pôle séparatiste et représentationnel d’une conscience malheureuse (européenne ?) incapable de se déposer dans le monde, de le vivre et de s’en imprégner, reflétait plutôt les attributs d’une conscience sinon heureuse, du moins exaltée de se sentir pleine du monde, pleine de la vie des autres et de la sienne, en communion perpétuelle avec l’étrange et le familier, avec l’univers du dehors et l’univers du dedans, l’ensemble proposant une expérience métaphysique du Tout de la réalité, une praxis fusionnelle de la Totalité où cohabitent les plus belles choses comme les plus laides, les plus profondément valides comme les plus superficiellement invalides, les plus saines comme les plus méphitiques. Ainsi les romans de Thomas Wolfe sont d’une même voix ceux du sang et ceux de la cicatrice, ceux de la puanteur et de l’essence divine, ceux de la matière et de l’esprit, comme le sont les romans de Roberto Bolaño évidemment, comme le sont les ouvrages de tous les créateurs qui ont su dialoguer avec les nécessités tourmentées de l’incarnation – les nécessités des états organiques traversés d’une conscience – et les subtiles présences d’un quelconque paraclet jamais trop éloigné des corps tracassés par la faculté de penser, de juger, d’aimer, de fomenter le Mal and so on and so forth. Au fond, le propre d’une certaine littérature américaine qui n’est sûrement pas celle de Jonathan Franzen et pas vraiment celle d’un William Gass ou d’un David Foster Wallace, c’est la capacité à ne pas désincarner les problèmes de l’incarnation en les asphyxiant sous des tombereaux stylistiques, en les neutralisant par des remarques profusément didactiques ou en les annexant à une espèce de hors-champ qui se soustrait à l’épaisseur de la condition humaine, qui se dérobe à ce qui survient in the thick of the action. Ce penchant pour la propreté est plus communément répandu en Europe où la littérature demeure fréquemment confisquée par la bourgeoisie (donc par une frange pusillanime de l’humanité) et il est d’ailleurs inutile de s’attarder sur l’égotisme rédhibitoire qui sévit en France (un égotisme si prononcé que même les œuvres visiblement dispensées d’autofiction servent à promouvoir le narcissisme de tel ou tel plumitif coopté). L’erreur, néanmoins, serait de croire que la littérature désincarnée ou désincarnante sent la rose alors même qu’elle est la plupart du temps unie aux plus immondes corruptions.
Par conséquent, si nous partons du principe que l’Amérique (septentrionale, centrale et méridionale) des grands écrivains est la terre favorite d’un statement du sang et de tous les supplices et pénombres et excitations et scintillements que cela sous-entend, si nous partons également du principe que ce sang polycéphale n’est jamais détaché de ce qui fait un homme au Ciel comme à la Terre, de ce qui sculpte l’homme au Royaume comme aux gouffres qui en sont le miroir, si nous acceptons cela, alors non seulement nous pouvons comprendre que la pire des brutalités sanguinaires des romans de Cormac McCarthy se déroule toujours sous le dôme des étoiles divines et au-dessus des saints mystères engloutis, que la blessure mortelle et patente contient toujours sa guérison latente et simultanée, que l’apparente gratuité des crimes abjects, chez McCarthy bien davantage que chez d’autres, dissimule en fin de compte l’intérêt d’une impalpable puissance omni-englobante que les romanciers de génie nous font systématiquement sentir, mais nous pouvons comprendre aussi, à l’inverse de cette sympathie pour tous les sangs, que les pseudo-romanciers ou les romanciers d’une moindre intensité exercent une sorte d’understatement à l’égard du sang et de ses ramifications, à l’égard de la vie sanglante ou de la vie galvanisante.
De là se déduisent les déconcertantes radiations philosophales qui entourent des personnages comme Lester Ballard (14) ou le Juge Holden (15), tous les deux porteurs des valises du démon à première vue, mais tous les deux arrimés aux indéchiffrables décrets de Dieu pour peu que l’on se dégage des grilles de lecture ordinaires et bassement moralisatrices, tous les deux surgissant à l’instar de vigoureux correctifs, symptômes d’une essentielle dynamique au verso de nos stabilités en général inessentielles et hallucinogènes. Expliquons-nous : derrière les fanatismes de la morale que Nietzsche a soigneusement déconstruits, au-delà de tous les tribunaux de l’inquisition des bonnes mœurs où siègent des eunuques mordus par la «tarentule morale qu’était Rousseau» (16), se dresse un horizon enveloppant où les vaguelettes d’un petit catéchisme, de même que les saillies des plus insoutenables homicides, sont emportées par l’immense vague d’une vérité indépendante de nos encyclopédies. Aussi n’est-il pas complètement saugrenu de soutenir que des hommes tels que Lester Ballard ou le Juge Holden, par leur démesure, par leur surréalité, sont des vecteurs de métabolisation par l’intermédiaire desquels les exaspérations perceptibles et composées du Mal sont réorientées vers une improbable et imperceptible décomposition de ce Mal, vers une terre insondable, vers ce que Jankélévitch appelait le tout-autre en parlant de la mort mais qui serait dans notre perspective le lieu du devenir, le lieu de la faramineuse effervescence, le lieu de l’atelier divin, le lieu d’un Ça cosmique, le lieu, finalement, de la bacchanale primitive que les livres exceptionnels nous dévoilent un tant soit peu et que les livres médiocres nous cachent. Pour toutes ces raisons admissibles ou inadmissibles, je vois dans Lester Ballard et le Juge Holden des médiateurs énigmatiques, des transitions étonnamment libératrices, et contrairement à ce que disait Adorno sur le fait qu’il était chaque fois nécessaire de flairer le Mal au revers de l’arbre en fleur (17), je dirais, avec McCarthy et ses impétueux suprématistes du Mal séculier, qu’ils sont chacun d’eux les promesses de l’arbre en fleur par-delà les phénomènes de la dévastation ou de la vie statique, les signes sacrés d’une abolition des catégories morales qui nous ramènent à la vie pure délestée de toutes nos références. Ce n’est pas tant l’individualité phénoménale et profanatrice de ces personnages qui compte que leur dimensionnalité, que leur corps astral, que la quantité d’énergie qu’ils ont requis dans la sphère pré-individuelle où se négocie la constante mise en forme du monde. Nous dirons alors que leur déstabilisante forme vivante, aussi coupable soit-elle dans nos palais de justice, traduit un éventuel sursaut de la vie surnaturelle dans un monde humain en train de mourir psychiquement, une punition potentielle pour les résignés d’une vie mutilée, diminuée, anesthésiée. On trouve également beaucoup cela chez Flannery O’Connor, la promesse d’une grâce sous les décombres de l’humanité.
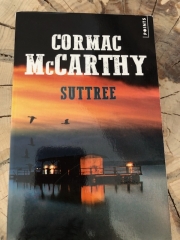 C’est pourquoi je verrai toujours plus de vie dans le Knoxville (Tennessee) désaxé que McCarthy décrit avec son incroyable Suttree que dans le Paris coquet de tant de nos imposteurs de la littérature. C’est pourquoi encore, par souci de cohérence, j’établis une distinction décisive entre ces monstres absolus de la fiction que sont Ballard, Holden et tout le collège des méchants de McCarthy, lesquels possèdent leurs équivalents marginaux dans le réel, et les pseudo-innocents des mauvais romans ou de la réalité qui s’agrègent en une foule navrante, tragiquement conventionnelle, davantage mobilisée dans la mort (la vie diffamée ou accaparée par quelques-uns) que dans la vie (la mort acceptée pour tous comme dialectique d’une reprise d’élan dans les cycles de vitalité). En d’autres termes, nous avons certainement plus à craindre des champions de la morale et de la rationalité que des rares éruptions de la monstruosité la plus irrationnelle, la plus hermétique, la plus sanglante, parce que ce sont invariablement les hommes de peu de vitalité qui font multitude et qui ourdissent les pires manifestations du Mal, les pires attentats à la vie, les pires coagulations du sang de la Terre, trahissant le minimum de vie qu’ils ont en eux, le minimum de vie qui leur a été alloué avant l’avènement de leur forme terrestre. De telle sorte qu’il faudrait oser rappeler que l’excès de morale conduit généralement à l’immoralité, à l’hétéronomie, à la cécité du discernement, comme l’excès de raison conduit au nazisme pour ce qui est de l’arsenal d’une production industrielle de la mort, et les uns et les autres qui ont permis cela, les uns et les autres qui se sont adaptés à l’holocauste de la liberté et à l’holocauste des Juifs, ce ne sont pas les intraitables personnages de McCarthy ni leurs symétriques personnalités réelles, ces individus-là étant à l’abri des propagandes et des grégarismes démentiels.
C’est pourquoi je verrai toujours plus de vie dans le Knoxville (Tennessee) désaxé que McCarthy décrit avec son incroyable Suttree que dans le Paris coquet de tant de nos imposteurs de la littérature. C’est pourquoi encore, par souci de cohérence, j’établis une distinction décisive entre ces monstres absolus de la fiction que sont Ballard, Holden et tout le collège des méchants de McCarthy, lesquels possèdent leurs équivalents marginaux dans le réel, et les pseudo-innocents des mauvais romans ou de la réalité qui s’agrègent en une foule navrante, tragiquement conventionnelle, davantage mobilisée dans la mort (la vie diffamée ou accaparée par quelques-uns) que dans la vie (la mort acceptée pour tous comme dialectique d’une reprise d’élan dans les cycles de vitalité). En d’autres termes, nous avons certainement plus à craindre des champions de la morale et de la rationalité que des rares éruptions de la monstruosité la plus irrationnelle, la plus hermétique, la plus sanglante, parce que ce sont invariablement les hommes de peu de vitalité qui font multitude et qui ourdissent les pires manifestations du Mal, les pires attentats à la vie, les pires coagulations du sang de la Terre, trahissant le minimum de vie qu’ils ont en eux, le minimum de vie qui leur a été alloué avant l’avènement de leur forme terrestre. De telle sorte qu’il faudrait oser rappeler que l’excès de morale conduit généralement à l’immoralité, à l’hétéronomie, à la cécité du discernement, comme l’excès de raison conduit au nazisme pour ce qui est de l’arsenal d’une production industrielle de la mort, et les uns et les autres qui ont permis cela, les uns et les autres qui se sont adaptés à l’holocauste de la liberté et à l’holocauste des Juifs, ce ne sont pas les intraitables personnages de McCarthy ni leurs symétriques personnalités réelles, ces individus-là étant à l’abri des propagandes et des grégarismes démentiels. Ainsi la tendance qui consiste à immédiatement criminaliser le tout-autre humainement structuré répond selon toute probabilité à un impératif d’abomination de la vie et laisse de jour en jour s’installer un suicide quasi universel. Dès lors je suis persuadé que les quelques tueurs imaginés par McCarthy et leurs synonymes imaginés par Dieu sont des êtres mandatés pour renverser nos tables et nous remémorer que là où nous postulons volontiers qu’ils seraient un scandale, un sang impur, une défécation, une puante anomalie, ils nous indiquent plutôt que le Mal hyperbolique s’amorce dans la banalité, dans le murmure des concertations malveillantes, dans les «bureaux louches et faux» des «coups de vent de la démence» (18), dans les fonctions, et non dans ce qui apparaît comme directement et furieusement dysfonctionnel. Partant de là, lorsque vous n’êtes pas l’un de ces monumentaux assassins de McCarthy (et de toute façon le monde ne pourrait en recenser qu’une centaine à tout casser), vous êtes, à mon sens, un bon degré en-dessous de cette nature survoltée, c’est-à-dire une version plus édulcorée de cet érémitisme féroce, peut-être un cas psychiatrique, un inadapté, un perdant, un alité, un William Gasper (19), possiblement un écrivain, assurément une entrave à tout ce qui voudrait empêcher le sang de suivre la pulsation originelle – la permanence pneumatique ou la respiration de Dieu, «cette résonance qui est le monde lui-même et qui ne peut être dite mais seulement célébrée» (20).
Il est du reste évident que les écrivains qui colportent la rumeur du sang originel à travers eux-mêmes ou leurs personnages sont pour la plupart ou bien des vivants forcenés qui n’ont pas survécu longtemps aux climats délétères des sociétés cadavériques, ou bien des experts de la souffrance et de la douleur, des âmes marquées au fer délicat de l’hyperémotivité et dont l’œil sidéral voit toutes les carences affectives de la Terre, les deux pouvant aller de pair car les titans de la vie ont souvent assez vite souffert des passions collectives pour la mort et pour le ressentiment. Quoi qu’il en soit, pour les premiers d’entre eux, pour les fauchés en plein vol, pour les Jack Kerouac, les Thomas Wolfe et les Roberto Bolaño, ils n’ont jamais été solidaires des trahisons successives de la vie qui donnent aux civilisations les dispendieuses fournitures d’un misérable hédonisme de parvenu, et pour les autres, pour les affligés congénitaux, les dépressifs from the outset, les natifs de la supra-sensibilité, pour les Sylvia Plath, les Carson McCullers, les Flannery O’Connor, les Francis Scott Fitzgerald et les Tristan Egolf, ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu le malheur par intropathie, qui se sont exprimés depuis les larmes de sang du visage de la Création, et, paradoxalement, leur expression d’une certaine défiguration de l’humanité, d’une certaine grimace mondaine, d’une certaine tératologie sociale, a ouvert les portes de notre perception afin de nous faire soupçonner la Vie extra-mondaine et irradiante dont ils n’ont cessé d’être les vénérables et fragiles ambassadeurs, rejoignant de la sorte leurs acolytes en vitalité zénithale. Or en écrivant ceci, je ne peux me retenir d’avoir une pensée émue pour quelques-uns de nos récents ministres français de la Lumière vivante, pour Vincent La Soudière et Thierry Metz qui se sont suicidés, pour Jacques Besse également, décédé dans la froideur d’une clinique alors qu’il était quotidiennement prosterné devant cet autel de l’incandescence dont vous avez souligné l’indispensable existence, autel qui, nous le savons, constitue l’aileron du requin qui permet d’échapper à la mer étale des mortelles platitudes.
Tous ces acharnés de la littérature, pour aucun prix qu’on leur eût garanti, n’ont eu le plus infinitésimal mouvement de recul devant le «ça» et les brûlantes révélations de l’autel susmentionné. Ils sont tous de la famille de Cornelius Suttree (peut-être le plus immense des personnages de McCarthy), ils ont tous un air de famille avec ce déclassé des vulgaires mais ce reclassé de Dieu, avec cet arpenteur de la détresse dont le titubant trajet nous offre une requalification du signe de la fécalité lorsqu’il descend dans l’Hadès présumé des égouts. Il faut s’imbiber de la merde comme Suttree – comme Louis-Ferdinand Céline aussi – pour franchir un seuil crucial de compréhension et déclarer que la puanteur relève d’une performance car elle régénère et fertilise les formes vivantes, et, en cela, elle s’inscrit en faux contre les formes livides du capitalisme. Si bien que le véritable Mal se déploie non plus sous les aspects de la saleté, du sanglant et du hors-la-loi, mais sous les traits policés du design capitalistique qui nous montre la sournoise laideur d’une certaine forme de la beauté. On pourrait même aller jusqu’à poser l’hypothèse que Suttree est davantage qu’un roman parce que ce livre, à bien des égards, propose une théorie critique de l’hygiène, un intelligent renversement de l’hygiénisme moral, une habile contestation de la prophylaxie capitaliste dont le but est de promouvoir un fort anti-hygiénisme cosmologique. Ce que nous apprend donc McCarthy par le biais de Cornelius Suttree, c’est que la cosmétique, rituellement, cherche à faire la guerre au cosmique. Une insidieuse forme satanique de la fausse pureté voudrait ainsi anéantir les formes véridiques et divines de la fécalité régénératrice. À ce titre, nous savons que pour Bichat la vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort, mais, avec Suttree, nous nous avisons du fait que la vie doit être l’ensemble des fonctions qui maintiennent le dynamisme des processus de décomposition. Il s’agit certes d’un
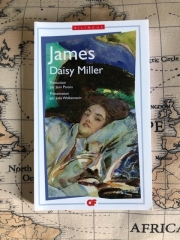 vitalisme contre-intuitif, mais c’est le plus fondamental qui soit, le plus nécessaire, car il nous fait deviner l’âme du monde, l’âme des profondeurs, l’âme de l’humus fécondateur où se réverbèrent les firmaments démiurgiques. Et cette décomposition rédimée ne se prévaut d’aucun romantisme de la charogne car sous la plume de McCarthy elle accroît son caractère effroyable et torturant. Les abîmes explorés par Cornelius Suttree ne sont pas des parcours fléchés pour les bourgeois. Ce sont des régions si rudes, si véhémentes, si miraculeuses de l’indiscutable Présence, qu’elles tueraient sur le coup l’imprudente ou orgueilleuse prostituée du Capital, comme les marais pontins de Rome ont jadis tué Daisy Miller (21). Ce sont encore des régions où McCarthy rapporte des indices ou des motifs récurrents de créosote, des régions, plus exactement, où des tréfonds indubitablement pétrolifères résonnent avec les personnages crasseux baignés de ce carburant existentiel. Aussi se dégage un genre de thème poétique du pétrole dans Suttree autour duquel s’organise la synthèse des vertus énergétiques (les profondeurs nourricières de ceux qui sont à la marge du Capital affameur) et des vices capitalistiques (comme mauvaise manière de sonder les entrailles de la Terre pour en extraire le pétrole et le vendre aux crapules).
vitalisme contre-intuitif, mais c’est le plus fondamental qui soit, le plus nécessaire, car il nous fait deviner l’âme du monde, l’âme des profondeurs, l’âme de l’humus fécondateur où se réverbèrent les firmaments démiurgiques. Et cette décomposition rédimée ne se prévaut d’aucun romantisme de la charogne car sous la plume de McCarthy elle accroît son caractère effroyable et torturant. Les abîmes explorés par Cornelius Suttree ne sont pas des parcours fléchés pour les bourgeois. Ce sont des régions si rudes, si véhémentes, si miraculeuses de l’indiscutable Présence, qu’elles tueraient sur le coup l’imprudente ou orgueilleuse prostituée du Capital, comme les marais pontins de Rome ont jadis tué Daisy Miller (21). Ce sont encore des régions où McCarthy rapporte des indices ou des motifs récurrents de créosote, des régions, plus exactement, où des tréfonds indubitablement pétrolifères résonnent avec les personnages crasseux baignés de ce carburant existentiel. Aussi se dégage un genre de thème poétique du pétrole dans Suttree autour duquel s’organise la synthèse des vertus énergétiques (les profondeurs nourricières de ceux qui sont à la marge du Capital affameur) et des vices capitalistiques (comme mauvaise manière de sonder les entrailles de la Terre pour en extraire le pétrole et le vendre aux crapules).Ici même où les préjugés ne tarderaient pas à proclamer par monts et par vaux que l’environnement de Suttree n’est qu’une atmosphère de désintégration, un témoignage minéral et chaotique de l’éboulement total, je suis convaincu que Max Picard, lui, aurait eu là le pressentiment d’une subsistance du «monde inaltérable» (comme il l’aurait eu en marchant dans la Cité dégringolée de Gary – Indiana) (22). Le Knoxville de Cornelius Suttree n’est pas perméable aux cadeaux empoisonnés du Capital, et la banlieue de cette ville anecdotique sur la carte américaine, inexorablement, contrarie les tentatives d’arraisonnement du Capital en le confrontant à l’eschatologie des fécalomes. Il y a quelque chose de résolument indestructible dans ce Knoxville de McCarthy et dans les quadrillages irréguliers de ses périphéries prophétiquement dédaignées. Parmi les bannis et les asociaux, s’effectue un partage naturel du Royaume, une manière d’habiter le monde en libres enfants de Dieu, en continuateurs de la créativité primordiale. Ils appartiennent à la Présence et la Présence les bénit. Ils sont déjà dans l’éternité, dans ce qui n’a ni de commencement et ni de fin, dans ce qui ne concède aucune aspérité pour les griffes hystériques du Capital. Ils ont considérablement échoué dans le temps court, mais ils ont absolument réussi dans le temps long, tandis que les habitants des métropoles, eux, ne sont pas prêts à
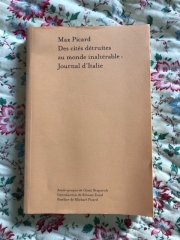 reconnaître qu’ils vivent au cœur des ruines, au cœur des fumants décombres de l’Occident effondré. Autrefois la guerre avait été la cause des «cités détruites» visitées par Max Picard dans l’Italie de 1949 et de 1950, des cités où Picard dépistera malgré tout la rédemption, mais les ravages insinués par McCarthy ne concernent pas les saccages perpétrés par un bombardement massif, ils concernent plutôt l’inconsciente autodestruction engendrée par le capitalisme, le fait que la verticalité de New York, de Chicago et de Los Angeles par exemple, en contrepoint des faubourgs de Knoxville, puisse être l’allégorie d’une horizontalité sacrilège où déambulent en lugubres processions les spectres des Américains qui ne savent pas qu’ils sont les tristes relégués du vaste monde inaltérable, les réprouvés du sang fédérateur, les pitoyables exilés de l’ivresse. Et s’il fallait localiser en Amérique un site colossalement impérissable, sanglant et euphorisant, il faudrait alors réquisitionner le Mexique de Conrad Aiken et celui de Jack Kerouac escorté de Neal Cassady, celui, également, de Roberto Bolaño et de Carlos Fuentes, le Mexique rétif aux cartographies, aux raisons pures et aux pronostics, le Mexique incommensurable qui attend John Grady Cole et Lacey Rawlins, cet au-delà du Rio Grande où «tout était blanc» sur la mappemonde alors que du côté des États-Unis «il y avait des routes et des cours d’eau et des villes» (23).
reconnaître qu’ils vivent au cœur des ruines, au cœur des fumants décombres de l’Occident effondré. Autrefois la guerre avait été la cause des «cités détruites» visitées par Max Picard dans l’Italie de 1949 et de 1950, des cités où Picard dépistera malgré tout la rédemption, mais les ravages insinués par McCarthy ne concernent pas les saccages perpétrés par un bombardement massif, ils concernent plutôt l’inconsciente autodestruction engendrée par le capitalisme, le fait que la verticalité de New York, de Chicago et de Los Angeles par exemple, en contrepoint des faubourgs de Knoxville, puisse être l’allégorie d’une horizontalité sacrilège où déambulent en lugubres processions les spectres des Américains qui ne savent pas qu’ils sont les tristes relégués du vaste monde inaltérable, les réprouvés du sang fédérateur, les pitoyables exilés de l’ivresse. Et s’il fallait localiser en Amérique un site colossalement impérissable, sanglant et euphorisant, il faudrait alors réquisitionner le Mexique de Conrad Aiken et celui de Jack Kerouac escorté de Neal Cassady, celui, également, de Roberto Bolaño et de Carlos Fuentes, le Mexique rétif aux cartographies, aux raisons pures et aux pronostics, le Mexique incommensurable qui attend John Grady Cole et Lacey Rawlins, cet au-delà du Rio Grande où «tout était blanc» sur la mappemonde alors que du côté des États-Unis «il y avait des routes et des cours d’eau et des villes» (23). Notes de la deuxième partie
(7) Krasznahorkai, Sous le coup de la grâce (sous-titré : Nouvelles de mort). Le texte auquel nous nous référons – Le dernier bateau – est celui qui ouvre le recueil.
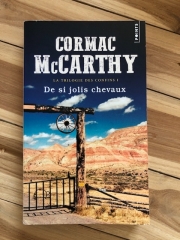 (8) Cf. Claudio Magris, Danube.
(8) Cf. Claudio Magris, Danube.(9) Shakespeare, Henry IV.
(10) Jack Kerouac, Big Sur.
(11) Carl Gustav Jung, L’homme à la découverte de son âme.
(12) Gilbert Cesbron, Notre prison est un royaume.
(13) Kerouac, op. cit.
(14) Cf. Cormac McCarthy, Un enfant de Dieu.
(15) Cf. Cormac McCarthy, Méridien de sang.
(16) Nietzsche, Aurore (préface).
(17) Cf. Theodor Adorno, Minima moralia.
(18) Émile Verhaeren, Les Campagnes hallucinées.
(19) Cf. Howard McCord, L’homme qui marchait sur la lune.
(20) Cormac McCarthy, De si jolis chevaux.
(21) Cf. Henry James, Daisy Miller.
(22) Cf. Max Picard, Des cités détruites au monde inaltérable : journal d’Italie (réédition de 2022 aux incontournables Éditions La Baconnière).
(23) Cormac McCarthy, De si jolis chevaux.





























































 Imprimer
Imprimer