« La panoplie littéraire de Bernard Frank | Page d'accueil | Entretien autour de l’anthologie J’ai mis la main à la charrue : Gregory Mion et Henri Rosset aiguisent le soc afin de rendre la terre moins vaine, 2 »
14/02/2023
Entretien autour de l’anthologie J’ai mis la main à la charrue : Gregory Mion et Henri Rosset aiguisent le soc afin de rendre la terre moins vaine, 1

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone.L’entretien qui suit a été le fruit d’une longue et féconde conversation dont l’initiative est à mettre au crédit d’Henri Rosset (du Cercle Jean Mermoz de Toulouse). Pendant l’année 2022, en des moments où la grâce pouvait vaincre la pesanteur, Henri Rosset a envoyé ses questions, ses réflexions et ses intuitions à Gregory Mion, afin que ce dernier approfondisse certains sujets qu’il aborde dans son anthologie J’ai mis la main à la charrue (Éditions Ovadia, 2021). En outre, comme dans toutes les discussions d’envergure, les thèmes abordés se sont volontiers agrégés à d’autres thèmes, beaucoup d’idées ont trouvé leurs suites impériales, tant et si bien que ce dialogue ne saurait se limiter à un acte promotionnel. Il n’est à vrai dire jamais question de promouvoir un livre – il est plutôt question de promouvoir la littérature et la façon dont celle-ci nous permet de mieux être une cible pour le Royaume de Dieu. Initialement paru sur le site officiel du Cercle Jean Mermoz de Toulouse puis disparu du même site à la suite d’une ruse de l’informatique, cet entretien reparaît maintenant dans la Zone du Stalker, amplifié de quelques fulgurances ou de quelques hermétismes qui sauront susciter le ravissement à notre époque de platitudes et de molles clartés.
Henri Rosset
Votre livre se compose exclusivement d’éloges et d’hommages aux grandes œuvres littéraires qui vous ont influencé («Il n’y a qu’une âme noble qui sache louer» comme le rappelle Abel Bonnard dans son livre L’Amitié) – ainsi vos critiques s’enroulent autour d’un même axe de grandeur : la poursuite inlassable du sacré à travers la littérature qui devrait
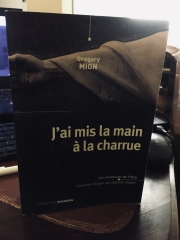 être le «vrai cerveau du monde» selon ce que l’on peut deviner des espérances de Don DeLillo que vous citez (p. 403). L’agencement et la structure que vous avez donnés à votre ouvrage sont explicites quant à vos intentions. Il se découpe en cinq parties : Ségrégation(s), Le Mal (patent et latent), Liberté(s), Géants d’Amérique, Sommets de France et de Suisse. Cette partition résonne étrangement avec la structure du Temps des livres est passé de Juan Asensio – le «meilleur héritier de Léon Bloy en France» selon le bel hommage que vous lui adressez dans votre épigraphe – qui a également utilisé le singulier unique pour un seul de ses chapitres (La parole viciée, Monstres, Cratères et Célébrations). Sur le modèle du Temps des livres est passé, on découvre que peu d’écrivains contemporains peuplent vos pages d’admirations, comme si le fil d’argent et de pourpre qui forge la littérature s’était – par un malencontreux et mystérieux événement – rompu (il convient toutefois de signaler au registre des vivants que vous avez consigné dans votre ouvrage les noms de Marien Defalvard, François Esperet, László Krasznahorkai et Don DeLillo). Pour relier la corde tendue par-delà l'abîme d’une fade littérature contemporaine par vos ouvrages respectifs, je voudrais vous demander si la parole viciée – habituellement charriée par tout son cortège de boutiquiers – est la manifestation la plus pure de ce Mal (patent et latent).
être le «vrai cerveau du monde» selon ce que l’on peut deviner des espérances de Don DeLillo que vous citez (p. 403). L’agencement et la structure que vous avez donnés à votre ouvrage sont explicites quant à vos intentions. Il se découpe en cinq parties : Ségrégation(s), Le Mal (patent et latent), Liberté(s), Géants d’Amérique, Sommets de France et de Suisse. Cette partition résonne étrangement avec la structure du Temps des livres est passé de Juan Asensio – le «meilleur héritier de Léon Bloy en France» selon le bel hommage que vous lui adressez dans votre épigraphe – qui a également utilisé le singulier unique pour un seul de ses chapitres (La parole viciée, Monstres, Cratères et Célébrations). Sur le modèle du Temps des livres est passé, on découvre que peu d’écrivains contemporains peuplent vos pages d’admirations, comme si le fil d’argent et de pourpre qui forge la littérature s’était – par un malencontreux et mystérieux événement – rompu (il convient toutefois de signaler au registre des vivants que vous avez consigné dans votre ouvrage les noms de Marien Defalvard, François Esperet, László Krasznahorkai et Don DeLillo). Pour relier la corde tendue par-delà l'abîme d’une fade littérature contemporaine par vos ouvrages respectifs, je voudrais vous demander si la parole viciée – habituellement charriée par tout son cortège de boutiquiers – est la manifestation la plus pure de ce Mal (patent et latent).Gregory Mion
Il existe en effet une synergie flagrante et profonde entre les luttes de Juan Asensio et les miennes, et, parmi ces luttes, la question du langage occupe une place éminente. On pourrait affirmer que la parole viciée (pour ne pas dire la parole vicieuse) que Juan Asensio critique avec son cœur épouvanté se définit formellement par une langue défigurée, asyntaxique, anémique, et, fondamentalement, par une insoutenable laideur morale. De sorte que là où cette parole sévit, la vertu est tenue en échec et le vice est érigé sinon en principe de vie, du moins en programme politique. En d’autres termes, lorsque la parole du vice est assimilée comme langue vivante et d’une certaine manière comme système unique de représentations, toute volonté de faire le Bien disparaît ou se trouve sournoisement réprimée (ce qui implique une amnésie du Bien et donc au bout d’un certain temps quelque chose de plus dévastateur que l’action du Mal en tant que telle). Il s’ensuit que le Mal infusé par cette parole est à la fois patent et latent : d’une part il est patent dans la mesure où il réduit la langue à son registre le plus superficiel possible (ce qui heurte les rares oreilles sensibles), et, d’autre part, il est latent dans la mesure où il dénoue dans les esprits ce que Dieu a pu y nouer à l’origine.
C’est du reste une langue d’autant moins vivante qu’elle détruit la singularité humaine au douteux bénéfice d’une homogénéisation des perceptions et des passions. L’amour et la haine, pour ne prendre ici que deux passions canoniques, deviennent alors l’amour et la haine déterminés par la foule, ou, si l’on veut, l’amour et la haine fixés dans un carcan infra-populaire de mots exsangues, répétitifs et artificiels. Ce faisant, l’intériorité de chaque individu, les subtils états de l’âme, les prodiges du Moi, ne sont plus que les grossiers reflets d’un monde extérieur nivelé par un langage strictement instrumental et insensible. L’individu privé, naturellement polymorphe, n’est plus qu’un individu a minima, dépossédé de son individualité, tombé dans la commensurabilité des sentiments de la masse et de leurs descriptions devenues approximatives et pauvres en signification. C’est ce que Bergson a très bien étudié dans Le Rire en soutenant que nous perdons «les mille nuances fugitives» (1) de l’amour et de la haine par un effet de déportation de ces passions au cœur d’un monde restreint, amputé, limité à un champ de désignations correspondant à de mornes étiquettes, à de déprimantes injonctions pratiques. On peut aussi évoquer un effet d’incubation : plus nous vivons dans une réalité sommée de ne répondre qu’à nos besoins les moins complexes, à nos intérêts les moins nobles, plus nous intériorisons une sorte de reductio ad unum, plus nous métabolisons un déplorable resserrement du réel à l’Unité exploitable, plus nous nous éloignons du Multiple qui encourage à la contemplation du miracle de la nature.
Et ajoutons de surcroît que Bergson réfléchissait durant l’amorce d’un XXe siècle déjà hautement contaminé par la religion du progrès, donc par la religion du rendement, de la vitesse et de la schématisation à outrance, contaminé par le culte de l’argent aussi, un culte que Léon Bloy réprouvera dans son indépassable Sang du pauvre un peu plus tard en 1909 (un peu avant les conclusions vaticinatrices de Charles Péguy sur le même thème). Ainsi, à l’aurore de ce nouveau siècle illuminé par un leap forward mood, on présage quelque chose de crépusculaire, peut-être la phobie culminante de la différence et de la générosité, la phobie des prodigalités de la nature conjuguée à la crainte malsaine des inaliénables dons humains. C’est-à-dire que s’esquisse là, possiblement, le dégoût prononcé d’une secourable langue de l’infini, un dégoût qui annonçait déjà la novlangue imaginaire d’Orwell, embryon fictif d’une gestion planétaire logocratique devenue réelle, tout comme cette aversion de l’infini préparait la maudite langue du Troisième Reich heureusement brocardée par les précieux commentaires de Klemperer, toutes deux des non-langues, toutes deux des langues de la finitisation qui ont défriché le terrain des langues outrageusement administratives, des langues antinaturelles et férocement inesthétiques, blasphématoires en fin de compte, déréalisant les réalisations divines, épousant les tropismes bureaucratiques d’Eichmann par anticipation, par imitation et par exacerbation. Un tel contexte à présent généralisé raréfie les âmes nobles et contribue à la multiplication des âmes ignobles, à la promotion des âmes d’épicier qui calculent tout, vraiment tout, jusqu’aux plus-values de leurs amitiés et de leurs inimitiés, jusqu’aux rentabilités de leurs amours, ce que montre parfaitement un John Dos Passos avec sa trilogie U.S.A. (2), précurseur des obsessions de DeLillo.
Cette parole corrompue est spécifiquement démoniaque et elle est même devenue pan-démoniaque depuis que l’Occident supra-industriel, néo-libéral et post-concentrationnaire étend sur la planète son obscène et putassière grammaire techno-moralisatrice, souillant à peu près tout ce qui existe, tout ce qui cherche à vivre dignement, tout ce qui accuse encore un élan de liberté, une vocation de créativité. Cette parole, par conséquent, sort de la bouche pourrie des pilleurs de tombes et des profanateurs de toutes les espèces du sacré : elle pénètre les grands cimetières pour troubler le repos des grands morts et elle s’empare des grandes valeurs éternelles pour les détruire méthodiquement. On le voit par exemple avec le stupide phénomène américain de la culture de l’annulation (cancel culture) qui relève d’un révisionnisme crapuleux et d’une propension à la victimisation adossée à un mesquin calcul des intérêts. Mais la parole du vice, en tant que telle, dans son essence même et au-delà de telle ou telle de ses manifestations particulières, se caractérise par une abominable parole de la Croix inversée qui désormais atteint presque le dernier stade de sa puissance diabolique : rendre éphémère ou caduc le Bien qui était durable et rendre durable le Mal que l’on croyait éphémère ou caduc. Cette parole du démon est d’ailleurs de plus en plus redoutable car elle confisque toutes les tribunes populaires, toutes les occasions d’apparaître, toutes les cases du tableau périodique des éléments du langage divin, semant dans le monde le règne croissant de l’Homme Malin qui prépare la venue définitive d’une satanodicée après avoir largement démantelé les saintes conditions de la théodicée. Ce problème-là, ce problème d’une ascendante législation du diable, je l’aborde transversalement dans mon livre et je le traite aussi de front avec ce que j’ai pu écrire sur La mélancolie de la résistance de Krasznahorkai. Mais tout en m’affolant de cela, je n’oublie pas le Jugement Dernier, je n’oublie pas ce jour où la suprématie des ténèbres s’inclinera devant l’ouverture du Livre de la Vie où ne seront pas consignés dans ces pages éclatantes de vérité les noms de ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la déshumanisation.
Outre cela, il ne me faut pas produire un effort d’athlète pour illustrer encore plus concrètement ce que je dis avec des termes parfois abstraits ou extatiques. Ce que nous avons traversé pendant deux ans avec le contexte pandémique (voire maintenant pseudo-pandémique et ultra-politique), ce que nous traversons là sur notre inquiétante barque de Charon, c’est, ni plus ni moins, un monstrueux chapitre de l’histoire humaine au sein duquel s’opère l’amplification spectaculaire de la parole viciée. Ce que cette parole produit, ce dont plutôt le ventre de la Bête accouche, c’est au préalable d’un Putanat sanitaire international dont le storytelling s’appuie sur un espéranto scientifique et managérial immonde. Ces enragés de la rationalité fanatique ont dû oublier (si jamais ils l’ont su un jour) les préconisations du philosophe Francis Bacon lorsque celui-ci nous exhortait à nous rappeler qu’on ne peut vaincre la nature qu’en lui obéissant (3), et non, vous l’aurez compris, en s’imaginant qu’on peut la dominer avec des décrets arbitraires, des prosélytismes pharmaceutiques et des discours bassement sermonneurs. Plus précisément ou moins polémiquement si vous préférez, quand on lit ou que l’on écoute cette nouvelle parole du vice, cette nouvelle mouture de la Némésis médicale jadis pointée du doigt par Ivan Illich, on devine ou l’on entend trois choses qui se recoupent : d’abord la fatale apologie d’une simplification abusive des flux vivants par une quantité astronomique de jargons mortifères, ensuite la criminalisation de la pulsion de vie par les monarchies de la pulsion de mort, et, enfin, l’affirmation d’une morale des esclaves qui veut assigner à domicile tout ce qui est dionysiaque (et qui veut libérer en revanche tout ce qui concourt à fortifier les dogmes du ressentiment). En gros, cela donne une catastrophe dont nous ne voyons pour l’instant qu’un infime prélude, une barbarie en puissance qui va s’actualiser lorsque seront définitivement massacrées les fondations de ce qui constitue en propre une civilisation. Je crois qu’il suffit seulement de souligner qu’une époque qui a dénigré tout ce qui est vital (par exemple l’amour susceptible d’unir deux êtres) au profit de tout ce qui est létal (par exemple le travail qui alimente le Capital fécaloïde) ne mérite pas d’être qualifiée autrement que dans les terminologies les plus sévères.
Et parallèlement à cette succession de désintégrations éhontées, on a logiquement assisté, dirais-je, à l’évidence d’une désintégration accélérée du sanctuaire de la littérature, car, enfonçons le clou sur la dalle mortuaire des lettres modernes, là où la parole viciée existe, la littérature existe beaucoup moins ou n’existe plus. Pour ne parler que du cas désespéré de la France, au fur et à mesure que le petit fascisme sanitaire a bidouillé ses petits protocoles et redonné au marché du livre les pleins pouvoirs de nuire, nos plus énormes cacographes ont significativement augmenté leurs recettes. Autrement dit les pires chieurs d’encre ont récemment connu leurs meilleurs moments de gloire et ils continuent en l’occurrence de les connaître, avec, en sus, la complicité des plus hauts dignitaires de la parole viciée, d’abord les journalistes évidemment, ces voituriers du démon, puis les libraires ensuite, qui, dans leur immense majorité inculte, ne sont que les porteurs de valises des scélérats locuteurs et rédacteurs du vice. À l’ère d’une population atomisée par le flot ininterrompu du vice cacographique et cacologique imitant ou contrefaisant la suprême vertu, à l’ère du panoptique sanitaire qui aurait suscité chez un Bentham une montée d’adrénaline mais chez un Tocqueville une fureur inégalable, l’écrivain français d’aujourd’hui ne se contente plus seulement de rouler des mécaniques et d’aller à la salle de sport (comme l’avait dûment fait remarquer Bolaño vers la fin de sa vie en évoquant la figure contemporaine de l’écrivain), mais il s’est procuré son immunité d’État, il a obstinément absorbé toutes les normes du discours officiel, et triplement, quadruplement, quintuplement, hyperboliquement silencieux sur cette dérive totalitaire 2.0 qui devrait le révulser, il poursuit son business comme si de rien n’était car pour lui le basculement du monde dans la servitude cybernétique est une opportunité commerciale accrue. Et l’indéniable surrection d’une tyrannie de la majorité, par extension, est pour ce traître en écriture et ce Judas de l’Écriture une alliance inespérée. Je pourrais d’ailleurs faire le même constat pour les intellectuels médiatiques et autres professeurs d’opérette à l’université, eux aussi dans leur effrayante majorité, plus soucieux de convoler avec le vice ambiant qui gratifie socialement plutôt que de choisir la vertu qui nous pousse à la marge mais laisse inentamé l’honneur d’être un homme, un vrai, et non un sous-homme, un salaud, un rouage de la Machine qui précipite en ce moment même l’instauration irréversible de l’inhumanité.
Montons cela dit encore d’un cran dans le catéchisme du vice parlant. Isolé dans sa mystique prodigieuse et donc relié à l’universel dont nous devrions tous être partie prenante, Ernest Hello, dans Le Jour du Seigneur, se posait naguère une question simple pour évaluer le degré de viabilité d’une civilisation : que fait-on de Dieu et que fait-on des pauvres ? Qu’est-ce que notre temporalité dorénavant saturée de jusqu’au-boutisme hygiénique et de despotisme économique nous dit de Dieu et des pauvres ? Comment la parole viciée aborde l’Être et son troupeau de lumière ? Elle exproprie Dieu et elle fait semblant de s’occuper des pauvres en prétendant leur proposer une indécente panacée. Et en cela, même le dimanche, même ce jour millénaire du Seigneur, a été transformé en un jour ouvrable, en solution de continuité pour la stratégie des bien-pensants et des cyniques. Du repos de Dieu et surtout du repos en Dieu, il ne reste presque rien. Et peut-être encore plus préoccupant : la substitution quasiment achevée de la parole théologique par la parole du vice donne même l’impression que l’Histoire est pétrifiée, que la main de Dieu s’est retirée, que la dynamique des peuples a dégénéré en multitudes statiques et sordidement réconciliées, le pape François étant lui-même allé jusqu’à se faire le chargé de mission des laboratoires anti-christiques. Alors je n’ai pas tellement le choix que de me tourner vers les consciences du passé quand je vois à quel point notre présent est déserté de lucidité, de force et de radicalité salvatrices. D’où mon insistance à louer, à célébrer, à m’acharner à écrire sur ceux ou avec ceux qui sont mes amis proches, mes amis de combat (Juan Asensio et François Esperet), ou mes amis lointains, inconnus dans l’espace mais connus dans l’esprit (Marien Defalvard, László Krasznahorkai et Don DeLillo), sans omettre tous les autres, tous les invités décisifs de mon anthologie, morts et pourtant plus vivants que les vivants, ces hommes et ces femmes dont Nietzsche eût immédiatement conclu qu’ils incarnent mes amitiés stellaires. Toute cette constellation humaine est une brillante matrice de la verticalité, une forteresse de résistance aux désordres de l’âme, un levier d’Archimède qui permet de soulever le monde vers le Royaume et d’affronter à mains nues les nombreux chaos rampants, les serpents de l’Enfer, en l’occurrence tous les crotales de notre planète saccagée auxquels Charles Dickens a fait un sort inoubliable avec son détestable personnage d’Uriah Heep dans le non moins inoubliable David Copperfield. Voulez-vous ainsi une directe préfiguration de la parole viciée de notre XXIe siècle ? Écoutez s’exprimer Uriah Heep et vous sentirez à travers lui les relents de ce vice qui n’en finit plus d’empoisonner le monde.
Henri Rosset
Parmi les romans contemporains qui explorent ce «vice qui n’en finit plus d’empoisonner le monde», La mélancolie de la résistance fait office d'œuvre majeure : ce roman publié en 1989 en Hongrie (traduit en France par Joëlle Dufeuilly en 2006) recense les sombres facettes du progrès technique ravageant le langage et la liberté sur l’autel toujours plus encensé du loisir et du divertissement, cela en plein cœur d’une Europe défigurée et frénétiquement démente. Au détour de votre note sur cet ouvrage intitulée «La mélancolie de la résistance de László Krasznahorkai : le centre inquiétant d’une œuvre prophétique» (p. 219), vous mentionnez au seuil de la page la souveraine et admirable préface du Nègre du Narcisse, où Conrad présente la «mission de toute œuvre d’art qui aspire à la qualité». N’en occultons nullement le majestueux souffle et la voici donc restituée partiellement : «Séduit par les dessous du monde
 visible, le penseur s’enfonce dans la région des idées, l’homme de science dans le domaine des faits, dont ils dégagent des vérités pratiques qui conviennent à cette hasardeuse entreprise qu’est notre vie. Ils parlent avec assurance à notre sens commun, à notre intelligence, à notre désir de paix où à notre inquiétude, fréquemment à nos préjugés, parfois à nos appréhensions, souvent à notre égoïsme, mais toujours à notre crédulité. Et l’on écoute leurs paroles avec respect, car elles ont trait à de graves questions, à la culture de nos esprits ou à la préservation de notre corps, à l’accomplissement de nos ambitions, à la perfection de nos moyens et à la glorification de nos précieux succès.»
visible, le penseur s’enfonce dans la région des idées, l’homme de science dans le domaine des faits, dont ils dégagent des vérités pratiques qui conviennent à cette hasardeuse entreprise qu’est notre vie. Ils parlent avec assurance à notre sens commun, à notre intelligence, à notre désir de paix où à notre inquiétude, fréquemment à nos préjugés, parfois à nos appréhensions, souvent à notre égoïsme, mais toujours à notre crédulité. Et l’on écoute leurs paroles avec respect, car elles ont trait à de graves questions, à la culture de nos esprits ou à la préservation de notre corps, à l’accomplissement de nos ambitions, à la perfection de nos moyens et à la glorification de nos précieux succès.»Cette préface mentionne le verbe «s’enfoncer», et c’est bien ce qui transparaît de vos écrits. Vous paraissez sonder avec une inlassable volonté la sourde voix de la nuit nichée au cœur des ténèbres de la littérature. À la lecture de vos notes, on découvre ce que l’on pourrait nommer emphatiquement la puissance pénétrante de la littérature — qui par sa géométrie délicate et féroce puiserait son implacable lucidité dans les cryptes abyssales de l’âme humaine qu’elle défricherait comme nulle autre discipline. On est donc bien loin de la littérature à la petite semaine, de cette littérature de divertissement (ce «divertissement n’étant que du vide ajouté au vide» tel que vous nous le présentez dans votre note finale sur Blaise Pascal) qui partout déchaîne sa propre médiocrité, à l’égal de sa journalistique promotion beuglante et assourdissante.
Néanmoins, à supposer que la littérature soit donc inévitablement et consubstantiellement liée à cet approfondissement de la connaissance du cœur vicié (et plein d’ordure ajouterait Pascal) de l’homme, une question se pose d’elle-même : la littérature n’a-t-elle donc jamais été amicale pour l’homme ? (N’est-ce pas, en tout cas, ce que disait ce même Conrad mais à propos de la mer dans Le miroir de la mer, dont les métaphores paraissent se transposer mimétiquement dans le domaine des Œuvres : «Malgré tout ce qui a été dit de l’amour que certaines natures ont – du rivage – professé pour elle; malgré les célébrations dont elle a été l’objet en prose et en chansons, la mer n’a jamais été amicale envers l’homme. Tout au plus a-t-elle été complice de la fièvre des hommes et joué le rôle de dangereux fauteur d’ambitions à l’échelle du monde»).
Gregory Mion
Si vous voulez, sous les aspects d’une amitié supérieure ou d’une très haute communion, sous ces aspects-là qui suggèrent donc la nécessaire et transitoire inimitié de l’ami qui se refuse à nous flatter, à nous ménager, toute littérature digne de ce nom doit être en priorité un irrévocable anéantissement de la tiédeur. J’entends par là une solution finale des formes les plus tièdes de l’humanité, une solution finale des cœurs inconsistants, comme le Christ, infailliblement, a pourfendu la suspecte tiédeur de l’Église de Laodicée dans l’Apocalypse. Par tiédeur, ici, comprenons tout ce qui fait la vilaine médiocrité du caractère humain, sa plus décourageante version, sa plus imprécise participation à la vie (combinée pourtant à l’insolente conviction de détenir une quelconque valeur, un quelconque poids, une quelconque crédibilité dont nul ne s’étonnera d’ailleurs qu’elle soit fondée sur l’innommable saint-frusquin). En d’autres termes, les membres de Laodicée souffrent d'une espèce d’arrivisme hallucinatoire qui les rend inaptes à vivre pleinement, à être résolus en quoi que ce soit, à réfléchir ardemment au mystère de l’existence. Ils ne brûlent ni de vivre ni de mourir pour quelque chose de bon ou de beau, encore moins pour quelque chose d’aussi pélagien que les destinations conradiennes dévolues au rinforzando de l’âme, pas davantage qu’ils ne sont glacés d’horreur à l’égard de ce qu’ils sont : des irrésolus dans l’essentiel éblouis par la confortable certitude de l’inessentiel, des avachis notoires dont l’unique levain transparaît dans l’argent et ses tangibles métamorphoses. Ils ne sont dans aucune extrémité de tempérament, dans aucune démangeaison de vivre qui les délivrerait du grégarisme des parvenus, ils ne trônent sur aucune cime de la psychologie, parce qu’ils sont convaincus de n’avoir plus rien à faire, sinon de laisser faire la grotesque opulence, de laisser travailler l’argent (4), et, ainsi, ils abandonnent leur cœur aux diastoles et aux systoles mécaniques de l’avilissante possession. Le Christ ne peut que vomir ces tièdes malfrats qui ne voient pas qu’ils sont aveuglés de fausse lumière, habillés d’illusions, pauvres en spiritualité, misérables traîtres de Dieu et calamiteux spectacle d’une fraction déshumanisée des créatures. Ceux-là, s’ils lisent, s’ils ont cette prétention, ils ne peuvent lire qu’une littérature manufacturée pour et par la méprisable bourgeoisie d’argent, aux antipodes d’une littérature qui étourdit les terres et les mers plates parce qu’elle provient d’un aérolithe aristocratique, d’une éruption surnaturelle qui tombe du ciel et qui extermine les climats tempérés des philistins – une littérature qui serait celle de l’Église de Philadelphie.
De telle sorte que si la littérature est inamicale, elle ne l’est que parce qu’elle relève d’une amitié difficile et exigeante, pas du tout encline à prendre le lecteur pour un imbécile ou pour un baron de Nucingen. Elle est en revanche fortement disposée à lui révéler la meilleure part de lui-même. Ce meilleur de nous-mêmes, cette excellence intime, ne peut se dévoiler qu’au moyen d’un engagement total dans la vie spirituelle, au gré d’un rejet intégral des églises béotiennes, d’une franche répudiation des sectes où prévaut la vulgarité du triomphe matériel. Il s’agit du seul mode de vie qui puisse nous permettre de retrouver tout à la fois le trésor de l’intériorité individuelle (pour abattre la duperie des conquêtes extérieures et individualistes) et les formes archaïques de la Création, les flamboyants et communs archétypes qui gisent au fond de chaque individu (pour abattre les ectypes qui ne sont que la traduction attiédie et extériorisée de ce que Dieu a déposé sans exception au sein de nos âmes respectives). Cette littérature-là, d’une terrible amitié, sœur d’une édifiante méchanceté qui veut être notre cicérone sur la voie compliquée d’un martyre ascensionnel (car il est pénible de tuer en nous-mêmes ce qui nous tuait sous couvert de nous faire vivre), cette littérature, sans l’ombre d’un doute, ne s’emploie qu’à nous détourner de l’extase descendante d’un quotidien analogue à celui de Laodicée. Elle est nécessairement apocalyptique, et, en conséquence, lestée d’une amitié ambiguë, hybride et volontiers perturbante. Elle est en outre apocalyptique comme cette étrange Bête dans la jungle d’Henry James, comme cette monstruosité présumée, retenue quelque part dans les alentours de notre vie courante et dans les couloirs infranchissables de notre inconscient, prête à bondir, sur le point de nous terrasser d’une douloureuse révélation qui pourra éventuellement nous racheter, nous rapatrier parmi les vivants, parmi ceux qui ont été guéris du monde spectral et désincarné, parmi ceux qui ont échappé de justesse au monde de la basse fréquence, au monde des intérêts bien compris. Je ne connais pas grand-chose de plus convaincant que ce bref roman d’Henry James pour nous remémorer les conditions d’une réelle vie sensible (au sens d’une vie retrouvée qui ne pourra plus être l’auxiliaire de sa propre et consternante anesthésie).
On en déduira que lorsque la littérature est amicale au sens le plus trivial du terme, elle se contente d’être une vulve syphilitique où vont se soulager à grands coups de reins écœurants les nécessiteux du Verbe, les illettrés du sublime et les analphabètes de l’enthousiasme. Cette littérature ne s’adresse qu’à la plus mauvaise part de nous-mêmes, à ce coefficient de Laodicée qui nous menace tous, et, cela va de soi, elle ne souhaite que neutraliser, modérer, aplatir les intensités divines sous quelque nature que ces dernières se présentent, tout comme elle souhaite réaliser son projet sacrilège sous les attributs d’une immonde bienveillance. Cette non-littérature ne peut du reste proliférer que par l’inadmissible perpétuation d’une croissante association de malfaiteurs dont le degré d’impiété n’a d’égal que son amour immodéré de l’argent. Ce sont de nouveaux marchands du Temple et il n’y a je crois qu’une turbulence religieuse qui pourra les mettre hors d’état de nuire. En France, ils ont des visages d’une affolante niaiserie, des physionomies de souteneurs, et, indifféremment, automatiquement, ils valorisent tous les livres qui contiennent la suffisante quantité de Putanat, la suffisante morphologie de républicanisme démocratique, le suffisant éjaculat de Babylonie qui est susceptible de retarder le ralliement aux célestes profondeurs de la Jérusalem éternelle. C’est là une désacralisation démultipliée de notre pays, un angle crucial de sa déchéance, une preuve de l’impossibilité provisoire du Bien (espérons-le !) et de la possibilité superlative du Mal.
Si mon livre peut servir de contrepoison, c’est, opiniâtrement, pour essayer d’inverser ce rapport de forces, ces valeurs controuvées, pour initier avec ce que nous avons de plus féroce en littérature et en philosophie une révolution axiologique ou du moins un rétablissement des valeurs fondamentales – celles d’une vie en spiritualité et en fraternité, celles, encore, d’un parcours de surhumanité nietzschéenne où tout est conspiration avec l’exhaustivité de la vie, de la plus énorme et la plus infime de ses facettes, sans la moindre intention d’écraser, de limiter ou de marginaliser. D’ailleurs ce n’est pas un hasard si dans le faisceau purulent des valeurs ambiantes et au cours d’une longue analyse j’ai voulu réinterroger le statut moral de deux personnages emblématiques : le James Wait de Joseph Conrad (ou le Nègre du Narcisse) et le Billy Budd d’Herman Melville (le Blanc à qui l’on offrirait le bon Dieu sans confession). À mon avis, on a trop vite fait de penser que le premier est coupable et que le second est innocent (ou que le premier est inamical et le second sympathique). En redistribuant les cartes de la moralité pour Wait et pour Budd, j’ai ordinairement rappelé que nos ennemis ne nous veulent parfois pas autant de mal que nos amis, ce qui, par les temps qui courent, doit nous aider à percevoir le double-fond de certains gourous du bonheur qui s’autoproclament les meilleurs amis du monde, de même que cela, par ricochet, doit nous alerter sur cette littérature soi-disant thérapeutique, très en phase avec l’air du temps, avec le Zeitgeist maléfique, très contagieuse, très virale, rédigée par des hommes et des femmes qui mériteraient subito le peloton d’exécution pour trahison spirituelle et pour prostitution sur les trottoirs du pandémonium capitaliste. Ces larbins et ces soubrettes à prétentions romanesques font des livres qui sont aimables avec l’idéologie dominante (mais qui salissent l’Idéal), tandis que les ultimes romanciers, les ultimes penseurs de notre siècle désolant, ne peuvent apparaître qu’à l’instar des ennemis viscéraux de l’idéologie (par amour inconditionnel de l’Idéal dont leurs œuvres sont imprégnées), donc à l’instar d’une maladie que tout un système s’acharne à combattre, à éradiquer. Autant dire à ce jour que les livres marqués du sceau de l’Idéal ne pourraient devenir les amis de la multitude qu’au prix d’un imprévisible concours de circonstances ou d’une parousie.
Henri Rosset
Il convient de signaler que les livres que vous défrichez, où plutôt que vous labourez selon le titre de votre ouvrage, ne sont pas des œuvres blêmes et plates et plaisamment accessibles. Décochant les flèches de leur acuité depuis les cryptes inexplorées de la réalité, la plupart de ces œuvres sont astreintes à une sorte de voilure hermétique plus ou moins dense. Cette langue unique de la littérature, vous en éclaircissez certaines ombres grâce à la philosophie comme en témoignent les deux auteurs les plus cités dans votre ouvrage : Nietzsche et Pascal (ce qui, vous en conviendrez, est déjà tout un programme). Nous parlions de Conrad et justement, dans une note de votre ouvrage consacrée à l’un de ses romans («La dimension infinie du secret dans Lord Jim : Joseph Conrad à la lumière de Pierre Boutang»), le caractère luminescent et approfondissant de la philosophie est nettement identifiable. On y retrouve la parole altière de Nietzsche : «Comme Nietzsche le suggère en outre nettement dans l’avant-propos du Gai Savoir, il ne faut pas chercher à pénétrer le mystère du réel en intégralité, il convient plutôt de l’accepter, d’en respecter le voile qui recouvre une précieuse nudité, vision à laquelle nous ne sommes pas éligibles.» (p. 254). Cet éloge secret des apparences, on le découvre également dans les derniers fragments de Nietzsche qui sont regroupés dans La volonté de puissance – livre dangereux où se mêlent griffonnages plus ou moins apocryphes et pure duplication de textes épars accolés et juxtaposés sur une même page pour se barioler dans un semi-cataclysme plus ou moins incompréhensible. En voici néanmoins un
 apophtegme saisissant : «Il serait possible que la véritable nature des choses fût tellement nuisible, tellement hostile aux conditions de la vie, que l’apparence fût nécessaire afin de pouvoir vivre». Voix discordante, voire grinçante par rapport à la tonitruante grandiloquence de «l’esprit de système» (manquant cruellement de «probité» selon Nietzsche), la littérature, en projetant son alchimie sauvage sur des réalités concrètes, semble avoir mieux que quiconque intériorisé cette maxime sculptée au fronton du temple édifié par l’ombre du voyageur.
apophtegme saisissant : «Il serait possible que la véritable nature des choses fût tellement nuisible, tellement hostile aux conditions de la vie, que l’apparence fût nécessaire afin de pouvoir vivre». Voix discordante, voire grinçante par rapport à la tonitruante grandiloquence de «l’esprit de système» (manquant cruellement de «probité» selon Nietzsche), la littérature, en projetant son alchimie sauvage sur des réalités concrètes, semble avoir mieux que quiconque intériorisé cette maxime sculptée au fronton du temple édifié par l’ombre du voyageur. Vos notes sont éclairantes quant à la profondeur amphibie de la littérature – capable d’apposer ses lèvres fébriles ou brûlantes sur les réalités d'une abyssale métaphysique (Dostoïevski, Esperet, Faulkner et Conrad pour ne citer qu’eux). La littérature a l’air également d’une cardinale banalité comme on le voit dans la nouvelle Baleine de Paul Gadenne. Ce livre, que beaucoup d’entre nous ont découvert grâce à Juan Asensio, ne raconte rien de plus que l’aventure diamétralement plate d’un demi-couple de bourgeois se promenant aux abords d'une plage quelconque, où une baleine blanche s’est échouée. Vous nous montrez, au détour de votre note («Baleine de Paul Gadenne : prestance de la charogne et mélancolie du bourgeois»), que derrière cette historiette d’une simplicité confondante, s’enroule autour d’un même pilastre virgilien une double corde mystique de compréhension. À rebours de sa pure innocence, la baleine échouée rappellerait aux hommes la royauté de la tragédie vitale qui anime le cours du monde : «Dès le début, donc, l’animal lugubrement accosté est le signe non pas d’un arrêt brutal de la vie ou d’un repos pétrifié dans une éternité immobile, mais il renvoie à quelque chose de mouvant, de lancinant, à une continuité subtile de la présence qui échappe aux regards novices qui n’ont pas été initiés à la réalité du devenir – à la nécessité du flux soutenu et incessant» (p. 571). Imprégné par la scansion fluide du fleuve d’Héraclite, cette note de lecture est néanmoins ambivalente : est-ce le texte même de Gadenne qui contient ces multiples et précieuses réflexions, où est-ce une extrapolation que seul le critique attentif a le devoir de tisser depuis son belvédère ? Placée dans le miroir des œuvres, dans l’inconfortable reflet des géants, Cristina Campo disait que le critique «est un écho, sans contredit. [...] Il doit l’avoir déjà entièrement subi : le restituer non comme un simple miroir, mais bien comme un écho : imprégné de tout le chemin parcouru, dans la nature par l’une et l’autre voix.» (5) Vos critiques se gravent-elles davantage dans la transparence parfaite d’un miroir réverbérant l'exacte syntaxe des œuvres ou dans la singularité d’un écho ?
Gregory Mion
Même s’il serait particulièrement tentant de vouloir reconstituer par une procédure analytique et synthétique la parfaite grammatologie d’une œuvre, je ne crois pas, le cas échéant, que l’on ferait autre chose que fantasmer un motif dans le tapis (pour de nouveau me référer à un texte fabuleux d’Henry James). Or si les œuvres étaient toutes traversées d’un motif objectivement identifiable, voire, pourquoi pas, d’un motif revendiqué par les auteurs eux-mêmes, nous n’aurions probablement qu’une littérature pour subventionner des articles universitaires aussi pudibonds que misérablement maniaques et pour entretenir des mythologies dont s’emparent les journalistes afin de répéter d’une année sur l’autre les mêmes sornettes. Aussi, voyez-vous, lorsque je redécouvre l’attitude de Hugh Vereker dans The Picture in the Carpet, lorsque je regarde l’attitude de cet écrivain qui prétend que les spécialistes sont tous passés à côté du grand mobile entretissé au sein de son œuvre complète, lorsque je vois le degré de folie obsessive que cela provoque, je ne peux m’empêcher de penser que ce n’est là qu’une mystification dont l’intention est de faire croire qu’une écriture médiocre serait en réalité coiffée d’un diadème de génialité quasiment imperceptible. Qu’est-ce à dire dans le cas de Vereker et de ses fétichistes ? Qu’est-ce à dire sinon que les hommes adorent se bercer d’illusions et qu’ils aiment l’ombre des ombres de la caverne platonicienne ? Et si l’œuvre de Vereker était vraiment géniale, serait-elle réductible à un canevas ? Pourrait-on la comprendre de part en part après l’avoir expliquée à satiété, après en avoir percé tous les coffres ? En cela j’ai une réticence à ravitailler la panse d’une critique supposée exprimer une «exacte syntaxe» des œuvres (car cela pue la note de bas de page), tout comme je n’ai guère de passion pour les écritures totalement perméables aux vanités de la raison pure, pour ne pas dire, maintenant, perméables aux vanités d’une raison pure lugubrement démocratique (car cela pue l’alibi du dépouillement ou de l’accessibilité, l’alibi des émotions conformes, l’alibi d’une littérature précisément managériale qui permet aux sidaïques du style et aux natures malingres de nous pondre de petites crottes saisonnières, de nous submerger ponctuellement d’infectes mignardises à destination des idéologues de la bienveillance et de l’industrie culturelle).
La France, avec Houellebecq, au moins depuis vingt ans à mes yeux, connaît un phénomène similaire à celui de Hugh Vereker. À force de répéter à chacun de ses livres qu’il y aurait quelque chose à y déceler, quelque chose comme une décisive clé de compréhension de notre société, on finit par oublier que c’est une œuvre d’abord démesurément surestimée du point de vue de son écriture, et, ensuite, que c’est une œuvre d’une affligeante pauvreté du point de vue des idées. Aucune métaphysique ne transparaît là-dedans, aucun motif ne s’y dessine de surcroît, hormis quelque chose de brouillon, de négligé, quelque chose de littérairement et de philosophiquement débraillé. Pour Houellebecq et tant de nos impostures nationales, l’écriture n’est pas un absolu mais un marchepied, une activité opportune, un moyen comme un autre de s’inscrire dans le rallye forcené de l’argent. Je crois même pour ces gens-là que la littérature n’est pas un plaisir mais une corvée (car comment pourraient-ils prendre du plaisir à rédiger des textes aussi mauvais ?). Si demain la chanson devenait plus avantageuse pour Houellebecq, alors il chanterait, il ferait une tournée estivale de sinistre primo uomo, et ainsi de suite de tous les imposteurs, ainsi de suite de tous les stratèges de l’usurpation qui écrivent relativement à des moments précis (des rentrées littéraires ciblées), mais jamais absolument car leur sang n’est pas celui des écrivains et leurs activités sont variées sur la palette de la vulgarité lucrative. Leur sang est celui des vampires qui sucent le sang du pauvre avant d’en recracher une partie dans les égouts de l’économie occidentale. Et du reste, indépendamment d’un cruel défaut de colonne vertébrale dans toutes ces productions usurpatrices, indépendamment aussi des velléités qui conjecturent dans les colonnes de tel ou tel torche-cul de la critique réputée littéraire une épine dorsale parmi ces livres invertébrés, quelle profondeur voudriez-vous qu’il y ait dans les œuvres de ces infâmes goules ? Quelle singularité ? Et quel gouffre énigmatique capable de nous transmettre un écho extraordinaire ?
Pour ma part, donc, je ne m’intéresse qu’aux œuvres qui nous font passer par-dessus le parapet, par-delà le limes d’un monde gouverné par les châteaux de Dracula. Je me soucie de ces œuvres pour plonger dans les précipices où l’on entend comme vous dites si bien «la singularité d’un écho» et où l’on saisit certainement par intuition optique le halo du divin. Au plus encaissé de ces régions initiatiques, ce n’est pas l’intellect qui se met à la recherche d’un motif de toute façon introuvable, mais le cœur, le cœur pascalien qui est le seul à pouvoir saisir les vérités premières, le cœur qui résonne de Dieu et qui reçoit les impressions d’un soleil perpétuellement levant, les impressions de l’infatigable imagination primitive du monde, comme si nous étions au centre de la Création, au cœur de la problématisation de l’existence, là où se décide la mise en forme de tout ce qui est suprêmement conçu. Tout grand livre est nécessairement habité par l’écriture de cet ordre de grandeur (en l’occurrence la grandeur de l’imagination la plus grande qui soit). Tout grand livre est une œuvre a priori commensurable pour l’intelligence et qui nous fait peu à peu descendre dans la lecture intuitive de l’incommensurable. Tout grand livre, pour utiliser une métaphore, commence par subjuguer l’intelligence comme un végétal complexe nous questionne, nous désarçonne, puis, d’heure en heure, de jour en jour, l’intellect cède sa place à l’intuition, la raison recule devant le cœur et nous remontons la forme finie de ce curieux végétal pour atteindre un atome indéfini de ses racines, un segment flou de son enracinement, une forme indistincte de sa participation à l’inspiration de Dieu (ou au souffle de la Nature pour les non-croyants).
C’est un écho particulier de cette inspiration divine que toutes les grandes œuvres du patrimoine littéraire et philosophique mondial nous transmettent. Par conséquent, lorsque je m’essaie à parler de ces œuvres, je ne trouve jamais quelque chose à dire en le cherchant, mais je le trouve sans le chercher, comme si l’écho mentionné par Cristina Campo m’avait lui-même capturé dans son paradoxal filet de lumière au plus profond des profondeurs abyssales, peut-être derrière le fameux mur de Planck que je cite dans mon étude sur Baleine, là où le bourgeois si friand de formes rassurantes, si passionné par la logique de la sécurité, si accoutumé aux affects les plus insipides, ne peut être qu’effrayé, tremblant, prêt à battre en retraite. Il me semble que c’est tout à fait ce qui arrive à ce couple que décrit Paul Gadenne dans sa superbe nouvelle : ils ont pressenti quelque chose de plus grand qu’eux, ils ont perçu l’écho des origines, ils ont auguré l’hétérogène sous l’homogène, mais ils n’ont pas franchi le Rubicon d’une révélation, ils n’ont pas pu se hisser dans la mystique pour se baigner dans l’Archè (dans le Commencement), pour nager dans les mêmes eaux privilégiées que la baleine échouée, ils n’ont pas pu y parvenir à cause de la misarchie consubstantielle à la bourgeoisie. Or cette témérité qu’il faudrait avoir à l’égard des Origines, ou ce courage qu’il faudrait se donner pour plonger dans les vastitudes océaniques de l’immortel Commencement, c’est cela, me semble-t-il, qui qualifie les grands écrivains et qui les habilite à nous véhiculer un retentissement spécial de l’irréductible symphonie créatrice. C’est cela qui les autorise à se rendre par exemple sous le volcan de Malcolm Lowry, quelque part aux abords du Secret, à l’avant-poste de la Solution, mais jamais dans le Secret qui n’appartient qu’à Celui qui sécrète infiniment le monde.
Dans cette perspective, et puisque vous rappeliez à juste titre le rôle d’orpailleur de Juan Asensio dans les dédales de la bibliothèque universelle, j’aimerais souligner que parmi les pépites qu’il a contribué à faire remonter à la surface de notre pays à la dérive, il y a l’écrivain grec Zissimos Lorentzatos, auteur étonnant du Centre perdu, un texte aussi lapidaire que vivifiant et dont les préoccupations esthétiques sont en sympathie avec les miennes. Pour résumer les choses, disons que Lorentzatos déplore une humanité excentrée, désaxée, déshéritée de son centre de gravité divin où elle puisait autrefois les ressources d’une vision fondatrice, les forces de la grandeur d’âme, les piliers d’un destin sacré, et, par-dessus tout, les principes d’un art fortifiant. La perte de ce centre élémentaire équivaut à l’oubli de «l’abîme béant à l’origine du monde», l’oubli du «silence tendu» (6) au milieu de la sempiternelle nativité du Tout de la réalité, l’oubli, finalement, des filiations primordiales. Sans cela, sans cette conscience de notre provenance, sans cet axe de profondeur, nous nous condamnons à des finalités de perdition, à une déperdition de la vie, à des bruits et à des fureurs qui profanent la concentration du silence originel (dont il faudrait postuler avec Lorentzatos un écho unique en son genre). En dehors ou plutôt inattentifs à ce centre omni-créateur, déliés de ce lien prioritaire et majoritaire, nous ne sommes alors que des égarés, des minoritaires, des corps errants, des âmes vides, des esprits dépourvus de métaphysique et d’imagination, des cultures sans artistes (et des raisons qui ne sont pas raisonnables). Un tel monde frappé d’une telle amnésie ne peut qu’amener des œuvres assorties de la plus épouvantable vacuité, des œuvres privées de gravité, de grâce, des œuvres flottantes, brumeuses, aussi vaporeuses que les algorithmes qui les font exister dans l’appareil des échanges financiers. Par contraste, ce que voudrait sans doute Lorentzatos, c’est la subite résurrection de notre mémoire des archaïsmes, le renouveau de nos facultés spirituelles, en somme tout ce qui rendrait possible la réforme de nos Cités désertées par l’esprit de finesse et possédées par une épaisse barbarie (c’est-à-dire une barbarie qui débute par la justification d’un monde dé-spiritualisé et qui s’achève par la scandaleuse promotion de toutes les œuvres qui avilissent les peuples).
Notes de la première partie
(1) Henri Bergson, Le Rire.
(2) John Dos Passos, Le 42e parallèle, 1919 et La grosse galette.
(3) Francis Bacon, Novum Organum.
(4) Léon Bloy a démoli cette platitude bourgeoise de l’argent censé travailler dans son Exégèse des lieux communs.
(5) Cristina Campo, Les impardonnables.
(6) Zissimos Lorentzatos, Le Centre perdu.





























































 Imprimer
Imprimer