Les Carnets noirs de Gabriel Matzneff (03/05/2012)

Crédits photographiques : Diana Markosian.
«Mais l'évidence qu'elle demeurait absolument étrangère au plaisir qu'elle donnait, éclatait dans l'immuable azur de ses yeux, et, lorsqu'elle levait la tête pour dire : «Mon chéri», dans la puérilité paisible de sa bouche. Elle tenait, voilà tout, à être très aimable, dans le lit, comme elle aurait voulu paraître très bien élevée dans un salon. Elle était aussi très méthodique. Elle mettait certainement quelque orgueil à se montrer savante, tenait à prouver qu'on n'avait plus rien à lui apprendre. Il y avait dans sa façon de faire crier de joie son amant un peu de la satisfaction qu'aurait une écolière à étonner un examinateur en récitant sans faute une leçon très bien étudiée, quoiqu'ennuyeuse peut-être».
Catulle Mendès, La Femme-Enfant, 1891.
 D'une coïncidence qui n'en est pas une
D'une coïncidence qui n'en est pas uneCommençant ma lecture de L'Apocalypse russe, un très bel ouvrage que m'a offert, il y a quelques mois déjà, Jean-François Colosimo, je reçois avec grand plaisir les Carnets noirs 2007-2008 envoyés et dédicacés par Gabriel Matzneff. Nous avons quelques connaissances et mêmes amis communs et pourtant nous ne nous sommes jamais vus. La lecture de ces Carnets noirs m'aura poussé, il y a quelques jours, à lui proposer de nous rencontrer, mais je doute que la lecture de la note qui suivra ce préambule donnera envie à Gabriel Matzneff d'accepter cette rencontre.
Si l'homme, bien sûr, est vraiment aussi libre qu'il ne manque jamais de le souligner et puisque je ne crois pas être ce que les vierges folles qui entourent Marc-Édouard Nabe (et Matzneff lui-même, qui féminise toutefois le terme) appellent un renégat, nous verrons bien...
Gabriel Matzneff évoquant à de multiples reprises Colosimo dans son Journal, l'un et l'autre partageant une sensibilité intellectuelle, artistique et sans doute théologique commune, j'ai estimé ne pas commettre une grande faute en lisant, simultanément, ces deux livres qui brûlent, malgré bien évidemment le fait qu'ils ne traitent point des mêmes sujets et appartiennent à des registres pour le moins différents, d'un même feu que l'on peut prétendre slave ou, plus précisément, orthodoxe. Avançant dans ces deux lectures menées de front, je me suis vite aperçu que les deux auteurs se citaient l'un l'autre (Colosimo désigne, page 205 de son livre, Gabriel Matzneff comme «le capitaine naturel» d'une douzaine d'hommes qui a éprouvé le diable comme présence, Matzneff évoque, lui, le livre de son ami page 240 de ses Carnets noirs, l'un et l'autre invoquent, pour le défendre contre les cons, le grand Soljenitsyne...), mon intuition était donc la bonne.
Cette sensibilité commune, qu'est-elle, sinon une esthétique teintée de préoccupations théologiques, à moins qu'il ne s'agisse d'une théologie n'ayant jamais pu se résoudre à considérer les arts comme une vulgaire béquille ou une échelle destinée à se rapprocher du ciel ? La pureté, du moins l'aspiration à la pureté, n'y est jamais autant magnifiée que lorsqu'elle est tirée vers le bas, retenue, empêchée de s'élancer vers le ciel par la pesanteur de la sensualité, au sens premier de ce mot qui évoque, d'abord, l'orchestre de tous nos sens jouant tour à tour une légère musique de chambre ou une grandiose symphonie. Gabriel Matzneff paraît ainsi persuadé qu'il paie ses bons livres par sa mauvaise vie (p. 239). Ou bien, pour le dire avec Colosimo (évoquant bien évidemment la Russie), dont l'ouvrage pourrait être compris comme la glose, passionnante, d'un des noirs paradoxes de l'âme russe jamais aussi puissamment illustrés que par Dostoïevski, c'est «le pays même, en son absence de limite, qui devient impossible image de l'ineffable et source du sentiment numineux, mêlant l'adoration et la terreur, l'intime et l'inaccessible en unique ferment du religieux» (1).
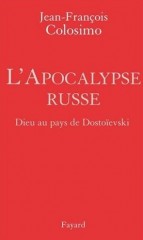 Gabriel Matzneff vit entouré de femmes, qu'il s'agisse de ses maîtresses présentes ou passées (lesquelles, parfois, semblent de plus de chair et de réelle présence que ne le sont ses compagnes actuelles) mais aussi d'amies et pourtant, comme Jean-François Colosimo qu'il voit, dans une église orthodoxe, entouré de sa famille, cette vision provoquant chez l'auteur du Carnet arabe une douloureuse prise de conscience de sa propre solitude, extrême, et pourtant, dans un livre comme dans l'autre, dans celui de l'homme couvert de femmes dont aucune n'est oubliée et dans celui de l'homme entouré de sa famille, c'est la solitude et elle seule qui peut nous servir de cicérone.
Gabriel Matzneff vit entouré de femmes, qu'il s'agisse de ses maîtresses présentes ou passées (lesquelles, parfois, semblent de plus de chair et de réelle présence que ne le sont ses compagnes actuelles) mais aussi d'amies et pourtant, comme Jean-François Colosimo qu'il voit, dans une église orthodoxe, entouré de sa famille, cette vision provoquant chez l'auteur du Carnet arabe une douloureuse prise de conscience de sa propre solitude, extrême, et pourtant, dans un livre comme dans l'autre, dans celui de l'homme couvert de femmes dont aucune n'est oubliée et dans celui de l'homme entouré de sa famille, c'est la solitude et elle seule qui peut nous servir de cicérone. Les pages qui ouvrent l'étude de Colosimo consacrée, après l'Amérique du Nord, à la Russie, sont somptueuses : l'auteur évoque l'âme secrète de l'immense continent, son foyer toujours ardent, quels que soient le régime en place et les persécutions qu'il lui fera subir, l'archipel des Solovski. Dans les Carnets noirs de Matzneff, les allusions à la solitude sont innombrables mais elle paraissent, comme des bêtes féroces, redoubler d'ardeur durant la Semaine sainte. Littéralement, comme en ce jeudi saint ou Matzneff assiste à la liturgie de saint Basile, l'écrivain ne communie pas (p. 72) avec les autres en recevant le corps du Christ : c'est d'ailleurs ce même jour que Matzneff voit Colosimo entouré des siens.
Cette solitude essentielle (p. 87, l'auteur souligne) n'est-elle que celle de l'homme couvert de femmes, celle, surjouée, du dandy qui, affirmant qu'il se moque du milieu littéraire parisien, a ses quartiers dans les cafés et les brasseries où se presse comme par hasard le milieu détesté, celle de l'auteur qui considère comme un devoir de livrer des indiscrétions sur sa seule vie (p. 35) ou bien celle, moins anecdotique, de l'homme dont l'existence, selon une belle image, n'est qu'une «allumette que Dieu craque dans la nuit» (p. 96) ? Parions sur cette dernière, sans doute la plus noble des quatre même si la monodique annotation des ébats sexuels auxquels Matzneff se livre, apparemment à toute heure de la journée, avec Gilda, Marie-Agnès, Anastasia (il y en aurait quatre même, avec Mayssa, disparue subitement selon Matzneff, bien heureusement à mon sens...), nous ennuie plus qu'elle ne nous fatigue très rapidement, comme le refrain d'une ritournelle sotte de Francis Cabrel qu'on aurait malicieusement détournée et qui donnerait, égrillarde : Je te baisais, te baise et te baiserai...
D'un éclair trouant des ténèbres pas franchement noires
Heureusement, à la différence d'un Alexandre Gamberra, bourgeois paltoquet de son état, écrivain sans écriture et même sans queue qui à mes yeux participe de cette mise en scène honteuse, pornographique, considérée comme de l'art, de la violence, de la stupidité la plus crasse, de l'exploration des gouffres volontairement (espérons-le du moins) confondus avec des béances un peu moins profondes, laquelle trouvera toujours quelque imbécile pour nous expliquer son contenu symbolique forcément novateur, à la différence de cet apôtre et de sa ribambelle de clones autofictifs, Matzneff est un écrivain.
Heureusement encore, il y a quelques éclairs de lucidité comme celui-ci, déchirant des pages de très honnête prose, parfois, hélas, d'un copieux bavardage qui n'est, selon le reproche que Matzneff répète un bon milliers de fois à sa pauvre Gilda, que goût pour le solipsisme, moimêmisme indécrottable écrirait Renaud Camus. L'un de ces éclairs est même parvenu à me sortir de ma léthargie en enflammant des mots que j'avais cru consumés, sans réel pouvoir évocatoire, malgré l'évidente facilité d'écriture que Matzneff déploie dans ses Carnets noirs : «Si mes livres me survivent, je serai justifié. Si mes livres sont encore vivants cinquante ans, cent ans après ma mort, je serai justifié. Si mes livres meurent avec moi, je n'aurai été qu'un aventurier» (p. 109). Aventurier voire simple pécheur, sans la moindre grandeur d'âme que confère, au bourgeois le plus prévisible, l'aventure, la vraie. Allons allons, n'employons point des mots qui sentent leur catéchisme, car Matzneff semble écarter d'un revers de la main les paroles, pour le moins dures, qu'il a entendues dans un sermon prononcé à l'église de Saint-Nicolas : «On ne peut servir Dieu dans le péché et dans le vice. [...] C'est vrai concède l'écrivain, mais il est, simultanément, non moins vrai que l'Église est faite pour les pécheurs, non pour les saints» (p. 127).
En somme, puisque l'Église est faite pour les pécheurs, péchons ! Et c'est sur ce point que Matzneff m'a finalement déçu : ses Carnets noirs ne sont absolument pas sombres, noirs ni même ténébreux mais roses, trop souvent même d'un rose pâle et, s'ils pèchent, c'est par l'insignifiance d'une vie désormais hantée par la perspective de la mort que rien ni personne ne semble parvenir à combler. Certes, ces belles pages, parfois réellement touchantes, sont remplies d'une vraie, enfantine dirait-on joie de vivre (les détracteurs de Matzneff affirmeraient, eux, qu'elle ne fait que parodier l'innocence et ils ont raison en grande partie), du rappel des vieilles leçons grecques enseignant le culte de la bonne santé, des plaisirs simples de la vie quotidienne et de l'amitié qu'il faut savoir entretenir comme un jardin foisonnant. Les amateurs de Matzneff me rétorqueront, je n'en doute pas, que s'entend dans ces Carnets la fameuse petite musique de l'auteur, cette ritournelle un peu sotte que l'on déniche toutes les fois qu'un autre thème, plus consistant, plus mâle, est noyé sous des notes sautillantes. Mais où se nichent, cependant, entre tant d'évocations de petits déjeuners, de déjeuners, de dîners dans le tout-Paris que Matzneff connaît mieux que la croupe d'une de ses maîtresses, la tentation du vide, l'horreur de la vie, le dégoût du vice, le désespoir peut-être, l'intensité d'une vie réellement consumée, bref, non point l'élévation vers l'idéal mais l'abaissement vers la fange ? La fange selon Matzneff semble être celle, délicatement parfumée, provenant des charniers serbes ou irakiens : pourquoi ai-je l'impression, lorsque je lis les lignes où vous évoquez des carnages, cher Gabriel, de voir un paon faisant la roue là où un Goya griffonnerait fébrilement l'horreur ainsi dénudée, sans fard ?
Je pourrais commenter à l'infini certains passages de ces Carnets noirs mais il me faut tenter d'en donner une vision d'ensemble. Et cette vision est impossible, pour la raison que le livre, approchant de sa fin, me semble s'alourdir, devenir plus grave, se creuser de la belle pesanteur dont parlait Carlo Michelstaedter. Matzneff, à mesure qu'il écrit ces Carnets, me paraît entrevoir l'issue de son entreprise, même s'il reste bien des années de notes à publier. J'avais ainsi écrit, il y a quelques jours, dépité, exaspéré par tant de coquetterie contente d'elle-même, ces lignes, et je me dois à présent, continuant de lire Matzneff (ce qu'il dit, par exemple, de l'indifférence des intellectuels parisiens aux souffrances des Russes sous le communisme, pp. 358-9, est tout à fait exact), de les nuancer : «Mais où donc se cachent ces notations d'une extrême lucidité qui émaillent le journal d'un Cocteau c'est dire, voire, tout simplement, quelques traits de joyeuse méchanceté ? (2) Mais où trouver dans ces innombrables pages enchaînant les galipettes comme un coureur à vélo les coups de pédale une scène puissamment érotique, comme il y en a tant dans un autre journal (mais imaginaire), cette fois réellement sombre, de Joë Bousquet intitulé Le cahier noir, comme il y en avait tant chez Catulle Mendès qui inventa le personnage de la Lolita bien avant Nabokov et Matzneff ? Mais où dénicher, enfin, une réelle impudeur ? Après tout, et s'il m'est permis de me citer, il y a plus d'impudeur (donc la possibilité de m'exposer à quelque fameuse corne de taureau, selon Michel Leiris) et d'érotisme (je ne les confonds pas), réels ou phantasmés, dans l'un de mes textes que dans les cinq cents pages des Carnets noirs.»
D'une sensualité qui a les yeux bandés, comme celle de Pornocrates
Un point toutefois sur lequel mon jugement n'est pas même tempéré par les belles colères, fort nombreuses, que Gabriel adresse à celles qui l'ont renié et, le reniant, se sont arraché une partie de leur vie. Je ferai donc à l'écrivain le même reproche, peut-être le plus féroce, qu'il adresse à l'une de ses maîtresses : Gabriel Matzneff, dans ce livre, ne se montre absolument pas sensuel au plume et se contente de nous dire qu'il a peu ou beaucoup joui, qu'il a fait peu ou beaucoup jouir, comme il nous confesse qu'il a trop mangé et donc grossi ou bien retrouvé son poids de jeune premier (62 kg) et c'est absolument tout. Même les analyses, appelons-les simplement psychologiques plutôt que romanesques – puisque, nous le savons, ses amantes deviennent des personnages de fiction –, du caractère de ses maîtresses sonnent creux. Gilda n'est ainsi qu'une ravissante et exaspérante idiote obsédée par elle-même, une midinette se promenant apparemment, quelle que soit la météorologie parisienne et le lieu qu'elle arpente, perchée sur ses chaussures à talons extravagants, avec des bouts minuscules de tissu sur le corps ! Certes, mais il y a plus, ou bien cette pauvre fille n'est qu'une plaisanterie et, dans ce cas, lui consacrer des dizaines de pages est une stupidité.
Et puis, Gabriel Matzneff, pourquoi diable s'enticher (je maintiens ce verbe, quels que soient les aléas de votre relation avec Gilda), d'une aussi insignifiante péronnelle si ce n'est pour tenter de l'extraire de son navrant cocon de bavardage et de futilité ? Puisque avez-vous fait de cette insupportable pécore le personnage principal, incontestablement, de vos Carnets noirs 2007-2008, pourquoi la rendre si peu consistante qu'un cachet d'aspirine en chasse le souvenir à jamais (sauf dans votre cerveau) ? Et puis, ne suffit-il point, une bonne fois pour toutes, à un amant, que dis-je un amant !, à un homme qui ne l'est point encore et qui prendrait un verre seulement avec telle possible future maîtresse pour savoir, presque immédiatement, quelles sont les qualités de cette dernière et bien évidemment ses insupportables défauts et tenter ensuite, sans même vouloir absolument mettre cette jeune bécasse dans son lit (ou alors ne l'y mettre qu'une seule fois, c'est bien assez), de les rédimer lentement ou bien que sais-je, de guerre lasse, de rompre, je veux dire, de rompre vraiment, pas de rompre pour quelques jours ou semaines avant de reprendre la molle rengaine des critiques et des figures de gymnastique !
Allons allons cher Gabriel, la lucidité, dit-on, vient avec l'âge et je ne vois, dans tant de vos pages des Carnets noirs, pas beaucoup de lucidité, du moins de celle, la plus terrible, qui s'exerce contre soi-même, ni même de maturité. Coucher avec une femme, mettre quelque sérieux dans cette seule activité (et Dieu sait que l'acte de chair ne peut que bien rarement se résumer à quelques échanges de caresses et de fluides, même si deux ou trois maîtresses s'allongent, par jour, dans votre plume), qu'elle soit stupide ou intelligente, c'est être embarqué, que vous le désiriez ou pas. À vous d'en assumer les conséquences plutôt que de vous plaindre comme si vous étiez un petit garçon privé de dessert à la table de Lipp. Matzneff, rompez donc, et pas seulement les rangs, cela, vous l'avez fait depuis belle lurette et il faut vous remercier de nous offrir votre belle liberté de fauve apparemment jamais rassasié. Mais il faut vous moquer, et plutôt rudement, d'être à ce point entiché de jeunesses le plus souvent décérébrées.
Vous leur tenez lieu de maître, au sens le plus noble de ce terme me direz-vous ? La belle affaire, vous prenez-vous donc pour Socrate ? Que peut donc apprendre une femme de vous quelle n'ait trouvé, si bien sûr elle sait lire, dans vos livres ? Rien. Il n'est même pas certain qu'elle parvienne, en vous connaissant, à mieux vous aimer qu'elle vous aura aimé en vous lisant, certaines rencontres ne valant que d'être imaginées, point vécues parce que, sitôt vécues, elles s'alourdissent du poids de la chair et de la volatilité des humeurs, elles confondent la chair de l'homme avec la chair phantasmatique mais pourtant seule véritablement réelle, de la littérature.
De l'envol, et du départ, et du silence qui est littérature
Gabriel Matzneff, vivez. Vous ne vivez pas. Ce que j'ai lu me fait croire que vous ne vivez pas. Pour vivre, vivre vraiment, il ne vous reste plus qu'à vous débarrasser de vos trop nombreuses attaches charnelles et, en les ayant rompues, en les revivant par la grâce d'un silence plénier, vous les captiverez de nouveau et, surtout, plus jamais ne les perdrez ! Ce sera cela, le palpable et le concret (cf. p. 372). N'avez-vous donc rien retiré de la lecture des mystiques ? N'avez-vous pas gardé en mémoire ces mots d'un gamin (à vos yeux et même aux miens désormais), Jean-René Huguenin qui écrivait dans son Journal ces phrases de feu : «Ce qui caractérise les faibles, c’est moins le goût de l’abdication, du laisser-aller, l’obéissance servile aux moindres désirs, qu’une espèce de penchant fataliste pour le recommencement, un désir d’éterniser, une tragique impuissance à rompre. Ils meurent de ne pas savoir tuer». Cher Gabriel, contrairement à ce que vous affirmez (cf. p. 269), le poète n'a pas, n'a jamais le dernier mot, même Arthur Rimbaud [l'un de mes oncles, selon votre terminologie] (opposé, dans ce texte que vous trouvâtes beau quand je vous le fis lire il y a quelques années, à Ernest Hello), même Arthur Rimbaud n'a pu réellement se taire, le pauvre, voyez l'écho, apparemment infini, que ses sèches missives d'Abyssinie provoquent chez nos contemporains cacographes ! Non ! Car ce n'est pas la littérature, ce ne sont point vos livres, même les meilleurs, qui sauveront de l'oubli et de la ruine vos amours déchues, oubliées, plus sûrement mortes que si elles n'avaient jamais existé. Vous le savez si bien que vous l'écrivez (p. 331) : «Claude-Michel [Cluny] tient son journal, moi le mien, Christian [Giudicelli], lui aussi, prend des notes. Cela nous donne l'illusion de fixer les visages, les baisers, les instants de bonheur, et de vaincre ainsi la camarde, mais comme nous sommes tous les trois d'une lucidité d'airain, nous savons que la victoire de la littérature sur la mort est une victoire à la Pyrrhus, et que nos poèmes, nos romans, nos journaux intimes, même s'ils feront battre des cœurs longtemps après que nous aurons disparu, ne ressusciteront pas les nôtres. Le boulevard du crépuscule est une voie à sens unique : on le descend, mais on ne le remonte pas».
C'est le silence qui, seul, peut-être puisque rien n'est donné et encore moins acquis, pourra constituer une arche, et ainsi non point garantir la Reprise qui a hanté, sa vie durant, un Kierkegaard et un de ses très grands lecteurs, Paul Gadenne, mais sa seule possibilité !
Taisez-vous Matzneff. Entrez dans le silence. Emportez vos belles colères (celle contre une de vos renégates, Aouatife, pp. 414-15) dans les eaux du silence car, oui, vous le savez mieux que quiconque, vos livres non seulement ne servent à rien (cf. p. 491), mais ne vous sont d'aucune utilité. Ils vous enchaînent. Vous êtes, comme Thibaud de la Jacquière, en train d'étreindre un corps pourri, sans même paraître vous en rendre compte ! Oubliez-vous, oubliez même, cela est plus difficile, voyez Bernanos qui cessa d'écrire des romans pour se consacrer à des textes polémiques, oubliez même vos créatures de papier (cf. p. 402) qui paraissent vous hanter comme si elles étaient les goules grimaçantes d'un mauvais rêve. Emportez dans votre silence toutes ces femmes que vous avez aimées sans relâche et que vous avez finalement si peu aimées puisque vous avez brûlé votre corps à d'autres corps que ceux de vos maîtresses favorites. Tuez-vous, Matzneff, tuez-vous véritablement, je veux dire, certes pas en suivant la leçon scrupuleuse de votre maître Sénèque ! Le suicide, fût-il inspiré par la haute geste stoïcienne, ne libère d'absolument rien mais enchaîne l'homme qui se tue (et que dire des proches qui lui survivront) dans le cachot de la fatalité. Tuez-vous vraiment, et ce songe suicidaire s'évanouira comme neige au soleil. Tuez-vous, arrachez de votre chair dont vous prenez un soin ahurissant, maniaque, ridicule, cette diabolique écharde qui vous paralyse et vous cloue à une roue et non à une croix de plaisirs aussitôt évanouis que prodigués ou reçus ! Tuez le vieil homme, débarrassez-vous de cette vieille peau qui paraît plus fine que celle d'un nourrisson, de cette mémoire plus vieille et épaisse que si elle appartenait à un de ces hommes fabuleux hantant les débuts de l'histoire selon la Bible (et qui finissent piteusement, voyez les immortels de Borges), larguez les amarres (n'avez-vous pas répété, à l'envi, Navigare necesse est, vivere non necesse) et surtout, surtout, ne vous retournez pas, celles et ceux qui se retournent sont maudits ! Ce sera alors, pour vous puisque je me moque de vos lecteurs dont certains paraissent à tout prix, sachant même qu'ils en souffriront inévitablement, vouloir devenir tel ou tel de vos personnages, ce sera alors, mais cette fois-ci réellement, l'apothéose du déracinement comme l'écrivait Chestov !
Vous avez peur mon cher Gabriel, et ne devriez pas avoir peur. Vous avez peur parce que vous êtes incapable de vous défaire de cette ultime idole, la plus précieuse et exigeante, cette maîtresse très fidèle, la plus fidèle que vous ayez connue, celle pourtant que vous n'avez jamais touchée, pas plus qu'un autre écrivain : la littérature. Relisez le livre de Colosimo qui écrit (p. 207) : «Sainteté, perdition : la polarité c'est l'homme». Vous n'êtes ni dans l'une ni dans l'autre mais dans le rêve de l'une et la nostalgie (le plus clair de votre temps : l'ignorance) de l'autre. Élancez-vous Matzneff, décidez-vous à le faire (et la «sainteté, c'est la décision», cf. p. 344), abandonnez une bonne fois pour toutes l'Europe aux si vieux parapets, vous en connaissez chaque troquet, chaque rue, mieux que si vous ne les aviez arpentés durant des siècles, embarquez-vous, c'est un gamin, moi à vos yeux, qui vous l'écris parce que vous ne faites rien d'autre dans ces Carnets moins noirs que crépusculaires, moins crépusculaires que mélancoliques, hélas, que de mourir à petit feu, ce qui n'est pas vraiment vivre, ou vivre si peu, ou alors vivre avec la claire certitude que vous vous perdez en vous conservant intact, étrange et touchant monstre dont la mémoire paraît sans faille, dont le corps est une prison et la langue un poids mort, insupportable, elle qui a tant servi à écrire, à parler, à embrasser. Je n'affirme pas, connerie pas même véritablement nietzschéenne, que vous aurez bouclé, alors, la boucle, puisque ce départ serait renaissance, naissance véritable et non point grotesque recommencement ou retour. Ne visitez pas, comme tel personnage du Soleil de Satan de Bernanos (Antoine Saint-Marin je crois), la cellule misérable du saint de Lumbres, en espérant y découvrir le choc vital qui lui fera de nouveau goûter l'écriture, devenez-le, ce saint ! (3).
D'un écrivain qui se confesse, d'un théologien qui ne l'absout pas
Les lectrices, les lecteurs de Gabriel Matzneff, et Dieu sait que, comme il en va pour Marc-Édouard Nabe, ce type d'écrivain nourrissant sa littérature des événements les plus intimes de sa vie personnelle qu'il expose par ailleurs dans un Journal, peut susciter de réactions hystériques, me reprocheront sans doute de n'avoir point vu les innombrables subtilités qui émaillent ses Carnets noirs, les constantes et très fines allusions à tant de ses livres, d'être passé outre la critique que Matzneff adresse lui-même à ses lecteurs (des crétins dit-il d'eux, p. 192) lui reprochant d'être monotone, bref, de n'avoir point suffisamment tendu l'oreille pour écouter sa petite musique. Peut-être, oui mais je tente de critiquer ce volume des Carnets noirs comme un ouvrage en soi ce qui, tout compte fait, est bien plus difficile que de le disséquer en l'étalant au milieu d'autres cadavres de livres. Et puis, faut-il avouer que je ne suis pas, à franchement parler, un matznévien endurci, encore moins béat, cette dernière catégorie constituant, de fait, la pire engeance lorsqu'il s'agit de juger un texte littéraire, mais je n'ai aucune gêne à affirmer que je trouve tout de même certains de ses textes polémiques d'une autre envergure que ces, paraît-il, impudiques Carnets noirs.
Je ne puis, quoi qu'il en soit, pardonner une chose à l'écrivain de grand talent qu'est Gabriel Matzneff : la rareté de ses réflexions sur l'écriture et sur la littérature et je ne m'étonne à vrai dire même pas de constater que c'est bel et bien dans l'essai théologique et politique de son ami, Jean-François Colosimo, que j'ai trouvé de remarquables passages consacrés à la littérature, singulièrement aux exemples de Dostoïevski anticipant le cas de Netchaïev et de Nietzsche qui, avant de sombrer dans la folie, a rejoué l'une des scènes imaginées par le génial romancier. Je recopie ce long passage du livre de Colosimo : «Puissance prédictive de l'écrivain en tant qu'artisan du prévisible ? Singulière lucidité que l'épilepsie devrait au «haut mal» au mal sacré dont il a donné l'une des plus saisissantes descriptions cliniques ? Intempestivité critique, plutôt, du philosophe (du seul vrai philosophe russe, selon Berdiaev) ? Ou simplement charisme du prophète ? Comment savoir ? Avec Dostoïevski, l'on hésite forcément, tant le roman s'impose, au-delà de la littérature, comme la continuation de l'Histoire sainte par d'autres moyens. Théologien, alors ? Oui et non. Oui, si l'on se souvient que la première théologie, biblique, est narrative. Non, si l'on admet que le romancier échappe à l'apologétique. Théologien politique, peut-être ? Non, sauf à considérer que l'exercice vaut par son inévitable faillite, que la meilleure réaction intellectuelle se retourne en avant-garde esthétique – comme le montreront à la suite Eliot, Pound, Céline, le Bernanos de Monsieur Ouine (4), et Mishima. Disons plutôt : porte-parole du Tiers-exclu, du Dieu assassiné, de l'encombrant cadavre paternel autour duquel se presse, convulsive, tourbillonnante, l'humanité rendue à elle-même et elle-même à l'agonie, dont il se fait en retour le greffier pour compiler, dans toute sa textualité, l'évangile nihiliste» (5).
C'est dans le chapitre suivant (pp. 195-6), intitulé Peuple criminel, nation théophore, que Colosimo, sans bien sûr s'en douter (est-ce si sûr ?), nous donne la clé de l'énigme matznévienne en poursuivant son analyse des romans de Dostoïevski et en évoquant sa figure centrale, le Christ bien évidemment. Il écrit ainsi : «C'est là où, pour [l'écrivain russe] qui ne fait que suivre la plus stricte orthodoxie, la foi suppose le renoncement à la croyance, le choix de Dieu sa désertion, et l'union la séparation. Retournons au peuple russe qui sait cela, même s'il ignore comment il le sait et ne sait pas le dire autrement que par sa vie, cela même que les Chappe, Corberon, Masson, Georgel [des contempteurs de la Russie qu'ils ont visitée] avaient noté sans le comprendre (les assassins, les adultères, les prostituées qui se signent avant d'agir, qui connaissent le Christ exalté dans les cieux comme le Christ descendu aux enfers).»
N'y aurait-il pas, ainsi, comme occultée, dans ces Carnets noirs, une position de Gabriel Matzneff que nous pourrions dire christique, dans son refus même, parodique ou plutôt anti-christique, de la douleur et de la souffrance, de la solitude et de l'abandon ? Ce n'est là qu'une hypothèse de lecture (6) mais c'est la seule, je crois, qui sauve la vie de Matzneff d'un marivaudage qui n'a même pas la grandeur du péché et confère un peu de dignité aux dernières années, dorées par le soleil couchant des magnifiques souvenirs et des corps étreints, d'un écrivain.
Ce que Gabriel Matzneff attend et ne nomme pas, cela ou plutôt celui qui serait le seul capable de lui apporter «quelque chose d'inattendu, de captivant» (p. 177), de résumer en les glorifiant la multitude des femmes aimées dont le souvenir, parfois cruel, parfois bafoué et renié par celles-là mêmes qui furent aimées de l'écrivain, menace de le faire exploser (cf. p. 175), c'est le Christ consolateur. Le seul problème, mais de taille est que, si j'en crois Jean-François Colosimo (7), pour les chrétiens orthodoxes, le miracle, une bonne fois pour toutes, s'est non seulement accompli en s'incarnant mais reste présent pour qui veut ouvrir les yeux.
Espérons qu'un peu d'eau, peut-être celle de Siloé plutôt que celle de la mer de Phénicie (8), ouvre les yeux de Gabriel Matzneff, qui a vu tant de choses et ne voit finalement pas cela seul qui compte : s'oublier.
Notes
(1) L'Apocalypse russe. Dieu au pays de Dostoïevski (Fayard, 2008), p. 147. Ce livre, édité par Fayard, m'a été offert et dédicacé par son auteur. Jean-François Colosimo, qui a un réel talent d'écrivain, devrait ne pas trop le gâcher en jouant au journaliste qu'il n'est, fort heureusement, pas. Je fais référence à cette bizarrerie stylistique répétée, dans ce bel ouvrage, un bon millier de fois, consistant à poser une question artificielle pour préparer une réponse qui ne l'est absolument pas.
(2) Comme celle-ci, écrite à la date du 15 février 1956 : «Julliard devrait mettre au point le poème prénatal. Le docteur colle son oreille au ventre de la femme enceinte. Peut-être pourra-t-il recueillir quelques vagissements de bonne vente», Jean Cocteau, Le Passé défini, Journal, t. V (Gallimard, 2006), p. 61.
(3) Je ne sais plus vraiment dans quel dépotoir (ah si, mais comme j'ai dit que je n'évoquerai plus cet éditeur-blogueur...) j'ai lu le commentaire d'un verbeux crétin qui a cru bon de faire remarquer que j'avais conclu mon article sur La Possibilité d'une île de Michel Houellebecq par des bondieuseries (sic) alors que mon texte, débordant bien évidemment le cadre étroit de la seule critique littéraire, va au fond des choses en constatant que, à moins de se répéter (ou de basculer entièrement dans la science-fiction), Michel Houellebecq ne peut écrire une suite à son dernier roman. Il est vrai que la voie dite littéraire suivie par un autre romancier, Maurice G. Dantec, dont j'avais annoncé le retour à la foi, aurait dû m'inciter à plus de prudence... Peu importe, si l'office du critique littéraire est celui de la vigie selon Sainte-Beuve, il faut donc indiquer le cap et pas seulement annoncer ce que tout le monde ou presque a déjà vu, n'en déplaise aux imbéciles pour lesquels Genette est né et a écrit.
(4) Cette remarque est bien sûr profondément fausse. Aucune «avant-garde esthétique» dans le dernier roman de Bernanos et encore moins de faillite inévitable. Montrer le Mal, c'est justement montrer qu'il n'est pas, ce que Bernanos a su faire mieux que tout autre avec Monsieur Ouine.
(5) Jean-François Colosimo, op. cit., pp. 176-7.
(6) Certes confortée par de nombreux passages où Gabriel Matzneff évoque sa solitude de plus en plus réelle, dramatique, le fait aussi qu'il a, aux yeux de la société, raté sa vie (cf. p. 177).
(7) Colosimo, pages 216-217 de son ouvrage, oppose le «temps messianique [catholique], de l'attente à combler, sous le signe de l'action et le contre-temps eschatologique [orthodoxe, d'une eschatologie réalisée, l'auteur souligne], de la pleine présence, sous le signe de la contemplation».
(8) Voir Le Carnet arabe (La Table ronde, coll. La petite vermillon, 2007), p. 217.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, gabriel matzneff, carnets noirs, jean-françois colosimo, l'apocalypse russe, éditions fayard, éditions léo scheer |  |
|  Imprimer
Imprimer