« Contamination de Sarah Vajda : Mouchette fiancée de Ian Curtis | Page d'accueil | Charlie Hebdo en procès, une chronique de l’intégrisme ordinaire, par Jean-Christophe Moreau »
29/01/2007
Apologia pro Vita Kurtzii, 4 : Le jour de la colère de Dieu de Jean-François Colosimo

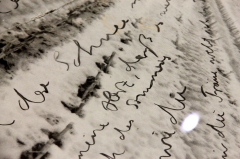 Apologia pro vita Kurtzii.
Apologia pro vita Kurtzii.Voici un article que je fis publier dans un numéro paru en 2000 de la revue Liberté politique que dirige Philippe de Saint-Germain. J'ai jugé bon de mettre en ligne ce vieux texte évoquant l'étrange et peu connu roman (Le Jour de la colère de Dieu, éditions Jean-Claude Lattès, 2000) de Jean-François Colosimo, écrivain, théologien et analyste politique de quelque culture historique. Le prochain chapitre de cette série intitulée Apologia pro Vita Kurtzii sera consacré au tout dernier roman de Cormac McCarthy, No Country for Old Men.
Quel a été, avec ce livre sec, tendu, aride, noueux comme un sarment dont les racines tenteraient de boire l’eau profonde du désert, quel a été le propos de Jean-François Colosimo ? Certainement pas, lui-même nous en avertit, de livrer à un public friand, une fois de plus, une de ces mauvaises reconstructions journalistiques qui choisissent l’horreur, le crime, l’insupportable du torve et de l’oblique qui louche son sourire avide vers un lecteur hérissé d’un plaisir ridicule. Quoique, en dressant dans son livre même la stature infatuée et, au fond, pathétiquement naïve de Morlay – on songe ici à l’un de ces hommes intelligents et creux, enflés par la prétention du vide, au M. de Clergerie de Bernanos –, pour lequel les raccourcis théologiques que l’auteur applique à l’histoire du curé d’Uruffe paraissent les ineptes constructions mentales d’un esprit arriéré, lui qui préfère, afin d’expliquer l’acte monstrueux du curé fornicateur, les platitudes journalistiques, Colosimo prévient et met en garde : son œuvre, Le Jour de la colère de Dieu, à la fois roman (mais roman bizarre, contrevenant aux normes du romanesque) et gigantesque «minute» accaparée par la redite inlassable de voix invisibles qui bataillent dure dans l’âme du curé infanticide, se moque comme d’une guigne des explications précises, c’est-à-dire, finalement, abstraites (ab-trahere, tirées hors du réel) : «Je ne menais pas une enquête, je ne dressais ni un réquisitoire, ni une plaidoirie», nous avoue ainsi le narrateur (p. 32). Ce réel, cet unique visible pourtant invisible et que la prose est, a priori, incapable de capter dans son essence volatile et secrète, c’est l’âme du curé volage, dont il s’agira toutefois de transcrire les effrois et les doutes en obtenant de la lecture des textes bibliques (la lectio divina), une espèce de sténographie palimpseste : «Mais de la confession du curé d’Uruffe, nous avertit Colosimo, de sa confession à son Dieu, pour autant qu’il la livrât, il n’existe, comme il se doit, nulle trace écrite dans aucune archive» (p. 12).
C’est une évidence et, bien sûr, un leurre que celui qui tente de comprendre, par l’effort réel de la sympathie, l’âme du personnage sur lequel il écrit, déclare tout à la fois son incapacité prétendue et son extrême avidité : en déplaçant la quête de l’âme prisonnière du curé infanticide vers la sphère de compréhension théologique, plutôt que de se perdre dans les truismes imbéciles des explications sociologiques ou, pis, psychologiques, Colosimo nous égare pour mieux, à la dernière page de son livre, nous rassurer : l’enquête qu’il a menée brillamment est aussi, est d’abord une tentative de vision et de sympathie, je l’ai dit, de l’âme malade et désespérée : «Il fallait que fût un tant soit peu connue la peine infernale de […] Desnoyers, curé d’Uruffe, menteur, parjure, fornicateur, adultère, homicide, infanticide, sacrilège et blasphémateur, frère humain, enfant de Dieu, captif du Démon» (p. 267).
L’ombre de Bernanos
Ainsi, tout à la fois, l’auteur se rapproche-t-il et s’écarte-t-il de l’exemple fourni par l’œuvre de Bernanos. Il s’en approche, bien évidemment, par le sujet qu’il a choisi de traiter – même si je crois que Bernanos, confronté à pareil exemple, l’aurait abandonné aux bons soins des experts en psychologie dévoyée – qui, trop visiblement encore, pour quelqu’un qui professe la disparition d’un Mal sous sa forme romantique, grandiloquente, convoque les puissances de la nuit. Il s’en approche aussi par le refus de la réduction prétendument explicative de la psychologie. Mais il s’en éloigne radicalement, de sorte que le fait de comparer l’intention et le style de Colosimo à ceux de Bernanos est, finalement, une bêtise de journaliste : jamais l’auteur de La Joie n’aurait osé, si facilement, si… naturellement, convoquer la théologie ou l’hagiographie, par exemple à propos du dogme de l’Enfer, ou encore en insérant dans son texte ces légendes dorées que sont les deux histoires de Xénia et d’Évagre, chargées d’édifier le curé adultère. On me répliquera, sans doute : épuisement de la littérature dans son essence romanesque, défaut de l’imagination, que sais-je encore, intertextualité savante, déjà illustrée par une foule d’écrivains comme John Dos Passos, James Joyce ou Ezra Pound ? Oui, mais ce n’est qu’en partie seulement que ces explications sont valables, car nous sommes à l’âge où la littérature, de haute lutte, a investi tous les domaines des discours et des savoirs, a capté toutes les voix et s’est accordée à leur chant propre (ainsi des variations de style dans la prose de Colosimo), s’est mêlée de ce qui la regardait (au sens propre, puisque la théologie a toujours puisé dans l’extraordinaire vivier d’exemples que lui fournissait, pour sa réflexion, la littérature) et, peut-être, a même décidé de remplacer la théologie, bien percluse, depuis l’œuvre d’un Hans Urs von Balthasar, dans les bourbiers stériles d’une réflexion boutiquière. À moins que, tout simplement, fidèle à sa mission ancestrale, après la déferlante saumâtre de tous les invertébrés du Nouveau Roman envasés dans la flache de l’insignifiance, cette littérature, moins nouvelle que ne craignant pas de considérer ses propres racines comme un trésor inépuisable et chatoyant, revigorée par un sang et une ardeur nouveaux, ne décide d’arpenter crânement son territoire immense, à vrai dire, illimité.
Le diable, signe de Dieu
J’ai parlé de l’âme du curé. Elle seule, certainement, est réelle. Ne parlons pas de sa motivation ou de la compréhension qu’il manifeste de ses actes odieux : à la fois «menteur, parjure, fornicateur, adultère, homicide, infanticide, sacrilège et blasphémateur», le curé d’Uruffe rejoue la pièce, mais, cette fois, dans l’arrière-salle d’un opéra-bouffe, où un Gilles de Rais a acquis, pour des parterres entiers de siècles dont Huysmans se fera la grosse caisse avec son Là-bas, sa réputation démoniaque. Quasiment, le curé d’Uruffe est un imbécile, trop mal noté par ses supérieurs – ainsi du Donissan du premier roman de Bernanos – dans les matières théologiques. Mais, invisible, l’âme de Desnoyers laisse derrière elle une écume rouge que le romancier pourra facilement suivre, puisque, selon l’auteur, la seule façon, la seule vraie façon de tenter de comprendre cette histoire sordide, c’est d’en faire un signe, de la lire comme l’enquêteur de Poe déchiffrerait une lettre volée, pourtant exposée aux yeux de tous. Identiquement, Durtal, dans le roman de Huysmans, suit patiemment la trace sanglante laissée par le compagnon de la Pucelle, pour déclarer sa stature insurpassable dans les matières noires, alors que le présent de la vie parisienne lâche un dernier jet de vigueur parodique dans des orgies de carton-pâte. Colosimo, lui, n’a plus que le présent, fade, sans grandeur, dépossédé de toute volonté, réelle, de satanisme, du rire altier de Melmoth qui était, selon Baudelaire, le type même de la beauté virile. Le curé fornicateur est ainsi un monstre, c’est bien évident, mais l’auteur a soin de nous rappeler que le sens étymologique de ce mot le range dans l’une de ces catégories, complexes et ambiguës, qu’une pléthore de manuels démonologiques du XVe et du XVIe siècles (et que Pierre Boutang, dont Colosimo fut l’élève, retrouvera dans son Ontologie du secret) déclaraient, quoique inversées, être le miroir en creux d’une réalité bonne, dont le chiffe énigmatique était Dieu. Le diable, même engoncé dans les paletots délavés de Ouine ou du héros de petite envergure de Sologoub, renvoie à Dieu, comme le faciès d’un singe au visage d’homme qu’il mime grossièrement, dont il constitue la grimace, proche et lointaine, justement terrible par cette contradiction familière. L’auteur le dit, ayant collecté les histoires d’Abraham, d’Osée ou de David, auxquels, parodiquement, chantant sur et contre les versets sacrés son chant inepte et dérisoire, le curé d’Uruffe est greffé, puisqu’il «les détournait, les transformait, en exploitait les éléments mineurs, disparates, quoique récurrents il était vrai, de transgressions, désordres sexuels et homicides, qu’il déformait, liait entre eux selon une causalité extrême, et pliait à une logique univoque du châtiment. Aucun des éléments, à proprement parler, n’était erroné. Mais l’ensemble était faux, contredisait la Bible, et soustrayait sa véritable biographie. Il s’agissait en fait d’une antibiographie cousue en coin d’une antibible» (pp. 136-137). Cette forme d’écriture contrapuntique, cette illustration, en même temps que réécriture du texte biblique fut familière à William Faulkner qui, dans son Absalon, Absalon !, a utilisé et dévoyé l’histoire du fils de discorde, incestueux et meurtrier. Dans le roman de Colosimo, le reste d’Israël, cette semence très précieuse dont Isaïe annonce la gloire future, est abolie, biffée, moins détruite par une présence mauvaise que tout bonnement avalée par la fadeur du siècle, à moins que, tout bonnement encore, l’enfant éphémère de Desnoyers (éphémère mais immortel par le baptême que lui donne son ecclésiastique de père) ne soit l’épiphanie de ce reste, aussitôt abolie que née.
Le visage moderne de l’Enfer
J’ai parlé, à propos du crime du curé, de signe. Il y a toutefois une ambiguïté quant au signifié auquel ce dernier renvoie. C’est que le diable s’étant affublé, au XXe siècle, de la triste défroque de la médiocrité et de l’horreur de masse (lourde autant que stupide, ce sont là les deux caractéristiques de la foule qui s’ennuie (1)), il n’est plus certain, il n’est plus évident que le crime odieux du curé d’Uruffe renvoie à un Dieu de charité, celui-là même qui fit plier la volonté malade de Gilles de Rais et, la faisant plier, le sauva de la damnation, certes pas des flammes de son bûcher. Je ne parlerai pas de la sempiternelle «mort de Dieu» que le plus écervelé de nos journalistes se permet de citer et d’accommoder à toutes les sauces du rabâchage aigre; notons-le, Colosimo penche pour ce type d’explication, l’infléchissant toutefois (pour la critiquer durement) vers une interprétation toute maistrienne, où le sang du sacrifice est élan immonde vers le Dieu inapprochable et meurtrier difforme, selon l’auteur, par l’exagération toute protestante du dogme du péché originel (cf. p. 264 : «L’homme avait tué Dieu dans son dépit de n’être pas Dieu. Par le sang, il expiait ce meurtre»). Également, au miroir déformant de la colère, l’histoire du curé d’Uruffe a valeur, pour le romancier, de symbole pathétique et cruel du Mal de notre siècle, vicié, selon la phrase superbe de Chesterton, d’idées chrétiennes devenues folles : «La foi de Desnoyers n’existait pas, ou seulement folle, inversée, dévoyée. Elle s’assimilait à un autre dévoiement, celui des systèmes de vérité sécularisés, des théologies cachées, sans Dieu et sans transcendance, qui n’avaient cessé de revenir depuis la proclamation de la mort de Dieu, où la nécessité de l’enfer l’emportait pareillement sur la figure de l’homme, mais qui se révélait infiniment plus meurtrières que n’importe quelle théologie d’hier. De la même façon que Desnoyers ne connaissait son crime que par les clichés qui lui étaient montrés, l’homme ne savait plus le mal que par les images des massacres qui se succédaient» (p. 217).
Cette explication reste pourtant superficielle, car le doute que l’auteur distille est autrement plus profond, scandaleux (puisqu’il nous fait entrevoir l’âme de l’écrivain, comme un miroir nous renvoyant notre propre visage, comme une pierre d’achoppement sur laquelle nous pourrions trébucher), je crois même qu’il n’en a découvert, vraiment, réellement, c’est-à-dire romanesquement, la racine noire et tortueuse qu’en écrivant ces pages, pourtant chargées d’apporter quelque réconfort au curé adultère. Pathétiquement, une première fois, il avoue sa crainte, et, peut-être, sa certitude terrible : sur la croix, le Christ était athée. Plus loin, il tente d’expliquer cette phrase, qu’une première lecture nous fait croire blasphématoire. Peu importe cette explication (cf. p. 227 à 232, où le Christ est déclaré trahi par ses Églises), qui, à mon avis, est superflue, puisqu’elle enrobe le paradoxe absolu d’un Dieu abandonné par son Père d’une praline rationnelle. Oui, sur la croix, le Fils de l’homme était athée, offert en sacrifice, agneau blanc que ne remplaça, comme pour Isaac, aucun bélier providentiel, Fils que, d’une certaine façon toute symbolique, le Père grima (c’est l’un des sens du mot Messie, c’est-à-dire l’Oint, le «peinturluré») pour la parade sur le Golgotha, flagella et, Lui-même, crucifia (afin, comme certains Pères orthodoxes le disent, que le Bourreau fût capturé par l’hameçon divin), comme Desnoyers a défiguré le visage de son enfant, l’a tué, l’a souillé en souillant sa mère, l’a crucifié en tuant sa mère, l’ayant crucifiée : «Création, incarnation, rédemption. Les trois, éradiquées, il n’y avait plus de salut. Non seulement le curé d’Uruffe avait offert “le prix outrageant au Diable” mais encore il l’avait offert comme si “le Diable l’avait reçu de Dieu lui-même”» (p. 216).
Impatience surnaturelle
Quel espoir reste-t-il alors, pour que Desnoyers ne tombe pas en Enfer ? Rien de moins, c’est le sens du titre, que le retour de Dieu, la parousie du Fils revenu sur terre, de nouveau corps de chair et de gloire, pour juger les bons et les méchants : «Sa faute [celle du curé] apparaissait irrémissible. L’impossibilité de la remise accompagnait celle du pardon. Ses victimes détenaient tout de ce pouvoir, et nulle autre personne sur terre. […] Pour qu’advienne le pardon, afin que l’ultime triomphe ne revienne pas au Malin, pour que soit renversée la logique du sang, il fallait Dieu, mais un Dieu dont la transcendance ne craigne ni la chair, ni la mort et encore moins l’offense. Celui que Desnoyers avait cru extirper d’un ventre de femme» (p. 265).
En somme dans ce roman, c’est, mais inversée, avortée, l’histoire de Mouchette, grosse d’un enfant qui ne parvient pas à naître, comme un peu de fumée du Démon incapable de s’incarner : le tribut sera payé par Donissan, agneau consentant de l’holocauste propitiatoire. Dans le roman de Colosimo, où pourtant s’incarne le fils, un instant, du Démon, nul ne paie ce lourd tribut, ni les victimes de la folie du curé, ni même, bien évidemment, ce dernier, ni même l’auteur du roman (dont les yeux brûlent d’un regard inquiet, dont l’anxiété dévore, (p. 238), qui me semble, d’une certaine façon qu’il ne m’appartient pas de sonder, enfermé lui-même dans la geôle de l’hermétisme) auteur qui, certes, va plus loin que Morlay dans sa tentative de délivrance ; identiquement, aucun saint ne se présente, même si leur complot pour sauver les damnés est annoncé dans la dernière page du livre, pour, selon la parole sublime de saint Dominique (ad in inferno damnatos extendebat caritatem suam), ne pas craindre d’offrir son âme en échange du salut du pécheur, aucun saint ne paraît, écumant et tout recouvert de l’ordure du péché de l’autre, Xénia ou Evagre, dont les histoire dorées n’émaillent le texte du Jour de la colère de Dieu que pour signifier la profondeur de la chute de Desnoyers dans les eaux troubles du péché.
Et le Christ ? Je crois qu’il faut lire dans ce roman l’impossibilité, pour Desnoyers, de participer à l’agonie sur la Croix (cf. pp. 140-141) d’une façon rien moins que véritable, non pas symbolique mais charnelle, participation qui, si elle se réalisait, signifierait le pardon et le rachat de l’âme du meurtrier (2). Ainsi, peut-être que la colère dont nous parlent les pages fiévreuses du roman de Colosimo est-elle chargée de signifier une mystérieuse absence, que l’on aurait tort, je crois, de trop vite confondre avec je ne sais quelle tentation apophatique : d’un côté, une peine irrémissible, absolue, jamais atténuable, puisque l’atténuation proviendrait de Celui qui, justement, ne revient pas, et ne peut revenir, de Celui que, à tort (c’est tout le sens de la longue explication que l’auteur donne de l’erreur de traduction ommise sur l’Épître aux Romains, 5, 12, p. 203 et sq.), en ayant décidé de Lui immoler une victime innocente, le curé pensera agréer, dans la crainte et le tremblement de la doctrine augustinienne de la transmission héréditaire du péché – peine, donc, irrémissible, absolue, jamais atténuable, consacrée par l’onction surnaturelle dont est revêtu le prêtre qui, en sacrifiant son enfant, sacrifie de facto et à jamais le Christ «sur une route de Meurthe-et-Moselle» – peine irrémissible, absolue, jamais atténuable, précieusement gardée par une Église qui n’a que très tardivement atténué l’excessive violence de son discours sur le péché et la rédemption – d’un côté, cette peine irrémissible, ainsi décrite et, de l’autre, une absence perpétuelle, ou, tout du moins (mais ce doute tue et crucifie, une nouvelle fois, le Christ sur la Croix), la tentation de penser que l’absence sera définitive, perpétuelle, puisque le Christ ne peut sauver l’âme qui s’est damnée par sa propre volonté démoniaque, ayant rendu au démon, à son père, au Père du Mensonge, ce qui réellement et de droit lui appartenait.
Je crois bien que la vraie question que pose cet ouvrage zébré d’une impatience surnaturelle est celle-ci : comment sauver celui qui s’enferme dans son désespoir ? Comment sauver le méchant, comment tenter de rédimer sa faute, contre sa propre volonté hermétiquement close ? Et la réponse, murmurée, quel que soit le résultat de la folle gageure : jamais un homme, dont le cœur tressaille «de porter au-dedans tout le cosmos et toute l’histoire», qui bat «d’attendre une autre lumière», ne pourra admettre d’abandonner aux ténèbres un de ses frères, frère humain, enfant de Dieu, captif du démon.
Notes
(1) Rappelons que, selon Kierkegaard, l’ennui est l’une des caractéristiques du démoniaque : «Le démoniaque est le vide, l’ennui. [...] Cette continuité en pendant au subit est ce qu’on pourrait appeler le tarissement. Car l’ennui, le tarissement sont de la continuité dans le néant. [...] La liberté, tranquille dans sa continuité, a pour contraste le subit [...].», in Le Concept de l’angoisse (Gallimard, 1990, coll. Tel), p. 303.
(2) Voir, par exemple, ce que dit Athanase d’Alexandrie sur ce sujet : «Mais depuis que le Sauveur a ressuscité son corps, la mort n’est plus effrayante, tous ceux qui croient au Christ la foulent aux pieds comme une chose qui ne compte pas et ils préfèrent mourir plutôt que de renier la foi au Christ.», in Sur l’Incarnation du Verbe (Cerf, coll. Sources Chrétiennes, n° 199, 1973, 27, 2), p. 363.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, roman, démonologie |  |
|  Imprimer
Imprimer




























































