Prélude à la délivrance de Yannick Haenel et François Meyronnis (09/04/2009)

Crédits photographiques : Sebastian Widmann (AFP/Getty Images).
Yannick Haenel et François Meyronnis, Prélude à la dél... Pardon, non : Juan Asensio bien sûr, Maudit soit Andreas Werckmeister !
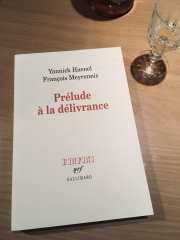 À propos de : Yannick Haenel et François Meyronnis, Prélude à la délivrance. Un volume de 214 pages, paru aux éditions Gallimard dans la collection dirigée par Philippe Sollers, L'Infini, 2009 (LRSP, livre reçu en service de presse. Les pages entre parenthèses renvoient à cette édition).
À propos de : Yannick Haenel et François Meyronnis, Prélude à la délivrance. Un volume de 214 pages, paru aux éditions Gallimard dans la collection dirigée par Philippe Sollers, L'Infini, 2009 (LRSP, livre reçu en service de presse. Les pages entre parenthèses renvoient à cette édition).Curieuse déontologie dite critique du trouillard qui signe cette rinçure moins consacrée au livre de Meyronnis et Haenel, qu'il n'a bien évidemment pas lu, qu'à l'article aussi pompeux que creux, en effet, que Bernard-Henri Lévy a écrit pour en claironner tout le bien qu'il en a (non-)pensé.
Je suis scandalisé par une telle façon de faire, surtout si celui qui se cache derrière ce blog n'est autre que Bernard Quiriny, vague critique littéraire officiant dans une feuille de chou non moins insipide désormais delaruellienne (1), alors que ce livre écrit à quatre mains, Prélude à la délivrance, malgré des défauts aussi évidents que nombreux dont je moquais fort méchamment l'accumulation dans une série de notes consacrées à l'un des plus mauvais livres que j'ai eu la malchance de lire (2), n'est absolument pas mauvais, moins mauvais même que ne l'indique Fabienne Dumontet dans son article.
Certes, le lecteur ne doit pas se laisser rebuter par une prétention himalayenne, probablement apprise grâce aux très aimables leçons de ce premier de cordée de la suffisance qu'est Philippe Sollers : en clair, à lire ces deux-là, nous avons l'impression qu'eux seuls (oui, ils en oublieraient même de citer l'intrépide Philippe !) connaissent, voire simplement ont lu Melville, Rimbaud, Lautréamont ou même Heidegger et Nietzsche.
Certes, le lecteur ne doit pas être incommodé par un religieux, pas même, un sacré de fête foraine qui mélange tradition chrétienne, gnostique, taoïste, bouddhiste, kabbalistique et (enfin !) hindouiste ni même partir d'un grand rire lorsque nos Romulus et Rémus des lettres françaises se campent en nouveaux mages aux pouvoirs aussi impressionnants que mystérieux (et, avouons-le, franchement ridicules quand François Meyronnis, reprenant ses lubies giratoires, les décrit, cf. pp. 34-5 où l'auteur souligne : «Nous étudions, et en même temps nous avons le mauvais œil. [...] Dans notre regard chamanique, il y a parfois une douceur. Mais aussi du saccage ! [...] Nous retournons les paroles de ceux qui se croient vivants. Et nous-mêmes, nous retournons perpétuellement ce qui fait notre assise»). Il n'est ainsi nullement besoin de prétendre utiliser un code secret, comme Viola Sachs le fait dans La Contre-Bible de Melville. Moby-Dick déchiffré (Mouton, 1975), pour tenter d'élucider, terme idiot, un roman, fût-il, comme tout grand roman, ésotérique au seul sens ou Leo Strauss l'entendait ! Je pose une question bien naïve : Armel Guerne, pour traduire, bien mieux que Jean Giono ne l'a fait, cet immense roman de remarquable façon, a-t-il attendu que les lumières de guirlandes clignotantes de Meyronnis et d'Haenel ou les déchiffrements savants et sots de Viola Sachs en exposent les mystères sous ses yeux dubitatifs et rieurs ? Fort heureusement non car la traduction se prouve en somme en traduisant.
Certes, le lecteur doit pardonner François Meyronnis (et même Yannick Haenel) de revenir, comme un chien à son vomi, à un style parfois déplorable, composé d'expressions aussi claquantes que creuses (je ne compte plus les «phrases de réveil», p. 37, «élément du réveil», p. 41, et autre mention, pour le moins comique, d'un «factionnaire de la dévastation nihiliste», p. 53, sans même m'arrêter à cette extraordinaire découverte évoquant un «quadrillage réticulaire [qui] maçonne l'enfermement des somnambules dans la torpeur convulsive de l'époque», p. 71; et que dire de cet exemple, sommet ou gouffre du verbiage : «retenue dans la menace, la possibilité d'un salutaire qui n'aurait rien de salutiste», p. 95, l'auteur souligne) et, bien sûr, de ce qui constitue la marque de fabrique ou, pour être plus poétique, la signature de l'écrivain meyronnien : l'antéposition de l'adjectif accompagnée de l'élision du verbe, procédé grotesque à force d'être répété censé, je le suppose, provoquer un choc chez le lecteur (allons-y pour un inventaire heureusement pas exhaustif avec «Détruite, la maîtrise», p. 80, «Collés, les doigts de leurs mains, des doigts rabougris et tout raides», p. 112 et enfin, «Détruit par le ravage, Pip», p. 178).
Certes, notre lecteur, décidément compréhensif, doit passer outre les références parfaitement convenues de nos deux auteurs puisqu'elles sont celles de l'intelligentsia de gauche (à savoir, Derrida, Blanchot, Deleuze, Badiou, Maldiney et Lacan, cf. pp. 122-3), passer outre encore les discrètes déclarations d'amour (à Philippe Sollers bien évidemment, qui d'ailleurs citait, si ma mémoire est bonne, ses petits protégés dans son Vrai roman, mais aussi Gérard Guest, p. 122 et, bonheur suprême et totalement inattendu, ma chère Cristina Campo, p. 165).
Certes, notre lecteur, décidément angélique à force de bonne volonté, doit parier sur le fait que Yannick Haenel et François Meyronnis sont non seulement les tous premiers lecteurs d'un des plus magnifiques romans de Melville, Moby Dick, mais aussi les plus fins, ceux en tous les cas qui n'ont pas hésité à proposer, de ce livre, une explication ésotérique, alors qu'une petite recherche de quelques minutes rabaisse tout de même quelque peu les prétentions de nos deux mages, puisqu'il existe, au moins, un bon millier d'études évoquant les dimensions symboliques, mystiques et religieuses du chef-d'œuvre de Melville !
Je prierai donc mes lecteurs de tenter d'accéder à une véritable sainteté épistémologique en leur demandant de bien vouloir non point ignorer mais passer outre ces défauts et présupposés, afin de concentrer leur attention sur l'unique idée, à vrai dire fort peu originale elle aussi, de Prélude à la délivrance : la littérature est infiniment plus que la seule production de (mauvais) livres à quoi, de plus en plus, les éditeurs, les auteurs, les journalistes et même les lecteurs la bornent, puisqu'on «n'homologue la production littéraire qu'à proportion de son appartenance au langage de la névrose dominante» (p. 47), autrement dit les menus tracas vagino-clitoridiens hautement intéressants de bourgeoises ennuyées et ennuyeuses.
Qu'est-ce que, selon Haenel et Meyronnis, la littérature ? Bien des définitions nous sont données, que nous pourrions examiner rapidement (3) mais je crois que toutes ses caractéristiques peuvent être ramassées si nous affirmons que la littérature est l'arme la plus puissante, peut-être même la seule, puisque l'art est la littérature pour nos auteurs (cf. p. 57), pour lutter contre le nihilisme, moins diable (excellente remarque sur sa quasi-disparition, p. 73) que néant : «Au fond, on pourrait dire que la littérature se reconnaît à la manière dont y est attrapée la nervure du nihilisme. Un livre (4) où se ferait entendre un tel événement serait entièrement composé d'expériences du néant; lui-même serait une expérience du néant» (p. 33).
Cette puissance de la littérature provient du fait même que les plus grands écrivains ont été confrontés à l'expérience de la souffrance radicale, qu'il s'agisse du silence (Rimbaud bien sûr, mais aussi Hoffmansthal), de l'enfer concentrationnaire nazi (Kertész, Celan) ou soviétique (Chalamov). Seule cette confrontation avec le bourreau, comme l'écrivait Paul Gadenne, peut nous prémunir contre le danger de l'insignifiance narcissique ou, selon un terme aussi laid qu'il est employé à toutes les sauces, autofictive.
Alors, au prix de cette blessure profonde, l'écrivain est celui qui, enfin, parvient à s'oublier et ainsi à se mettre à l'écoute du langage, car «quelqu'un ne parle vraiment que depuis une écoute du langage (p. 124, l'auteur souligne). Ou encore, un écrivain, «ce n'est pas un de ces blablateurs qui cherchent à faire valoir leur intimité et à l'imposer dans la sphère spectaculaire des narcissismes; mais au contraire quelqu'un qui, écrit Yannick Haenel, en se rendant disponible à l'apparition du lavoir carré [allusion à l'épisode de la recherche, par le narrateur de Proust, des sources de la Vivonne], se sépare radicalement de la subjectivité et de son «moi aux pieds fumants, comme l'a dit un poète» (pp. 127-8).
Les lignes qui précèdent ne vous rappellent-elles donc rien ? Pas même ce que j'écrivais dans mon propre petit livre à valeur de parabole (5) ? Je pourrais contresigner les lignes qui suivent sans trop de mal qui affirment qu'il «existe en effet dans le langage un creuset résurrectionnel à partir duquel ce qui s'écrit recueille l'ensemble de ce qui s'est écrit à travers le temps. À partir de ce point s'ouvre un savoir infini qui fait refluer les traditions [...]. La littérature est le nom de cette disponibilité qu'il y a dans la mémoire : il s'agit, à travers les phrases, de donner passage à l'immémorial» (p. 155).
Cette lecture de Moby Dick, je l'ai dit, n'est pas à proprement parler nouvelle et, hormis une référence (Viola Sachs, p. 145; je serai curieux d'ailleurs, n'ayant pas relu son étude pour écrire cette note, de savoir dans quelle proportion le livre de Meyronnis et Haenel est une simple paraphrase de cette dernière...), j'aurais aimé que nos auteurs évoquent les travaux des chercheurs sur lesquels ils s'appuient. Il n'en reste pas moins que cette lecture, moins symbolique qu'existentielle (un point qu'Olivier Noël, dans son compte rendu de mon livre, n'a absolument pas vu) est parfaitement valable : elle considère ce roman comme un creuset je l'ai dit, mais surtout comme le roman, dans lequel peut se lire le destin de l'Occident (y compris la destruction industrialisée de l'homme par l'homme, cf. p. 182).
En somme, ce roman fait partie, pour le dire dans mon propre vocabulaire, de la série de trous noirs où, à mes yeux, le langage s'effondre pour renaître, comme Jonas, avalé par le monstre puis recraché (6). «C'est tout l'enjeu du livre écrit ainsi Haenel, renverser un engloutissement en jaillissement, convertir un naufrage en résurrection» (p. 187).
N'accablons point trop, quoi qu'il en soit, ce livre inégal, intéressant, grotesque, ridicule et ambitieux qui sera, je n'en doute pas, vite oublié par les spécialistes du romancier américain mais qui lui apportera peut-être quelques lecteurs curieux.
Notes
(1) Jean-Luc Delarue, comme je l'annonçais récemment, est le nouveau patron de Chronic'art qui change de formule. À la suite de ma note, Bernard Quiriny/Ludovic Barbieri/Raoul Marx m'a écrit, fort mollement, si mollement que cela m'a semblé équivaloir à un consentement du bout des doigts, pour me dire qu'il n'était point la vipère littéraire mais éprouvait en revanche beaucoup de sympathie pour les vipères (ou les lombrics, je ne sais plus). Bien évidemment, Bernard Quiriny est la vipère littéraire, si tant est que nous puissions accoler à cette sommité morale de la conscience critique littéraire, le verbe être.
(2) De l'extermination considérée comme un des beaux-arts de François Meyronnis bien sûr.
(3) Une «opération magique, créant autour d'elle son propre élément, l'un des derniers gestes de l'existence où acte et pensée commutent et où, en un éclair, le divin se retrouve» (l'auteur souligne, p. 17 : très précisément, c'est la définition de la lecture mais je crois qu'aux yeux de Meyronnis et Haenel elle vaut également parfaitement pour la littérature). La littérature véritable est encore «cri à l'intérieur du langage [qui] détache celui-ci de son vieux commerce avec la subjectivité» (p. 83). Écrire des livres «consiste, aujourd'hui, à tourner ses phrases vers cet éclair résurrectif qui vous accorde à ce qui s'abrite dans le terrible aussi bien que dans le vif» (p. 131).
(4) Les Aventures d'Athur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe et bien sûr Moby Dick constituent, sans nul doute, des exemples de pareils livres pour les auteurs. Pas un mot sur Monsieur Ouine, à mes yeux l'épreuve (plutôt que l'expérience) la plus aboutie du néant.
(5) Je ne pousserai pas le ridicule jusqu'à affirmer, comme Alina Reyes l'a fait, qu'il y a eu plagiat de mon livre ! Et pourtant, dans sa structure même, Prélude à la délivrance ressemble à celui-ci : le chapitre, d'ailleurs vif et ma foi intéressant, intitulé La fin des Temps modernes, évoque un pourrissement du langage comme je le faisais au travers des chapitres intitulés Pétrification de la Parole vive et Gangrène du bavardage. Je ne rappellerai pas davantage que j'évoque le cadavre d'une baleine (un animal hautement symbolique) elle-même divine ni encore que je convoque à mon tour mes lecteurs à une plongée dans le maelström. À la différence toutefois du livre de nos deux bardes de la délivrance, mon ouvrage incruste cette dernière dans ses pages mêmes.
(6) N'oublions point la dimension apocalyptique de l'histoire de Jonas qui, une fois revenu à terre, annonce la destruction de Ninive. Dans mon livre, Maudit soit Andreas Werckmeister !, la destruction d'une ville (ou du monde entier) est bien présente, mais on ne sait si elle a eu lieu ou si le dernier témoin qui est le narrateur contemple ce spectacle dans le futur.

 Imprimer
Imprimer