Conquistadors d'Éric Vuillard (13/10/2009)

Crédits photographiques : Andre Penner (AP Photo).
Jean-Claude Margolin, Christophe Colomb et le millénarisme, Formes du millénarisme en Europe à l’aube des temps modernes (Honoré Champion, 2001), p. 170.
«Il avait dit plusieurs fois que s’il ne pouvait arriver au Pérou, et y détruire et tuer tous ceux qui s’opposeraient à lui, au moins le souvenir de ses cruautés resterait dans la mémoire des hommes et sa tête serait placée sur le pilori, afin que son souvenir ne s’effaçât jamais; et cela, disait-il, suffisait pour le contenter.»
Relation du voyage et de la rébellion d’Aguirre par Francisco Vázquez (Jérôme Millon, 1997), p. 168.
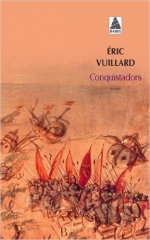 À propos d'Éric Vuillard, Conquistadors (Éditions Léo Scheer, 2009, puis coll. Babel, Actes Sud, 2015).
À propos d'Éric Vuillard, Conquistadors (Éditions Léo Scheer, 2009, puis coll. Babel, Actes Sud, 2015).LRSP (livre reçu en service de presse).
Acheter Conquistadors sur Amazon.
Rappel
Prélude à Conquistadors d'Éric Vuillard : l'or.
L'or, ou la sangre del dios Sol
Au commencement, il y a l'or. C'est lui qui, par sa souveraine puissance, créa Dieu pour se donner un rival moins éclatant et contempler ainsi sa munificence dans son miroir infini. L'or, voyant que sa création était belle, décida qu'elle manquait d'un être qui serait capable de partir à Sa recherche, de Le traquer durant des années, sans avoir peur de fouler des terres inconnues ou de s'enfoncer dans les profondeurs obscures de la terre, où il se repose depuis des millénaires. Alors l'or, qui est Dieu et plus que Dieu, créa l'homme, un être insatiable, dévoré par la faim et la cupidité, qui n'aurait de cesse de vouloir Le posséder et en parer sa compagne avant de retourner à la poussière de laquelle il vient. L'or créa l'homme pour qu'il Le cherche et Le trouve et je ne sais s'Il vit que cela était bon.
J'ai écrit ces quelques mots, comme par amusement, alors que je venais de commencer ma lecture de Conquistadors, le magnifique quatrième roman d'Éric Vuillard, puis j'ai noté ces lignes écrites par l'auteur (pp. 144-5) : «Le premier jour, Dieu avait séparé la lumière des ténèbres et il avait nommé la lumière or et les ténèbres fer. Il n'y avait pas eu de second jour.»
En quelques mots, l'écrivain a ramassé le sujet de son livre, qu'il déroule en plus de quatre cents pages de poésie, d'effroi, de beauté et de violences. Dieu. L'or. Le fer.
Dieu que tour à tour les conquistadors insultent, prient et implorent, veulent posséder dès qu'il se matérialise sous forme d'or, cet or que, cinq cents ans avant les Incas, les indiens Mochicas affirmaient être la sangre del dios Sol. Dieu qui paraît aux conquistadors plus lointain encore que ne le sont leur patrie et les femmes restées dans leur maison. L'or, l'or divin (cf. p 57), l'or omniscient, omnipotent et invisible (cf. p. 50), idole dont le culte sanglant (cf. p. 114) transcende les époques («Mais, bientôt, il n'y aurait plus de Terre promise où disperser nos tribus. L'unité du monde ferait fondre les idoles et les vouerait à terminer leur vie minuscule en lingots dans les coffres de la couronne», p. 61), l'or qui est devenu aux yeux des conquistadors un mirage de plus de réalité que leur propre vie en Espagne, lorsqu'ils n'avaient encore point quitté leur pays âpre et violent, l'or que l'on dirait avoir été extrait des ténèbres chaudes de la terre par la seule ténacité d'hommes dignes d'être peints par Goya (cf. p. 63 : «Pareils sont les tableaux de Goya. Des hommes taillés dans le charbon. Un mouvement de panique, une charnière. Ils vivent d’une satisfaction très forte mais fugace. Ils ne partagent rien, le soir ils s’allongent dans l’herbe rase. Après le repas, ils se rincent les mains dans la terre»).
L'or qui, comme Dieu, ne peut être représenté puisque même la vue de montagnes d'or ne donne aux conquistadors qu'une seule certitude : l'or, ce n'est pas encore cela, Il se trouve derrière le voile, dans le Saint des Saints, Il ne peut être vu et celui qui Le voit est puni de mort : «On avait beau leur raconter encore la même histoire, leur décrire le même jardin où tout était en or, ils croyaient entendre une autre comptine, un autre récit, venu de plus loin (p. 417). L'or est ce lointain tremblant sous le soleil, cet horizon que nul navire n'atteindra jamais, qu'importe que la Terre soit ronde ! Il se cache, Il ne peut pas simplement se réduire à ces objets de la vie quotidienne ou bien à d'autres, sacrés, réservés au culte des dieux. Il ne peut même pas se calculer, se chiffrer ou se déchiffrer. En fait, comme Dieu, l'or n'est absolument rien d'étant, rien qui se puisse circonscrire, embrasser, posséder. Son empire est infini et tous les hommes de la Terre, mis les uns derrière les autres pour constituer quelque interminable colonne de chiffres et de servitude, d'avarice et de cupidité, n'en constitueraient qu'un unique maillon (cf. p. 157).
Le fer qui est l'âge, et la matière, et l'instrument des hommes pour amonceler des montagnes d'or et, peut-être, parvenir, par la force, à contempler quelque écaille d'un or spirituel (puisque «Celui qui cherche Dieu verra une écaille de soleil», p. 163), Dieu peut-être ou sa trace, dont le métal précieux n'est pas même le symbole mais l'incarnation mauvaise, grotesque, impérissable et pourtant née de la terre et y retournant.
Cet unique et monstrueux jour de la création enfin, qui paraît se consumer dans sa giration, dans une gyre qui, à la différence de celle de William Butler Yeats, ne s'élargit pas sur sa propre base, accomplissant ainsi des révolutions qui embrasent de nouveaux mondes, font naître de nouveaux destins, fécondent de nouvelles âmes.
L'or et le fer, symboles de Dieu ou bien du temps, sont liés, moins par quelque lointaine parenté minérale ni même une décision d'archonte ou de démon les ayant créés dans ses fourneaux que par la mystérieuse alchimie d'un temps qui n'obéit pas aux lois de la physique.
Turning and turning in the widening gyre ou la ronde maléfique
Il n'y a, dans le roman de Vuillard, aucune progression possible vers el Dorado, le pays de cocagne rêvé par les conquistadors, même si ces derniers ne nous sont décrits que marchant, ou dormant, ce qui est pareil puisqu'ils sommeillent sur leurs montures, rêvent sur leurs montures, pensent, sur leurs bêtes qui impressionnèrent tant les Indiens, à leur bien-aimée restée en Estrémadure la pouilleuse reconquise aux Infidèles, font leurs besoins, même, sans descendre de cheval. Cette marche est sans fin, comme celle des guerriers de Lord Dunsany s'avançant vers une Carcassonne qui n'existe que dans leur esprit. Cette marche est une longue fuite, un épanchement, celui du sang des hommes qui coule sans rémission dans notre roman, celui de l'or qui est le sang de Dieu, celui, aussi, de la syphilis, discrète mais terrible contre-incarnation de l'or, maladie du fer peut-être, en tous les cas de la convoitise charnelle, voyageant beaucoup plus vite que l'or sur les routes du monde ouvert, forcé, déchiré par la rapine et l'immense désir de tout posséder.
Cette marche éternelle se refermant sur ses propres pas contredit les attentes apocalyptiques et parousiques qui façonnèrent bien des légendes propres au Nouveau Monde, lesquelles pourtant naquirent dans les cervelles millénaristes des Européens (cf. l'extrait de Jean-Claude Margolin cité en exergue) qui, sur les terres nouvelles, amenèrent avec eux maladies, armes et attentes religieuses.
Dans le roman d'Éric Vuillard, ce cercle vicieux n'est jamais mieux illustré (j'allais écrire, de nouveau, déroulé) que par l'image de l'écoulement (des fleuves, des torrents, du temps), de l'étirement (des colonnes pouilleuses d'hommes harassés, des cortèges de guerriers déterminés s'étendant comme des fils d'or (p. 42), des routes, des ponts de cordes au-dessus des abîmes) d'un passé qui aboutit à un présent qui n'est que sa monstrueuse contrefaçon, non point seulement sa conséquence et son résultat mais comme son double dégénéré, son bâtard malformé. Un présent de fer, gris, insipide, ayant comme dans Fondation d'Isaac Asimov recouvert la terre tout entière d'une chape épaisse, colossale, l'asphyxiant. Le présent, ignoble de platitude, tout entier dévoré par la publicité, l'argent et le kitsch modernes, n'est point ce que Vuillard pourrait désigner par telle allusion discrète ou digression évidente interrompant son récit. Le présent de la nation sud-américaine, comme tel personnage de la mythologie grecque, semble ainsi être né complètement formé du cerveau de nos conquistadors, cette brusque déhiscence des conséquences de leurs actes intrépides et sordides au milieu même de leur entreprise de conquête expliquant, peut-être, leur mystérieuse mélancolie (cf. p. 214), magnifiquement évoquée par le destin d'Almagro, ami de Pizarre puis son ennemi bourrelé de remords et de craintes (cf. pp. 369-379) : «Prodigalité signifie toujours : despotisme et religion. Mais ici, cela signifiait également parade ultime, bref reflet d’un monde riche et plein, différent, et qui bientôt ne serait plus que feuilles de coca que l’on mâche, cruches de chicha et pommes de terre cuites dans la cendre» (p. 109). Le style même de Vuillard, volontiers parataxique, semble vouloir confondre ce lointain passé dormant dans les archives et un présent de plus en plus uniformisé, aussi irréels l'un que l'autre, aussi éloignés l'un que l'autre de la vrai vie (p. 333) qui finira bien, de toute façon, par contaminer les récits les plus merveilleux, les légendes les plus pures.
Nous avons employé des mots (or qui est richesse, Dieu qui est appel mais aussi invocation de l'invisible, violence qui est endémique et ne semble appeler aucun déchirement des sceaux de l'Apocalypse) qui paraissent être les indices disséminés dans tous les anciens récits de conquêtes comme celui d'Aguirre, cité en exergue, du moins de ces récits de conquête que nous pourrions dire seconds au sens que Merleau-Ponty donnait à cet adjectif, puisque romancés. Ces mots sont tout juste bons pour les papiers de certains journalistes qui ressemblent, davantage qu'à des critiques, à de poussives quatrièmes de couverture. Tout grand roman abrite en son centre un monstre comme l'écrivait José Bergamín.
Tout dire en une phrase
Quel est donc le sujet véritable de ce roman ? La défense et l'illustration des opprimés, ces nations amérindiennes massacrées par les conquistadors espagnols en quelques années à peine, par la vertu de leurs armes, de leur incroyable audace et, surtout, des maladies qu'ils transportaient dans leurs corps et les flancs de leurs putains ? Non bien sûr, n'en déplaise à Jean Ristat qui confond écriture romanesque et programme communiste électoral (1). À dire vrai, les véritables vaincus semblent être, aux yeux mêmes de Vuillard, les anciens frères d'armes de Francisco Pizarre comme Almagro davantage que les Indiens dont la psychologie est pour le moins le point ou l'angle morts de Conquistadors. Jean Ristat, en outre, se trompe lourdement lorsqu'il écrit : «Je lis, par exemple, dans le Dictionnaire des genres et notions littéraires, sous la plume de Michel Zéraffa, que «même rédigé en vers (le Roman de la rose), un roman fait pencher les symboles du poétique vers les aspects prosaïques (quotidiens, familiers, utiles, sociaux en un mot) de l’existence». Or poursuit-il, ici, dans Conquistadors, le quotidien de Pizarre, de ses soldats, des Indiens, est élevé à la dimension du mythe». Non bien sûr, puisque Vuillard est au contraire taraudé par l'urgence de redonner à la vie quotidienne tout son poids de sens, déposé dans les gestes les plus humbles au cours d'une longue sédimentation que les mots et les symboles ne paraissent plus, à ses yeux, être capables d'accomplir.
La vie romancée de l'implacable Fernando Pizarre ? Sur cet homme étonnant, Bernard Lavallé a déjà écrit un texte excellent et Cormac McCarthy, pour créer la figure errante et implacable de son Glanton, s'en est peut-être souvenu même si, on le sait, le romancier américain s'est minutieusement documenté à des sources historiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la conquête de l'Amérique du sud par les Espagnols (cf. Notes on Blood Meridian de John Sepich, University of Texas Press, 2008, pp. 22-36) (2).
La grande épopée de la conquête de l'or et de la folie que sa recherche puis possession ont provoquée dans les cervelles de milliers d'hommes, criminels ou saints ? Pas davantage. Je ne suis même pas certain que ce roman, malgré certaines pages (celles, surtout, de la fin, où éclate la guerre civile entre conquérants espagnols) qui semblent atteindre quelque aire secrète où le siècle de fer et d'or s'auréole d'une véritable beauté tragique plutôt qu'elles n'utilisent les ingrédients du registre épique (accumulations, hyperboles, exclamations, phrases complexes, motifs récurrents comme le cano, etc.), puisse être qualifié, même de façon imagée, d'épopée ni même, inversement, d'épopée parodique.
Dieu peut-être, toujours présent dans les gestes barbares de ces tueurs que l'on dirait tous hantés par un mauvais rêve ? Dieu sûrement, que les conquistadors, selon un magnifique passage du roman de Vuillard (cf. pp. 417-8) chassent comme s'ils étaient de nouveaux Nemrod ? Non, alors même, pourtant, que ce livre est façonné par de constants rapprochements entre les aventures des conquistadors et telle geste merveilleuse et terrible des Juifs de l'Ancien testament ou des héros du panthéon grec. Pizarre est même une espèce de nouvel Adam, remplaçant la bassesse de ses origines par l'acte inimaginable consistant à devenir ce que Nietzsche appela un nommeur : «Lui, Pizarre l’obscur, il nommait, il baptisait. Seul un exploit pourrait le tirer hors du noir. Pour que le néant cède une place à sa chair, il devrait accomplir une chose inouïe» (p. 70).
Le sujet véritable de ce roman admirable qu'est Conquistadors est purement littéraire : il s'agit, comme Julien Capron l'a écrit dans un autre gros livre somptueux, Match aller, comme encore Mathias Énard a tenté de le faire, avec beaucoup moins de réussite, dans Zone, d'enfermer la totalité de l'expérience humaine s'étirant d'une mythique origine vers un présent qui n'est que l'aboutissement d'une longue décadence dont l'expérience de la conquête du Nouveau Monde n'est elle-même qu'une syllabe, dans une phrase d'homme. En quelques mots, l'écriture est «cette tentative désespérée d’atteindre les côtes brumeuses du monde» (p. 292), afin de redonner chair et esprit à tous ces hommes dont les voix ont continué de tourner «autour des arbres, pleines de leur violente vérité», eux ayant disparu après «une brève journée de colère» (p. 322).
Cette affirmation rapproche ces deux écrivains, Julien Capron et Éric Vuillard, des plus grands bien sûr : William Faulkner avec le baroque et tourmenté Absalon, Absalon !, Joseph Conrad avec le prodigieux effort qu'a dû représenter l'écriture du labyrinthique Nostromo. Ajoutons également Diadorim de João Guimarães Rosa et même 2666 de Roberto Bolaño. De Pierre Michon encore ? J'en doute. Grand styliste sans conteste, Michon n'en paraît pas moins obsédé par la perfection formelle de ses livres, souci qui me paraît l'éloigner, en le rapprochant d'un autre grand prosateur et pourtant fantôme romanesque, Julien Gracq, du fleuve torrentiel dans lequel ne craignent pas d'entrer les romanciers-démiurges plus haut cités qui se moquent du polissage maniaque et infini de l'écriture pour préférer à ce travail de bénédictin, à la force de leurs seules mains, l'extraction douloureuse, l'arrachage de quelque gangue noire et dure comme une veine souterraine d'un diamant presque laid de n'être point taillé. L'irruption, rare mais bien réelle, de la première personne du singulier ne trompe pas dans le roman de Vuillard : il s'agit de se glisser dans la troupe pauvre des conquistadors, dans l'intimité de ses chefs, dans leur esprit, quitte à ce que le romancier avoue ne pas savoir ou ne pas se soucier de telle ou telle chose, alors qu'il a dû, pour bâtir son livre, lire bien des récits.
Conquistadors ou la quête des origines ?
En somme, pour chacun de ces grands auteurs, l'intention première ayant commandé la trame narrative, quelle que soit la complexité de cette dernière et, bien évidemment, ses caractéristiques propres, peut être embrassée sans trop de mal par un regard surplombant : nous pourrions alors voir, de cette illusoire position, que la volonté de ces écrivains a bel et bien été de tenter de trouver une origine au mal qui gangrène et ronge patiemment l'époque où ils ont conçu leur livre, époque qui ne peut qu'être l'héritière d'une horreur lointaine, passée, où les livres n'existaient pas encore.
C'est sans doute pour cette raison que Francisco Pizarre, de même qu'Aguirre (3), aussi violents et cruels soient-ils, ne peuvent être considérés que comme des instruments du mal, ou peut-être, simplement, d'une soif qui, sur terre, ne peut que se révéler inextinguible et être ainsi, toujours, une brûlure qui conduira ces hommes et leurs compagnons, vers d'autres pillages, d'autres viols, d'autres meurtres, d'autres extases devant des monceaux d'or confondus avec des idoles propitiatoires.
Cette quête, comme toutes les quêtes, est chimérique, même reconduite deux fois, afin de tromper le destin puis de tromper le hasard (cf. p. 382). Dans les meilleurs romans de Conrad, le narrateur tente toujours de remonter le fil, celui du fleuve et du temps vers Kurtz envahi par des forces aussi maléfiques que primitives, celui de l'enchaînement fatal ayant abouti à la trahison de Lord Jim, celui de l'argent, sillage fabuleux, déversé par la mine dans Nostromo. Tous échouent, plus ou moins symboliquement : Marlow a été bien près de mourir et a menti à la fiancée de Kurtz, Lord Jim reste, aux yeux de ce même Marlow, une coquille vide (4) et le cargador de capataz est un homme enchaîné à l'idée même de son trésor plutôt qu'à ce dernier (5). Dans le roman de Vuillard, l'un des conquérants, De Soto, ressemble à quelque Kurtz nostalgique, et c'est dans le néant, «au bord de rien» (p. 282) que s'achève la course des compagnons de Pizarre : «Le vide où il marchait l'avait peut-être dépouillé de son humanité, et une autre nature était venue remplacer la première» (p. 298).
Ainsi cette quête d'une origine chimérique du mal est-elle à son tour condamnée : nul ne paraît pouvoir s'échapper du cercle maléfique de l'histoire universelle, comme ces milliers d'Incas entourant leur roi qui, une fois attirés dans les enceintes de la ville où les Espagnols les attendent, seront massacrés par ces derniers sans pouvoir s'échapper. Éric Vuillard écrit, dans l'une de ses phrases foudroyantes qui traduit sa rage de tout dire et, surtout, de percer à jour le secret de l'élan fondateur qu'il quête comme ses personnages cherchent la moindre paillette d'or : «Car, ignorant les lois du monde qu’ils assemblent à coups de sabre, aveuglés par la toute-puissance de leur règne, sous l’impulsion d’une violence initiale, ils resteront, à travers le miroir d’Occident, cadavres rassis sur les talus galiléens du progrès, après avoir étiré de toutes leurs forces les rails du vaste train qui part de Tolède et termine sa course, cinq cents ans plus tard, dans les barrios altos de Lima» (p. 11).
Les conquistadors, tout à la fois brutalement et humainement peints (cf. p. 174, où De Soto pleure devant le roi inca), paraissent jouir d'autant de discernement, quant à l'action réelle qu'ils mènent en ce monde, que le Napoléon de Léon Bloy. Après avoir été utilisés (mais par qui ?), ils seront jetés et se dessècheront lentement, à l'image de ces vieillards indiens qui lentement se ratatinent dans leur niches de ténèbres.
N'est-ce donc là que le tribut, légitime après tout selon Hans Blumemberg, qu'il faut payer à l'insatiable soif de conquêtes intellectuelles propre aux temps modernes ? Si c'est le cas, et sans confondre ce mouvement que l'on dirait animé d'une force inconnue avec le mal, il nous faut cependant admettre qu'il n'y a point seulement conquêtes de la liberté intellectuelle dans la marche du progrès. Avant tout, il y a chute, comme l'indiquent ces deux passages, qu'une seule page sépare (6), du roman de Vuillard : «Les conquistadors descendaient vers le sud et suivaient la route inverse des trois Créateurs qui avaient fait sortir de terre les ancêtres des peuples; eux, les Créateurs, ils avaient fait surgir les peuples des sources, des grottes, des rochers» (p. 59) alors que «ce que firent, bien après eux, Francisco Pizarre, Hernando de Soto et Sebastián de Benalcazar fut, en revanche, qu’ils déchussent» (p. 60). Chute consécutive à l'expulsion de l'Éden, dans lequel les conquistadors veulent se perdre nous dit Vuillard (p. 417).
Les mots ne sont pas de ce monde
Il y a peut-être une autre raison, plus souterraine, plus secrète, qui empêche ces hommes de briser les épaisses murailles du mauvais rêve duquel ils restent prisonniers : celui qui pourrait les libérer, le romancier, est en effet lui-même emprisonné dans un cachot que les mots ont construit. Il hésite, il paraît procrastiner, comme Almagro crevant de ces bubons syphilitiques hésite et, en toute connaissance de cause, sait qu'il prend les mauvaises décisions, par fidélité non récompensée à son maître, Pizarre. Conquistadors est en fait, paradoxalement, la prison que l'auteur édifie patiemment, mot après mot, phrase après phrase, et dans laquelle il emprisonne ses personnages courageux et pervers, brutaux et bons, compliqués et naïfs comme des enfants : «Il aurait voulu, nous dit Éric Vuillard de Hernando, le frère de Fernando Pizarre, des mots qui comme une vague de la mer emportent tout. Mais de tels mots n'existent pas. Les seuls mots qui soient permettent à peine de se rencontrer et de s'unir. Pourtant ils palpitent d'une vie sous leurs cendres d'orgueil. Pour Hernando, les leçons de ses maîtres avaient châtré les mots. Elles en avaient fait un projet sans âme. Où trouver des mots intacts et purs ? À quel courant d'air les rafraîchir ? Il ne savait pas» (p. 192). Contrairement à Almagro l'hésitant, le trop humain, Francisco Pizarre, lui, paraît savoir, et, s'il ne sait pas, il se lance dans l'arène sans la moindre hésitation, faisant fi des opinions et des longues heures sèches où les idées sont mûrement soupesées puis écartées : ayant peu de mots à sa disposition, il est comme un roc inébranlable au milieu du courant du fleuve (cf. p. 376). Celui qui a connu la soif et la faim (cf. p. 352) agit comme un forcené c'est sûr, ne rêve pas en tout cas ni ne peut se payer le luxe de le faire : Pizarre est le fils (du moins romanesque) de Thomas Sutpen l'ambitieux, qui lui aussi s'est hissé jusqu'au pouvoir par la seule force de sa volonté.
À vrai dire, un passage antérieur à cet extrait de la page 192 eut dû nous mettre sur la voie d'un pessimisme radical, passage dans lequel Éric Vuillard, à l'encontre même de la certitude gouvernant les textes des auteurs du Siècle d'or et, bien avant cette époque, contre les images d'un monde aussi lisible qu'un livre ouvert contenues dans les épopées comme le Cantar de mío Cid et plus tard les romanceros, referme le magnifique livre de la nature dont, tout au plus, nous parvenons à déchiffrer quelques syllabes : «Et tandis qu’ils avançaient dans la buée des choses, des événements, des signes, ils sentirent que chaque fragment du monde ne pouvait être déchiffré que par un autre, ne pouvait être compris qu’en le permutant, qu’en l’insérant ailleurs, qu’en le déplaçant, qu’en le pliant et le superposant de mille manières. Les événements appartenaient à la même fourrure dont le monde se couvrait le corps. Chacun caressait la fourrure et admirait les reflets de lumière. Mais le sens ne voulait pas être approfondi. Rien ne voulait être compris. La vie circule et danse. On la convertit en images, on ne sait rien faire d’autre» (p. 177).
En quelque sorte, le langage, les nombreuses images verbales (certaines d'entre elles sont absolument magnifiques dans le roman de Vuillard) ou peintes, des passages remarquables (comme ceux, brefs et scintillants, qui décrivent la fin de l'aventure pour les compagnons de Pizarre, pp. 295 et sq.; comme, encore, l'histoire d'Alvarado, pp. 277-288) s'écartent bien trop du réel qu'il s'agit pourtant de faire chanter (p. 292), recouvrent la réalité, comme les plaques d'or recouvrent les temples indiens. Ailleurs (pp. 353-4), Éric Vuillard évoque le symbolisme universel propre au pain, à la chair, à l'or, au vin et au sang «circulant depuis le centre de nos vies jusqu'aux quatre coins du monde» qui, même s'il paraît, davantage que les mots, puiser sa force dans les réalités les plus humbles, n'est lui aussi que «vieilles amphores [et] vieux tonneaux de bois, aux douves jointes et cerclées par des myriades d'images, et qui contiennent un vin piqué». C'est peut-être cette certitude de ne jamais pouvoir parvenir à l'ultime vérité qui rend les Espagnols si méthodiques et acharnés pour dépouiller les Incas de leurs fabuleuses richesses, l'or recouvrant l'or sans jamais laisser entrevoir, sous les masques grotesques des idoles et des dieux, quelque chose comme une matrice de laquelle l'or a jailli, et la faim de l'or, et la rage de le posséder coûte que coûte, et la soif insatiable de nouvelles conquêtes absurdes, alors que les conquérants, comme le Gilles de Rais peint par Huysmans, détruisant et massacrant les indiens incas, excoriant leur chair avec une rage infernale sans jamais parvenir à quelque mystérieuse limite qui, en assouvissant leurs abominables passions ou plutôt en montrant leur profonde inanité, leur apporterait, aussi, un peu de paix, sont condamnés à ne pouvoir se reposer.
La main racla le Christ jusqu'à l'os
Le repos, dans le roman d'Éric Vuillard, me semble toutefois constituer, de temps à autre, la troublante percée d'une lumière douce s'aventurant dans les ténèbres : trouée de lumière paradoxale puisqu'il s'agit de celle qu'apporte la dissipation de la nuit pure et longue, terrible et douce, toute chargée de «ces désirs amassés venus du fond de la nuit comme un rocher qui serait remonté brutalement du fond des mers» (p. 255). De même, si l'or semble être devenu le Dieu véritable et sanguinaire de ces adorateurs brutaux que sont les conquistadors, nous ne serons guère étonnés de remarquer que les nombreuses mentions de la figure du Christ (cf. p. 187, 228 ou 352) constituent autant de cales de radoub narratives si je puis dire, où le romancier répare et reconstruit tout ce que ses personnages se sont ingéniés à détruire. Mais après tout le Christ de Pizarre n'est pas d'humilité mais d'or et de sang (cf. p. 389) et son unique science n'est pas celle qui s'apprend en s'humiliant au pied de la croix mais en «tétant le sang» même si les pages bouleversantes relatant la mort de Pizarre peuvent nous laisser penser qu'enfin, à l'instant de la plus grande gloire et du plus grand dénuement (cette extension puis contraction mimées dans les sensations mêmes qu'éprouve Pizarre agonisant, pp. 425-6, souvenir peut-être de la mort de Virgile d'Hermann Broch), au moment où l'intrépide conquistador comprend qu'il n'a pas changé une virgule au récit de l'histoire comme, se souvient-il, il n'a jamais osé couper la branche couverte d'épines d'un petit arbre lui barrant le passage d'un chemin qu'il empruntait enfant (p. 428), qu'enfin donc, il remet tout entre Ses mains.
Un dernier mot : la perfection, de même que l'or illusoire que poursuivent sans relâche les explorateurs du Nouveau Monde, n'est pas de ce monde, et le roman d'Éric Vuillard, dominant tout de même, avec celui de Julien Capron, cette rentrée littéraire, n'est point dépourvu de défauts : parfois trop de didactisme sentant sa petite fiche (le court chapitre sur la succession des Papes) ou bien encore la volonté un peu trop appuyée de nous délivrer un cours, d'ailleurs approximatif, sur les mutations sociales, économiques et financières ayant eu lieu à l'époque des conquistadors (voir, page 236 (7), le passage sur la figure du petit employé, ancêtre de Bartleby ou encore, pages 264 et 265, celui sur les bourgeois), leçon bien apprise qui, à mon sens, contribue à désépaissir la matière énigmatique et charnelle (8) de ce roman fulgurant et admirable.
Notes
(1) Précisons toutefois que le texte de Jean Ristat pour Les Lettres françaises peut seule prétendre au titre de critique littéraire digne de ce nom, si on lui compare les fort maigres papiers parus dans Le Nouvel Observateur (Claire Julliard), Le Figaro Magazine (Jean-Christophe Buisson) et enfin Télérama (NA.C).
(2) N'oublions tout de même pas que Méridien de sang décrit un acte de bravoure des hommes de Glanton qui, grâce aux connaissances du juge Holden, parviennent à tuer des Indiens avec de la poudre à canon qu'ils auront eux-mêmes créée. Cet épisode n'est pas sans rappeler, comme l'indique John Sepich, l'usage qu'un Hernán Cortés fit de cette même poudre à canon pour défaire les Indiens aztèques.
(3) «Ce maudit rebelle disait quelquefois qu’il était certain par avance que son âme ne pouvait se sauver, que, tout étant encore en vie, il brûlait déjà dans l’enfer; et que, puisque le corbeau ne pouvait pas devenir plus noir que ses ailes, il voulait commettre autant de crimes et d’infamies qu’il pourrait, afin que le nom d’Aguirre eût du retentissement», in op. cit., p. 170.
(4) «Maintenant qu’il n’est plus là, il y a des jours où je sens la réalité de son existence avec une force immense, envahissante; mais, par ma foi, il y a aussi des moments où il fuit sous mon regard comme un esprit désincarné égaré parmi les passions de la terre, prêt à répondre fidèlement à l’appel de son univers de fantômes», Joseph Conrad, Lord Jim (traduction d’Odette Lamolle, Le livre de poche, coll. Biblio, 2007), p. 484.
(5) «Nostromo s’était tu; puis il reprit sur un ton de voix différent, se parlant à lui-même comme s’il avait oublié l’existence du docteur.
«Il y a dans un trésor quelque chose qui s’attache à l’esprit d’un homme. Il prie et blasphème et persévère cependant; il maudit le jour où il en a entendu parler pour la première fois, et laisse arriver sa dernière heure sans s’en apercevoir, croyant toujours qu’il ne l’a manqué que d’un cheveu. Il le voit chaque fois qu’il ferme les yeux. Il ne l’oublie qu’à sa mort – et même alors… docteur, avez-vous jamais entendu parler des misérables gringos de l’Azuera, qui ne peuvent pas mourir ? Ah ! ah ! Ce sont des marins comme moi. On ne peut pas échapper à un trésor une fois qu’il s’est attaché à votre esprit», Joseph Conrad, Nostromo, (texte traduit, présenté et annoté par Paul Le Moal, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, tome II, 1985), pp. 949-50.
(6) Ou celui-ci : «Mais, bientôt, il n’y aurait plus de Terre promise où disperser nos tribus. L’unité du monde ferait fondre les idoles et les vouerait à terminer leur vie minuscule en lingots dans les coffres de la couronne. Il n’y aurait plus qu’un seul monde, une seule humanité. Il n’y aurait plus de replis, plus de lacunes, plus de royaumes rêvés. Il n’y aurait plus d’Éden sauvage. La terre était ronde à présent. Il y aurait les dialogues de Galilée, la merveilleuse mappemonde et la tragédie prosaïque du savoir» (p. 61).
(7) «On voit apparaître ainsi, au milieu de nulle part, la figure du petit employé qui dominera, longtemps après, la littérature d’une époque. Celui-ci s’est donc signalé, bien avant que la poussière ne froisse ses épaules, par un rôle à la fois futile et déterminant. Le petit homme, le plus moderne en somme de la troupe, la silhouette d’avenir, comptait peut-être pour peu, mais il était là toujours, au meilleur moment. Il y eut, au temps de ces croisades mirifiques, plein de gentils scribes, juristes et copistes, Bartleby des confins, pour écrire, noter, sommer, compter, enjoindre, négocier, et parfois détruire les actes inopportuns. Que sont-ils devenus ? Riches. Et, depuis, bien davantage que le conquistador sanglant et miteux.»
(8) «[...] tous les contempteurs des Pizarre, des Almagro et de tous les tyrans de la terre, mais aussi des plus petits criminels et de n'importe qui, devraient ouvrir la poitrine de ces hommes et y faire battre quelques instants leur cœur. Ils verraient comme on est Pizarre, à sa manière, comme on est avide, lâche et violent et triste aussi» (p. 410).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, conquistadors, éric vuillard, éditions léo scheer |  |
|  Imprimer
Imprimer