Monsieur de Phocas de Jean Lorrain (07/06/2018)
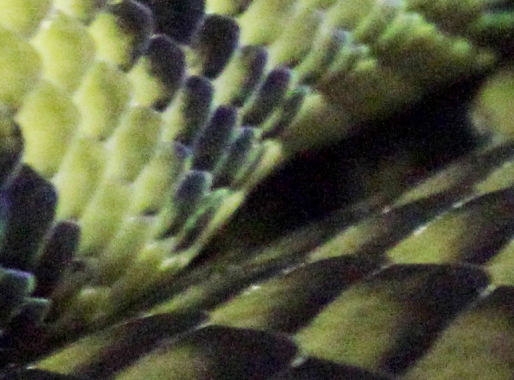
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Acheter Monsieur de Phocas sur Amazon (attention, il ne s'agit pas de l'édition que j'ai utilisée, et je ne sais rien par ailleurs de celle qui est proposée à la vente).
Acheter Monsieur de Phocas sur Amazon (attention, il ne s'agit pas de l'édition que j'ai utilisée, et je ne sais rien par ailleurs de celle qui est proposée à la vente).Ce n'est pas tant dans la description des vices, finalement moins frontalement évoqués que suggérés (et même, petite ruse narrative, caviardés par celui auquel le personnage principal a remis son manuscrit, cf. p. 23), que Jean Lorrain excelle, que dans la dénonciation d'un Paris rappelant la Rome décadente (cf. p. 163) et, plus largement, d'une Europe faisandée de vanités, de dégoût et d'ennui, devenue, sous la croûte du vice, une goule pétrifiée en fait sous son apparence de vie débauchée, factice, «vieille Europe routinière et pourrie» (p. 245) qui ne vit plus mais survit, bête deux fois millénaire «qui a déformé la vie» (p. 209). Les étranges manies du malfaisant peintre Claudius Ethal, que Monsieur de Phocas, naguère encore le duc de Fréneuse, finira par tuer pour se libérer de son emprise, ne ressortissent finalement que de l'esthétique tavelée propre au décadentisme, et peu nous importe que le personnage principal, dont nous lisons le Journal avant qu'il ne quitte définitivement la France, admette que la «palpitation de la vie [l']a toujours rempli d'une étrange rage de destruction» (1) ou qu'il y a en lui «un fonds de cruauté qui [l']effraie» (p. 33). Ce n'est là rien de plus, après tout, que les attendus pour ainsi dire de tout texte s'inscrivant dans le sillage, parfois le remugle, de la littérature fin-de-siècle
Il est bien plus intéressant de remarquer l'acuité du regard de l'écrivain, qui, sous les masques des gens de la haute société parisienne, voit, par l'entremise du diabolique Ethal qui semble tout savoir sur tout le monde, l'horreur, moins celle du péché d'ailleurs que celle d'un ennui qui dévore tout : de chacun de ces personnages dont le peintre anglais évoquera le passé turpide, nous pouvons dire que «l'âme lui était remontée au visage» (p. 38) (2) et, avec l'ennui, «l'irréparable vide» (p. 176) qui est non seulement celui du personnage principal, mais des monstres que Claudius Ethal place sous son regard. Léon Bloy a peint de façon insurpassable cette galerie de médiocres fardés lorsqu'il fait tonner Caïn Marchenoir au dîner de Beauvivier.
Bien davantage encore que Des Esseintes qui s'enferme dans la folie de ses idées fixes, Monsieur de Phocas semble gémir à la seule idée de ne point trouver, au milieu du cloaque que représente Paris, une parcelle de pureté, que Claudius Ethal, lui, veut à tout prix tenter de découvrir, mais de manière évidemment inversée, parodique, perverse, dans des compositions picturales représentant des créatures chlorotiques, dévorées vivantes par des vices imaginaires ou bien réels, comme l'inceste, qui les rongent. C'est ainsi à l'heure «où Paris s'allume» que Claudius Ethal se met en chasse, accompagné de son nouvel ami qu'il prétend vouloir sauver d'une de ses bizarres obsessions, alors qu'il ne fait qu'accentuer son mal («le Démon de luxure», p. 18; ailleurs comme nous l'avons vu, il se déclare plein d'une «étrange rage de destruction», p. 49), jusqu'à le faire basculer dans l'état second du meurtre libérateur, à cette heure noire où «toute la boue de la ville [coule] vers la débauche» (p. 155).
Dans un passage assez étonnant qui semble annoncer le Claudel de L'Œil écoute, Jean Lorrain affirme que «les yeux des hommes écoutent», et qu'il y en a «même qui parlent, tous surtout sollicitent, tous guettent et épient, mais aucun ne regarde» car, poursuit l'écrivain en soulignant cette phrase, «l'homme moderne ne croit plus, et voilà pourquoi il n'y a plus de regard», ajoutant qu'il «n'y a plus d'âme» dans les «yeux modernes», puisque même «les plus purs n'ont que des préoccupations immédiates : basses convoitises, intérêts mesquins, cupidité, vanité, préjugés, lâches appétits et sourde envie : voilà l'abominable grouillement qu'on trouve aujourd'hui dans les yeux» (p. 39). Il n'y aura dans le roman de Jean Lorrain, sauf erreur de ma part, qu'une seule mention directe de Dieu : «Chaque créature indique Dieu, aucune ne le révèle, ai-je lu quelque part. Dès que notre regard s'arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu» (p. 193) mais pourtant, nous ne pouvons nous empêcher de croire qu'il manque à Monsieur de Phocas quelque Durtal consolateur qui eût pu se faire son aimable bien qu'exigeant guide vers les pieds de la Croix, même si pas une seule fois le Christ n'est nommé dans le livre de Lorrain. Belle idée que cette impossibilité de voir réellement, en raison même de l'absence de Celui que le regard ne peut voir, mais qu'il peut seulement tenter d'apercevoir en énigme, dans la composition d'une infinie subtilité que font entre eux, dans leurs trames visibles et invisibles, les êtres et les choses.
C'est d'ailleurs cette absence même, bien que Monsieur de Phocas transperce les masques, qui me fait douter de la réussite de la thérapie recommandée à ce dernier par son ami, Sir Thomas Welcôme : la fuite. La fuite hors d'Europe mais aussi, comme le montrera magnifiquement Max Picard, la fuite devant Dieu. C'est tout un, et le programme, on le sait exécuté par Arthur Rimbaud avec une obstination démentielle, consistant à «voyager, vivre avec ferveur une vie de passion et d'aventures, s'anéantir dans de l'inconnu, dans de l'infini, dans l'énergie des peuples jeunes, dans la beauté des races immuables, dans la sublimité des instincts» (p. 245), outre qu'il réserve de cruelles déceptions, aura vite fait de se transformer en réclame publicitaire pour ailleurs frelatés. Cet imaginaire strictement commercial nous semble déjà, monstrueusement, en train de germe dans cette énumération touristique pour amateur de chairs fraîches : «S'ils savaient ! Oh ! les nuits de Naples et d'Amalfi, les promenades en barque dans le golfe de Salerne et les longs et insatiables baisers avec les deux sœurs hongroises à l'hôtel de Sorrente; les soirs en gondole sur la lagune morte, à Venise; les haltes dans les canaux abandonnés de la Judecca, et les rencontres imprévues, les aventures passionnées de Florence, aventures sans lendemain et qui sont éternelles, et les hallucinations exténuantes de Sidi-Ocba et de Thimgad, les baisers de vampire, dans le mirage des sables et la brise salée du désert !» (p. 46).
Monsieur de Phocas fuit, mais n'assume pas, comme le montre telle citation de Swinburne, selon laquelle le péché n'existe pas vraiment au fond de nos âmes, puisque celles-ci «sont jetées dans le gouffre» (p. 23) de la vie moderne, contre laquelle il est vain de prétendre lutter.
Je crains donc que Monsieur Phocas, si pressé de quitter le cloaca maxima qu'est la Ville des Lumières qu'il désire voir réduite en cendres sous «les bombes de l'Anarchie» (p. 70), ne parte chercher ailleurs, en Égypte ou en Inde, qu'un ersatz de pureté ou, à tout le moins, une illumination passagère, incrustant définitivement dans l'esprit et dans l'âme, la certitude de la cruelle idole enfin rencontrée, l'homme ayant alors «traversé une minute enchantée, vécu quelques instants d'une vie miraculeuse, divine, et si décevante pourtant !» (p. 136), comme cela a été le cas pour Thomas Welcôme (voir le chapitre intitulé Le sphinx), puis définitivement perdue et alors pourchassée de bouge en bouge, de lupanar en quartiers de maraude, de ports mal fréquentés en raouts pestilentiels où trainer son invincible ennui. D'ailleurs, Ethal ne s'y trompe pas, ramène notre amateur de dépaysements exotiques aux venelles louches et aux œuvres torves pour esthètes, qui déclare à Monsieur de Phocas : «ah ! malade que vous êtes, vous emporterez votre mal avec vous. C'est un regard de Musée que vous cherchez, mon ami; la civilisation pourrie d'une grande ville comme Paris ou Londres pourra seule vous l'offrir» (p. 98).
Ce n'est évidemment pas sans raison que le duc de Fréneuse, autrement dit Monsieur de Phocas, a tué l'amateur de poupées maladives qu'est Claudius Ethal, qualifié de «mauvais esprit de [sa] vie» (p. 187), et qui n'est, bien davantage que son initiateur, que son double comme nous le suggère Jean Lorrain : «Serais-je amoureux d'agonies ? Effroyable et déroutant, cet invincible attrait vers tout ce qui souffre et qui se meurt ! Jamais je n'avais vu si clair en moi-même. Cette irréparable tare de mon âme malade, Ethal l'avait-il assez devinée, le soir où il me mit devant cette poupée d'abord et cette cire ensuite, cire dans laquelle j'ai trouvé, modelée avec amour, l'effigie même de la douleur et de l'espèce de douleur qui me plaît ?» (p. 97).
Monsieur de Phocas, plus d'une fois, se plaît à évoquer les monstruosités de Claudius Ethal de façon clinique, comme s'il ne faisait rien d'autre que voir dans les vices du peintre ceux qui sont les siens : «L'horrible l'attire, la maladie aussi; l'entorse morale et la misère physique, la détresse des âmes et des sens sont pour lui un champ d'expériences affolantes, grisantes, une source de joies complexes et coupables, auxquelles il se complaît comme pas un. Il a pour le vice et les aberrations plus qu'une curiosité de dilettante : une prédilection innée, l'espèce de vocation fervent et passionnée qu'ont, pour certains cas peu connus et les maladies rares, des tempéraments de savants et de grands médecins». Si Monsieur de Phocas lit dans le mystérieux Ethal comme dans un livre ouvert, c'est probablement parce que, tout comme lui, «il va au vice comme le pourceau à la truffe» (p. 133).
Cette identité, fût-elle partielle, entre les deux âmes corrompues, me fait craindre que le vieux rêve d'une pureté reconquise loin de l'Europe accroupie dans sa fange ne soit rien de plus qu'un mirage un peu plus tenace que les autres. Écoutons le très barrésien, mais tout autant gidien (3), Sir Thomas Welcôme évoquer la quête, aussi lyrique qu'émouvante, qui a été le rêve de tant d'artistes de la fin du 19e pourrissant, n'en finissant pas de pourrir, prétendant guérir ses maux en les asséchant sous le soleil des Tropiques : «Partir vers le soleil et vers la mer, aller se guérir, non, se retrouver dans des pays neufs et très vieux, de foi encore vivace et non entamée par notre civilisation morne, se baigner dans la tradition, de la force et de la santé, la force et la santé des peuples restés jeunes, vivre dans l'Inde et dans l'Extrême-Orient, dans la clarté du ciel et de la mer, se disperser dans la nature, qui seule ne nous trompe pas, se libérer de toutes les conventions et de toutes les vaines attaches, relations, préjugés qui sont autant de poids et d'affreux murs de geôle entre nous et la réalité de l'univers, vivre enfin la vie de son âme et de ses instincts loin des existences artificielles, surchauffées et nerveuses des Paris et des Londres, loin de l'Europe surtout !...» (p. 137). La page suivante, commençant par «Oh ! la griserie complexe et salutaire de l'éloignement !» est superbe, qui met en scène le «monde aventureux, nombreux et splendide» comme seul remède à nos «plaies, les atroces petites plaies de notre âme moderne exténuée de lecture, de bien-être et de civilisation...», et, plus loin, la recherche de la vraie vie que l'on sait bien sûr absente, seule force capable de lutter contre les «raffinements et les recherches du rare [qui] conduisent fatalement à la décomposition et au Néant» (p. 177), mais c'est peut-être en l'une de ces silhouettes indolentes que Robert Louis Stevenson figure dans son remarquable Creux de la vague que nous pouvons le mieux imaginer un duc de Fréneuse promenant «par la mer remueuse la fièvre de [ses] sens excédés ou le renom gênant de [ses] tares» (p. 146).
Il est à ce titre significatif que Monsieur de Phocas ne trouve aucun réconfort après avoir passé quelques jours dans le village de son enfance, Fréneuse, et qu'il revienne à Paris, pitoyable, «meurtri, endolori, rempli de lassitude physique et lourd, comme d'une tumeur, de [s]on indifférence, de [s]a morne impuissance à pleurer et à souffrir !», impuissance qui le fera se poser cette douloureuse question : «Qui me rendra le don des larmes ? Je serais sauvé si je pouvais pleurer» (p. 191), mais Monsieur de Phocas ne pleure pas, ou plutôt si, il pleure une seule fois, mais son plaisir ou sa douleur, son plaisir et sa douleur, sa tristesse et ses regrets, sans leur diffraction littéraire, jamais ne l'atteignent, et c'est en lisant quelques vers du si mésestimé Alfred de Musset extraits d'un poème intitulé Adieu ! que ses yeux s'emplissent, enfin, de larmes (cf. p. 175) :
«Un jour tu sentiras peut-être
Le prix d'un cœur qui vous comprend.
Le bien qu'on trouve à le connaître
Et ce qu'on souffre en le perdant.»
Notes
(1) Jean Lorrain, Monsieur de Phocas (La Table Ronde, coll. La petite Vermillon, introduction, assez inutile, de Thibaut d'Anthonay, 1992), p. 27.
(2) La même image est employée plus loin (p. 56), où Jean Lorrain évoque «l'innommable de l'âme humaine remonté à fleur de peau». La thématique des masques sera importante dans ce roman, puisque «c'est aussi l'égoïsme et c'est aussi l'avarice, qui font de l'humanité un bestiaire où chaque bas instinct s'imprime en traits d'animal...», soit autant de «masques ignobles» (p. 57). Monsieur de Phocas avoue même deviner, parfois, les cadavres qui se cachent sous ces masques, et ce sont même «souvent plus que des masques puisque ce sont des spectres» (p. 53) qu'il voit !
(3) Les Nourritures terrestres de Gide sont d'ailleurs explicitement mentionnées à la page 194, et tel passage peut sonner comme une invitation à un irrésistible carpe diem : «L'importance est dans le regard et non dans la chose regardée. Qu'importe d'où vienne l'extase, si l'extase nous vient ? Toutes les émotions sont comme autant de portes ouvertes vers un prestigieux avenir : le devenir, voilà la religion» (p. 206). Le Maurice Barrès du Culte du Moi, singulièrement d'Un Homme libre, lui, semble avoir inspiré ces lignes : «laisser entrer l'univers en soi et prendre ainsi lentement et voluptueusement possession du monde, voilà le bréviaire du voyageur. Être une cire savante et consciente aux impressions de la nature et de l'art, trouver dans la nuance d'un ciel, la ligne d'une montagne, les yeux attirants d'un portrait, le profil d'un buste de musée ou la silhouette d'un temple, le coït intellectuel et sensuel pourtant d'où naît l'idée rafraîchissante et féconde...» (p. 140). Cette malléabilité infinie de l'âme et de l'esprit se double d'une volonté de se débarrasser de ceux que Barrès, on le sait, appelle les Barbares : «Vivre sa vie, voilà le but final; mais quelle connaissance de soi-même il faut acquérir avant d'en arriver là ! Personne ne nous éclaire, les amis nous trompent sur nos propres instincts, et l'expérience seule nous les fait découvrir. Nous avons contre nous notre éducation et notre milieu, que dis-je ? notre famille» (p. 142). D'autres références parcourent le texte de Jean Lorrain, comme Huysmans bien sûr (cf. p. 172). Les peintures de Gustave Moreau sont évoquées dans le chapitre intitulé Le piège.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, décadences, fin de siècle, jean lorrain, monsieur de phocas, claudius ethal, joris-karl huysmans, andré gide |  |
|  Imprimer
Imprimer
