« La littérature sous le soleil noir de la violence, 3 | Page d'accueil | Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 1, par Francis Moury »
03/07/2012
Le Creux de la vague de Robert Louis Stevenson

Crédits photographiques : Camila Massu (National Geographic Traveler Photo Contest).
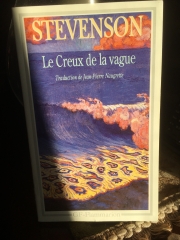 Lorsqu'il termine d'écrire Le Creux de la vague avec Lloyd Osbourne, Stevenson n'a plus qu'une année à vivre.
Lorsqu'il termine d'écrire Le Creux de la vague avec Lloyd Osbourne, Stevenson n'a plus qu'une année à vivre. Il mourra à Vailima le 3 décembre 1894 et sera enterré au sommet du mont Vaea, sa dépouille portée par les indigènes et leurs chefs qui l'avaient surnommé Tusitala, le conteur d'histoires, alors que son roman aura commencé à paraître en feuilletons de novembre 1893 à février 1894 dans la revue Today.
C'est peut-être la présence de la mort qui a rendu ce roman si noir, ce roman dont Stevenson excuse même la noirceur dans une lettre à son ami Henry James du 17 juin 1893, cette dernière œuvre qui, nous dit encore Jean-Pierre Naugrette, est un roman qui sent «la mort qui rôde, la désillusion, la nausée, la peur du mal» (1) alors qu'il a été écrit sous la lumière magnifique de Samoa, mais aussi, a-t-il raison d'ajouter, qui évoque les questions de la «rédemption», de la «lucidité» et du «combat intérieur». La lumière tranche : si elle sature ce que nous pourrions appeler la balance des noirs (par opposition à la balance des blancs que connaissent les photographes et les vidéastes), elle les condamne aussi à se replier puis s'évaporer par sa fureur à recouvrir toute la surface du visible en brûlant ses zones d'ombres.
Car, à l'évidence, le roman de Stevenson qui offre la vision de trois médiocres revenus de tout, ayant même perdu leur nom (2) et qui s'embarquent dans ce qui sera leur dernière aventure, est truffé de références religieuses, bibliques ou évoquant le célèbre Voyage du Pèlerin de John Bunyan, que le romancier a salué comme l'une des sources majeures de son inspiration. Dans ce livre, la lumière consume et aveugle.
Face à ces trois médiocres, dont Robert Herrick représente la plus superbe condensation si je puis dire (3), Stevenson a dressé le mystérieux colosse Attwater (cf. p. 131), dont l'un des plus énigmatiques descendants est sans doute le personnage du juge Holden dans Méridien de sang de Cormac McCarthy, qui consigne méthodiquement dans un carnet tout ce qu'il va détruire (4) et qui salue la fatalité (5), comme Attwater (cf. p. 153), quoique ce dernier la place sous l'autorité de Dieu.
Il est également vrai qu'un certain nombres d'indices pourraient légitimer une parenté entre Attwater et Kurtz, le premier étant décrit comme un homme fasciné par les âmes (cf. p. 133) et tout proche de créer, sur son île perdue, «un nouveau peuple» d'adorateurs (p. 146).
Il est de fait étrange que ce soit Attwater qui serve de borne plus que de miroir (6) à nos trois compagnons d'infortune qui, seuls, sans le regard d'Attwater qui semble pénétrer les reins et les cœurs, n'en connaissent pas moins des débats moraux plus ou moins poussés, à l'instar des paroles du capitaine Davis, incapable d'affronter selon ses propres dires la «vérité nue» (p. 107) et qui estime que ses deux compagnons et lui-même ont «comme qui dirait atteint la cote d'alerte de l'inhumanité bête et brutale» (p. 59), ou encore d'Herrick qui ne cesse de s'interroger sur son honneur (cf. p. 92), Herrick qui, nous dit Stevenson, a «épousé le creux de la vague dans les affaires des hommes, et la vague l'avait emporté au loin» (p. 152).
Devant lui, «ange de la colère de Dieu, armé de son savoir et brandissant ses jugements» (p. 155), le capitaine Davis, qui a pourtant désiré le tuer mais l'admire d'avoir su devenir, comme Kurtz, le maître de sauvages (cf. p. 162), Davis qui, devant la vilenie que son associé Huish se propose d'accomplir et à laquelle il n'a su dire non, se sait damné (cf. p. 199), se convertit et devient un insupportable bigot alors que l'incroyant Herrick ne s'en remet pas moins à son autorité et son évident prestige, comme si, en fin de compte, Stevenson nous proposait avec son roman une parabole où serait signifiée les trois degrés d'impénétrabilité du Mal : Huish est hors d'atteinte car, vermine, il ne mérite que d'être abattu. Davis, tenaillé par la faute qu'il a commise et par celle qu'avec Huish il risque de commettre, s'il se repent, peut être sauvé. Mais Herrick ? La force du roman de Stevenson consiste peut-être dans peinture d'une médiocrité qui se situe à égale distance du Bien et du Mal. Non, c'est plus complexe que cela : Herrick est littéralement dégoûté par le sort dans lequel il est tombé et encore plus par le spectacle de ses deux compagnons de déveine. il est conscient qu'il risque encore de continuer à dévaler la pente qui le conduira à la déchéance ultime et tente même de se suicider. Mais il ne le fait pas et confie sa destinée à Attwater, disparaissant du récit puisque, à proprement parler, le lecteur se moque désormais de savoir ce que ce médiocre pense, éprouve ou même rêve.
Ainsi, une page saisissante du roman de Stevenson nous décrit Herrick au moment où il prend conscience de sa médiocrité ou plutôt, de sa lâcheté puisqu'il est incapable de mettre un terme à sa misère en se jetant dans la mer pour s'y noyer : «À quoi bon tarder ? Ici même, et maintenant, c'était à lui de baisser le rideau, à lui de chercher le refuge ineffable, à lui de s'allonger avec toutes les races et générations humaines dans la maison du sommeil. C'était facile à dire, facile à faire. Cesser de nager : il n'y avait rien de mystérieux à cela, à condition de pouvoir le faire. Le pouvait-il ? La réponse était non. Il le sut d'emblée. Il eut d'emblée conscience d'une opposition dans ses membres, unanime et invincible, s'accrochant à la vie d'une volonté têtue et tenace, de tous ses doigts, de tous ses muscles; quelque chose qui était à la fois lui et pas lui – à la fois en lui et hors de lui; la fermeture d'une valve miniature dans son cerveau, qu'un homme, un vrai, eût réussi à ouvrir d'une simple pensée – et l'étreinte d'un destin extérieur aussi inéluctable que la pesanteur. À tout homme peut arriver parfois la sensation que souffle là, à travers toutes les articulations de son corps, la brise d'un esprit qui lui échappe en partie; que son intelligence se rebelle, tandis qu'une autre l'enveloppe et l'emporte où il ne voudrait point. C'était ce qui arrivait alors à Herrick, avec l'autorité d'une révélation. Il n'y avait aucune échappatoire possible. La porte ouverte se refermait à sa face de lâche. Il lui fallait retourner dans le monde des hommes avec ses illusions perdues. Il lui fallait tituber jusqu'au bout sous le poids de la responsabilité et de la disgrâce qui étaient siennes, jusqu'à ce qu'un rhume, un cou, la clémence d'une balle perdue, ou la plus grande clémence du bourreau, viennent le délivrer de son infamie. Il existait des hommes capables de commettre un suicide; il existait des hommes qui en étaient incapables; et il faisait partie de ceux qui en étaient incapables» (pp. 179-80).
De fait, il semble bien que Herrick ait connu, avec cet événement qui est la proclamation irrécusable de sa lâcheté, une révélation, tant le réseau métaphorique dans lequel le romancier enserre son pathétique personnage nous semble religieux, voire christique : «Il se vit lui-même implacablement confronté aux conséquences de ses actes pour le restant de l'existence : étendu sur une croix, cloué et rivé qu'il était par le fer de sa propre couardise» (p. 181).
Notes
(1) Page 6 de l'Introduction à la belle traduction qu'il donne du roman de Robert Louis Stevenson, Le Creux de la vague (Flammarion, coll. GF, 1993).
(2) «Chacun, en effet, possédait un long apprentissage de la déchéance; et chacun, à une étape quelconque de sa chute, avait connu ce déshonneur qu'est l'adoption d'un pseudonyme» (p. 40).
(3) Jean-Pierre Naugrette écrit : «S'il est le personnage le plus attachant du roman, c'est qu'il annonce l'homme moderne, dépouillé de ses espérances sans être tout à fait désespéré, capable de sauver son prochain sans pour autant se rallier à lui, doutant de tous les projets et de tous les dogmes parce que doutant profondément de lui-même. [...] Sans qualités, Herrick est un homme à faire, un être en devenir. Il n'est plus un lâche, il n'est plus crucifié, il n'est plus. Il n'est plus en croix, il est en creux. Entre les prières de Davis et les ordres d'Attwater, Herrick a choisi de ne pas répondre. Il est sauvé, mais sans plus. Entre la mort de Huish et l'autre vie entrevue par le capitaine, il se situe dans un entre-deux, homme en suspens, seul, entre la vie et la mort», p. 33. Notons toutefois que Stevenson semble s'être particulièrement attaché à peindre les tourments moraux de cet homme sans qualités, qui se déclare incroyant (cf. p. 150), alors que Huish n'est qu'un voyou de la pire espèce ne reculant devant aucune infamie et peut-être même un criminel et Davis un capitaine qui ne s'est pas remis d'une faute énorme et traîne sa déchéance avec lui depuis qu'il a laissé périr les passagers du vaisseau qu'il commandait, un épisode qui a sans doute inspiré Joseph Conrad lorsqu'il a écrit Lord Jim (cf. p. 60). De la même façon, aussi répugnant soit-il, Huish, selon Stevenson, n'est pas dénué de qualités comme le courage. Nous reconnaissons la grande complexité psychologique des personnes de Stevenson, à l'instar de ceux qu'il a peints dans Le Maître de Ballantrae.
Notons qu'Herrick, homme de culture capable de citer Virgile et Heine, pourtant le plus accompli des médiocres puisqu'il semble condense toutes les qualités de l'homme sans qualité, est décrit par Stevenson comme étant incapable de «se plier à l'idée de déchoir» (p. 44).
(4) Alors qu'Attwater affirme que «ce qui reste de[s] actions [d'un de ses anciens compagnons] n'est-il pas consigné dans le livre des chroniques ?» (p. 147)
(5) Fatalité d'ores et déjà inscrite dans le titre du roman de Stevenson, qui renvoie au Jules César de Shakespeare (IV, 3, vers 219-221).
(6) Ce rôle sera réservé aux pauvres gens qu'Herrick prend à témoin de sa déchéance, en déclarant qu'ils «doivent avoir le bien sacrément chevillé au corps» (p. 88) ou encore à l'équipage de «cannibales» monté à bord du Faralone, vus comme des «innocents» ayant des «âmes d'enfants» ou encore des «pauvres âmes» (cf. p. 98).






























































 Imprimer
Imprimer